Au-delà de l'effondrement, 12 : Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (29/11/2009)

Crédits photographiques : David McNew (Getty Images).
 Tous les effondrements.
Tous les effondrements.«The Sea of Faith
Was once, too, at the full, and round earth’s shore
Lay like the folds of a bright girdle furled.
But now I only hear
Its melancholy, long, withdrawing roar,
Retreating, to the breath
Of the night-wind, down the vast edges drear
And naked shingles of the world.
Ah, love, let us be true
To one another ! for the world, which seems
To lie before us like a land of dreams,
So various, so beautiful, so new,
Hath really neither joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain;
And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,
Where ignorant armies clash by night.»
Matthew Arnold, Dover Beach (1)
Was once, too, at the full, and round earth’s shore
Lay like the folds of a bright girdle furled.
But now I only hear
Its melancholy, long, withdrawing roar,
Retreating, to the breath
Of the night-wind, down the vast edges drear
And naked shingles of the world.
Ah, love, let us be true
To one another ! for the world, which seems
To lie before us like a land of dreams,
So various, so beautiful, so new,
Hath really neither joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain;
And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,
Where ignorant armies clash by night.»
Matthew Arnold, Dover Beach (1)
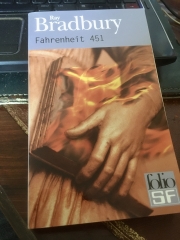 Ray Bradbury m'a toujours semblé être l'un des très rares écrivains de science-fiction (2) les plus profondément mésestimés, en dépit même de la multitude de récompenses qu'il a reçues. Trop souvent, les critiques se contentent de saluer la beauté poétique, certes bien réelle, de ses splendides Chroniques martiennes et évoquent, pour stigmatiser les périls de quelque régime autoritaire dont la sombre et palpable menace ne fait trembler que leur petite personne et dont ils flairent la méphitique odeur jusque dans les écrits profondément subversifs de Florian Zeller, la prescience des thématiques développées dans Fahrenheit 451. Pourtant, relisant récemment ce petit livre que, comme beaucoup d'entre nous je suppose, j'ai découvert très jeune (ainsi que Le meilleur des mondes d'Huxley ou encore 1984 d'Orwell : il s'agissait, avec ces livres, de la sainte trinité, aux yeux du corps enseignant, de la contre-utopie anti-totalitaire, du moins durant ma scolarité), j'ai été frappé de constater que ces thématiques étaient pour le moins polémiques, voire, diraient les journalistes, scandalisés de découvrir pareil loup dans la bucolique bergerie bradburienne où ils mâchaient de la provende en toute inconscience du lion cherchant qui dévorer, franchement réactionnaires.
Ray Bradbury m'a toujours semblé être l'un des très rares écrivains de science-fiction (2) les plus profondément mésestimés, en dépit même de la multitude de récompenses qu'il a reçues. Trop souvent, les critiques se contentent de saluer la beauté poétique, certes bien réelle, de ses splendides Chroniques martiennes et évoquent, pour stigmatiser les périls de quelque régime autoritaire dont la sombre et palpable menace ne fait trembler que leur petite personne et dont ils flairent la méphitique odeur jusque dans les écrits profondément subversifs de Florian Zeller, la prescience des thématiques développées dans Fahrenheit 451. Pourtant, relisant récemment ce petit livre que, comme beaucoup d'entre nous je suppose, j'ai découvert très jeune (ainsi que Le meilleur des mondes d'Huxley ou encore 1984 d'Orwell : il s'agissait, avec ces livres, de la sainte trinité, aux yeux du corps enseignant, de la contre-utopie anti-totalitaire, du moins durant ma scolarité), j'ai été frappé de constater que ces thématiques étaient pour le moins polémiques, voire, diraient les journalistes, scandalisés de découvrir pareil loup dans la bucolique bergerie bradburienne où ils mâchaient de la provende en toute inconscience du lion cherchant qui dévorer, franchement réactionnaires. Le fait même que l'écrivain stigmatise les procédés de réduction à l'absurde et de réification de la réalité (ainsi, dans notre roman, du spectacle de chasses à l'homme réelles sur grands écrans dévorant les murs de particuliers !) dont sont friands les médias serait à verser, bien évidemment, dans les pièces du procès à charge contre l'auteur, au cas où ce dernier se révélerait, décidément, infréquentable : «Condensés de condensés. Condensés de condensés de condensés. La politique ? Une colonne, deux phrases, un gros titre ! Et tout se volatilise ! La fête finit par vous tourner à un tel rythme sous le matraquage des éditeurs, diffuseurs, présentateurs, que la force centrifuge fait s’envoler toute pensée inutile, donc toute perte de temps !» (3). Notre valeureux et vertueux critique n'est cependant point au bout de ses longues peines et de ses surprises puisque l'une des idoles les plus vénérées de notre époque, la très sainte minorité, subit à son tour les foudres du doux et poétique Bradbury qui écrit (pp. 85-6) : «Plus la population est grande, plus les minorités sont nombreuses. N’allons surtout pas marcher sur les pieds des amis des chiens, amis des chats, docteurs, avocats, commerçants, patrons, mormons, baptistes, unitariens, Chinois de la seconde génération, Suédois, Italiens, Allemands, Texans, habitants de Brooklyn, Irlandais, natifs de l’Oregon ou de Mexico. Les personnages de tel livre, telle dramatique, telle série télévisée n’entretiennent aucune ressemblance intentionnelle avec des [personnages] existants. Plus vaste est le marché, Montag, moins vous tenez aux controverses, souvenez-vous de ça !». Complétons le sordide portrait de notre monstre en détaillant sa dernière grimace, qui prétend cette fois-ci défigurer l'inexpressif et hâve masque de l'art contemporain (p. 54) : «Et les musées, y êtes-vous jamais allé ? Rien que de l’abstrait. C’est tout ce qu’il y a aujourd’hui. Mon oncle dit que c’était différent autrefois. Jadis il y avait des tableaux qui exprimaient des choses ou même représentaient des gens.»
La nostalgie des choses perdues (qui fait écrire à Bradbury, dans ses Chroniques martiennes (4) : «Ce qui est ancien ne sait-il pas toujours quand il arrive du nouveau ?») suffirait-elle donc à expliquer une aussi bizarre complexion de pensée ? Ou bien encore notre propension à vouloir détruire ce avec quoi nous ne pouvons intimement, poétiquement nous lier ? (5) Ou, plus certainement encore, la foi, partout en recul dans nos sociétés déchristianisées comme le suggère, dans notre livre, la citation du magnifique poème de Matthew Arnold ? Il faut ainsi remarquer que «la longue, plaintive et grondeuse rumeur» est dans le roman de Bradbury celle d'une disparition dramatique (6), puisque les livres sont systématiquement détruits, qui pourtant accomplit, mystérieusement, la destinée de tout grand livre, qui est de survivre, vivre dans l'esprit et la chair des hommes : cette destinée commande peut-être la disparition physique des ouvrages pour qu'ils renaissent dans les très fragiles consciences individuelles et accèdent ainsi à l'étrange immortalité que la tradition orale confère, comme l'illustre Herbert Régis dans un livre peu connu, paru en 1939, L'Éclipse.
Ainsi, bien que la mer semble avoir disparu, demeure, selon le héros de notre roman, un fleuve invisible, peut-être plus réel que celui que, dans les toutes dernières pages du livre, il s'apprête à suivre, accompagné par une poignée de résistants qui constituent autant de vivants temples conservant les trésors des livres détruits mais pas oubliés : «Montag considéra le fleuve. Nous nous laisserons guider par le fleuve. Il considéra l’ancienne voie ferrée. Ou nous suivrons les rails. Ou nous marcherons sur les autoroutes maintenant, et nous aurons le temps d’emmagasiner des choses. Et un jour, quand elles se seront décantées en nous, elles resurgiront par nos mains et nos bouches. Et bon nombre d’entre elles seront erronées, mais il y en aura toujours assez de valables» (p. 208).
De sorte que, dans Fahrenheit 451, la pieuse conservation des livres par et dans les esprits des derniers hommes libres, qui patiemment tenteront, quelque jour prochain peut-être (7), de recomposer les grandes œuvres dont ils ont appris quelques lignes, pages ou chapitres, parce qu'elle retrouve l'admirable anonymat des bâtisseurs de cathédrales et des artistes du Moyen Âge, est au moins le signe que tout n'est pas perdu, que l'esprit de ruine ne peut totalement, comme, semble-t-il, cela se produit dans le crépusculaire La route de Cormac McCarthy (8), prétendre avoir triomphé du génie des hommes et de leur invincible goût pour la beauté et la grandeur de l'art.
Notes
(1) «[La mer], hier, de la Foi
Était haute et faisait à la terre
Une ceinture étincelante de ses plis;
Mais je n’entends plus aujourd’hui
Que la longue, plaintive et grondeuse rumeur
Qu’en se retirant elle exhale, au vent du soir,
Tout le long des vastes et mornes franges du monde,
Et sur ses galets nus.
Ah mon amour, soyons fidèles
L’un à l’autre : le monde, bien qu’il semble
S’étendre devant nous comme un pays de rêve
Aussi varié que beau et neuf,
Est vraiment sans amour, sans joie et sans lumière,
Sans paix ni certitude, où la douleur est reine.
Nous semblons être au soir tombant sur une plaine
Que traversent les bruits confus de luttes et de débandades
D’armées aveugles qui se heurtent dans la nuit.»
Matthew Arnold, La plage de Douvres in Pierre Leyris, Rencontres de poètes anglais suivies de Sonnets de Shakespeare (José Corti, 2002), pp. 217-9.
(2) Lui-même contestait cette appellation, ne la réservant qu'à Fahrenheit 451 puisque la science-fiction s'appuie sur la réalité qu'elle joue à développer jusqu'à ses plus extrêmes conséquences, alors que le genre fantastique (auquel les Chroniques martiennes appartiennent ou appartiendraient), lui, se fondait sur une description plausible de l'irréalité.
(3) Ray Bradbury, Fahrenheit 451 [1953 puis 1981] (Gallimard, coll. Folio SF, 2008), p. 83.
(4) Ray Bradbury, Chroniques martiennes (Gallimard, coll. Folio SF, 2004), p. 95.
(5) «Les noms que nous donnerons aux canaux, aux montagnes, aux cités glisseront dessus comme l’eau sur les plumes d’un canard. Peu importe la façon dont nous y toucherons, nous ne toucherons jamais Mars. Alors ça nous mettra en rage contre cette planète, et savez-vous ce que nous ferons ? Nous la dépècerons, la dépiauterons et la transformerons à notre convenance», ibid., p. 96.
(6) «Nous transmettrons les livres à nos enfants oralement, et les laisserons rendre à leur tour ce service aux autres. Beaucoup de choses seront perdues, naturellement. Mais on ne peut pas forcer les gens à écouter», p. 198.
(7) «Mais pour le moment une longue matinée de marche les attendait, et si les hommes restaient silencieux, c’était parce qu’ils avaient largement matière à réfléchir et beaucoup à se rappeler. Plus tard peut-être, au cours de la matinée, quand le soleil serait plus haut et les aurait réchauffés, ils se mettraient à parler, ou simplement à dire ce dont ils se souvenaient, pour être sûrs que c’était bien là, pour être absolument certains que c’était bien à l’abri en eux. Montag sentait la lente fermentation des mots, leur lent frémissement», p. 212.
(8) Bien évidemment, nombreux sont, dans ce roman splendide, les signes évidents, parfois, littéralement, eucharistiques, que tout, justement, n'est pas perdu : le jeune garçon survit, sa mémoire est remplie des mots recouvrant des réalités qu'il n'a pas mêmes connues, lui-même est maintes fois comparé à un porteur de feu, à l'incarnation, aussi fragile que mystérieuse, de Dieu, etc. Reste que la leçon du roman de Ray Bradbury me paraît tout de même plus optimiste que celle de celui de Cormac McCarthy.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, ray bradbury, fahrenheit 451, cormac mccarthy, la route |  |
|  Imprimer
Imprimer