La Machine, de Descartes selon Marcel De Corte à Günther Anders (30/12/2022)
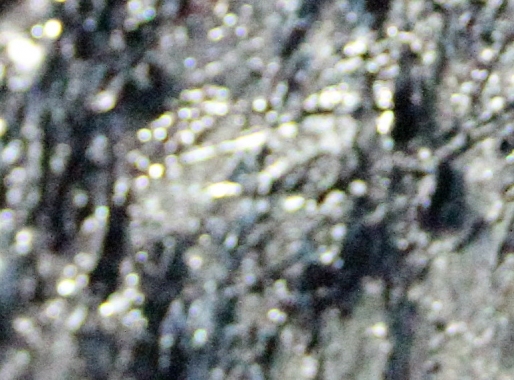
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Günther Anders dans la Zone.
Günther Anders dans la Zone. Acheter Le Rêve des machines sur Amazon.
Acheter Le Rêve des machines sur Amazon.Günther Anders (1) s'amuse à parodier la si célèbre sentence de René Descartes, qualifiant le sujet humain, à l'ère des machines, comme celui qui «cogitat, ergo non sit», autrement dit celui qui pense, donc n'est pas, comme si, pour infirmer l'image frappante qu'utilise le philosophe, «les franges et les cordelettes de notre humanité [qui] s'accrochent toujours et sans cesse dans l'engrenage» avaient cessé de menacer leur mécanisme et ne nous permettaient même plus de nous considérer comme «de possibles saboteurs» (p. 116). Il ne sert à rien, pour des esclaves, de penser, surtout s'il ne leur est même plus accordée la liberté de se rebeller ou même, tout simplement, la simple envie de remonter à la surface de la planète pour voir ce qu'il s'y passe après un si long temps passé sous terre, dans une demi-vie maintenue par la Machine.
J'ai parlé d'image frappante utilisée par Anders, mais son ouvrage, composé de deux lettres (dont la seconde n'avait jamais été traduite jusqu'à cette édition) adressées à Francis Powers, pilote d'un avion espion U-2 qui sera abattu au-dessus de la Sibérie occidentale, en comporte bien d'autres, de ces singulières comparaisons, et il m'a toujours paru que cet auteur pouvait être considéré comme un écrivain visionnaire, tant certaines de ces prédictions vont plus loin, dans la logique avec laquelle il détaille «notre transformation en appareils» (p. 113) que nombre des plus noires visions de romanciers spécialisés dans le beau genre de l'anticipation.
Quel roman de science-fiction a su dépeindre, avec la brièveté qui caractérise l'écriture de Günther Anders systématiquement pris par l'urgence de la situation, un avenir où émergerait «l'image eschatologique d'espoir que ces pulsions obscures des machines poursuivaient comme idéal : l'image de la machine universelle», où, d'autre part, il n'existerait plus rien d'autre que des pièces de machines, bref : «la situation dans laquelle l'équation «monde = appareil» serait réalisée» (p. 95) ? Quel auteur a su imaginer le jour où il ne serait «pas du tout inconcevable [que] les produits affamés, enragés car non consommés, se précipitent, en quelque sorte, comme des cannibales masochistes pour se faire consommer les uns par les autres» ? Même Dick, s'amusant à évoquer des publicités volantes pour le moins envahissantes puisqu'elles n'hésitent pas à entrer chez les personnes considérées, toutes, comme des consommateurs, n'est pas allé aussi loin. Dès lors, «demander ce qu'il adviendrait de nous [serait] superflu car [ces produits] ne s'en préoccuperaient pas davantage» (p. 93).
Notre «devenir appareil» (p. 69) est inéluctable aux yeux d'Anders puisqu'«il n'existe aucune région qui ne soit tombée aussi intégralement dans un processus de mécanisation que notre vie intérieure : notre volonté, nos pensées, nos attentes, nos sensations, nos devoirs»; c'est bien simple même, étant donné qu'il ne reste en fait rien «qui soit épargné par les appareils : car nos forces vitales elles-mêmes, qui restent intactes ou seront stimulées par l'appareil, ne demeurent libres qu'en apparence, autrement dit : le traitement de faveur qui leur est accordé est dû exclusivement au fait que, sans elles, nous ne servirions à rien comme pièce d'appareil. Bref : nous devons devenir machiniques à tous les égards : comme être sociaux pas moins que comme individus; comme consommateurs pas moins que comme travailleurs, comme corps physiques pas moins que comme âmes» (p. 68, l'auteur souligne).
Notre être-machine résolument engagé, toutefois pas encore accompli, du moins espérons-le, est d'autant plus palpable que nous est accordé un semblant de liberté qui n'est en fait que l'éradication de toute responsabilité, donc culpabilité pouvant en résulter. Si le pilote qui largue la bombe qui anéantira plusieurs dizaines de milliers de personnes en quelques secondes, encore plus en quelques jours, mois et même années, estime qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres, pourquoi éprouverait-il le moindre remords ? Ainsi, «tandis que la roue à augets de la machine, s'abattant toujours plus loin avec une force toujours plus violente, engloutit toujours davantage de portions du monde et d'hommes et que, par conséquent, la situation totalitaire finale (l'appareil universel) se profile toujours plus clairement à l'horizon», naît l'illusion que «méchanceté et avilissement auraient été abolis» car, en effet, «où que nous regardions, ne s'offre rien d'autre à nos yeux que la nébuleuse laiteuse d'une pensée plus dévote, dans laquelle les coupables soi-disant libres et les victimes soi-disant libres, les Truman et les Eatherly (3) de tous les pays, tourbillonnent pareillement comme des fantômes» (p. 72).
Cet état d'hébétude permanente, peu importe finalement que le déroulement insignifiant de nos monotones journées soit interrompu, durant quelques secondes de réalité hurlante et des minutes, heures voire jours d'inlassable redite médiatique, par un accident banal, un fait divers atroce, un meurtre sanglant ou un attentat sauvage, soit provoqué par le phénomène que Günther Anders a baptisé du nom de décalage prométhéen, puisque, comme nous l'explique le préfacier, «le développement des systèmes techniques a connu une réussite si fantastique que l'homme qui utilise des instruments aux effets démesurés n'est plus capable de se représenter, ni d'éprouver, ni d'imaginer, même après coup, les conséquences de ce qu'il a déclenché» (p. 9); cette situation n'est pas simplement une particularité d'ordre imaginatif, propre à ce que nous pourrions définir comme étant la complexion psycho-intellectuelle de l'homme des foules, mais bien davantage, essentiellement eschatologique, puisqu'elle caractérise toute notre époque, au sens de monde à part entière, de masses dispersées partout sur le globe mais de plus en plus uniformisées, condamnées à la perpétuelle et monotone ondée du sous-langage dont parlait Armand Robin. En effet, Anders postule l'existence d'une règle selon laquelle «les événements qui n'ont pas été assimilés», comme, par exemple, la double explosion, au-dessus des villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki d'une bombe atomique, «sont condamnés à rester présents, une façon de punir, pour ainsi dire, cette omission; ils ne sont pas autorisés à appartenir au passé» (p. 16). D'où l'amplification formidablement dickienne de l'irréalité de notre univers, vivant de faux-semblants, son éphémère vérité n'ayant finalement qu'une importance toute relative en regard de cette évidence : nous sommes déjà-tous-morts, et nous jouons à nous penser vivants.
Autant dire, en somme, que nous n'avons absolument pas laissé derrière nous cet événement qui nous hante non seulement mais constitue notre avenir plus ou moins proche, la catastrophe nucléaire, qu'il s'agisse d'un accident ou d'une guerre, considérée comme le triomphe de la Machine, ne pouvant, d'une certaine façon, représenter que la vengeance de cette dernière : les machines, en effet, «pour se venger, en quelque sorte, d'avoir été chargées et accablées de tout le travail servile, et même de davantage de travail que nous n'aurions jamais pu accomplir nous-mêmes, se sont emparées du pouvoir» (p. 43) comme Anders l'affirme dans la seconde de ses deux lettres à Powers, puisqu'il semble hélas certain qu'une «ontologie de l'appareil» reviendrait à considérer l'étant sous le regard (si je puis dire) de la machine, autrement dit, admettre que chaque chose lui fait face «en tant que pièce d'appareil à venir» ou, mieux encore, poursuit Anders avec cette logique inébranlable qu'il semble avoir apprise à force de sonder les reins de fer du Moloch qui nous gouverne tous (4), que «seul ce qui trahit une aptitude à devenir une pièce d'appareil sera répertorié et reconnu comme 'étant'» (p. 51), s'il est vrai que le principe de la machine découle d'une pure soif, d'une avidité permanente qui «consiste à traiter leur environnement comme un territoire d'expansion et d'occupation» (p. 59) et que l'homme, «vivant exclusivement comme complice de la machine», s'est pour sa part «soumis à un principe d'avidité semblable à celui de l'animalité» (note 1 p. 52).
En somme, nous avons été battus par les machines et il nous importe assez peu de le savoir; c'est ainsi que Günther Anders précise «la nature de notre défaite par une image : nous ne sommes pas vaincus seulement comme des combattants vaincus, mais comme des vaincus qui à présent se reconnaissent esclaves de la puissance victorieuse et qui collaborent avec elle; qui voient leur propre situation avec les yeux de ces derniers; qui poussent avec eux leurs hurlements de triomphe» (pp. 61-2), un état de servitude volontaire qui ne peut que nous rappeler le mécanisme infernal (5) poussant Winston Smith à déclarer qu'il aime Big Brother et, même, plus pernicieusement encore, à accepter volontairement de l'aimer, obéissant à l'inébranlable certitude que 2+2 = 5.
Il n'est finalement qu'assez anecdotique selon nous qu'Anders, qui a détourné nous l'avons vu l'établissement du cogito cartésien, mentionne La Mettrie parlant de l'homme-machine, une théorie découlant directement de la pensée de Descartes, puisque la thèse «selon laquelle nous, les hommes, serions semblables à des machines, s'est maintenant renversée en postulat selon lequel nous, les hommes, devons devenir semblables à des machines, nous devons nous transformer en machines, ou plutôt en rouages de machines plus grandes, en définitive en la machine». Alors, nous serons parvenus au stade ultime du devenir appareil de l'humanité, lorsqu'il n'y aura plus «aucune machine individuelle parce qu'elles auront été incorporées en tant que rouages dans les entrailles d'une unique machine, hors de laquelle il n'est point de salut». Anders précise encore, si cela est possible, la monstruosité du projet, affirmant que ce stade ultime, «toutes les machines l'ont visé dès le départ; elles ont rêvé depuis toujours de ce règne de la félicité instrumento-eschatologique, et elles en rêvent encore aujourd'hui parce que, tant qu'elles restent assujetties à la malédiction de devoir travailler individuellement ou du moins dans une coordination et une synchronisation qui ne sont pas encore totales, elles n'ont pas atteint leur rendement optimum, et donc leur destinée» (p. 53, l'auteur souligne); par conséquent, conclut Anders, «elles restent entachées du statut funeste» de ce qu'il appelle, en soulignant l'expression, péché technique (p. 54).
Il y a donc fort à craindre que Günther Anders n'estime comme le fruit d'une rigoureuse démonstration que ce que nous pourrions appeler une machinodicée, qui verra le règne sans partage de la Machine étant assez facilement parvenue à réifier et absorber l'homme devenu engrenage, ne soit une satanodicée, comme s'il fallait décidément tenter d'attirer notre attention «sur le fait que le dualisme de la métaphysique des machines est aussi abrupt que le manichéisme le plus sec» puisque, en effet, pour les machines, «il n'existe que l'alternative de l'utilisable et du déchet» (note 1 p. 60). Nous sommes donc bel et bien déjà morts mais, pire encore, d'ores et déjà déchet qu'il nous faudra bien finir par nous résoudre à recycler, faute de nourriture suffisante pour les milliards de cadavres ridiculement inefficients et rigoureusement inutiles que nous sommes pour les machines.
 Acheter Descartes, philosophe de la modernité sur Amazon.
Acheter Descartes, philosophe de la modernité sur Amazon.C'est dans un petit texte très ramassé que Marcel De Corte évoque la situation actuelle de l'homme (6) tout entier, ou presque, soumis à une «raison séparée de la vie», autrement dit à une «raison formelle et logicienne, farcie d'abstractions, de schèmes, de plans, d'épures, de diagrammes, de calculs et de statistiques», donnant au «monde du rationalisme moderne» l'aspect «d'un immense chantier où règne souverainement dans tous les domaines le spécialiste, le technicien, qui traite les hommes et les choses d'en-haut, a priori, du fond de son laboratoire ou de son bureau, comme une matière plastique et indéfiniment transformable» (p. 220, je rétablis les italiques).
Selon Marcel De Corte, l'origine de cet assèchement drastique de la vie spirituelle et intellectuelle, de la vie, même, toute banalement quotidienne, des hommes, trouve son origine paradoxale chez Descartes, le cartésianisme n'étant à ses yeux que «la rationalisation d'un irrationnel» (p. 212), irrationnel que le penseur identifie à la faveur d'un rêve survenu le 10 novembre 1619, qui sembla marquer Descartes jusqu'à ses toutes dernières années. Voici le commentaire qu'en fait Marcel De Corte : «Le 10 novembre 1619, le père du rationalisme, sous l'empire d'une transe que son dur vouloir s'efforce de dompter, a découvert une métaphysique qu'il devine infiniment féconde et capable de renouveler de fond en comble la physique et les sciences qui la prolongeront. Comprenant, d'une manière encore confuse, mais qui s'explicitera par la suite en se transposant, que le poète ne part pas du réel, mais s'y dirige par une sorte d'extase et de déploiement intérieur de sa pensée, il va, littéralement, opérer une transfusion de la poésie, en son système vital, dans l'acte même de la connaissance de la réalité. Connaître ne consistera plus en une intussusception par laquelle l'esprit devient «l'autre en tant qu'autre», mais en une construction d'un ensemble d'idées faisant face au réel. Connaître le monde sera faire le monde et, en vertu du réalisme dont la pensée de Descartes sera toujours lestée comme d'un contre-poids, le conquérir» (p. 181, l'auteur souligne).
Voici la modernité durablement lancée dans sa course folle et toute prête à obéir au cartésianisme (auquel Marcel De Corte met une majuscule) dont il pointe pourtant «l'indigence métaphysique» mais, aussi, et c'est le danger qui nous occupe, l'«énorme puissance de dilatation logique» (p. 146), s'il est vrai que «connaître les choses revient à les faire», selon Descartes et l'innombrable cohorte d'ingénieurs qui sortira, toute armée et bardée de fer, de son cerveau si puissamment obstiné, «c'est-à-dire à en être le créateur» poursuit Marcel De Corte, mais aussi, en conséquence, «à les dominer, à substituer la transcendance de l'homme à la transcendance de Dieu», rejouant en somme «l'éternelle tentation de l'homme [qui] est de reconstruire par lui-même et par lui seul le Paradis perdu» (p. 143).
Si le monde est une fable, en vertu du fait que Descartes a dû reconstruire un monde pour «le substituer à celui qu'il avait perdu par le doute», il s'agit donc de penser les conséquences inouïes de ce renversement : «Pareil à l'artiste qui substitue à l'univers banal un univers d'images qui émane de sa pensée créatrice, Descartes met en lieu et place du monde sensible un monde de représentations qu'il construit à l'aide des mathématiques» (p. 133). De fait, selon Marcel De Corte, c'est Descartes qui aura transformé la connaissance philosophique en activité poétique, s'il est vrai que le poète ne part pas du monde extérieur, «mais s'y dirige par une sorte d'extase et de déploiement spirituel à partir de sa propre pensée» : «Connaître le monde sera faire le monde, lui imposer le sceau du génie créateur de l'homme, et, en vertu du réalisme dont Descartes ne se départira jamais, le conquérir. Alors que la philosophie médiévale avait placé l'homme au centre de l'univers, comme point d'aboutissement de toute la création divine, la philosophie moderne va laisser l'homme au même centre de l'univers, mais comme point de départ d'un monde qui sera la création de l'homme». Dès lors, le «poète déguisé en Philosophe», Descartes qui avance masqué, larvatus prodeo comme il disait, «se dresse sur la scène du nouveau monde faustien de la Science où chaque chose et chaque être humain sont transmués, dans la pleine acception alchimiste du verbe, en œuvre de l'homme» (p. 131, l'auteur souligne).
Voici maintenant Marcel De Corte affirmant que «la grande révolution cartésienne et malebranchiste (7) qui prélude à toutes les autres révolutions», qu'elles soient culturelles, politiques, sociales et économiques que nous avons connues et connaissons «et dont les déflagrations se succèdent de nos jours jusqu'à l'éclatement final de la planète, consiste dans la substitution de l'intelligence créatrice d'objets utiles au seul être auquel ils puissent l'être : l'individu, à l'intelligence contemplative d'un monde qu'elle n'a pas fait et à l'intelligibilité duquel elle doit se soumettre». C'est ainsi que l'activité technicienne, «transformatrice du monde, productrice d'un monde, d'une société, d'un homme nouveau» font et ne peuvent faire retour «à l'individu ou aux groupes d'individus comme à leur centre créateur» (p. 103), le cartésianisme aboutissant selon Marcel De Corte reprenant Bossuet qui le premier pointa ce formidable danger (8) à «l'explosion continue du subjectivisme» (p. 101) avant que ces mêmes individus ne soient, nous l'avons vu, eux-mêmes réduits à l'esclavage par les créations les plus efficientes du cartésianisme, les machines bien sûr.
L'homme qui s'est fait lui-même Dieu car il s'est laissé emporter par l'intempérance de l'esprit qui n'a rien à envier à celle des sens selon Bossuet, va alors être soumis par sa propre créature, elle-même fruit métallique de l'évidence rationnelle, «universellement transparente, souveraine et dominatrice d'un monde», cette «idéologie intransigeante, ivre de clarté logique», étendant désormais «sa dictature sur l'univers enchaîné» (p. 92), la raison n'atteignant plus la vérité «que sous le seul signe du mécanisme ou du machinisme universel» (p. 93).
Comment en sommes-nous arrivés à un tel point ? D'abord, Marcel De Corte explique pourquoi le cartésianisme a, semble-t-il, eu le triomphe si facile : en effet, si ce dernier, «considéré en son idée séminale, n'est qu'un vaste mythe logique dont l'intelligence s'est intoxiquée jusqu'à l'ivresse pendant trois siècles, s'il a cultivé l'intellectualisme de l'imagination et le mysticisme de la raison raisonnante, c'est qu'une scolastique décadente avait désappris à la raison le mystère de l'être, le message secret que chaque chose murmure, l'universelle symphonie d'un monde où les thèmes les plus divers fusent et se rassemblent dans l'unité d'un indicible élan» (p. 75).
L'unité a été cassée, le centre perdu selon Zissimos Lorentzatos, car l'homme s'est désormais installé dans «un manichéisme permanent qui l'oblige à refaire, à partir de lui-même converti en raison, et non plus à partir de la nature, du destin, des dieux, du Créateur ou du Rédempteur, un pacte nouveau avec l'être dont il s'est dissocié»; s'il s'agit donc pour lui de «retrouver une unité perdue, en fonction d'une dualité qui lui est consubstantielle et qui le contraint à la lutte», là où «la relation organique ne joue plus naît le combat entre les éléments séparés» (pp. 58-9), autrement dit la volonté de plier, de casser, d'araisonner le monde.
Ainsi, c'est à bon droit que Marcel De Corte peut prétendre que «l'histoire du cartésianisme est celle de l'Apprenti sorcier» et, aussi, que «nous en sommes au final du scherzo» (p. 74) car, par définition, jamais le système cartésien, «axé dès l'origine sur le cogito et sur la pensée pure, coupée de toute relation avec l'être par le doute méthodique, est foncièrement finalité indéfinie, sans terme imaginable» : «parti de cette abstraction qu'est l'esprit, son mouvement toujours abstrait ne rejoindra jamais un terme concret», l'homme étant toujours l'avenir de l'homme même si cela signifie qu'il lui faille signer un pacte avec le diable machinique et «une transformation [s'ajoutant] à une transformation dans un devenir sans repos» selon «la mystique du progrès indéfini dont vit et meurt l'âge contemporain» (p. 57).
Si, selon le cartésianisme et Günther Anders qui en aura analysé les plus implacables conséquences, «de même que la réalité extérieure doit se soumettre aux lois mathématiques de l'esprit, à l'impératif du nombre et de la mesure, l'homme quotidien doit, de gré ou de force, s'inscrire dans le cadre d'une humanité parfaitement raisonnable» (p. 54) et si, «dans une humanité subjuguée par les prestiges de l'idéalisme, la connaissance se réduira foncièrement à un acte de transformation technique des choses par l'homme» (p. 48), l'avenir qui nous est réservé ou plutôt : l'avenir qui est d'ores et déjà notre présent est plus que sombre, à moins que l'homme ne parvienne à porter témoignage en rétablissant «les plus humbles valeurs naturelles» (p. 221) que le rationalisme issu de l'idéalisme cartésien a profanées. Mais ce n'est sans doute là qu'un vœu pieux, car la modernité, qui «ne recherche plus la finalité des choses mais leur efficacité, quitte à les réinventer pour mieux y arriver» (p. 11) selon le juste propos du préfacier de ce superbe ouvrage, Arnaud Jaÿr, s'est bien trop éloignée des sources d'eau vive, cette «philosophie du sens commun» (p. 18) que le philosophe d'origine rurale qu'est Marcel De Corte, selon sa propre définition, doit pratiquer à tout prix, lui qui doit «tirer du sommeil dogmatique du rationalisme par une critique impitoyable de tous les aspects de ce dernier» les hommes, sauf à se dédire, renoncer, baisser les bras et, qui sait, désespérer de la situation dans laquelle «la vie, la vraie vie au sein des vraies réalités liées à l'essence et à l'existence de l'homme» (p. 32) deviendrait proprement impossible.
Notes
(1) Günther Anders, Le Rêve des machines (traduction de l'anglais et de l'allemand de Benoît Reverte, Allia, 2022). Le livre a été bien relu, à l'exception de la double occurrence de «ses» en lieu et place de ces ou bien leurs, p. 99.
(2) Comme celle-ci où Günther Anders, de la même façon qu'il a machinisé les comportements humains, anthropomorphise les machines en évoquant les meilleures d'entre elles, celles qui s'éternisent le moins sur terre et sont donc immédiatement remplacées par d'autres : «Comme les appareils quelconques doivent se sentir honteux devant la prompte disparition dont sont capables les missiles, eux qui, congélateurs, machines à écrire ou voitures, ont, pour devenir convenablement usagés, à se soumettre à un processus d'utilisation archaïque et de longue haleine» (p. 85).
(3) Le major Eatherly fut l'homme qui donna le feu vert météo au largage de la première bombe atomique sur Hiroshima, et avec lequel, comme nous l'apprend Benoît Reverte, Anders «entretient une correspondance depuis juin 1959» (p. 8).
(4) J'imagine la tête que ferait Günther Anders s'il pouvait lire les sempiternelles jérémiades d'un Renaud Camus se lamentant que le Français, l'Européen et même : l'homme occidental, ne soient de plus en plus rapidement et visiblement remplacés par des populations étrangères déversées chez nous depuis l'hémisphère Sud, alors même, bien sûr, que ce sont tous les hommes, quelle que soit leur origine, leur croyance et leur couleur de peau, qui seront non seulement fatalement remplacés par les machines, mais qui le sont d'ores et déjà. Le voilà, le Grand Remplacement véritable : l'homme disparaissant devant la machine, devenant, même, à bien des égards, alors que les futurs progrès du transhumanisme nous promettent l'advenue de créatures augmentées perdant sans beaucoup de regrets des parts et des pans entiers de leur humanité, devenant même Machine. Il n'y a donc pas, il ne peut pas y avoir, philosophiquement, selon Anders, quelque dernier Blanc selon le titre d'un roman oublié d'Yves Gandon; il y aura peut-être, en revanche, un dernier homme ou, à tout le moins, un dernier fragment d'humanité qui finira par disparaître lorsqu'il aura été définitivement intégré à la Machine. Mais il ne restera plus personne pour déplorer cette liquidation.
(5) Günther Anders évoque lui-même une «loi de l'enfer» qui est la suivante : «Si, à la satisfaction générale, des liquidations de corps étrangers devaient se produire, plonger si possible ces corps étrangers dans un état de satisfaction, préalable nécessaire à celui du bonheur» (p. 66). C'est quelques lignes plus haut que le philosophe a qualifié les hommes de corps étrangers pour la Machine, puisque «nous devons exprimer notre être-étranger dans l'idiome de l'appareil lui-même et, par conséquent, remplacer notre vocable par celui qui est employé dans le monde triomphant des appareils» (p. 64), à savoir, donc, corps étrangers. Rappelons que c'est ainsi que les Nazis qualifiaient les Juifs et les Tziganes, et que c'est donc désormais ainsi, aussi, que les appareils, «avec mépris» (p. 64) selon Anders, nous considèrent.
(6) Marcel De Corte, Descartes, philosophe de la modernité (éditions Hora Decima, coll. Marcel De Corte dirigée par Adrien Peneranda, préface d'Arnaud Jaÿr, 2022). Quelques fautes à signaler comme, note 3 p. 15, une phrase qui se termine pour le moins bizarrement. Deuxième et non «troisième» à la dernière ligne de la page 50. La parenthèse n'est pas refermée pour le rappel de la note 17, p. 52. Il manque un point final à la dernière phrase de la page 65. Remarquons encore un «et» absent dans la célèbre affirmation de l'épître aux Corinthiens («Nunc videmus per speculum et in aenigmate»), p. 113, un «de» manquant (dans «Tout le cartésianisme procède de cette...», p. 144), un «de» au contraire en trop («[La deuxième cause de l'absurdité de sa doctrine est] sa brusque irradiation» et une majuscule inutile au Discours de la Méthode, p. 145), l'absence d'une préposition dans la phrase où se trouvent «seraient antérieures à l'exposé» (p. 157). Pour plus de facilité de lecture, nous avons omis de signaler systématiquement à quel texte, puisqu'il s'agit en fait d'un recueil, nous faisons référence, nous contentant de n'indiquer que la page du volume.
(7) Marcel De Corte a analysé la philosophie de Malebranche, cartésien endurci dans un superbe texte (cf. pp. 89-125) initialement paru en 1938 dans la Revue catholique des idées et des faits.
(8) Dans une lettre au marquis d'Allemans, «fidèle et enthousiaste disciple de Malebranche» selon Marcel De Corte, qui cite la lettre admirable de l'Aigle de Meaux (cf. pp. 98 et sq.).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, philosophie, marcel de corte, descartes, günther anders, les rêve des machines, éditions allia, éditions hora decima |  |
|  Imprimer
Imprimer
