Le langage au risque de la technique (09/01/2018)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Études sur le langages viciés
Études sur le langages viciés Baptiste Rappin dans la Zone
Baptiste Rappin dans la ZoneVoici le verbatim de ma conférence sur le langage et la technique. C'est à l'invitation de Baptiste Rappin que je suis venu à Metz les 11 et 12 mai 2017, deux jours que je ne risque pas d'oublier pour bien des raisons, dans le cadre du cinquième congrès des Philosophies du management organisé par mon ami, sur le thème Management, langage et technique, qui s’est tenu à la SPSG. Afin d'aérer quelque peu la présentation de ce texte, j'ai jugé utile d'évoquer directement les ouvrages et auteurs que j'ai mentionnés au cours de mon intervention. Voici cette même conférence au format PDF.
Bonjour à toutes et à tous.
J’aimerais commencer par remercier Baptiste Rappin, qui a eu la gentillesse de m’inviter à ce colloque de savants ou, comme le disent désormais nos contemporains contaminés par la novlangue managériale, nous y reviendrons, de «sachants». Autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas un de ces savants ou sachants, mais un modeste critique littéraire, c’est-à-dire un lecteur, qui a été, qui plus est, convié à ouvrir cette journée, en remplacement inopiné de la personne initialement désignée. Vous voyez donc que je cumule les handicaps ! Je ne vous apprendrai rien sur la technique, bien sûr, une thématique tellement vaste que des milliers de livres et d’articles lui ont été consacrés, mais j’espère quand même parvenir, avec un peu de chance, à évoquer quelques exemples des interactions entre le langage et la technique, que le champ littéraire, puisque je me borne à ce champ-là, nous offre.
Commençons toutefois par faire un gigantesque bond dans le passé, où l’ignoble langage managérial, et que dire de nos fascinantes machines, n’existaient pas, où la littérature n’existait pas, ni même l’écrit, bien que les paléontologues lisent les archives de la terre, des sédiments, comme autant de livres qu’il convient de parvenir à déchiffrer. Nous allons un peu nous écarter du domaine littéraire, pour aborder celui des plus récentes recherches scientifiques. Nous pourrions croire, naïvement, c’est du moins ainsi que je pensais que les choses avaient dû se produire, et en toute logique, nous pourrions croire que le langage est apparu avec la technique, ou du moins que son essor n’a pu qu’être corrélé à celui du développement technique de nos lointains ancêtres. Il n’en est rien semble-t-il, comme je vais le montrer dans cette première partie de mon exposé ayant pour thématique l’essor de la technique et du langage, moins concomitant que nous pourrions le penser, et qui s’intitule, très sobrement : La technique et le langage.
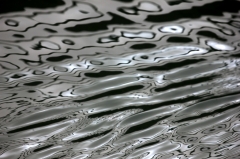
Certes, comme l’affirment deux spécialistes éminents du langage, Jean-Marie Hombert et Gérard Lenclud, dans une somme passionnante sur les origines du langage récemment parue, intitulée Comment le langage est venu à l’homme, je cite : les «gestes de la créature quadrupède dont le chimpanzé et l'homme descendent tous deux semblent être le meilleur candidat au statut de précurseur phylogénétique du langage humain», proposition répétée quelques pages plus loin, via une image. Je cite encore : «Chez l'ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé, les gestes communicatifs auraient donc constitué la rampe de lancement d'où aurait décollé le langage pour son périple évolutif de sept millions d'années», mais ces gestes, dont se souviendra par exemple Condillac, s'ils témoignent des progrès de la dextérité manuelle et des capacités du cerveau qui lui paraissent pouvoir être associées (et vice-versa bien sûr), n'expliquent pas tout, et n'expliquent peut-être même rien du tout, car il est fort peu probable, poursuivent nos chercheurs, que «l'art du langage parlé» ait pu «prendre sa source» dans ladite dextérité «d'un grand singe africain parmi d'autres, point encore abonné à la station debout».
En effet, nous apprenons que la thèse de Leroi-Gourhan exposée dans Le Geste et la Parole, que vous connaissez tous bien sûr, à savoir le lien fascinant «entre l'action technique et le langage», autrement dit le fait que l'action ait pu constituer «l'embryon des processus cognitifs de haut niveau que sont, inséparablement, la capacité langagière et l'attribution d'états mentaux à autrui», eh bien cette thèse, somme toute logique, qui associe les balbutiements de l’expérimentation technique et ceux de l’usage d’un langage parlé, est sujette à caution. En effet, à supposer «qu'Homo, disent nos deux auteurs, ait entamé sa longue ascension en direction du langage à partir de l'expression gestuelle, et sachant, ainsi que le prouve l'existence des langues des signes, que le geste n'offre pas moins de ressources expressives que la voix, d'où vient alors que le langage humain soit parlé et que le geste ne semble plus remplir qu'une fonction ancillaire, sauf chez les non-entendants ?». Autrement dit, «pourquoi nos milliers de langues ne sont-elles pas des langues de signes» mais, bel et bien, notre réunion en est la preuve, des langues parlées ?
Cette question reste apparemment non résolue, peut-être en raison même des caractéristiques de l'«histoire processuelle» dans laquelle s'inscrit selon nos auteurs «l'acquisition de la modernité humaine, qu'elle soit biologique, culturelle ou linguistique». Ce n'est pas tout car, de la même manière, il n'existe pas de correspondance claire entre les évolutions biologique ET culturelle, laquelle eût pu être perceptible en examinant l'outillage produit par nos lointains ancêtres. Or, si nombre de chercheurs se sont efforcés «de détecter un lien entre les modifications des comportements culturels et les transformations du cerveau et du squelette», certains d'entre eux, comme Ian Tattersall (dans L’Émergence de l'homme, Gallimard, 1999) affirment, une fois croisées les archives paléoanthropologiques et archéologiques, que «l'innovation anatomique a procédé indépendamment du changement technologique» et que «l'apparition des espèces nouvelles et l'apparition de nouvelles techniques n'ont jamais été directement liées».
Cela signifie donc, estiment nos deux auteurs, que ce n'est pas seulement «l'émergence de l'outil qui paraît s'être produite indépendamment de toute phase significative dans l'évolution du cerveau», mais que c'est même «l'ensemble du processus au long cours, représenté par le développement de l'outillage», lequel «s'obstine, en effet, à manifester une autonomie certaine par rapport à l'hominisation du cerveau».
En résumé, «l'histoire des progrès de l'outillage ne s’ajuste pas à celle des capacités cérébrales», le divorce étant même «flagrant», jugent nos deux scientifiques, entre «les caractères biologiques ET les comportements techniques». Plus loin, Hombert et Lenclud rappellent que notable est le fait que, selon nombre de chercheurs, «l'outil considéré en lui-même, séparément d'autres traces comportementales, ne saurait être promu indicateur fiable de la capacité linguistique», car, si «l'outil parle», il «resterait muet pour ce qui est du langage de ceux qui l'ont tenu en main». En effet, si le langage est «indispensable pour chercher à innover», il ne l'est pas «pour apprendre à reproduire efficacement, ni même pour améliorer significativement une technique ayant fait ses preuves, de mieux en mieux établie et donc normalisée, culturellement ou non». Et nos deux auteurs de nous assurer une fois de plus que «l'outil préhistorique considéré isolément et sous le seul angle de la performance technique en laquelle aurait consisté sa fabrication n'offre aucune réponse assurée à la question de savoir si son fabricant était ou non, et dans quelle mesure, un être linguistique».
Nous sommes donc bien coincés, nous qui pensions qu’un lien indéfectible, en tout cas logique, existait et avait toujours existé entre le langage d’un côté et, de l’autre côté, la technique, l’une et l’autre se nourrissant de leurs progrès respectifs et communs, dans une espèce de symbiose aux possibilités exponentielles, un peu comme celle rêvée par Teilhard de Chardin imaginant l’acmé évolutif de l’homme dans une noosphère hélas de moins en moins incarnée et de plus en plus spirituelle !
Il y a peut-être autre chose, finalement, une faille dans le bel ordonnancement qui fait croire, et continue à faire croire, aux modernes que nous sommes, que le langage humain n’a pu émerger de la boue de la «verte primitivité», comme le disait Kierkegaard, qu’à la faveur de l’excellence technique ou technicienne. Cette autre chose, c’est encore le langage, mais, nous le verrons, un langage qui n’a pas encore été complètement envahi par le parasite technique, un langage qui n’a pas été vidé de son sang comme un poisson est asséché, sucé, vivant, par une lamproie. Ce langage qui n’est pas encore vicié, c’est la parole, le langage point encore rigidifié dans le marbre pour ainsi dire, et qui vole, verba volant, scripta manent, qui se libère en tout cas du ciment de l’écriture. Ce n’est sans doute pas un hasard si certains des plus grands penseurs occidentaux, de Platon à Giambattista Vico, ont non seulement pointé les défaillances du langage écrit, fossilisé d’une certaine manière, mais, surtout pour le second de ces génies, ont imaginé qu’à l’origine du langage, ce n’est point la hideuse fée Carabosse de la technique qui était penchée sur le berceau, ni même le geste humain, mais la voix, la douce mélopée de la musique, du chant, d’une parole libre, point encore technicisée. Après tout, la racine même du mot «fée», fari, renvoie à la parole, tout comme le «charme», carmen, des contes de notre enfance, évoque une parole poétique, prononcée à haute voix avant que d’être intériorisée par la pratique de la lecture silencieuse. Le plus fascinant peut-être, et je vous renvoie à la belle somme sur la naissance du langage que nous venons d’évoquer, réside dans l’hypothèse selon laquelle l’homme de Neandertal aurait chanté plus que parlé, et que c’est ce chant qui, d’une certaine façon, l’aurait handicapé par rapport à l’homme moderne, qui l’aurait battu à plate couture par les possibilités de communication plus larges qu’offre le langage parlé si on le compare à la mélopée.
Nous n’allons pas faire comme Lewis Mumford dans son ouvrage classique, Technique et civilisation, une chronologie des principales inventions techniques, de l’apprentissage du feu en passant par l’invention de la machine à coudre en 1711 jusqu’à la découverte de la pénicilline en 1929. Nous allons nous contenter d’évoquer quelques exemples, je l’espère intéressants, où technique et langage ont maille à partir. C’est la deuxième partie de mon exposé, intitulé : La technique envahissant le langage, ou le langage devenu tout entier technique. C’est la partie qui me tient le plus à cœur, et vous me permettrez de prendre quelque temps pour exposer plusieurs exemples riches de significations.
Bien sûr, je ne puis d’abord faire l’économie de quelques exemples connus de tous, comme les langages programmatiques Fortran (pour Formula Translation), Algol (pour Algo-rythmic Language) et Cobol (pour Common Business Oriented Language). Bien avant ces langages de programmation, inventés pour, en quelque sorte, permettre à la Machine de penser, d’évoluer et donc de parler, nous pourrions évoquer les recherches d’un Leibniz, d’un Francis Bacon ou d’un John Wilkins autour de la langue universelle, dont la matrice première est bien évidemment le mythe de la Tour de Babel, dans lequel la technique la plus pure, celle qui permet aux hommes de construire une tour, une Machine donc, capable de rivaliser avec Dieu, est inextricablement liée avec l’unification réifiante, rationnelle, des hommes réduits au rang de rouage. Une seule langue pour tous, c’est peut-être le premier slogan de tout dictateur mégalomane rêvant d’étendre son pouvoir à la terre entière, et pas seulement à son trop minuscule pays.
C’est évidemment un vieux rêve de l’humanité que celui de pouvoir disposer d’une langue tout entière rationnelle, dont la rigoureuse architecture aurait la beauté d’une solution mathématique, et je ne puis m’attarder sur de trop nombreux exemples comme celui de l’Unilo, ou projet de langue internationale élaboré par le danois Verner Jorgensen en 1961, comme celui de l’Uni-Spik, encore un projet de langue internationale dont le vocabulaire est fondé, lui, sur les langues romanes, germaniques et slaves, élaboré par Gontier de Biran en 1950, ou encore ceux de langues appelées, plus ou moins poétiquement, Universala, Unilingua, Interlingua, Parla ou Parlamento, Monda Linguo, l’Unita ou encore, l’exemple le plus connu de tous : l’Esperanto bien sûr, inventé par Zamenhof, un Russe qui signait ses textes de la mention Doktor Esperanto, ou docteur plein d’espoir, Esperanto ayant lui-même fait naître l’Ido (ou descendant en Espéranto), ce même Ido ayant inspiré, nous l’avons vu, l’Unilo déjà mentionné.

L’une des dernières résurgences de ce rêve très ancien d’un langage qui brillerait pas la simplicité purement technicienne de son utilisation, est figurée dans un roman de science-fiction de Samuel Delany, intitulé Babel 17. Quelques mots de son histoire. Dans un futur point si éloigné que cela du nôtre, l’Alliance terrestre est attaquée par des Envahisseurs que nous ne voyons jamais, mais dont chaque attaque est signalée par l’usage d’un langage qui a été appelé le Code B. C’est la poétesse Rydra Wong, parlant couramment plusieurs langues, terrestres ou pas, qui va être chargée par l’Alliance de comprendre le secret de ce langage, qui en fait est une véritable arme de guerre puisque, en abolissant chez celui qui le parle toute conscience du moi (puisqu’il n’existe aucun pronom pour dire la première personne du singulier mais aussi celle du pluriel), il fait de lui un combattant sans pitié et invincible. Voici ce que Samuel Delany écrit dans cet excellent roman publié en 1966 à propos du Babel 17 : «Il ne s’agissait pas seulement d’une langue mais encore, elle le comprenait maintenant (il s’agit de la poétesse Rydra Wong), d’une matrice souple aux immenses possibilités analytiques, et un monème définissait à la fois les points de tension d’un réseau de bandelettes contraignantes sur un lit d’infirmerie et le rideau de défense d’astronefs de guerre. Que donnerait ce langage, utilisé pour exprimer les tensions intérieures et les désirs intimes que reflète un visage ? Peut-être réduirait-il un battement de paupière ou un frémissement de doigts à des termes de mathématiques pures ?». Je n’en dis pas davantage, vous n’aurez qu’à lire ce remarquable et très intelligent space opera, dont je m’étonne qu’il n’ait toujours pas été porté à l’écran.
Quelques années plus tôt, en 1957, Jack Vance, un autre auteur de science-fiction, imaginait dans Les langages de Pao qu’un peuple inventait plusieurs langages spécifiquement dévolus à l’accomplissement de tâches diverses, très compartimentées entre elles, comme dans une espèce de taylorisation des langues. Ainsi, la paonais est-il un idiome polysynthétique sans verbes ni adjectifs comparatifs, qui est réservé à l’usage de gens simples, comme les agriculteurs. A Pao existent encore d’autres langages comme le Mercantile, ou langue mercantiliste, mais aussi de nouveaux langages imposés par les savants de la planète Breakness (à savoir : force suspendue) que l’on appelle le Réfléchi ou Cogitant, mais encore le Technique ou Techniquant et enfin le Preux ou Vaillant, utilisé comme il se doit par les soldats.
Ces deux exemples assez célèbres, du moins dans le monde de la science-fiction, évoquent les dangers d’un entremêlement entre langage et technique, le premier, étant plié aux contraintes purement mathématiques du second, devenant ainsi une espèce de filet de pêche meurtrier qui, utilisé à mauvais escient, emportera tout sur son passage.
Vous allez me dire que ces exemples strictement littéraires sont encore bien loin de la réalité, puisque nous sommes dans l’ère de la reproductibilité technique infinie, cause, selon Walter Benjamin, de la perte d’aura, cette dimension qui excède la stricte matérialité de la marchandise. Il était donc évident que cette reproductibilité technique allait s’attaquer, ne pouvait que s’attaquer au langage, puisque la technique, par définition, Ernst Jünger, Martin Heidegger comme Günther Anders l’ont suffisamment répété, n’a pour unique ambition, mais dévorante, que celle de tout englober et de recouvrir la terre d’un manteau de machines, comme cela se voit dans la planète Trantor du cycle Fondation d’Isaac Asimov ou, plus récemment, dans la trilogie Matrix.
Je prendrai trois exemples de la contamination du langage par la technique, jusqu’à un point de saturation permettant l’éclosion de ce que j’ai appelé les langages viciés.

Le premier exemple de cette contamination du langage, de la langue courante la plus quotidienne, la plus banale, par la technique, est une analyse minutieuse, par un philologue, de la langue transformée, empoisonnée par le délire nazi, je veux parler de LTI, la langue du Troisième Reich. Je vous laisse, si ce n’est déjà fait, découvrir cette analyse étonnante et précise, et lire le chapitre où Klemperer évoque la volonté, plutôt comique, que la LTI manifeste à l’endroit de la technique, censée délivrer la langue des maîtres de tout pathos et de toute sensiblerie. Cette fascination pour la technique se voit, selon Klempererer, dans la maniaque utilisation de l’abréviation par la LTI. Je cite : «L'abréviation moderne s'instaure partout où l'on technicise et où l'on organise. Or, conformément à son exigence de totalité, le nazisme technicise et organise justement TOUT. D'où la masse immense de ses abréviations. Mais parce qu'il tente aussi, au nom de cette même exigence de totalité, de s'emparer de toute la vie intérieure, parce qu'il veut être religion et que, partout, il plante la croix gammée, chacune de ses abréviations est apparentée au «poisson» des premiers chrétiens». Nous verrons comment la LTI est aussi une parodie de langage religieux.
L’une des premières caractéristiques de cette novlangue à prétentions scientifiques et techniques qu’est la LTI est son homogénéité. Logique. C’est en effet le caractère total mais aussi la «parfaite uniformité» de la langue nazie qui semblent en tout premier lieu avoir frappé Klemperer, alors même que la langue maudite n'a selon toute probabilité inventé aucun terme, se contentant de les reprendre tous, au gré de ses besoins. Je cite l’auteur : «Le Troisième Reich parle avec une effroyable homogénéité à travers toutes ses manifestations et à travers l'héritage qu'il nous laisse, à travers l'ostentation démesurée de ses édifices pompeux, à travers ses ruines, et à travers le type de ses soldats, de SA et des SS, qu'il fixait comme des figures idéales sur des affiches toujours différentes mais toujours semblables, à travers ses autoroutes et ses fosses communes». L'homogénéité absolue de «la langue écrite [explique] aussi l'uniformité de la parole», alors même que la première pensée de l'auditeur inattentif ou bien médusé (l'un et l'autre sans doute) consisterait à penser que la langue des meurtriers est au contraire aussi bondissante qu'une truite dans une rivière ou, métaphore beaucoup plus appropriée je le crains, qu'un chien en train de poursuivre des fuyards pour le compte de son maître.

Prenons un peu de hauteur sur ce livre, essayons en quelques minutes, comme Max Picard l’a fait dans un ouvrage évoquant l’homme du néant qu’était Hitler, essayons de nous abstraire de la seule problématique de la technique contaminant le langage, en évoquant la redoutable souplesse d’une langue capable d’adopter, de copier, de décalquer tous les autres discours, de se nourrir de tout un tas de matériaux hétérogènes : fascination pour le progrès technique, mais aussi convocation d’une dimension spécifiquement religieuse et messianique. Ce qui frappe Klemperer, lorsqu'il dissèque patiemment, quotidiennement, la LTI, c'est sa formidable capacité d'agrégation : ainsi, si cette langue malade n'est jamais présentée autrement que comme un poison ou une «épidémie nouvelle», si même le fascisme italien a pu l'infecter par le biais d'une «bactérie étrangère», force est de constater qu'elle représente une «maladie spécifiquement allemande, une dégénérescence proliférative de la chair allemande», et qu'elle est aussi parfaitement capable de se nourrir de la symbolique chrétienne, alors même que ses sbires détestent ce Juif qu'est le Christ, ou de se transformer encore en «psychose religieuse», ses mots reprenant alors «le sens de la transcendance chrétienne», les «actes du Führer et de son parti» transformés en «représentations catholiques ou pour ainsi dire parsifaliennes», le «fait qu'elle culmine dans sa dimension religieuse [venant], d'une part, de certaines tournures spécifiquement imitées du Christ, ensuite, et dans une proportion plus grande, de la déclamation de longues séquences de discours sur le ton du sermon et de l'enthousiasme». Dès lors, les «multiples expressions et tournures de la LTI qui touchent à l'au-delà [forment], dans leur homogénéité, un filet qui est jeté sur l'imagination des auditeurs et qui les entraîne dans la sphère de la croyance», le nazisme ayant été finalement pris «par des millions de gens pour l'Évangile, parce qu'il se servait de la langue de l'Évangile». En somme, Klemperer tient peut-être là une des explications de la fascination qu'a pu exercer le nazisme sur les esprits les plus divers, y compris les plus armés, intellectuellement, pour résister à son prestige, en même temps qu'il tentait d'asseoir sa fumisterie ventriloque sur le socle religieux, chrétien et même christique. Commentant un communiqué rédigé de la sorte : «Cérémonie de 13 à 14 heures. À la treizième heure, Hitler viendra à la rencontre des ouvriers», Klemperer écrit ainsi : «C'est, à l'évidence, la langue de l'Évangile. Le Seigneur, le Rédempteur, vient à la rencontre des pauvres et des égarés. Raffiné jusque dans l'indication de l'heure. Treize heures – non, «treizième heure» – c'est comme s'il était trop tard. L'étendard de sang au congrès du Parti, c'est déjà de la même farine. Mais, cette fois-ci, l'étroitesse de la cérémonie religieuse est dépassée, le costume intemporel retiré, la légende du Christ transposée dans un présent immédiat : Adolf Hitler, le Sauveur, vient à la rencontre des ouvriers de Siemensstadt».
Si la LTI frappe les esprits par sa capacité reptilienne à se contorsionner et à envahir le plus petit recoin de langage resté sain, si elle peut à juste droit être comparée à une épidémie s'étendant à la langue allemande mais aussi à celle des Évangiles, c'est dans l'histoire de l'Allemagne qu'il faut pourtant chercher ses racines pourries, comme ne cesse de le rappeler l'auteur dans le chapitre 21 de son ouvrage, intitulé La racine allemande, où il évoque le Français Gobineau : «Pour apaiser ma conscience de philologue, j'ai essayé pendant l'ère nazie d'établir cette relation entre Gobineau et le romantisme allemand et je l'ai aujourd'hui un peu renforcée. J'avais en moi, et j'ai toujours, la certitude que le romantisme allemand est très étroitement lié au nazisme : je crois qu'il l'aurait forcément engendré, même si Gobineau, ce Français allemand de cœur, n'avait jamais existé, lui dont l'admiration envers les Germains vaut d'ailleurs bien plus pour les Scandinaves et pour les Anglais que pour les Allemands. Car tout ce qui fait le nazisme se trouve déjà en germe dans le romantisme : le détrônement de la raison, la bestialisation de l'homme, la glorification de l'idée de puissance, du prédateur, de la bête blonde...». Ajoutons au romantisme la dimension parodique propre au barnum et nous pourrons reproduire les principales caractéristiques de la LTI ou bien, comme le craint Victor Klemperer, la «langue du Quatrième Reich en devenir !» : «Le romantisme et le business à grand renfort publicitaire, Novalis et Barnum, l'Allemagne et l'Amérique», s’exclame-t-il.
Le peu de sympathie que Klemperer témoigne à l'endroit de l'américanisme (soit, dans son esprit : le monde de la technique rationalisée, le cirque publicitaire, mais aussi la propagande, la «confusion entre quantité et qualité») s'explique sans doute, du moins en partie, par sa sympathie à l'égard du régime soviétique, qu'il s'empresse de différencier du régime nazi, bien que l'un et l'autre présentent, il ne peut l'occulter, d'indiscutables caractéristiques communes : «Il est certain que le bolchevisme a fait son apprentissage technique en Amérique, qu'il technicise son pays avec passion, ce qui doit forcément laisser des traces profondes dans sa langue. Mais pour quelle raison fait-il cela ? Pour procurer à ses habitants une existence plus digne, pour pouvoir, sur de meilleures bases matérielles, après avoir diminué le fardeau écrasant du travail, leur offrir la possibilité d'une élévation intellectuelle. La profusion nouvelle de tournures techniques dans la langue du bolchevisme témoigne donc exactement du contraire de ce dont elle témoigne dans l'Allemagne hitlérienne : elle indique les moyens mis en œuvre dans la lutte pour la libération de l'esprit, alors qu'en allemand les empiétements du technique sur les autres domaines m'obligent à conclure à l’asservissement de l'esprit». Une multitude de témoignages comme celui, implacable, d'Ossip Mandelstam, nous ont hélas appris que, en Russie, les empiétements du technique sur les autres domaines nous obligent à conclure à l'asservissement de l'esprit.

Pardonnez-moi d’avoir, peut-être, passé trop de temps sur ce premier exemple, mais je crois qu’il définit remarquablement ce qu’est la contamination du langage par la technique : une propagande et même, une fausse parole. Le deuxième exemple que je vais évoquer est celui d’un ouvrage tout bonnement stupéfiant, aussi stupéfiant qu’il est malheureusement inconnu du grand public. Il s’agit de La Fausse parole d’Armand Robin qui, d’une certaine façon, commence là où s’arrête le livre de Klemperer, puisque Robin va décortiquer, disséquer comme un médecin légiste redoutable la langue morte de la propagande soviétique. Il est vrai que cet ouvrage déroutant, fulgurant même, poétique au sens où ses analyses ne sont pas d'ordre linguistique comme celles que Klemperer rendit familières dans son étude magistrale sur la langue du Troisième Reich rebaptisée LTI, avait de quoi indisposer la majorité des intellectuels qui, dans les années 50, n'avaient de cesse de haler leurs figures pâles au soleil rouge qui, pour des dizaines de millions de Russes et d'autres nationalités, signifia une mort assurément plus rapide que celle que provoque un cancer de la peau. Certes, Armand Robin n’évoque pas directement l’imbrication entre langage et technique, langage contaminé par la technique. Pourtant, c’est bien le visage blafard de la technique, au travers de sa fille la propagande, que nous voyons dans chacune de ces lignes. C’est bien à la technique, aux moyens de communication moderne et, en l’occurrence, à la radio qu’il écoutait sans relâche, que la fausse parole doit son rayonnement. Le spectre de la technique est omniprésent, dans le choix même de certains termes. Ainsi, la première caractéristique du sous-langage qu'est la fausse parole réside, selon Armand Robin, dans son irréalité ou plutôt, sa puissance de décréation, parfaitement capable d'ériger un univers-reflet, simulacre remarquable du nôtre. Je cite Armand Robin : «Ils ont troqué, en calculateurs étourdis, toute substance contre seulement sa semblance; puis, ne disposant plus que de l’irréalité, réduits à jouter l’un contre l’autre dans l’épiphénomène, ils ne peuvent que se livrer des combats inexpiables, avec inédits massacres, pour maintenir à tout prix leur situation dans le monde spectral des «puissances nationales», des «régimes sociaux», des «forces politiques», pour sauver leur place très exiguë sur la très mince pellicule des apparences». L'irréalité que décrit Armand Robin au travers de termes évoquant le monde des spectres et de la semblance, est une inconstance (cf. Pierre de Lancre et son Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons), évoquée par cette image d'une giration incontrôlée qui sera plusieurs fois employée par l'auteur : «Des univers géants de mots tournaient en rond, s'emballaient, s'affolaient, sans jamais embrayer sur quoi que ce fût de réel».
Étonnamment, nous croyons lire dans les phrases suivantes, avec quelques années d'avance, la trame d'une de ces histoires inquiétantes inventées par Philip K. Dick telles qu'Ubik ou bien Le Maître du Haut Château, où la réalité semble non seulement dédoublée par une profondeur maléfique mais encore contaminée par l'existence même du simulacre. Le mensonge, s'il ne peut rien contre la vérité sinon la salir durablement, peut toutefois, surtout lorsqu'il est proféré à des doses massives par la propagande moderne, la rendre malade ou même aller jusqu'à la pervertir, parfois provoquer le désespoir, conscient chez les plus chanceux ou intelligents, de millions d'êtres : «le fait que des millions d'hommes sont tués dans les conditions les plus sottes et les plus ironiques, que des millions encore plus nombreux sont tués d'une mort qu'ils ne connaissent même pas, d'une mort qui les laisse apparemment vivants, automates de la personne spontanée qu'ils furent, décapités et désensibilisés, le fait qu'on ne dit pas aux hommes que la mort en pleine vie à eux destinée en ces temps est une mort qui ne paraîtra pas la mort, mais qui plus mortellement les cadavérise, ce fait est le seul fait».

La technique, comme le langage de la propagande qui est le langage absolument technicisé, ne peut que tuer, bien sûr à grande échelle puisque nous sortons des terrifiants massacres de la Seconde Guerre mondiale, comme le montre cette image aussi atroce que choquante, dans le sens premier du terme, devant provoquer un choc pour réveiller les consciences paralysées des hommes confondus avec de diligents robots, remplaçables à souhait : «Si le dictateur possédait selon son rêve l'univers entier inconditionnellement, il établirait un gigantesque bavardage permanent où en réalité nul n'entendrait plus qu'un effrayant silence; sur la planète règnerait un langage annihilé en toute langue. Et cet envoûteur suprême, isolé parfaitement dans l'atonie, loquacement aphasique, tumultueusement assourdi, serait le premier à être annulé par les paroles nées de lui et devenues puissance hors de lui; il tournerait indéfiniment en rond, avec toujours sur les lèvres et dans les oreilles les mêmes mots obsessionnels, dans un camp de concentration verbal».

Le troisième et dernier exemple est lui aussi remarquable, puisqu’il s’agit de l’analyse, par le fils d’un homme, Jorge Semprun, ayant connu les camps de concentration, d’un nouveau langage, qu’il baptise, sur les brisée du George Orwell de 1984, la novlangue. Tout est génialement ironique dans ce texte, et d'abord l'absolue froideur avec laquelle Jaime Semprun décortique la novlangue, dont il présente la magnifique éclosion comme le signe et la conséquence des progrès incontestables et tous azimuts que la France a réalisés durant ces dernières décennies : si tout «progrès individuel ou national» est sur-le-champ «annoncé par un progrès rigoureusement proportionnel dans le langage», il est clair que notre glorieuse époque «devait nécessairement s'illustrer par de remarquables créations artistiques», puisqu'elle a renversé le français tel que nous le connaissions jusqu'à une date encore récente, à savoir la langue de la clarté, de l'infinie richesse de son vocabulaire et des prodigieuses possibilités offertes à ses écrivains. Cette entrée en matière est du reste quelque peu ambiguë, car Jaime Semprun nous laisse entendre, au début de cette page, que la novlangue est signe précurseur de bouleversements, alors qu'il la conclut en affirmant qu'il devient désormais possible, à une époque ayant détruit la vieille civilisation multi-séculaire, «d'en discerner les conséquences pour la langue».
La novlangue ne peut s'opposer qu'à la langue qu'elle vise à remplacer, langue que Jaime Semprun baptise, fort logiquement, l'archéolangue, dont la suppression bientôt totale ne pourra constituer qu'un heureux événement et avènement, ceux d'une société dont l'effondrement «si bien agencé de nos commodités techniques» pourrait seul faire renaître «d'anciennes pratiques» condamnables, comme celle consistant à croire, douce folie réactionnaire, que «cette langue périmée était une sorte de dépôt sacré, voire qu'en elle résidait quelque chose comme une âme immortelle, l'Esprit, le Verbe et autres chimères métaphysiques».
Je note ce que je pense être une nouvelle hésitation de l'auteur entre la cause et ses conséquences : est-ce la société qui se façonne sous nos yeux qui transforme l'archéolangue en novlangue, ou bien le contraire ? Apparemment, l'une et l'autre s'influencent réciproquement, créant une espèce de nœud gordien impossible à dénouer, constituant une fournaise capable de dissoudre les matériaux les plus résistants : «La formidable puissance d'égalisation qui s'est développée avec la société moderne est parvenue à faire adopter partout un même mode de vie, ou du moins à le rendre enviable : là où l'on ne peut y accéder, on en contemple les images. L'étonnant n'est donc pas que nous parlions de plus en plus une langue nouvelle, il serait, au contraire, que dans un monde si transformé nous continuions à parler la même langue».
Cette compénétration entre le monde moderne, à la fois creuset et réussite sans cesse procrastinée (légitimant donc le mouvement) de la marche perpétuelle vers le Progrès, et la novlangue, s'explique par une réification commune qui est due à la technique, partout triomphante, y compris, nous allons le voir, dans la langue : «Façonnée par les contraintes du traitement automatique de l'information, la novlangue tend par nature à une parfaite conformité au monde lui-même rectifié par la logique technique automatisée», l'auteur admettant en fin de compte une «sorte de preuve ontologique de la perfection de la novlangue dans cette circularité où elle est à la fois effet et cause, l'efficacité technique présupposant son existence tout autant qu'elle-même présuppose la sienne».
Cette mutualisation des efforts, pour reprendre l'une de ces horribles expressions par lesquelles les dirigeants d'entreprise, tout autant qu'ils se paient de mots enlaidis, dupent femmes et hommes réduits à des sachants ou à des adeptes d'éléments de langage, s'explique par l'existence d'un ciment entre la novlangue et le monde qu'elle institue. La technique est ce ciment : «Car ce que nous donne la nature prise en charge par la science et transformée par la technique, ce ne sont pas des prétextes à effusions lyriques, ce sont des informations à modéliser». La technique est elle-même source et illustration de la «tendance démocratique à l'abstraction» et, du coup, la novlangue peut bien apparaître comme «le résultat ultime, au sens où l'on parle de déchets ultimes» de la technique et de l'abstraction, toutes deux délicieuses, selon le bon mot d'Oppenheimer parlant «de la mise au point de la bombe atomique» comme d'un programme «technically sweet», l'une et l'autre, technique et abstraction, abrasant un monde qui ne pourra être que considéré comme étant passé, aboli, faisant naître «le sentiment vague d'une harmonie perdue, la nostalgie d'un équilibre qui se trouvait sans avoir été cherché, le regret impuissant de paysages sans paysagistes».
Jaime Semprun situe l'origine de cet épanouissement de l'esprit d'abstraction, du calcul et, in fine, de la technique, au XVIIIe siècle, car ce sont des passages entiers de l'Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain de Condorcet «qu'il faudrait citer pour montrer tout ce que la novlangue doit à une volonté de rationalisation qui ambitionnait «d'assujettir toutes les vérités à la rigueur du calcul»». L'esprit d'abstraction, s'il présente bien des avantages pratiques (la rage de dent soignée avec une simple aspirine) que ne manquera pas de vous énumérer n'importe quel penseur ayant beau jeu de vous rappeler que le progrès des connaissances et des techniques est une marche inéluctable vers le Graal de la connaissance ultime, n'en perd pas moins l'humain de vue, et annonce ainsi, en même temps que le massacre de la langue, celui des femmes et des hommes tenus pour quantités négligeables : «L'adoption du système métrique et de sa terminologie représente donc plus que toute autre chose un affranchissement par rapport au travail manuel, à ses contraintes et à ses peines. Cet affranchissement ne fut alors qu'intellectuel, et il restait à en réunir les moyens matériels. Il pouvait en conséquence passer pour une simple vue de l'esprit, arbitraire et chimérique, sur laquelle on ne se priva pas d'ironiser. Mais par la précision et la régularité impersonnelles qu'il introduisait, il annonçait l'émancipation réelle qui serait l’œuvre du machinisme. Il faisait même mieux que l'annoncer, il la rendait possible, y préparait les esprits, et les néologismes qu'il imposa peuvent donc être tenus pour les présages objectifs d'une nouvelle ère. En effet, comme je vais le montrer, conclut Jaime Semprun, l'instauration de la novlangue est indissociable de l'avènement des machines».
Le chapitre qui suit ce passage nous intéresse tout particulièrement, qui s'intitule Que la novlangue s'impose quand les machines communiquent, où Jaime Semprun, s'il prend le soin de rappeler le méthodique travail par lequel Klemperer a désossé la langue du Troisième Reich, insiste sur la nouveauté radicale que représente la novlangue : «Je ne répéterai pas ce que j'ai dit plus haut concernant la différence entre l'empiétement des termes techniques dont parlait Klemperer et les emprunts par lesquels la novlangue s'enrichit de nouvelles tournures. Le fait que l'idéal de rationalité technique ne soit pas imposé brutalement de l'extérieur, mais ait été intériorisé, intégré à l'existence de chacun, permet de comprendre également combien le statut des clichés diffère dans la novlangue de celui qu'ils avaient dans les anciennes «langues de bois»». En somme, la brutalité nazie était encore extérieure au langage, alors que la novlangue montre la victoire d'une langue ayant tout bonnement intégré le programme d'arraisonnement technique et même, une langue qui est toute entière technique. Autant le dire simplement : la novlangue présente un progrès indéniable sur les anciennes tentatives, aussi maladroites que ridiculement forcenées, d'embastillement totalitaire de la langue.
Fort logiquement, Jaime Semprun étant un fin lettré, ne pouvait que surgir, à ce stade de sa réflexion, l'exemple trop peu connu de l'Erewhon de Samuel Butler, paru en 1872, envisageant une contre-utopie dans laquelle la Machine avec une majuscule, comme l'écrira Günther Anders, aura pris le pouvoir sur l'homme. Jaime Semprun développe dans des passages qu'il faudrait citer in extenso l'alliance entre la Machine et la novlangue, celle-ci étant une langue non seulement machinale mais la langue même de la Machine, qui s'oppose à la langue ancienne, l'archéolangue de la poésie et des sens : «Mais c'est dans tous les domaines, du trafic aérien au circuit des virus, de l'absence d'ozone à la présence de dioxines, que la seule connaissance objective appartient aux machines. Il est donc logique et nécessaire qu'un langage mieux adapté à la transmission de telles connaissances précises prenne définitivement le pas sur le vieux langage humain, forgé à partir d'une expérience sensible si manifestement déficiente».
Jaime Semprun poursuit, en écrivant, de la novlangue, qu'elle est un langage «univoque, fonctionnel» qui a pour seul but, désormais évident, de devenir le langage de la Machine : «La connaissance exacte des phénomènes et la vérité objective n'étant plus accessibles par les moyens limités qu'offre à la pensée le langage humain, celui-ci garde néanmoins pour fonction de traduire, à l'usage des populations, ce que disent les machines, c'est-à-dire les décisions prises par l'intelligence artificielle. C'est pour remplir efficacement cette tâche qu'il devient toujours plus rigoureux, univoque, fonctionnel. Cependant l'automatisation de la pensée a simultanément un effet tout opposé, puisque le langage, dans tous ses autres usages sociétaux, se trouve ainsi, pour la première fois dans l'histoire, affranchi des relations, toujours difficiles, qu'il entretenait avec le monde objectif. Jusque-là pesait sur lui la charge d'en rendre compte, ou du moins d'en dire quelque chose, ne serait-ce que des mensonges ou des fables. Le voilà allégé de ce fardeau, et par là de toute responsabilité quant à sa véracité».
Nous atteignons la thèse centrale de l'ouvrage de Jaime Semprun ou, pour le dire un peu moins scolairement, nous commençons à comprendre quelle «Pentecôte électronique», quel «chantier électronique mondial d'une Tour de Babel inverse à l'achèvement de laquelle il n'y aura plus qu'une langue pour le genre humain» la novlangue nous promet, qui passera par une égalisation universelle, non seulement l'ensemble des êtres et des choses capturés dans le même filet à mailles fines, mais une nappe de nihilisme dévastateur se dirigeant vers le passé, recouvrant bien sûr le présent, mais se proposant en outre de réifier, d'abraser le passé, qui ne peut être que le domaine coupable, non encore éduqué, du regret, si peu compatible avec la course sans fin vers le bonheur généralisé !
Nous arrivons maintenant à ma troisième partie qui servira de conclusion à cet exposé littéraire si je puis dire qui, du moins je l’espère, n’aura pas trop ennuyé les redoutables décortiqueurs du management et de la technique que vous êtes. Je suis assez pessimiste de nature, et je ne vois pas trop par quel miracle nous pourrions nous extraire, comme le baron de Münchhausen le faisait avec sa propre main, de ce marasme qui paradoxalement est une réification soutenue, implacable, de l’humain et de tout ce qui donne à l’humain sa qualité de vivant pensant, au premier chef duquel se tient, de plus en plus menacé dans sa prodigieuse souplesse, le langage. Les solutions, ou plutôt la solution que je me risque à proposer est extrême, mais vous n’aurez après tout qu’à expliquer cette extrémité par son caractère fictionnel. J’ai appelé cette dernière partie : La vox cordis contre la déshumanisation du langage
«Aujourd’hui, écrivait Lewis Mumford en 1934 dans son ouvrage classique intitulé Technique et civilisation, aujourd’hui donc, c’est-à-dire en 1934, cette foi indiscutée en la machine a été sérieusement ébranlée. Sa valeur absolue est devenue conditionnelle. Oswald Spengler lui-même, qui avait conseillé aux hommes de sa génération de devenir des ingénieurs et des hommes d’action, considère cette carrière comme une sorte de suicide honorable et attend le moment où les monuments de la civilisation machiniste seront des masses informes de fer rouillé et des coquilles de béton vide».
Je ne suis pas aussi optimiste que Lewis Mumford, et mon réel pessimisme s’appuie en grande partie, non seulement sur mes lectures, mais sur mon expérience. La vraie littérature, tout comme la vraie critique littéraire ne payant guère, il me faut bien vivre d’un métier point trop déshonorant. C’est pour cela que je suis, à mes heures perdues où je gagne ma vie, ce qu’il est convenu d’appeler un rédacteur des débats. Je me rends dans les réunions de Conseils d’administration, de Comité d’entreprise, de CHSCT de grandes entreprises ou même dans des colloques pour des ministères et, toutes les fois que je m’y trouve, je suis frappé de constater qu’une seule chose unit entre eux, mais très intimement, les délégués du personnel, les représentants syndicaux et les dirigeants ou même les actionnaires de ces organismes et grandes sociétés. Cet élément commun, dont ils ne se rendent même pas compte qu’ils le partagent plus sûrement que les membres d’une même famille partagent l’amour, c’est le langage de l’entreprise, la novlangue managériale que certains d’entre vous, ici même, vont peut-être évoquer au cours des prochaines heures. Vous connaissez aussi bien que moi le vocabulaire, le mot est trop fort, le sabir affreux, sorte de jargon mononeuronal de français et d’anglais basique, composé de ces chimères que sont, entre mille autre exemples, les bullet point, slide, pipe, feedback, benchmark, profit warning, deadline, reporting, ou encore, et l’on se demande si ces termes ne sont pas pire en français : résilience, agilité ou solutions agiles, sachants nous l’avons dit et autres co-construction faisant sens, mode projet, cœur de métier et force de proposition, etc. ! Bref, un dictionnaire critique pourrait être publié, il a peut-être même été publié du reste, qui regrouperait cette théorie de petits monstres absolument pas adorables, et qui à mes yeux, parce qu’ils traduisent une uniformisation drastique de l’étonnante plasticité du langage, réduisent l’esprit humain à une série de tâches basiques, orthonormées, les mêmes finalement auxquelles des millions d’hommes et de femmes, prisonniers des camps soviétiques ou allemands, étaient réduits. Tout appauvrissement de la langue se traduit immédiatement par un appauvrissement équivalent de l’esprit et, si nous n’y prenons garde, de nos faits et gestes, donc de notre liberté. Dans le classique de George Orwell, la novlangue, s’appauvrissant de jour en jour, ne peut qu’accompagner et même précéder la dégringolade programmée de l’homme au rang de l’animal, puis du simple rouage programmable, comme le montre Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley.
Ce mouvement que d’autres ont qualifié de nihilisme ou d’arraisonnement planétaire, comment parvenir à l’arrêter, si ce n’est par une révolte ou peut-être même une révolution ? J’ai parlé de solutions au pluriel, mais je crains de vous alarmer en affirmant que je ne vois à vrai dire qu’une seule solution, qui est le soulèvement de l’homme contre le monde secondaire comme le disait Botho Strauss, le monde secondaire désignant ici l’arrière-monde spectral et désincarné où prolifère la Machine, et qui va bien finir par dévorer le monde primaire ou plutôt premier, celui de l’homme.
Les textes plus ou moins célèbres qui imaginent une révolte, dans la tradition du soulèvement luddite, ces ouvriers «briseurs de machines» qui provoquèrent en Angleterre un événement violent au début du 19e siècle et, dans le meilleur des cas, une disparition de la Machine, ces textes sont nombreux. J’ai cité Erewhon de Samuel Butler, mais nous pouvons aussi penser au Jihad Butlérien que Frank Herbert a figuré dans le cycle le plus célèbre de la science-fiction, Dune bien sûr. Le premier commandement de ce célèbre jihad romanesque figure dans la Bible catholique orange sous la formule suivante : «Tu ne feras point de machine à l’esprit de l’Homme semblable», raison pour laquelle les mentats, ces espèces d’ordinateurs humains doués d’une mémoire prodigieuse, ont été créés, comme Thufir Hawat, Piter de Vries, ou encore Miles Teg.
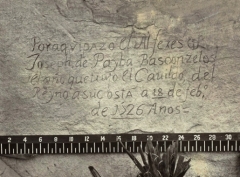
Finalement, sans bien évidemment s’en douter, Frank Herbert n’a fait que développer une longue tradition de penseurs, s’étirant de Platon à Pierre Boutang que Baptiste Rappin connaît bien nous en avons discuté, éprouvant de la méfiance face à la réification, accélérée par le développement technique, de la parole vive comme un cabri, bondissante comme un saumon remontant le courant réputé inéluctable d’un fleuve et, ainsi, accomplissant, je le dis en souriant, un acte véritablement réactionnaire. Il faudrait privilégier, toutes les fois que nous le pouvons, la voix du cœur, la vox cordis, la voix du par cœur qui, en alliant les ressources de la mémoire à une dilection pour la transmission et l’enseignement oraux, briserait le monopole de fer de la Machine. Nombreux sont les exemples romanesques qui, après l’Effondrement de notre civilisation, imaginent que les restes de la société humaine pourraient renaître au moyen de la mémoire et d’une parole drastiquement réduite, mais existant encore, et luttant à sa façon pour sa survie. Certains d’entre vous connaissent sûrement ce superbe et crépusculaire roman de Cormac McCarthy qui s’intitule La Route, où un père et son fils luttent chaque jour pour ne pas mourir de faim et de froid, ou ne pas finir, tout simplement, sous les dents d’autres survivants point trop préoccupés de considérations morales. Cormac McCarthy semble douter de la capacité de la mémoire, assimilée peu ou prou à une véritable prière, à garder le souvenir du monde ancien, celui d'avant la catastrophe, justement parce que la catastrophe a détruit la matrice même de la représentation humaine, comme si l'homme, que l'on dit si aisément adaptable qu'il a pu être, par Pic de la Mirandole, comparé à un caméléon, ne pouvait toutefois complètement s'abstraire de la réalité purement terrestre qui a été, est et restera la sienne, même s'il colonisera dans l'avenir des mondes nouveaux. Je cite le romancier : «Comme le monde mourant qu'habite l'aveugle quand il vient de perdre la vue, quand toute chose de ce monde s'efface lentement de la mémoire». Qu'est-ce qui mérite donc d'être sauvé et transmis ? L'humanité ou plutôt, les règles tacites, non écrites, qui préservent l'humanité de l'abîme et l'empêchent de basculer dans l'horreur. Comment sauver et donc transmettre ce qui mérite de l'être ? Par l'oralité, le texte de McCarthy illustrant par son propre exemple l'extrême dépouillement d'un langage qui par exemple, lorsque père et fils dialoguent, ne peut que dire l'essentiel. Par une parole, aussi, qui convoque les souvenirs du monde perdu, même si se pose la question, pour le père, du droit qui est le sien à «ranimer dans le cœur de l'enfant ce qui était en cendre dans son propre cœur», même si nous devons constater que la véritable rupture entre le monde qui fut et celui qui est concerne moins la transmission des choses perdues que la possibilité que le jeune enfant, à la suite d'un traumatisme par exemple, se mure dans une espèce d'autisme et ainsi refuse désormais le savoir du père, sa parole encourageante. Je terminerai mon exposé par quelques mots empruntés à ce texte d’une noirceur presque totale, à peine contrebalancée par une dernière lueur de fragile espoir : «Il se disait que chaque souvenir remémoré devait faire plus ou moins violence à ses origines. Comme dans un jeu de société. Dites le mot et passez-le à votre voisin. Alors prenez garde. Ce que l'on déforme dans le souvenir a encore une réalité, connue ou pas».
Je vous remercie.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, langage, technique, philosophie, baptiste rappin, jaime semprun, armand robin, victor klemperer, langages viciés, jean-marie hombert, gérard lenclud, machine, lewis mumford, lti, cormac mccarthy, samuel delany |  |
|  Imprimer
Imprimer

