C'est la gloire, Vanessa ! C'est la fin, Gabriel ! et vice-versa : à propos du Consentement de Vanessa Springora (19/01/2020)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Gabriel Matzneff dans la Zone.
Gabriel Matzneff dans la Zone.Avant Le Consentement : le témoignage, ou la littérature paresseuse
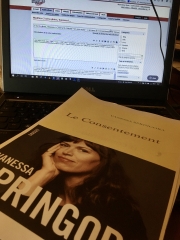 Au risque de me faire de nouveaux ennemis véniels ou acharnés et de perdre quelques amis superficiels, ce qui ne sera pas d'un grand profit dans l'un et l'autre cas, Le Consentement de Vanessa Springora publié chez Grasset et dont le premier tirage est d'ores et déjà épuisé incarne à peu près tout ce que je déteste puisqu'il représente à la perfection ce que j'appelle le livre paresseux.
Au risque de me faire de nouveaux ennemis véniels ou acharnés et de perdre quelques amis superficiels, ce qui ne sera pas d'un grand profit dans l'un et l'autre cas, Le Consentement de Vanessa Springora publié chez Grasset et dont le premier tirage est d'ores et déjà épuisé incarne à peu près tout ce que je déteste puisqu'il représente à la perfection ce que j'appelle le livre paresseux. Le sujet est plus que sensible, car, comme on dit, toutes les apparences sont contre moi : Vanessa Springora n'a visiblement rien d'une hystérique compulsive dont l'hystérie aurait couvé, au chaud, durant bien des années avant d'éclater en amertume boueuse, en haine peut-être, son discours est mesuré, parfois troublant de silences qui nous montrent qu'elle-même a pu émettre bien des doutes sur la difficulté consistant à définir le consentement d'une jeune fille à un adulte qu'elle admire puis aime, doutes qu'elle relate d'ailleurs dans son propre livre. Il me faut aussi être prudent en rappelant qu'un critique littéraire, et je ne m'honore d'aucun autre titre que celui-ci, juge un livre, une écriture, un texte et que, même si, en bloyen fanatique que je suis, j'estime que les coups de trique s'abattant sur un mauvais livre n'ont aucune raison d'éviter le dos de celle ou celui qui l'a écrit, je ne m'acharnerai évidemment pas sur Vanessa Springora que je ne connais pas et que je n'ai absolument pas envie de connaître, tant elle me semble appartenir à cette catégorie d'écrivants (et non écrivains) que je méprise par-dessus tout, la catégorie des écrivants point tout à fait nuls mais aussi paresseux que leurs livres.
J'ai parlé d'un seul sujet mais, à vrai dire, ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire Matzneff en soulève plusieurs, toutes importantes bien qu'évidentes comme celle-ci : comment un écrivain qui a bâti la moindre de ses lignes ou peu s'en faut comme une défense et une illustration décomplexée de la pédomanie a-t-il pu aussi longtemps ne pas être inquiété outre-mesure ? Question corollaire : comment a-t-il joui, dans le petit milieu littéraire parisien que je ne connais pas plus mal qu'un autre, d'une telle aura à la fois sulfureuse mais aussi faisant grand cas de sa plume ? Je donnerai à cette question une réponse qui est celle d'un modeste critique littéraire, qui a l'avantage de ne pas avoir à convoquer le ban et l'arrière-ban du complotisme, ni invoquer les problématiques du laxisme voire de la tolérance des journalistes, des écrivains, des policiers et des juges à l'égard d'un vieillard obsédé par lui-même et par les jeunes, et obsédé par sa propre mirifique beauté jusqu'à ravir cette jeunesse et cette beauté qu'il convoite comme un vampire convoite le sang, en déflorant des femmes et, qui sait, de jeunes garçons et, de la sorte, en possédant ce que jamais plus ils ne donneront, ne pourront donner à un autre, leur innocence, une part de leur beauté qui, après le passage de ce Gilles de Rais de boudoir germanopratin, sera à tout jamais flétrie.
Nous parlerons plus avant de ces questions pour le moins intéressantes mais, pour l'heure, arrêtons-nous sur ce un terme anodin que j'ai employé plus haut en qualifiant Le Consentement de livre paresseux et même la personne qui l'a écrit, rédigé conviendrait mieux, de paresseuse.
Qu'est-ce donc qu'un livre paresseux ? Sans trop entrer dans le détail, il s'agit tout simplement d'un livre qui se contente, avec plus ou moins de talent, plus ou moins d'honnêteté, d'exposer la haute teneur langagière de ce qui est désormais devenu un genre littéraire à part entière, le témoignage et même, plus que cela, un genre qui risque de finir par englober tous les autres genres, tant nous sommes, tous, écrivains et lecteurs, lecteurs professionnels surtout, devenus paresseux. Nous aimons que tout, autour de nous, aille vite, et il n'y a donc absolument aucune raison pour que, dernier bastion réactionnaire, les livres soient déclarés lents, exigeant de nous des efforts d'attention, qu'ils soient encore soucieux de nous apporter autre chose qu'un texte pour écran de salle de rédaction et statut de réseau social. La littérature, réduite au témoignage, peut ainsi bénéficier du mouvement irrésistible vers plus de fluidité, de vitesse, de souplesse, d'agilité selon le terme en usage dans la novlangue managériale. Dès lors devenu témoignage, donc paresse faite livre, mauvais livre, la littérature par et pour journalistes affirme son exigence de ne point se laisser distancer, et d'être toujours à la page, en tête des évolutions les plus notables de notre temps et bien sûr, en tout premier lieu, en tête des ventes, car il n'est pas rare que le livre paresseux se hâte comme un bolide vers l'appétit, consciencieusement aiguisé, de milliers, de dizaines de milliers de lecteurs qui auront acheté un livre sur la foi d'un avis, d'un témoignage lui-même fondé sur la prescription abêtie d'un milieu journalistique faisant office de caisse de résonance du vide. Le témoignage est alors le surgeon le plus évident, l'un des plus prometteurs aussi, d'un langage devenu purement machinal au sens premier du terme, sommaire, indigent même manié, avec des cris d'extase et des yeux grandis par l'admiration, par les Dante et Shakespeare, les Dostoïevski de la littérature paresseuse que sont les Yann Moix, Christine Angot et autres animalcules têtardant dans la flache germanopratine comme le pathétique Édouard Louis, tous nous exposant par le menu baffes, torgnoles, vits cadencés et cela non point dans une coulée orgasmique de langue célinienne, bloyenne ou rabelaisienne, ce qui aurait à tout le moins quelque grandeur stylistique, mais avec quelques mots puisés dans de pauvres livres étiques, idiots, eux-mêmes paresseux et indigents, vite faits mal faits.
Si la littérature contemporaine s'est réduite comme peau de chagrin, c'est que, tous, selon l'impératif catégorique de notre si bienveillante démocratie participativement préoccupée de bien-être égalitaire, nous avons quelque chose à dire, une saleté, une expérience, de préférence traumatisante, un ridicule petit tas de secrets à évoquer et exposer par le menu, sans rien omettre de bas, de sordide, d'édifiant dans la petitesse ainsi étalée au grand jour. Cela veut donc dire que, si tout le monde est témoin, tout le monde est écrivain, n'est-ce pas ! C'est sur cette concaténation absurde que prospère la grande majorité des femmes et des hommes qui écrivent et qui, aux yeux des journalistes et même d'autres écrivains, passent pour des écrivains : j'en ai cité trois, il y en a plusieurs centaines, plusieurs milliers en vérité, il y en a autant que les journalistes décideront qu'il y en ait, et tant pis pour les amoureux de la grande prose, ceux-ci n'auront qu'à lire en cachette Guy Dupré ou Christian Guillet, comme un plaisir coupable qu'il convient de mettre à l'abri de la convoitise du troupeau.
Ah, le témoignage, pain et vain quotidiens de notre société qui n'a plus trop d'autre façon de communier que de lorgner par le trou de la serrure, d'y surprendre un petit garçon se faisant tabasser par un adulte, un sexe turgescent dans la bouche d'une gamine à l'heure du goûter, pour reprendre telle plaisante image de Vanessa Springora, le témoignage et son plus infâme sous-genre, l'auto-fiction, est devenu l'air même que nous respirons, s'étale en grandes lettres capitales, sur toutes les surfaces, surtout lorsqu'elles permettent des ventes, alors que, voici quelques années encore, le terme même de témoignage, si extraordinairement difficile à porter, et d'abord pour le témoin, ne semblait pouvoir être décerné, comme une couronne d'épines, qu'à des écrivains de la race des Paul Celan, Philip Mechanicus, Joseph Czapski, Boris Pahor ou quelque autre survivant acharné revenu des camps d'extermination, le témoignage donc, foin de littérature grise (au sens que Giorgio Agamben donne à cet adjectif, suivant les brisées de Primo Levi), nous en soupons tous, à toute heure de la journée, nous en soupons même quand nous n'avons plus faim, même quand nous essayons, risiblement, de faire un jeûne de quelques pauvres heures de silence, nous en regardons et nous en écoutons, nous en déféquons, aussi, du témoignage, devenu quelque chose d'affreux comme la rumeur qu'évoque Max Picard dans son Monde du silence, et que seul le cri du dictateur, selon le philosophe, est capable de concentrer en une force diabolique !
Le cri du dictateur, en France comme dans le reste de l'Occident, est celui de l'opinion publique qui, moins que jamais désireuse de s'élever à la littérature, s'abaisse à ingurgiter du témoignage, car il faut imaginer le veau, comme Sisyphe, heureux ! De Christine Angot la radicalement affreuse à Mimi Mathy, de Yann Moix l'affreusement ignoble à Chantal Goya, de ma coiffeuse à ta caissière, une certaine Agnès-Emmanuel devenue Raoul par la magie de la science médicale, désireuse d'évoquer son changement de sexe à 38 ans et sa nouvelle vie de découvertes qui en découle, qui ne témoigne pas ? Les exemples sont légion des livres qui témoignent, qui paressent, qui défèquent, qui vomissent, qui s'abaissent et abaissent celles et ceux qui les lisent. Le témoignage est universel, au moins aussi universel que sont infinis les exemples nourrissant son insatiable appétit de morne trou noir : ici, un homme perd son enfant, sa fille unique bienaimée, dans des circonstances tragiques, même si elles sont ridicules puisque sa petite a été mortellement percutée par une trottinette électrique, cette moderne rosse de Jugement dernier lâchée sur Paris par hordes cavalcadantes entières et excitées d'un sifflement par l'Antichrist en robe qu'est Anne Hidalgo, et témoigne de sa peine, de sa douleur, arrache des larmes à ses lectrices (ce qui est bien normal) et aussi à ses lecteurs (ce qui l'est presque autant), pardonne même, devant les caméras, au trottineur responsable d'un coupable excès de vitesse en pleine ville mais qui toutefois n'est pas vraiment coupable puisqu'il a tenté par son geste citoyen de réduire l'empreinte carbone liée à son déplacement festif et, s'il a la chance d'attirer l'attention des journalistes, ce qui dépendra de l'habileté du service de presse de son éditeur et du nombre d'hectolitres lacrymaux qu'il aura versé et fait verser dans les chaumières, vendra énormément d'exemplaires dudit témoignage émouvant, ce qui lui permettra de se reconstruire mais plus encore car, sans bien sûr oublier la mort de son enfant, d'en refaire un autre, de commencer une nouvelle vie, de tenter un nouveau départ, de rendre sa chance au bonheur. Il jure qu'il donnera au nouveau-né, en guise de second prénom, celui de l'enfant défunt, ravi aux cieux des purs et des innocents et, comme la ferveur est transmissible, Frédéric Beigbeder, lui aussi bouleversé par cette histoire qui le touche de si près, se démène comme un beau diable pour faire obtenir au père rédimé le Renaudot, enrôlant pour l'aider le tambour-major du journalisme, Franz-Olivier Giesbert. Tout est bien qui finit bien, habile transition pour revenir, enfin, au Consentement qui commence, lui, dans une atmosphère de conte.
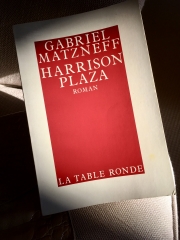 Je ne puis donc, avant même de le lire, qu'avoir horreur d'un livre comme celui de Vanessa Springora, témoignage glacial et bouleversant nous répète-t-on, implacable même selon les ânes, de ce qu'elle a vécu, témoignage paraissant plusieurs dizaines d'années après les faits d'ailleurs religieusement consignés par le volume du Journal de Gabriel Matzneff intitulé La prunelle de mes yeux : or, comme tout témoignage, surtout touchant à de pareils sujets qui peuvent constituer de véritables séismes psychiques chez celle ou celui qui les a endurés, la mémoire n'est peut-être pas le meilleur des alliés mais, après tout, qu'importe la mémoire, puisque le patron même de Grasset, le tout-puissant Olivier Nora, nous assure qu'il a lu un texte véritablement littéraire, ayant la force des textes les plus bouleversants, et ce n'est pas l'envie qui lui manquerait de citer de célèbres livres comme ceux écrits par Messieurs Primo Levi et Imre Kertész revenus de l'horreur, comme Vanessa Springora, elle aussi, est revenue de l'horreur et s'est enfuie du cœur des ténèbres où le glabre Gabriel Matzneff, tel un sordide Kurtz tripoteur de petits sauvages, écoutait de terrifiantes voix lui intimant de consommer de la chair pas même nubile. Seule une lecture aussi minutieuse qu'attentive entre les textes de Springora et de Matzneff, par exemple Harrison Plaza où Vanessa Springora est Allegra, pourrait nous donner quelque idée de la fidélité purement factuelle aux événements relatés mais, bien davantage, nous aiderait à différencier la vision même rapportant, enrobant, déformant (nécessairement) lesdits actes et événements. Qui me reprochera de suggérer une lecture comparative puisque, en choisissant de livrer un texte au public, Vanessa Springora a de fait implicitement admis le statut proprement littéraire de sa production ? Au demeurant, ces vétilles mémorielles pourraient être balayées d'un battement de paupière si les faits étaient transposés dans une langue admirable, dans un grand livre dont nul n'eût pu contester la beauté, hormis quelques rats de bibliothèque et peine-à-jouir tatillons jusqu'au ridicule.
Je ne puis donc, avant même de le lire, qu'avoir horreur d'un livre comme celui de Vanessa Springora, témoignage glacial et bouleversant nous répète-t-on, implacable même selon les ânes, de ce qu'elle a vécu, témoignage paraissant plusieurs dizaines d'années après les faits d'ailleurs religieusement consignés par le volume du Journal de Gabriel Matzneff intitulé La prunelle de mes yeux : or, comme tout témoignage, surtout touchant à de pareils sujets qui peuvent constituer de véritables séismes psychiques chez celle ou celui qui les a endurés, la mémoire n'est peut-être pas le meilleur des alliés mais, après tout, qu'importe la mémoire, puisque le patron même de Grasset, le tout-puissant Olivier Nora, nous assure qu'il a lu un texte véritablement littéraire, ayant la force des textes les plus bouleversants, et ce n'est pas l'envie qui lui manquerait de citer de célèbres livres comme ceux écrits par Messieurs Primo Levi et Imre Kertész revenus de l'horreur, comme Vanessa Springora, elle aussi, est revenue de l'horreur et s'est enfuie du cœur des ténèbres où le glabre Gabriel Matzneff, tel un sordide Kurtz tripoteur de petits sauvages, écoutait de terrifiantes voix lui intimant de consommer de la chair pas même nubile. Seule une lecture aussi minutieuse qu'attentive entre les textes de Springora et de Matzneff, par exemple Harrison Plaza où Vanessa Springora est Allegra, pourrait nous donner quelque idée de la fidélité purement factuelle aux événements relatés mais, bien davantage, nous aiderait à différencier la vision même rapportant, enrobant, déformant (nécessairement) lesdits actes et événements. Qui me reprochera de suggérer une lecture comparative puisque, en choisissant de livrer un texte au public, Vanessa Springora a de fait implicitement admis le statut proprement littéraire de sa production ? Au demeurant, ces vétilles mémorielles pourraient être balayées d'un battement de paupière si les faits étaient transposés dans une langue admirable, dans un grand livre dont nul n'eût pu contester la beauté, hormis quelques rats de bibliothèque et peine-à-jouir tatillons jusqu'au ridicule. Car, quoi qu'il en soit de ces thématiques que, face à l'horreur de l'expérience racontée, nous pourrions juger futiles, il faut bien admettre que le témoignage le plus percutant n'est rien, ou alors rien de plus qu'un fait divers parmi des milliers d'autres (et quoi de plus banal, hélas, qu'un enfant abusé par un adulte ?) sans une écriture digne de ce nom, et bien évidemment non point pour magnifier l'expérience relatée, mais pour la faire accéder à une dimension supérieure : toute la Divine Comédie de Dante, rapportée à sa trame la plus élémentaire, telle que pourrait l'interpréter un Bernard Pivot, pourrait à bon droit être considérée comme la relation de la perte de la jeune femme aimée, Béatrice, mais c'est le génie de l'écrivain qui a élevé son texte à une hauteur insurpassable. De la même façon, Sous le volcan de Malcolm Lowry, qualifiée de divine comédie de l'ivresse, n'est en fin de compte rien de plus que l'errance pathétique d'un homme abandonné par sa femme, mais ce cheminement dans les ténèbres, vers la lumière, a pourtant une portée universelle. Certes, il serait ridicule de demander à Vanessa Springora d'écrire un texte d'une telle portée mais, à tout le moins, il me semble que nous étions en droit d'attendre, de la part d'une femme a priori habituée au commerce des livres, autre chose que l'éternuement allergique, donc répétitif, d'une Christine Angot n'ayant, en guise de vision, que le fonds de commerce jauni d'un inceste raconté dans une langue sommaire à faire pleurer de rire une guenon de laboratoire.
Ce n'est pas tout ce qui me répugne et, malgré ma réserve à l'idée de livrer mes soupçons, je me dois de les indiquer sans fard : je suis gêné, oui, gêné, par le battage médiatique fait autour de ce qui est désormais devenu une affaire Matzneff, après l'affaire de deux autres moitrinaires, Richard Millet et Renaud Camus, affaire qui s'explique bien sûr par la gravité des faits reprochés au petit Aldo Maccione de la piscine Deligny mais, bien davantage je le crains, par l'avidité si commune de la meute journalistique à se jeter sur l'homme qu'il s'agit de capturer puis d'abattre, non sans bien sûr qu'il ait fait acte de contrition publique, quitte à ce que ce soient les mêmes mains des personnes ayant tenu une plume pour chanter les louanges d'un écrivain ouvertement pédomane qui témoignent désormais d'un zèle de dément pour allumer la torche qu'il faudra bien vite, le plus vite possible et surtout, avant tous les autres, jeter sous les pieds du bouc juché sur un beau fagot de bois exposé en place publique. On voit ainsi le ridicule amuseur Frédéric Beigbeder, contrarié que cette maudite affaire ait fichu en l'air son plan de communication bien rôdé pour lancer son dernier texticule, pleurer à chaudes larmes et répéter, le regard hagard et la morve (bizarrement blanche) au nez, qu'il pensait que tout était littérature, que tout n'était que littérature et pas morne consigne pédérastique, dans les pages de l'insolent nouvel Émile de Saint-Germain-des-Prés.
Je doute que Vanessa Springora soit elle-même, dès lors, absolument pure de toute intention si bassement matérielle, et que l'on ne me rétorque pas que je suis un monstre de mettre en doute l'honnêteté d'une femme meurtrie à vie, dont c'est le premier beau roman qui, comme il se doit, ne saurait être exposé à quelque critique littéraire que ce soit. Je vais le dire d'une façon moins abrupte : c'est aussi parce que cette femme a gravi tous les échelons du monde éditorial (rappelons que sa mère était elle-même attachée de presse) jusqu'à devenir la patronne de Julliard (qui édita, par les bons offices de Jacques Chancel directeur de la collection Idée fixe, Les moins de 16 ans) que son témoignage, avant même sa parution, ne semblait plus avoir le moindre secret pour des journalistes qui, tout aussi sûrement, n'en avaient lu que des bouts, pire, des éléments de langage communiqués par les bons soins des attachées de presse de Grasset. On sera scandalisé que j'accorde quelque place d'importance à des pratiques absolument communes, mais pas moins lamentables, dans le petit monde germanopratin de l'édition mais je répondrai d'abord que ce n'est pas la banalité d'une pratique qui la place d'office au-dessus de tout soupçon et, ensuite, que ces facilités trahissent en fait la pourriture du monde journalistique parisien (donc peu ou prou national), s'apprêtant à condamner les textes d'un homme qui sont publiés depuis des lustres avec la même ferveur que, naguère, elle les défendait et, dans les deux cas, sans les avoir le plus souvent lus. Que la femme ou l'homme purs de tout reproche me jettent la première pierre mais, avant cela, qu'ils me permettent de leur rappeler qu'en 2013, la note pour le moins cruelle que je décidai de consacrer aux Moins de 16 ans, dont le titre même ne pouvait laisse aucune ambiguïté quant au sens de mon propos, a été accueillie par une indifférence totale de la part des petits cénacles parisiens qui n'en finissent plus, désormais, de crier haro sur le bouc lubrique !
Il y a, enfin, les avis de quelques lecteurs qui me gênent et même me rebutent franchement, notamment celui d'un imbécile de première magnitude, sorte de Bételgeuse de l'esthétisme immature, camusien ébahi, matznévien transi (tiens : je doute que cette double attirance ne soit que le seul effet du hasard), dont on ne soulignera jamais assez la fantastique capacité d'enthousiasme non point juvénile mais infantile, qui plus d'une fois a dû se rêver complice du vieux faune à visage de poupin, tenant Le Consentement pour le chef-d’œuvre décisif que Gabriel Matzneff, s'il le lisait d'aventure, considérerait comme le Mane, Thecel, Phares de sa propre rédemption. Ce vivant décombre au jugement littéraire jamais certain puisqu'il n'est en fait préoccupé, comme d'ailleurs Renaud Camus ou Gabriel Matzneff, que de son seul bonheur, son seul contentement, son seul plaisir artistique ou prétendu tel, sa seule jouissance esthétique supérieurement chérie par des doigts boudinés de Baron Harkonnen, a pu sans rire affirmer en 2005 que l’essentiel, avec Gab la Rafale, c'est que «restent de beaux livres et dont le pouvoir d’éveil à la sensualité et la spiritualité n’est pas prêt de s’éteindre». Il gonfle encore, et jusqu'à l'éclatement hélas sans cesse procrastiné, sa suffisance de baudruche lâchant beaucoup de gaz en affirmant, sans la moindre trace d'ironie comme c'est toujours le cas chez cette sorte de phocomèle de l'interprétation grasse à faire cuire des beignets, qu'il «parie sur la postérité de Matzneff [car] tout ce qu’on pourra dire contre lui n’altérera jamais notre bonheur de l’avoir lu. Qu’importe alors ces faiblesses et ces crimes. Qu’importe cet extraordinaire aveuglement sur lui-même. Qu’importe même qu’il se révèle un pauvre type, pathétiquement perdu dans ces chimères. Denise Bombardier pourra toujours avoir cent fois raison contre lui, ces cent raisons n’aideront jamais à vivre. Alors qu’une page de Matzneff suffit à rendre heureux. Ses livres sont là, et il suffit d’en ouvrir un pour que le sortilège recommence : sur la femme, sur le Christ, même sur l’enfant. Qui n’a pas été sensible à la dernière page, si scandaleusement bien écrite des Moins de seize ans ?» Le reste de cette daube bourrée d'ail avec lequel notre cinquantenaire pré-pubère va farcir son cadavre de porc préféré se trouve dans son bidet virtuel. Peut-être faudrait-il placer de force ce crétin pontifiant, tel le héros de L'Orange mécanique, sur un fauteuil à pointes et lui faire lire et relire telle merveilleuse page de Gabriel Matzneff (pourquoi pas celle où il vante l'étroitesse d'un cul d'enfant ?) censée apporter du bonheur ? Plaisir encore plus direct que nous nous proposons : l'obliger à regarder en boucle des vidéos pédopornographiques, où le sens esthétique est bien la dernière chose que même son cerveau si particulièrement malade parviendrait à dénicher. Pauvre imbécile ! Pauvre Gabriel Matzneff, petit maître de l'autoérotisme, d'avoir engendré d'aussi ridicules serviles servants, lisant ses livres à hauteur de queue !
Espérons du moins que, dans le livre de Vanessa Springora, la démangeaison d'écrire tienne beaucoup moins de place que les choses qu'elle a vraiment à dire ! Cependant, comme l'époque contemporaine est une rigole universelle allant au maxima cloaca de la bêtise et de la vulgarité, que l'on me permette de douter fortement et, sans plus attendre, que l'on me mette sous le regard Le Consentement qui a émerveillé, par sa qualité d'écriture et la puissance de son témoignage, ceux qui, hier encore, tenaient Gabriel Matzneff pour le fils naturel de Lord Byron et de Gilles de Rais.
Pendant Le Consentement : comment aplanir la complexité avec une truelle en guise de plume
Maintenant, ce livre, Le Consentement de Vanessa Springora, un fier patronyme qui claque comme un étendard au vent d'une plaine tartare, et dont la langue est aussi pauvre qu'un lichen de steppe mongole !
Je vais faire mon vieux con aigri.
Je vais puer mon envieux.
Je vais exsuder ma haine.
Je vais exhaler mon mépris.
Je vais atterrer les imbéciles, qui auront beau jeux de me traiter de misogyne à l'aise dans son petit boudoir sexiste.
Je vais jouer au petit juge.
Je vais prendre mon stylo bille rouge de professeur d'université, ce qui signifie que je parie sur la capacité de cette caste mandarinale, en France donc à Paris, de parvenir à lire un livre qui n'ait pas été recommandé par feu Roland Barthes ou Gérard Genette.
Je vais donner des fléchettes en plastique aux petits soldats de la vertu, du courage, de la force, de la raison, que sais-je encore de beau et de grand, tels que les incarne la lumineuse Vanessa Springora : ils pourront se servir de moi comme d'une cible facile, car je promets de rester immobile.
Je vais analyser un texte que l'on (le on immonde de la rumeur) me dit, que l'on me répète, sur tous les tons pourvu qu'ils soient rigoureusement identiques à celui de la Presse unanime, être littéraire.
Je vais radiographier un témoignage que l'on (le on terrassant de la bêtise surnuméraire) me clame être bouleversant.
Bref, je vais lire un livre, le lire vraiment, autrement dit le respecter, l'honorer, le juger puis, l'ayant trouvé mauvais, le jeter. Mon geste n'aura que peu d'importance, puisque des milliers d'exemplaires de ce livre ont été vendus, qui permettent, on nous le redit sur tous les tons, une salutaire prise de conscience. Au moins aurais-je montré, une fois de plus bien seul, qu'un livre se juge sur ce qu'il est : un acte de langage, plus spécifiquement d'écriture.
Je vais tout bonnement lire un texte et montrer qu'il ne vaut rien ou, soyons prudents, pas grand-chose, à peine de quoi faire gonfler le jabot putrescent du Journalisme.
Je vais faire ce que plus personne, décidément, n'ose faire : je vais accomplir l'office de vigie selon Sainte-Beuve, et il faut bien garder en tête que je me moque par avance des sifflets, des insultes et des insinuations car, attaché comme je le suis au sommet du plus haut mât du navire faisant eau, je ne regarde plus que le cul des albatros majestueux.
Lire un texte, le juger, pardon d'utiliser un langage aussi peu châtié, est devenu une tâche non seulement excentrique mais vicieusement prétentieuse, qui vous expose à tous les crachats. Pour un peu, je serais presque une ordure supérieure à ce sale pédophile, puisque j'ose critiquer un livre qui dénonce ce dernier.
J'ai bien évidemment eu raison de me méfier du Consentement, cette petite production auto-fictive à peu près indigente. Sommes-nous certains que ce livre a bel et bien enfermé dans sa cage le prédateur devenue proie ? Comment un livre aussi médiocre pourrait-il enfermer ne serait-ce qu'une rognure d'ongle, non pas du divin pied pédicuré de frais de Gabriel Matzneff, mais de qui que ce soit ? Comment pourrait-il, lui, à son tour, distiller une seule goutte de poison ? Tout, dans le premier livre de Vanessa Springora qui n'est un roman que si l'on y tient absolument, disons par cette paresse si typiquement journalistique consistant à affubler un objet d'un terme inadéquat, tout est cliché : les premières pages sentant bon leur si sotte psychanalyse plaquent une analyse d'adulte tout aussi sotte sur un regard d'enfant, Vanessa bien sûr intéressée par de menus jeux avec les garçons et les ébats de ses parents qui ne se supportent plus. Comme c'est plat, comme c'est digne (ou indigne c'est selon) d'un roman de gare pour ménagère de plus de 40 ans, c'est écrit platement, ce qui est d'une rigueur absolue, accordons cet unique bon point à Vanessa Springora : un couple qui se sépare, une mère complètement stupide qui, au moment où sa fille lui apprend sa décision de quitter Matzneff, lui déclare : «Le pauvre, tu es sûre ? Il t'adore !», un père violent chez lequel on trouve une poupée gonflable et qui, assistant à une scène idiote bien qu'innocente entre les poupées de sa fille Barbie et Ken lui demande si «ça baise», un vieux dégueulasse qui, à la sortie de l'école, «écarte d'un coup sec les pans de son pardessus» et laisse Vanessa et sa jeune amie, Asia, «médusées, devant la vision grotesque d'un sexe boursouflé, tendu à travers la glissière d'une fermeture Éclair», quelques tripotages saphiques comme nous ne pouvions, encore fort logiquement, qu'attendre impatiemment, comme nous attendions ce non-style absolu qui est le triste apanage des livres idiots, paresseux, écrits (ou réécrits) pour que le plus parfait imbécile, par exemple un journaliste du Monde des Livres, puisse y trouver, les yeux remplis de gratitude, quelques phrases simples qui composeront son petit article ému, comme celle-ci : «Un jour, moi aussi, j'écrirai des livres». Hélas, Vanessa Springora a tenu sa promesse enfantine, mais le résultat, lui, est proprement infantile, et d'ailleurs se résume assez facilement, en phrases faciles : «Un père aux abonnés absents qui a laissé dans mon existence un vide insondable. Un goût prononcé pour la lecture. Une certaine précocité sexuelle. Et, surtout, un immense besoin d'être regardée». Il pourrait s'agir de la naïve confession d'une gamine tout juste devenue femme après l'écoulement de ses premières règles mais ces phrases-là, que l'on dirait avoir été écrites, non, le terme est trop fort : produites sur demande par une machine sommaire sont bien celles de Vanessa Springora. Cette première partie est placée sous le regard implacable de l'un des plus grands écrivains français, Marcel Proust, mais elle eût pu être vissée par le regard perpétuellement idiot d'Alexandre Jardin que nous n'aurions constaté aucune différence : c'est plat, c'est banal, c'est bourré de clichés ou plutôt, ce n'est qu'une enfilade de clichés, c'est du journalisme sans beaucoup de talent et qui n'a même pas la prétention de nous apprendre quoi que ce soit, ne serait-ce que l'adresse d'un bon psy.
Une autre partie est elle aussi ouverte par une citation de Marcel Proust, que je recopie, immédiatement suivie par le texte de Vanessa Springora. On m'accusera d'être cruel en mettant ainsi en regard une belle phrase complexe, aux périodes musicales, et la phrase sèche, paresseuse, facile, journalistique de celle qui, pourtant, a non seulement lu beaucoup de livres mais, désormais, en publie : «Il est curieux qu'un premier amour, si, par la fragilité qu'il laisse à notre cœur, il fraye la voie aux amours suivantes, ne nous donne pas du moins, par l'identité même des symptômes et des souffrances, le moyen de les guérir», exergue surplombant immédiatement suivi par cette pénéplaine stylistique : «De guerre lasse, G. a cessé de me poursuivre avec ses lettres, ses appels chez ma mère, qu'il suppliait jusque-là, à toute heure du jour et de la nuit, de m'empêcher de couper les ponts avec lui». Je dois dire, relisant cette phrase, que c'est sans doute l'une des mieux balancées qu'a écrites Vanessa Springora mais, comme quelques autres, rarissimes, elle est immédiatement noyée sous des quintaux de bêtises et de clichés absolus, d'images aussi sottes qu'usées jusqu'à la corde comme, au hasard : «Pas facile de se refaire une virginité», ou bien : «je me rappelle ma mission dans ce bas monde, donner du plaisir aux hommes. C'est ma condition, mon statut», ou encore : «c'est m'empêcher de déployer mes ailes», sans oublier : «Les écrivains sont des gens qui ne gagnent pas toujours à être connus», ou pourquoi pas : «J'ai la sensation d'avoir vécu mille ans», mais que dire de : «Il m'aura fallu du temps, des années, pour enfin rencontrer un homme avec qui je me sente pleinement en confiance», ou encore de : «Nous avons maintenant un fils qui entre dans l'adolescence. Un fils qui m'aide à grandir» et tant d'autres fadaises que nous pourrions continuer de citer comme tel bouleversant constat en fin de page : «Je n'en ai pas encore fini avec l'ambivalence» ça c'est sûr ma bonne dame ou : «L'amour n'a pas d'âge, ce n'est pas la question», sans omettre de citer ce passage qui aurait pu sans trop de peine être écrit par Christine Angot ou l'une de ses sœurs en déshérence littéraire : «Je commence à reprendre mon souffle. Je dois me recentrer. Respirer. Réfléchir. Prendre une décision».
La deuxième partie intitulée La proie est placée, elle, sous une citation du Trésor de la langue française : nous craignons donc le pire avant même que d'en avoir parcouru la première ligne, aussi plate que toutes celles qui l'ont précédée et que toutes celles qui la suivront : «Un soir, ma mère me traîne dans un dîner où sont invités quelques personnalités du monde littéraire». Cette deuxième partie, de toute évidence la plus croustillante puisque nous y voyons la tactique utilisée par Gabriel Matzneff pour séduire la jeune Vanessa Springora est aussi platement écrite que la première, aussi platement écrite que le seront les autres parties, usant et abusant de ce tic lamentable que l'on voit faire tressauter une écriture dans n'importe quel livre écrit par un auteur, peu importe qu'il soit une femme ou un homme et qui consiste, par paresse comme toujours ou plutôt, dans ce cas, par incapacité flagrante à élaborer une phrase de plus de quatre mots, à couper artificiellement une phrase, à tenter de la rendre complexe en abolissant toute forme de complexité grammaticale, toute subordination labyrinthique. Ce tic lamentable, qui constitue à peu près l'alpha et l'oméga stylistique d'une Solange Bied-Charreton se répète jusqu'à la grimace dans le livre de Vanessa Springora. En voici un seul exemple : «Jamais je n'accepterai d'être séparée de lui. Plutôt mourir».
Les autres parties sont tout aussi peu intéressantes, hormis peut-être celles contenant les pages où Vanessa Springora évoque, après sa séparation, son errance, sa souffrance, mais il faut bien admettre que cela n'a pas beaucoup d'allure, ne ressemble que vaguement à un texte, sauf peut-être aux yeux d'Olivier Nora qui, nous apprend Vanessa Springora n'oubliant pas de le remercier, «a décidé sans hésiter de le publier». Bien évidemment, osant critiquer l'écriture d'un texte qui n'a d'autre ambition, sans doute, que d'être un témoignage implacable et la relation objective de faits, je passerai pour un intraitable butor n'ayant aucune compassion pour la victime (consentante ? La voilà, la question que se garde bien de trancher Vanessa Springora !), mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas seulement l'écriture qui, à bon droit, peut être critiquée et c'est là que, pour reprendre une image si merveilleusement journalistique, le bât blesse. Je suis en effet presque aussi peu convaincu par le talent littéraire de Vanessa Springora que par la capacité de son narrateur à évoquer une situation plausible, comme le montre l'exemple de la scène, désastreuse du strict point de vue de la vraisemblance littéraire, entre la jeune femme et Cioran, le vieil ami de Matzneff chez qui l'adolescente a cherché un peu de réconfort. Je crains qu'il n'y ait nul besoin d'être un intime du fameux penseur nihiliste, voire de connaître une personne qui aurait été directement amenée à le rencontrer, pour percevoir immédiatement la fausseté romanesque, la nullité de cet épisode, sa facilité. Les belles âmes, les défenseurs acharnés des femmes devenues proies me rétorqueront que la mémoire a ses limites (1), ou bien, hypothèse encore plus farfelue, que Vanessa Springora a volontairement modifié ses souvenirs, pour je ne sais trop quelles raisons saugrenues d'ailleurs comme faire du penseur le défenseur de Matzneff, mais quel supplice que cette rencontre avec l'auteur des Syllogismes de l'amertume où tout sonne faux, quelle bêtise dans le phrasé même de l'auteur, la réponse que lui prête Springora invoquant le droit supérieur de l'écrivain, la chance d'une gamine d'avoir été placée sous l'aile protectrice d'un grand créateur ! Non, rien n'est crédible dans cette scène, et je ne parle que de sa cohérence interne, littéraire, de son efficacité romanesque, sans même évoquer la question, elle-même révélatrice d'un manquement de la part de l'auteur, de la véracité des détails décrivant l'apparence physique de Cioran ou de sa compagne, de son accent même, que celles et ceux qui l'ont connu pourraient évoquer bien mieux que moi et, apparemment, bien mieux que Vanessa Springora.
Après Le Consentement : de l'urgence vitale d'une critique littéraire point veule ni inculte mais libre
Voici à présent les mots d'une femme qui a été la maîtresse de Gabriel Matzneff et qui, du moins jusqu'à ce jour, n'a pas voué son ancien complice et maître aux gémonies : «Une œuvre ne compte que si elle arrive à hanter une autre âme, à provoquer de l'amour» écrit Cocteau dans son Journal avant de mourir : alors, à l’heure du me too, j’aurais envie de dire moi non plus. Envie de dire que j’ai connu la vie inimitable, que c’est une immense chance. Maître et complice, Gabriel provoque de l’amour; il élève». Ce sont les mots, bien évidemment un peu niais et même : parfaitement sots, d'une certaine Véronique B qui devint, à l’âge de seize ans et à la suite de Vanessa Springora, soit il y a plus de trente ans, l’amante de Gabriel Matzneff. Je doute que les textes de Gabriel Matzneff, qui tous, comme des tournesols obscènes, ne s'orientent que sous un soleil pédophilique, puissent élever autre chose qu'une certaine catégorie d'êtres finalement assez peu doués mais qui, saisissant, après tant d'années de silence, leur chance éditoriale (qui le leur reprocherait ?), nous infligent le témoignage prétendument littéraire de ce qu'ils ont vécu, et d'autant plus littéraire, donc universellement salué par nos amis journalistes dont c'est pourtant le métier que de savoir lire, que nous y trouvons ce genre de phrase résolument idiote : «le soleil brille et n'attend que moi pour que la fête commence». Il est bien entendu qu'il est absolument interdit de juger la qualité littéraire d'un témoignage, puisque celui-ci, comme une effusion ou, plus prosaïquement, un filet de bêtise liquide, sort directement de l'organe le plus noble de l'homme, son cœur, alors même, dans le mouvement le plus rigoureusement contraire, qu'un grand texte, qu'un livre écrit dans une langue admirable (je ne parle bien évidemment pas de celle de Gabriel Matzneff !) sera, lui, voué aux flammes du bûcher s'il était jugé méchant, dangereux voire pervers par nos moralisateurs faisant office de critiques littéraires. En somme, nous ne sortons pas du dilemme Céline ou Rebatet : être de grands écrivains (mais certains le contestent) et des ordures (mais certains, aussi, le contestent).
Nous en manquons pourtant cruellement, de critiques littéraires, autrement dit de juges prononçant un jugement (et, hélas, presque aucune sanction) et je m'en vais l'affirmer d'une façon frappante, en écrivant cette proposition : si, en France, nous disposions d'une critique journalistique digne de ce nom plutôt que d'un réseau consanguin de clowns, jamais, je dis bien : jamais, jamais Gabriel Matzneff n'aurait pu être considéré comme autre chose qu'un pervers obscènement obsédé par lui-même disposant d'un minuscule talent de plume, le petit talent qui ne provoquerait pas davantage qu'un haussement de sourcils de la part de lecteurs avisés. Face à de vrais critiques, ses textes eussent été balayés, détricotés pour ce qu'ils sont : les éjaculats d'un perpétuel Narcisse se mirant au miroir de sa jeunesse perdue, la cherchant, comme un monstre, dans celle de ses proies. Ce n'est pas un hasard si l'une des phrases de Vanessa Springora a peu près dignes de pouvoir prétendre à un peu de tenue mentionne tel fameux exemple : «Version moderne du portrait de Dorian Gray, son œuvre serait le réceptacle de tous ses défauts, lui permettant de revenir à la vie ressourcé, vierge, lisse et pur». C'est cette dimension qu'il fallait ne pas craindre d'explorer ! C'est dans ce gouffre dangereux qu'il fallait oser descendre ! Ainsi, pour convenue qu'elle est, l'affirmation qui suit est parfaitement ridicule, pour la simple et toujours bonne raison qu'un grand texte est essentiellement moral, non pas moralisateur, mais moral : dont la portée n'est pas seulement esthétique mais convoque directement l'homme, lui rappelle ce qu'il est ou plutôt, l'élève à ce qu'il devrait être : «Il faut croire, écrit donc Vanessa Springora, que l'artiste appartient à une caste à part, qu'il est un être aux vertus supérieures auquel nous offrons un mandat de toute-puissance, sans autre contrepartie que la production d'une œuvre originale et subversive, une sorte d'aristocrate détenteur de privilèges exceptionnels devant lequel notre jugement, dans un état de sidération aveugle, doit s'effacer». Notre jugement ne s'est jamais effacé devant un faiseur, fût-il cultivé et fort habile comme Gabriel Matzneff, et il ne s'effacerait même pas devant un grand écrivain, mais ne serait-ce pas le dernier ridicule que l'on prétendît qu'il s'effaçât devant quelques pages malhabiles jugées remarquables au prétexte fallacieux que celle qui les a écrites a souffert, a témoigné de sa souffrance ? La souffrance, hélas ou heureusement, ne donne pas la certitude du talent car, à ce compte, un Yann Moix, pour n'en citer qu'un qui a récemment défrayé la chronique journalistique, pourrait se prétendre écrivain.
De la même façon, jamais un livre aussi faible que celui de Vanessa Springora, vraisemblablement retouché, ici ou là ou même, pourquoi pas, dans sa totalité, par quelque nègre pour qu'il frappe le plus grand nombre de lecteurs et ainsi constitue une bonne affaire pour le si médiocre éditeur qu'est Grasset, de la même façon donc, jamais Le Consentement, correctement lu, lu en le jugeant comme ce qu'il est d'abord, un livre donc, un texte, n'aurait pu être qualifié de réussite littéraire, de témoignage émouvant voire de superbe exercice d'écriture, si nous pouvions compter sur des lecteurs qui lisent avec leurs yeux et pas avec leurs tripes amollies qui, nous le savons, ne sont pas exactement d'une transparence cristalline.
J'ai lu, attentivement, Le Consentement, d'ores et déjà succès éditorial, et je l'ai même relu pour m'assurer que telle fulgurance m'avait échappée : ce n'est pas parce que ce livre est un grand livre que la critique journalistique a dit qu'il était bon, voire grand. La critique journalistique, comme un seul mouton suivant un mouton plus gros que lui, a dit tout le bien qu'elle pensait du livre de Vanessa Springora parce qu'il eût été proprement scandaleux qu'elle fasse son métier, au risque de déplaire : juger la qualité littéraire d'un texte, et non point sa moralité, du reste elle-même assez trouble selon l'aveu de l'intéressée, plus perdue, désorientée que témérairement sûre de son propos. Je le dis et répète : on ne juge pas un texte en évoquant sa portée morale ou immorale, mais en analysant ce qui le compose, des lettres, des mots, des phrases : la moralité, elle, se donnera par surcroît, si elle existe, sans qu'il nous faille la dénicher comme un Pokémon farceur au détour d'une phrase un peu plus touffue que les autres. Si le texte est mauvais, que nous importe alors son exemplarité morale ou sa bassesse immorale ? Un architecte, avant de considérer la beauté d'un édifice, veille à ce qu'il soit correctement construit et qu'il ne s'effondre pas au premier coup de vent. Si, une fois que l'on s'est assuré qu'il reposait solidement sur ses fondations, il émerveille les badauds par son originalité, son harmonie ou sa véritable et indéniable beauté, ce n'est qu'un surcroît de sens apporté au soin avec lequel il a été, humblement, solidement, méthodiquement, bâti. Si, une fois qu'il se tient seul et debout, tout le monde remarque sa laideur, il y a fort à parier pour qu'il se détruise assez vite, ou qu'il soit rasé par tel contemplateur solitaire, ou que la nature finisse par se rebeller contre ce corps étranger, cette verrue déparant sa belle ordonnance, ce couac à son rythme interne. Au pire, tout le monde le jugera laid, comme un bouquet de tulipes géantes de l'imposteur milliardaire Jeff Koons, et ce jugement, fût-il implicite, sera un châtiment suffisant. Il en va de même d'un livre. Il en va de même d'un livre de Gabriel Matzneff et, dans un silence que l'on peut à bon droit prétendre sépulcral, j'ai dit tout le mal que je pensais des Moins de 16 ans qui est, d'abord, un texte assez pauvre, un livre à thèse fût-elle ignoble, donc un livre bête, paresseux, trahissant l'essence même de l'écriture. Il en va de même pour le livre de Vanessa Springora, dont on guette avec impatience le huitième ou neuvième retirage qui, lui, n'est certes pas un texte ignoble mais creux. Ce n'est pas parce qu'il est moral, et encore, que le texte de cette autrice est ou serait beau. C'est parce qu'il serait beau qu'il serait moral. Malheureusement, Le Consentement n'est pas un beau texte, et je ne suis pas vraiment certain qu'il soit un texte moral. Rien n'y tient, rien ne se tient. Faites donc l'essai, il vaut la peine : ne vous contentez donc pas de lire ce que la Presse dit, stupidement, bêtement, monotonement, ridiculement, pathétiquement, de ce texte : lisez-le et vous constaterez qu'il n'y a pas que ses phrases qui ne tiennent pas debout, car le même constat vaut pour ses personnages.
Car enfin, quelle est cette impuissance totale à ne pas même parvenir à comprendre ses propres personnages, réduits à de grossières silhouettes que l'on dirait avoir été tracées, comme autant de preuves compromettantes pour les adultes coupables, par un enfant martyrisé ? Le père de Vanessa Springora, en tant que personnage, en tant, donc, que rouage d'une machinerie littéraire, est parfaitement creux, superficiel, aussi consistant qu'un fantôme. On me dira que ce n'est là qu'une conséquence logique de sa présence pour le moins stochastique et ectoplasmique dans la vie de notre adolescente. Sa mère, à cette aune, devrait donc avoir une véritable consistance, pas vrai ? : or, ce n'est absolument pas le cas et, si le père est un fantôme, la mère est une imbécile qui pousse et retient sa fille, la jette entre les bras de Gabriel Matzneff tout en l'avertissant de ce que tout le monde sait, puis plaint le pauvre homme que sa fille a fini par quitter. Si j'étais méchant, j'affirmerais de ce personnage qu'il est la plus ridicule incarnation d'une pauvre idiote. La narratrice elle-même, Vanessa Springora donc, est résolument creuse et si mauvaise écrivaine qu'elle réussit le tour de force de rendre à peu près digne d'attention l'ogre qui, selon ses dires, l'a dévorée, salie, détruite et, maintenant, qu'il continue de hanter. Qu'il est difficile de peindre une ordure, n'est-ce pas ? Dans ce cas, si l'on n'est même pas capable de supposer une intelligence au démon, à quoi bon raconter, tenter de décrire ses turpitudes ? C'est là une peinture qui est tout à fait hors de portée de Vanessa Springora, tout juste capable, dans un texte apparemment écrit et réécrit durant des années, de tracer quelques lignes grossières et maladroites qui sont censées condenser la figure du salaud absolu, un homme affable, cultivé, prévenant, qui n'a d'autre but que de ravir l'innocence sous prétexte de littérature.
Ce n'est donc pas l'anormalité d'un personnage qui le rend, dans l'économie d'un texte, crédible voire impressionnant de réalisme : c'est l'écriture et, d'écriture, Vanessa Springora n'en a pas, n'en a jamais eu, et encore, peut-être me trompé-je, car je parie qu'elle a écrit, seule, son texte qui, à bien des endroits, sent la réécriture professée par quelque relecteur éditorial, la phrase journalistique, facile, morveuse, bête, la phrase journalistique qui est slogan, témoignage, froid sans doute mais nullement puissant, littérature indigente, et, pour tout dire, paresseuse.
Note
(1) La mémoire a ses limites : assurément, mais de là à prétendre que Cioran habitait au premier étage d'un immeuble cossu alors qu'il vivait dans trois chambres de bonne réunies en un seul appartement se trouvant au dernier étage, de là à prétendre que Simone Boué était «une petite dame» alors qu'elle était grande, de là à affirmer qu'il s'agissait de sa femme alors que Cioran ne l'a jamais prise comme épouse, de là à raconter qu'elle avait été comédienne alors qu'elle aura été toute sa vie professeur d'anglais, de là à prétendre qu'une adolescente pouvait appeler «Emil» l'atrabilaire au style impeccable et alors même que ses meilleurs amis ne se permettaient pas de le faire, de là à affirmer que le philosophe avait un nez d'aigle ou un accent lui faisant déformer les mots, de là à raconter bien d'autres absurdités et contre-évidences (je n'ose parler de mensonges ou d'affabulations !), il y a donc un pas de géant que l'insignifiant petit talent de Vanessa Springora n'est pas même capable de hausser jusqu'à une scène qui fût non point conforme à la réalité mais, à tout le moins, banalement, simplement vraisemblable. Comment est-il donc possible d'être si nulle et de donner aussi facilement des armes à ceux, et il en reste bien sûr, qui auront alors beau jeu de suspecter la sincérité de tout un livre ? Mon Dieu, mais c'est à croire que Vanessa Springora, inconsciemment peut-être (j'emploie ce terme à dessein, puisque l'intéressée en parle), veut encore ménager son bourreau et lui offrir une honorable porte de sortie, en le faisant défendre par un défenseur aussi prestigieux qu'intègre en la personne de Cioran !
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, pédophilie, pédomanie, gabriel matzneff, vanessa springora, le consentement, harrison plaza, cioran, éditions grasset |  |
|  Imprimer
Imprimer
