Je m'accuse... d'avoir douté que Tiens ferme ta couronne de Yannick Haenel était moins mauvais qu'il ne l'est en vérité (23/11/2017)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Le roi Philippe Sollers entouré de ses bouffons.
Le roi Philippe Sollers entouré de ses bouffons.Si vous aimez les livres de Yannick Haenel, vous aimerez aussi ceux de :
 Antoni Casas Ros.
Antoni Casas Ros. Romaric Sangars.
Romaric Sangars. Et bien sûr ceux du frère jumeau phocomèle de Yannick Haenel, François Meyronnis.
Et bien sûr ceux du frère jumeau phocomèle de Yannick Haenel, François Meyronnis. Si vous n'aimez pas Yannick Haenel, vous aimerez chacun de ces romans monstrueux.
Si vous n'aimez pas Yannick Haenel, vous aimerez chacun de ces romans monstrueux. Sur le précédent roman couronné par le prix Médicis, une belle note de Gregory Mion.
Sur le précédent roman couronné par le prix Médicis, une belle note de Gregory Mion.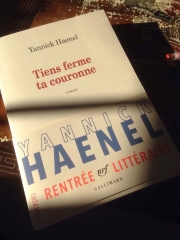 Je m'accuse, très-humblement et très-douloureusement, d’avoir, il y a quelques jours, le 9 novembre 2017 très-exactement, en lisant l'un des plus lamentables échotiers dont la presse française peut se déshonorer, Mohammed Aïssaoui officiant au Figaro (dit) littéraire dirigé par le piètrissime Étienne de Montety jamais avare d'une petite douceur consanguine, dans un article non pas sot mais pathétique où ce Monsieur-pipi de la réclame prostituait quelques noms dont ceux de Melville, je m'accuse donc d'avoir pensé que non seulement je n'avais pas été assez sarcastique et critique à l'égard des livres de Yannick Haenel, mais qu'il allait me falloir inventer un mot plus fort que celui que j'avais utilisé pour caractériser le plus prometteur des ventriloques sollersiens, mot pourtant assez fort pour faire avorter les prétentions de tout écrivain digne de ce nom, ce que Yannick Haenel n'est absolument pas : ce mot, c'est celui d'imposteur. Je l'emploie de nouveau, en toutes lettres : Yannick Haenel est un imposteur, comme je vais, une fois encore, le prouver et celles et ceux qui saluent cet imposteur sont, au mieux, des crétins qui ne savent pas lire et, au pire, des complices de cette imposture. Une imposture n'est rien, sinon le rêve d'un illuminé, sans l'aide de celles et ceux qui donnent à cette imposture les moyens de se propager, d'agir, de la seule action que connaisse l'imposture : en gonflant. Nous attendons le moment où cette baudruche va éclater, non pas en réalité, car elle est à nos yeux dégonflée depuis belle lurette, mais auprès de la noria de bouches sales (journalistes, éditeurs et attachées de presse, et même, donc, lecteurs), sales et indigentes, incultes, qui le disent écrivain de talent, écrivain tout court. Si Yannick Haenel est un écrivain, alors la terre n'est pas ronde mais plate. Si Yannick Haenel est un écrivain, alors Philippe Sollers est le plus grand écrivain de ces cinquante dernières années. Je me demande laquelle de ces deux propositions est la plus capable de déboiter l'axe de l'univers. Hormis Josyane Savigneau qui fort heureusement n'a plus guère de moyens de nuire depuis qu'elle ne parasite plus Le Monde des Livres, je ne sais personne, pas même le ridicule Benoît Chantre, être capable de soutenir une telle énormité; ergo : Yannick Haenel est une baudruche.
Je m'accuse, très-humblement et très-douloureusement, d’avoir, il y a quelques jours, le 9 novembre 2017 très-exactement, en lisant l'un des plus lamentables échotiers dont la presse française peut se déshonorer, Mohammed Aïssaoui officiant au Figaro (dit) littéraire dirigé par le piètrissime Étienne de Montety jamais avare d'une petite douceur consanguine, dans un article non pas sot mais pathétique où ce Monsieur-pipi de la réclame prostituait quelques noms dont ceux de Melville, je m'accuse donc d'avoir pensé que non seulement je n'avais pas été assez sarcastique et critique à l'égard des livres de Yannick Haenel, mais qu'il allait me falloir inventer un mot plus fort que celui que j'avais utilisé pour caractériser le plus prometteur des ventriloques sollersiens, mot pourtant assez fort pour faire avorter les prétentions de tout écrivain digne de ce nom, ce que Yannick Haenel n'est absolument pas : ce mot, c'est celui d'imposteur. Je l'emploie de nouveau, en toutes lettres : Yannick Haenel est un imposteur, comme je vais, une fois encore, le prouver et celles et ceux qui saluent cet imposteur sont, au mieux, des crétins qui ne savent pas lire et, au pire, des complices de cette imposture. Une imposture n'est rien, sinon le rêve d'un illuminé, sans l'aide de celles et ceux qui donnent à cette imposture les moyens de se propager, d'agir, de la seule action que connaisse l'imposture : en gonflant. Nous attendons le moment où cette baudruche va éclater, non pas en réalité, car elle est à nos yeux dégonflée depuis belle lurette, mais auprès de la noria de bouches sales (journalistes, éditeurs et attachées de presse, et même, donc, lecteurs), sales et indigentes, incultes, qui le disent écrivain de talent, écrivain tout court. Si Yannick Haenel est un écrivain, alors la terre n'est pas ronde mais plate. Si Yannick Haenel est un écrivain, alors Philippe Sollers est le plus grand écrivain de ces cinquante dernières années. Je me demande laquelle de ces deux propositions est la plus capable de déboiter l'axe de l'univers. Hormis Josyane Savigneau qui fort heureusement n'a plus guère de moyens de nuire depuis qu'elle ne parasite plus Le Monde des Livres, je ne sais personne, pas même le ridicule Benoît Chantre, être capable de soutenir une telle énormité; ergo : Yannick Haenel est une baudruche.Il y a quelques jours, disais-je, dans un accès de faiblesse ou parce qu'une douce aménité a relâché, pour quelques secondes, mes défenses les plus solides, j'ai supposé, à Yannick Haenel, un degré de nullité, pas seulement matérielle je vous prie de le croire, que j'ai visiblement, scandaleusement, coupablement, sous-estimé. Par ces lignes et toutes celles qui vont suivre, je bats donc publiquement ma coulpe, répétant, après tant d'autres qui fort heureusement n'ont pas eu la malchance de lire Yannick Haenel : Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon..., et j'espère ainsi rééquilibrer les plateaux de la balance où, pesé, Tiens ferme ta couronne montre qu'il a moins de poids qu'une chiure de bruche, et peut-être même qu'une sentence de Philippe Sollers.
C’était trop, mille fois, je le confesse, que cette faiblesse inusitée, et mon repentir est sincère. Pourtant, je dois bien dire que je faisais une entière confiance, comme toujours, à deux des plus remarquables consécrateurs de nullités, deux des plus phénoménaux producteurs de daube littéraire de ce demi-siècle, produisant des hectolitres de piquette littéraire comme d'autres produisent du fumier, en quintaux cette fois-ci, Bernard Pivot et Pierre Assouline que je ne présente plus, pour récompenser Tiens ferme ta couronne à la hauteur de sa remarquable médiocrité, en le plongeant dans l'eau fétide du bidet du prix Goncourt, où des dizaines de pieds, et sans doute même quelques paires de fesses, ont soulagé leurs brûlures provoquées par de prospères colonies de champignons gonorrhéiques.
Je me suis trompé : il y a visiblement plus médiocre, plus consanguin, plus fétide, plus amanite que le raout se réunissant chez Drouant : celui qui se réunit à La Méditerranée, un restaurant palourdé place de l'Odéon. Lydie Salvayre, avec l'ignoble brouet fragnolisant Pas pleurer tout pelliculé de nouilles catalanes qui ne songeaient pas encore à proclamer leur indépendance avait fort heureusement pu participer à la communion des imbéciles de la célébration journalistique dont les ondes concentriques, désormais, font tanguer et même vomir ceux que l'on pensait les plus habitués des hautes mers : j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu des bernanosiens point complètement incultes je vous prie de le croire me tenir le discours inepte selon lequel ce roman permettait de faire découvrir le Grand d'Espagne et, occasionnellement sans doute, vendre quelques-uns des exemplaires des Grands cimetières sous la lune. Si Lydie Salvayre a reçu le Goncourt, Yannick Haenel lui, qui était pourtant bien parti pour le recevoir, non. Certes, il a pu fort heureusement, avant de regagner la ténèbre bienfaisante qui lui est nécessaire pour aligner des phrases étiques et translucides comme ces vers immondes des cavernes qui jamais ne voient la lumière du jour, phrases mort-nées formolisées aussitôt que sorties de son esprit en forme d'anuscope, bénéficier d'une douche de purin médiatique dont il n'a même pas fait mine de refuser d'avaler quelques lampées, grâce au prix Médicis. La République des lettres sait toujours récompenser ses plus zélés serviteurs, c'est-à-dire les plus médiocres.
Comme une résipiscence n'est jamais sincère que si elle pousse l'humilité dans ses derniers retranchements, je dois aussi avouer que je trouve à Yannick Haenel un talent rare : celui de ne jamais dévier de ses obsessions et donc, d'être d'une fidélité d'eunuque à sa propre nullité, fidélité qui jamais ne se se trahit mieux que lorsque cet expérimenté avorteur de phrases évoque Hermann Melville. C'est dans le meyronnissien Prélude à la délivrance que Yannick Haenel clamait son amour du grand écrivain nord-américain qui est devenu la bouée de sauvetage de tous les écrivants et pseudo-savants comme Olivier Rey qui, dans le plus anodin point-virgule d'un texte comme Billy Budd, marin, voient non seulement tout ce que l'écrivain y a mis mais tout ce qu'il n'y a pas mis, tout ce qu'il n'aurait jamais pensé y mettre et, par-dessus le marché, tout ce qu'il n'aurait pour rien au monde voulu y mettre. Les nains, avant, se contentaient de se jucher, comme ils le pouvaient, sur les épaules des géants : voici désormais qu'ils parlent à leur place.
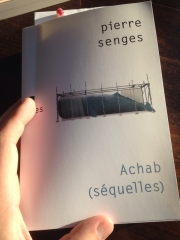 Dernièrement, j'ai lu un pléthorique et bizarre roman (le terme me semble bien impropre; j'y vois davantage une enquête à la Sebald ou à la De Quincey, l'hystérie de l'épanchement en plus, la prolifération de la liste, du récit enroulé à l'infini sur lui-même) où Pierre Senges tente d'épuiser, avec ses quelques lecteurs courageux parvenus à finir ce lourd et étrange pensum, le sujet qu'il se propose d'illustrer sur plus de 600 pages aux lignes serrées, et qui n'est absolument pas éloigné de celui du dernier roman de Yannick Haenel, et qui n'est à ce point pas visiblement éloigné de celui-ci qu'il faudrait creuser bien plus avant les rapprochements possibles entre ces deux textes, comme je l'ai fait, tiens, pour Soumission de Michel Houellebecq, l'un savant, celui de Pierre Senges bien sûr, rabelaisien, revenant sans cesse sur ses affirmations pour mieux les nuancer, les dépasser, les répéter, les infirmer, du moins en apparence, et ainsi donner l'idée d'une progression qui ne serait pas celle d'un navire fendant les eaux mais bien plutôt celle de l'imperceptible mais pas moins réelle avancée d'un navire quasiment immobile, mais qui n'en avancerait pas moins, dans une durée pratiquement infinie, de quelques centimètres ou même moins si l'on y tient, quelques millimètres, les phrases accumulatives de Pierre Senges (utilement résumées de la sorte : «ses descriptions voudraient être linéaires, elles s'étalent et se ramifient, on dirait un seul fil séparé en plusieurs») (1) voulant tout dire, avançant millimètre par millimètre comme si elles avaient dû escalader et même abraser des montagnes de savoirs et de lectures, finissant bien par être comme de tranquilles et minutieuses vagues qui, à force de lécher la coque du navire, non seulement le feront minusculement, pouce après pouce, imperceptiblement, se déplacer sur la mer elle-même en mouvement, mais le corroderont, et, après l'avoir conservé un temps, le dissoudront.
Dernièrement, j'ai lu un pléthorique et bizarre roman (le terme me semble bien impropre; j'y vois davantage une enquête à la Sebald ou à la De Quincey, l'hystérie de l'épanchement en plus, la prolifération de la liste, du récit enroulé à l'infini sur lui-même) où Pierre Senges tente d'épuiser, avec ses quelques lecteurs courageux parvenus à finir ce lourd et étrange pensum, le sujet qu'il se propose d'illustrer sur plus de 600 pages aux lignes serrées, et qui n'est absolument pas éloigné de celui du dernier roman de Yannick Haenel, et qui n'est à ce point pas visiblement éloigné de celui-ci qu'il faudrait creuser bien plus avant les rapprochements possibles entre ces deux textes, comme je l'ai fait, tiens, pour Soumission de Michel Houellebecq, l'un savant, celui de Pierre Senges bien sûr, rabelaisien, revenant sans cesse sur ses affirmations pour mieux les nuancer, les dépasser, les répéter, les infirmer, du moins en apparence, et ainsi donner l'idée d'une progression qui ne serait pas celle d'un navire fendant les eaux mais bien plutôt celle de l'imperceptible mais pas moins réelle avancée d'un navire quasiment immobile, mais qui n'en avancerait pas moins, dans une durée pratiquement infinie, de quelques centimètres ou même moins si l'on y tient, quelques millimètres, les phrases accumulatives de Pierre Senges (utilement résumées de la sorte : «ses descriptions voudraient être linéaires, elles s'étalent et se ramifient, on dirait un seul fil séparé en plusieurs») (1) voulant tout dire, avançant millimètre par millimètre comme si elles avaient dû escalader et même abraser des montagnes de savoirs et de lectures, finissant bien par être comme de tranquilles et minutieuses vagues qui, à force de lécher la coque du navire, non seulement le feront minusculement, pouce après pouce, imperceptiblement, se déplacer sur la mer elle-même en mouvement, mais le corroderont, et, après l'avoir conservé un temps, le dissoudront. L'un itératif donc, le livre de Pierre Senges, s'épuisant, comme Achab, à poursuivre la baleine blanche mythique qu'est le Livre, en en détaillant jusqu'à l'ophtalmie (des neiges, forcément, à moins qu'il n'existe une ophtalmie propre à la fixation de la surface réfléchissante des mers), et peut-être même la cécité, la moindre nuance de blanc.
L'autre poussif, pauvre, sans style, pas blanc mais, je l'ai dit, translucide et pas transparent (car c'est de cela que rêve secrètement notre écrivant : la transparence), sans écriture, si ce n'est celle de Yannick Haenel : plate, houellebecquienne, insignifiante mais luttant contre son propre tropisme et écroulement vers la platitude morne, prétentieuse mais indigente, prétentieuse mais jamais inventive, prétentieuse mais sotte, prétentieuse mais vide, prétentieuse, vide et indigente, sollersienne en diable donc et, pour le dire en un seul adjectif qui à mes yeux présente l'avantage de condenser la médiocrité bavarde, haenélienne.
La nullité de l'écriture haenélienne, si justement récompensée par la nullité des jurés du prix Médicis, n'est jamais aussi visible que lorsqu'il s'agit d'évoquer une coucherie. Nous savons que, chez Houellebecq, les plus hautes figures de style, lors d'une scène de sexe, se limitent à l'usage de termes tels que queue, chatte (épilée voire rasée comme habituelle et monotone épithète de nature), cul et, sous-tendant ces tropes d'une verte originalité, salope et chienne et le participe présent afférent à ces exquises réalités, bandant. Yannick Haenel, lui, contrairement à Michel Houellebecq, ne saurait employer de tels termes, que l'on devine bien incapables de franchir la fine ligne étroite de ses petites lèvres pincées de vieille supérieure de couvent où de jeunes filles font mine de lire en cachette Femmes de Sollers. Hélas, comme il n'a aucune capacité littéraire digne de ce nom, il est bien obligé, sans les employer, de nous en faire sentir et ressentir l'exquise présence. Voici ce que cela donne : «Je me redressai, le visage ruisselant; elle se mit à genoux et engloutit ma queue. Son regard avait la couleur de l'orage, mais déjà elle semblait absente. La nuit nous enveloppait comme un mouchoir de velours. malgré la douleur au cul [le narrateur vient d'être mordu par le chien Sabbat], je me sentais sous les doigts d'Anouk devenir entièrement fluide. Peut-être la béatitude commence-t-elle ici, lorsque la main d'une femme vous soustrait à la pesanteur. Sabbat se mit à aboyer. J'approchai ma queue contre la joue d'Anouk et lui barbouillai le visage de foutre, en criant de joie à mon tour. Elle éclata de rire, moi aussi.» Ce passage si laidement banal décrivant une éjaculation masculine est bien sûr précédé d'une mise en bouche dont voici la substance : «Sa main était chaude, presque fondante et ses longs doigts aux ongles vernis pressaient ma queue avec une vigueur humide. «Pas de pénétration», dit-elle. De petites lumières clignotaient dans la chambre et nous nous embrassions avec une telle ardeur qu'un peu de salive s'écoulait sur nos corps et mouillait les seins d'Anouk que je pétrissais comme un enragé. Je lui suçai la chatte, longtemps : c'était joie de fouiller ses lèvres, de lécher toute cette pulpe juteuse et d'ouvrir avec le bout de ma langue les adorables plis de sa vulve. J'avais la bouche en feu, pleine de bave, je ne me contrôlais plus. Elle s'accrochait à mes cheveux en gémissant, et en appuyant sur ma tête pour que ma langue aille plus loin dans sa chatte, elle se mit à tressaillir, ses épaules se secouèrent, et elle poussa un cri : sa joie déchira la nuit» (1). Pourquoi diable Yannick Haenel éprouve-t-il le besoin de décrire un double coït si c'est pour nous affliger tous les clichés non pas jaunis ni même momifiés mais pulvérulents d'avoir tant et tant servi ? On me dira qu'il faut un talent particulier pour décrire, sans arracher un bâillement d'ennui au lecteur, ce genre de scène, et je répondrais bien volontiers par l'affirmative car, face à l'Himalaya de clichés et de catachrèses que convoque la moindre description d'ébats sexuels, il faut savoir disposer d'une plume allègre, sinon inventive voire salace, ce que ne saurait être le moignon dont se sert Yannick Haenel, pathétique peine-à-jouir qui ne parvient ni à émoustiller, ni à frapper ni même à creuser le sexe d'une profondeur que Fabrice Hadjadj, autre spécialiste de l'éjaculation contrariée c'est-à-dire catholique, semble chercher de livre en livre de plus en plus bavard. Hélas pour le lecteur, ce passage grotesque n'est point unique : vers la fin du roman, Yannick Haenel, pardon, son narrateur, nous déclare qu'il a envie, lorsqu'il est dans la bouche de Léna, «de sa vulve et de son cul» car il lui aurait fallu «plusieurs queues pour assouvir l'immensité du désir» (p. 231) qu'il a pour cette femme, sans doute parce que, à la page suivante, elle a eu la bonne idée de lui enfoncer «son index dans le cul en [le] regardant droit dans les yeux».
Finalement, Yannick Haenel, lui aussi, cherche à jouir, à se délivrer, chacun de ses ouvrages n'étant qu'un prélude à la délivrance puisque, ne cesse-t-il de nous répéter, il croit en «une conception de la parole comme vérité» (p. 11) qui est comme «un certain destin de l'être» (p. 15) puisque, apprenons-nous encore, il s'agit de faire «coïncider son [celle de Melville] expérience de la parole avec une expérience de l'être» (p. 16), expérience qui fascine aussi bien Heidegger que Yannick Haenel qui, à défaut de lire (et encore moins comprendre) ce dernier, pourra toujours demander des conseils à l'augure (dont la langue est impénétrable, comme celle de tous les augures) Gérard Guest, l'un et l'autre de ces écrivants sollersiens, mais surtout Yannick Haenel qui n'a guère d'autre moyen de vendre sa réclame, répétant comme des mantras quelques formules qui épateront toujours l'imbécile qui y percevra du génie. Yannick Haenel, pour répéter, répète, il n'y a qu'à voir le nombre de fois où il cite une phrase de Moby Dick où Melville évoque «l'intérieur mystiquement alvéolé de sa tête» (pp. 12 et sq.), il n'y a qu'à voir aussi le nombre de fois où il nous bassine avec l'unique image ou presque qu'il a réussi à capturer dans son épuisette, celle du daim blanc qu'est censée être, du moins je le suppose, la vérité impossible à atteindre et encore moins à capturer.
Ces quelques bouts de phrase qui, fort commodément, mais sans cependant que l'on puisse m'accuser de faire preuve de mauvaise foi, résument tout l'art de Yannick Haenel : un discours pseudo-mystique à paillettes heideggeriennes, de grandes phrases creuses, le plus souvent mises en italiques lorsque l'auteur veut faire comprendre quelque chose d'important, y compris à Assouline, Pivot, Aïssaoui et aux bigleux du jury du Médicis; l'impuissance de tous ces eunuques du Verbe qui, comme Casas Ros (tiens, comme il est drôle que Yannick Haenel évoque le cerf obsédant Casas Ros !) ou Romaric Sangars, prétendent mettre le feu aux poudres, lever les masses, transformer les moutons en loups et les assis en verticaux, mais ne parviennent même pas à redresser une seule de leurs propres phrases, n'est jamais plus visible que lorsqu'ils inventent une vague histoire pas vraiment romanesque mais qui déborde de références et de clins d’œil, de cavernes d'Ali Baba en papier mâché où les imbéciles puisent à pleines mains des bibelots en plastique («j'avais découvert qu'une étincelle s'allume au cœur de la destruction comme un cristal arctique; et que cette étincelle suffit pour mettre le feu au monde. Ce feu est blanc, croyez-moi. Il est le contraire du ravage. Nous y brûlons sans être consumés. Et ne riez pas, c'est exactement ce que je vois : un incendie immaculé», p. 48; pardon Yannick : j'ai ri).
Yannick Haenel, outre le talent que j'ai mentionné plus haut, son extraordinaire capacité, dans l'imposture, à se montrer constant, c'est-à-dire formidablement médiocre, médiocre en tout livre, et même, médiocre en toute ligne ou presque (zut, me voici à mon tour contaminé par un italiquisme aigu), parvient à faire croire, du moins à celles et ceux qui ne savent pas lire ou à celles et ceux qui, n'ayant lu aucun de ses livres, font tout de même confiance aux aveugles pardon, aux mal-voyants du prix Médicis, qu'il est un initié dont le charabia grandiloquent masque généralement assez piètrement la pauvreté de l'enseignement, la richesse des trouvailles. Pour une assez belle et juste évocation d'Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, ce roman qui les contient tous (3), combien de phrases creuses et indigentes, combien de d'étoiles qui «ne meurent pas, [mais] déchirent la gorge des humains qui admirent le soleil. Il faudrait enfoncer un couteau dans la matière des journées, trancher le gras, y découper ce qui seul vous éblouit : a-t-on besoin d'autre chose que de vertige ?» (p. 57), combien de métaphores ineptes du genre de celle-ci : «Certains soirs, le velours glisse entre les voix comme si les étoiles s'allumaient dans nos gorges» (p. 66), d'autant plus ineptes que le personnage principal du roman de Yannick Haenel paraît être un clone d'un des romans de Michel Houellebecq. Au moins, ce dernier, conscient de ses possibilités somme toutes assez limitées, donne, à ses personnages de médiocres, des vies de médiocres, et ne s'avise point subitement, comme Yannick Haenel le fait, de soupçonner la présence de l'aleph borgésien au moindre recoin de ruelle ! S'il faut employer le vocabulaire de faux mage qu'est Yannick Haenel, le personnage se tenant dans la dévastation ne pourra qu'être dévasté, et il ne lui sera point utile, du moins j'ai la faiblesse de le penser, de supposer que la fin, «l'idée de fin», le filigrane «d'une interminable fin qui détrame le monde» ne relève pas «aussi, mystiquement, de la rosée» (p. 72), sachant, bien sûr, que, pour Yannick Haenel, il ne faut pas se contenter de dire qu'un homme a soif, mais que «la soif ouvre un chemin d'étincelles qui glissent dans [s]es veines» (p. 78), et pas davantage je ne suis prêt à parier que l'un des médiocres narrateurs de Houellebecq discourrait, par pur plaisir priapistique, de notre monde «qui ne cesse de mettre fin à ses jours, un monde qui en camouflant son vide sous l'esprit du spectacle et de la marchandise qui a déjà avalé chacun de nous n'en finit pas de s'enliser dans l'inessentiel» (p. 76).
Si j'étais aussi méchant qu'on le dit, je me contenterais d'ailleurs comme le faisait Karl Kraus, ce démolisseur impénitent d'impostures, de ne rien faire d'autre que de citer Yannick Haenel, d'aligner méticuleusement, l'un après l'autre, l'un derrière l'autre, ses effarants poncifs, ses catachrèses indigentes, ses figures de non-style que les imbéciles ont non seulement récompensés mais encouragés, en offrant à Tiens ferme ta couronne une tribune médiatique conséquente. Si j'étais un critique bardé de haine, je ne ferais rien d'autre que de citer le texte de Yannick Haenel. Je colligerais, oui, si j'étais un critique rempli d'une seule goutte du fiel d'un Sainte-Beuve, les phrases de Yannick Haenel, sans autre commentaire de ma part, ce qui me permettrait ainsi d'enchaîner les platitudes se voulant énigmes insondables, les lieux communs habillés d'une panoplie de mage de cour d'école, les métaphores creuses, les aperçus se croyant inouïs et n'étant que plats, et même creux, telle «voix de l'agneau [qui] est à la fois un incendie et une brise» (p. 82), tel autre «cœur de tigre qui halète sous la peau de l'océan» (p. 101), telle «mise à mort [qui] ne s'arrête jamais parce que la concupiscence des hommes mène les femmes à la pierre du sacrifice» (p. 111) rendez-vous compte, cette pensée grandiose étant lâchée à propos d'une scène d'Apocalypse Now, un film que Yannick Haenel paraphrase durant plusieurs pages et mêmes chapitres, telle scène consternante auréolée d'une lumière de drame métaphysique de préau lorsque Haenel s'en empare et la campe, dont on ne sait trop s'il faut rire ou pleurer (rire et pleurer nous répondrait l'intéressé), scène que je cite in extenso : «Car chaque fois que m'apparaît l'hélicoptère des Bunnies entravé dans le déluge de la jungle, ma pensée s'envole : je pense à Moby Dick, je pense à l'Arche de Noé. Et tandis que j'écris ces phrases, des colombes volettent dans la forêt autour de moi. Au milieu d'une guerre, l'arche attend d'être remise à flot; et par les fenêtres, on voit des femmes nues. Est-ce là qu'ont lieu les métamorphoses ? Je crois que quelque chose de plus obscur encore s'y déroule, depuis toujours, qui relève du trafic entre les hommes et les dieux, c'est-à-dire de la folie des récits» (p. 112), telle impayable «immensité sous-marine parcourue de squelettes où germaient de longues tiges minérales rouges, semblables à des algues dures qui à travers l'obscurité me faisaient signe : elles me disaient qu'il est bon de ne pas se détourner des abîmes car c'est là que les corps se changent en perles; c'est là que la mort se transforme en une vie rouge et dure; c'est là que le temps se cristallise» (p. 122), tel autre bizarre cours de plongée avec masque et palmes sollersiens mais sans la bouée que ne manque jamais de faire gonfler cette baudruche intarissable, grâce auxquels, à condition de descendre «assez profond pour manger le corail du Père, plus aucune limite ne le retiendrait : il arrive qu'on parle avec le feu, mais plus rares sont les instants où le feu lui-même vous irradie, où la lumière vous soulève, où votre vie ruisselle. Car en avalant les os, vous devenez la perle» (p. 124, l'auteur souligne), mais ce serait compter sans l'insistance de dizaines d'autres passages tout aussi mauvais, tout aussi involontairement comiques, comme cette interrogation bouleversante : «Que se passerait-il si l'on sentait vraiment que la terre tourne ?» (p. 133), ou si l'on prenait conscience que «la délivrance n'a pas d'objet : ce qu'elle promet, c'est elle-même» (p. 136), et tant d'autres inepties que je finirais alors bien par perdre patience à consigner méthodiquement, pour l'édification future des lecteurs s'il en reste, lesquels se diront, en branlant significativement du chef, tristesse ou conscience de la folie de pareille tâche : Juan Asensio a été assez fou pou vouloir démontrer, de livre en livre de Yannick Haenel, que ce dernier n'était qu'un imposteur se disant écrivant.
Je pourrais continuer cette navrante et monotone liste de perles, c'est le cas de le dire, reliées entre elles par l'image, elle-même digne d'un monomaniaque amateur des œuvres complètes d'Antoni Casas Ros, du «daim blanc de la vérité», qui lui-même se détache sur le fond obsessionnel, maladif, invariable comme la morve dégoulinant du nez d'un idiot de naissance, des éclats et reflets de lumière (cf. p. 136) se reflétant à l'infini, dans le moindre verre porté à ses lèvres par le narrateur, nouvelle illustration haenélienne de l'évidence selon laquelle tout renvoie à tout dans l'esprit de cette Pénélope devenue folle, attendant, inquiète, le retour d'Ulysse Sollers, tout doit être relié à tout, Apocalypse Now à Melville, l'extermination des Juifs d'Europe à, non seulement et bien sûr, celle des Indiens d'Amérique, mais aux techniques de sélection expérimentées par les Américains à Ellis Island, qualifié de «parc à bestiaux» (p. 172), «la vie qui mène à l'espace absolu» (p. 155) à cette «amure [qui] s'écrit dans l'esprit» (p. 153) vers laquelle le narrateur tend sa main, l’œil du cerf mort qui ne cesse de regarder le très casasrossien Pointel aux noms qui «agissent comme des clefs : alors les murs tombent, le labyrinthe devient une contrée qui éclaire» (p. 168); je pourrais donc, à l'instar de Yannick Haenel, tout relier ou plutôt : tout confondre, tout mélanger, les «vieux bâtiments de brique rouge» d'Ellis Island dont «cet impeccable abandon, ce calme parfait dans la désaffection ressemblaient à ceux des camps nazis» (p. 182), je pourrais encore confondre le Pequod et quelque nouvelle Arche transportant tous les migrants du monde (cf. p. 183), dans un délire derrière lequel je masquerais à grand-peine l'inanité de mon talent littéraire probablement dû à la bizarre conformation, mystiquement alvéolée, de ma tête, inanité qui, mais très rarement, miraculeusement, me permet d'écrire tout de même un beau passage (4) ou de m'essayer à l'humour, je pourrais faire tout cela, avoir autant de temps à perdre et si peu de talent pour le combler que Yannick Haenel, que je n'en finirais pas de tourner autour de cette évidence : Yannick Haenel est un imposteur, ce que je répète, tranquillement, depuis des années, depuis que j'ai lu, sur les conseils d'une amie qui, fort heureusement, à elle-même fini par comprendre qu'elle avait été abusée, qu'elle s'était elle-même abusée par les mantras monodiques de ce serviteur du Néant, depuis que j'ai lu les toutes premières lignes des livres pléthoriques, amphigouriques, creux, exaltés, chimériques, ridicules, grandiloquents, sots, écrites par ce lamentable écrivain.
Tiens ferme ta couronne, comme les autres romans de Yannick Haenel et surtout Les Renards pâles qu'il mentionne explicitement (cf. p. 254), preuve s'il en est que notre auteur sait parfaitement maîtriser de vertigineuses mises en abîme, ne parvient pas à conclure ou plutôt : comme les autres textes à prétentions romanesques d'Haenel, il ne sait pas conclure. Il est au demeurant férocement drôle, d'une drôlerie bien sûr involontaire, point prévue par l'auteur, de voir de quelle manière notre si mauvais fabricant de boudin verbal juge l'un de ses romans les plus inaboutis (5), qui poussait la nullité flagrante de Yannick Haenel jusqu'à une espèce d'acmé inversée, une acmé négative.
Je sais bien que, dans la tête mystiquement alvéolée de Yannick Haenel, relayée par tel allumé du ciboulot (cette image est équivalente à la précédente, bien que moins noble), Matthieu Baumier pour ne pas le nommer qui, dans L'Incorrect, n'a pas manqué de saluer le talent de ce mage de pacotille, je sais bien que, dans cette tête-là, dans ces têtes qui ont oublié de lire ou ont lu de travers La poésie moderne et le sacré de Jules Monnerot, tout correspond avec tout, l'imposture avec la vérité, «le chuchotement entre une femme et un cerf» (p. 231), un bon livre avec un mauvais, un médiocre germanopratin avec un guerrier de l'invisible, mais enfin, quoi qu'il fasse, la pseudo-quête, gnostique comme toutes les quêtes ridicules et creuses des scribouillards de la collection L'Infini, ne débouche sur rien, et c'est à l'aune de pénibles efforts (6) que nous pouvons juger la maigreur de la révélation : «Elle [Léna] s'est tournée vers moi, nous nous sommes regardés longuement : c'était comme si elle voyait mon érection. J'allais être changé en cerf [décidément !], sans doute l'étais-je déjà [j'aurais personnellement parié pour un animal moins noble, pourquoi pas l'âne ?], et des bois poussaient autour de ma tête, comme une forêt de phallus au bord de gicler, qui bientôt seraient tranchés par ses chiens [ceux de Léna, confondue avec Artémis]» (p. 200). Tel lecteur attentif de Yannick Haenel, sans doute un des membres du jury du prix Médicis, ne manquera pas de m'objecter que la révélation à laquelle aboutit l'auteur de Tiens ferme ta couronne est bien au contraire d'un empan autrement plus grand que celui de quelques images boursouflées et idiotes. Ah oui, je crois la tenir, cette révélation, la voici : «Vous avez la révélation que les dieux sont morts, mais que le rite continue. Vous sentez qu'un filigrane s'écrit en silence derrière l'histoire des hommes» (p. 235), et qu'aucun mauvais coucheur ne vienne se plaindre à moi qu'il a tenté, mais sans le moindre succès, d'imaginer ce que pouvait bien signifier un filigrane qui s'écrit en silence !
Nous approchons, tremblants et respectueux, du dénouement de Tiens ferme ta couronne de Yannick Haenel et, comme nous savons qu'il n'est qu'un hiérophante de carnaval, un prestidigitateur de foire, nous subodorons que son final ne sera pas grandiose mais ridicule. Il est en fait pathétique, et sombre dans un syncrétisme pagano-chrétien dont la bêtise pourra, je crois, être assez difficilement surpassée, si ce n'est par le maître es-farces et attrapes lui-même, Yannick Haenel redivivus, en route pour le prix Nobel de littérature. Il s'agit en premier lieu de rassembler quelque part la ménagerie du roman, cerf, daim, dalmatien égaré par notre narrateur perpétuellement aviné. Bien sûr, il faut garder à l'esprit qu'un zoo n'est absolument pas suffisant pour Yannick Haenel, ni même un musée révélé comme il se doit la nuit, plein de présences silencieuses et inquiétantes. Il faut à notre génie de l'imposture beaucoup plus noble, grand, profond, archétypal, en un mot, rituel : il faut à Yannick Haenel la grotte de Lascaux dont il aurait aimé pouvoir lécher, «il y a quinze mille ans», les parois «où ces biches, ces gazelles, ces bouquetins s'élancent au-dessus d'un trou», ce qui lui aurait permis de devenir «absolument limpide, clair comme on l'est quand on fait l'amour, et cette clarté serait venue à travers le temps jusqu'ici» (p. 261), à savoir près du lac italien, lui aussi sacré comme il se doit aussi puisqu'il est encore tout auréolé de la présence d'un temple votif à la déesse Diane, où le narrateur/Haenel écrit le roman que nous lisons.
N'allons point trop vite en besogne car, avant d'assister, médusés, à la révélation, ou plutôt, à la double révélation que le roman de Yannick Haenel nous propose, nous devons patiemment, très-patiemment souffrir quelques longueurs, où ce bavard clownesque étale son absolu manque de talent. Cela donne tel passage : «Voilà, des trous passent dans l'existence; on cherche à les éviter, mais ce n'est pas une bonne idée parce que les trous ne font jamais que signaler l'immense trou qui permet au monde de respirer; on s'imagine séparé de toutes choses par un espace creux à la limite duquel on ne se presse même pas d'arriver, et voici qu'un jour l'espace creux s'ouvre à nos pieds, voici que le trou s'élargit aux dimensions du monde : on est dedans» (p. 264). Oui, dans le trou, nous y sommes, mais quel dommage tout de même que nous ne disposions, pour unique divertissement, que du dernier roman de Yannick Haenel.
Ce doit être la douzième occurrence de cette expression, car nous retrouvons alors «l'intérieur mystiquement alvéolé de la tête de Léna» (p. 268), l'un des deux personnages, avec sa sœur morte, acteurs d'une scène grotesque, qui déploie en couleurs bavantes la finesse d'une unique fulguration, qui rachète sans doute Tiens ferme ta couronne de la nullité abyssale dans laquelle, à pieds joints, les spéléologues perclus du prix Médicis ont sauté : «Le monde visible est un trait imperceptible dans l'infini que la souffrance révèle» (p. 281), belle pensée bloyenne, mais je l'ai dit gâchée par l'embabouinage immédiat auquel Yannick Haenel ne saurait résister sous prétexte de délivrance (ce mot, tant de fois employé, cf. pp. 120, 220, 292, etc.) et même, car c'est décidément l'eczéma de nombre de nos romanciers les plus inquiets comme Michel Houellebecq, de résurrection : j'ai écrit que l'auteur de Soumission était un frôleur du christianisme et de la grâce. Je l'écris de Yannick Haenel qui, à la différence de Houellebecq, chance ou malchance je ne sais, dispose d'un nombre d'appendices supérieurs et peut ainsi, tout en tripotant le Christ, tripoter quelques biches, daims, femmes et même déesses comme Diane, pourtant réputée vierge.
Je ne dirai rien de la scène où Léna (celle qui a enfoncé son index dans le cul du narrateur, on s'en souvient) porte le cadavre de sa sœur pour le disposer dans son cercueil ouvert installé devant le retable d'Issenheim se trouvant à Colmar, et où elle ordonne au Christ qui y pend si lamentablement de faire revivre sa sœur, réputée sainte et, pour ce que nous en savons, vierge, le comique de cette scène (il eût fallu un Bloy ou un Bernanos, celui, tiens, qui fait ordonner à Dieu, par le biais de Donissan, de faire revivre un petit mort, pour ne pas ridiculiser une telle scène) étant encore surpassé par les toutes dernières pages du roman de Yannick Haenel, qui bavarde, en s'appuyant sur Le Rameau d'or de Frazer, sur «la violence qui est au cœur du sacré» (p. 322), et finit, assez piteusement tout de même, par raccrocher ses wagons (Michael Cimino, le livre dans le livre, The Great Melville donné en offrande à Diane, le chien toujours pas retrouvé et son maître peu avenant en pétard contre le narrateur auquel il l'avait confié, la sœur de Léna qui ne sera pas le nouveau Lazare, etc.) à sa locomotive devenue folle, tortillard peinturluré qui ne prendra jamais à bord que celles et ceux qui croient au Père Noël, à la virginité de Diane, à la sainteté de la sœur percluse de Léna, à l'équivalence entre la délivrance et la résurrection, la grâce et les «fameux cantuccini di Prato di Mattonella» (p. 327), aux «échelles de la Kabbale» (p. 91), à quelque intérieur de tête mystiquement alvéolé, daim apeuré de la vérité ou cerf encastré dans le pare-brise d'une voiture, à cette «voix du sacrifice qui traverse les époques et dévoile la trame sous les apparences» (p. 50), à «cet instant où la clarté déchire le voile» (p. 283), à cet autre où «les phrases qu'on répète sont comme des prières lancées contre un mur» (p. 229), à cet autre encore, pour faire bonne figure et parce qu'il est impossible qu'un roman de Yannick Haenel puisse se terminer, à cet autre où «écrire un livre» consiste en fait «à trouver le récit capable de dire les noms et de tramer les détails» (p. 179), à celui où des «constellations qui pour nous sont éteintes brillent dans le dernier bond d'un animal» (p. 152), au fait que nous croyons toujours, par erreur, mais heureusement Yannick Haenel nous prouve le contraire, que «les pères sont morts, mais chaque fois des perles, des coraux, et tous les autres trésors possibles naissent à leur place et attendent que nous les trouvions» (p. 122), et même au talent de Yannick Haenel auquel, nous, nous n'avons jamais cru même si, l'espace durant lequel telle ou telle phrase est passée sous notre regard, nous avons coupablement pensé que Tiens ferme ta couronne était peut-être moins mauvais qu'il ne l'est réellement et de toute évidence.
Notes
(1) Pierre Senges, Achab (séquelles) (Éditions Verticales (autrement dit : Gallimard), 2015), p. 313. Le rapprochement le plus notable, entre les deux livres, tient à la fascination pour les adaptations cinématographiques, réelles ou imaginaires, de l'aventure d'Achab. Mais, tandis que Yannick Haenel ne fait que broder quelques éléments sur Michael Cimino qui traînent sur la Toile, rattachant ses derniers à la trame pour le moins vague de son navet aquatique (ou qui prend l'eau, en l'occurrence), le livre de Pierre Senges nous semble beaucoup plus conséquent, maîtrisé : il s'en tient à son sujet, qui est pour le moins vaste, mais ne part pas dans tous les sens. Cette évidence, il faut la répéter sans cesse : le sujet compte peu, quand le talent de celui qui le met en scène, lui, est évidemment absolument essentiel. Nous pouvons en déduire que Yannick Haenel n'a aucun talent, sinon celui de faire croire qu'il en a. Autre point commun entre les deux ouvrages : les noms considérés comme des filets enserrant le monde, noms jamais aussi puissants que lorsque l'un et l'autre, Senges et Haenel, prennent conscience du fait qu'ils ne cessent «de former des rapports» comme l'écrit ce dernier en soulignant cette incroyable illumination (p. 18). Haenel encore, décidément inspiré : «Chaque nom en allumait un autre, ça ne finissait jamais : je passais mes journées à me réciter des listes, des bouts de phrases, des citations, et tout se mettait en rapport et s'ouvrait démesurément, comme une terre sans limites, avec des flammes de bonheur qui s'arrachent au monde éteint» (p. 27), Haenel n'ayant de cesse de nous répéter que sa tête est envahie par «un flot de noms, d'anecdotes, de citations» (p. 135). Dans le livre de Pierre Senges, nous assistons à la duplication-gigogne, que l'on parierait infinie bien qu'il faille tenter de la dire dans un livre fini mais certes interminable, des récits et des motifs : «la baleine, c'est maintenant le récit de l'homme qui a entendu l'homme qui a entendu l'homme qui a touché la bête» (p. 199), Achab, devant chacun des réalisateurs à qui il confiera son histoire, éprouvant le vertige, puis l'ennui de devoir «assister à la métamorphose de son histoire en autre chose, une fresque flamboyante orchestrée, totalement étrangères à ses baleines» (p. 372). Trait d'humour assez réussi et illustration originale de cette prolifération spéculaire des récits, la Table des matières de l'ouvrage, qui peut être lu comme un petit livre à part entier. Pierre Senges écrit assez bellement, toujours à propos des mots ou plutôt, ici, de la façon de les agencer : «si on lui demandait à quoi doit ressembler un récit, Billy Wilder répondait à un hamac», lequel «est tissé rigoureusement, fixé au commencement et à la fin, sans décrocher de ses deux points d'attache, tendu mais assez souple d'ici à là pour contenir et bercer, se balancer, agrémenter les siestes ou comliquer, juste ce qu'il faut, des projets érotiques qui manquaient de sel; le hamac obéit à quelques règles simples (les mailles, la pesanteur, pour faire vite), mais sa souplesse importe autant que la tension» (p. 403). Si j'étais pinailleur à l'excès, ce qu'à Dieu ne plaise, je relèverais enfin le motif commun de la délivrance ou de la rédemption, ainsi que la curieuse intrusion d'un certain Coleman dans les deux romans (cf. p. 369 dans le texte de Pierre Senges et p. 174 dans celui de Yannick Haenel), mais il est vrai que ce patronyme anodin apparaît dans Moby Dick.
(2) Yannick Haenel, Tiens ferme ta couronne (Gallimard, coll. L'Infini, 2017), pp. 69 et 68.
(3) «Je me souviens que, dans Au-dessous du volcan de Malcom Lowry, un troupeau de chevaux sauvages [...] ne cesse de galoper au gré d'une lumière aux nuances violettes qui éblouit les cimes de la Sierra Madre; les déplacements de ce troupeau à travers le livre y inventent une prairie toujours plus lointaine, creusée par un désir sans fin : et c'est peut-être à cette vision furtive et pleine de joie, plutôt qu'à son mescal, que le Consul, prisonnier de lui-même, ne cesse de s'abreuver» (p. 51). Où nous voyons, aussi, que Yannick Haenel me lit, qui comme par hasard évoque l'image de ces chevaux, objet de l'illustration que j'avais choisie pour ma propre note sur ce roman immense !
(4) Car il y a tout de même, dans ces 331 pages, un ou deux morceaux ayant échappé, on se demande bien par quel hasard, au naufrage intégral du livre, comme celui-ci : «il [Melville] avait mené l'existence d'un célibataire spirituel, un de ces hommes privés de leur dieu, comme nous le sommes tous plus ou moins devenus aujourd'hui à travers notre solitude, nous qui n'apercevons plus que de loin, de très loin, comme dans un rêve ancien, comme dans un mirage inventé par la frustration et la nostalgie, l'écume d'un énorme mammifère qui, dit-on, glisserait parmi les vagues de l'océan avec la grâce effrayante, la solennité mauve et dorée d'une basilique vivante, et que des récits entendus depuis notre enfance nous invitent à considérer comme un trésor qui contiendrait l'univers aussi bien que l'abîme, comme le nom immaculé d'un dieu qui s'absente, comme le témoin étincelant de l'exil de la Chekhina, en quoi le peuple d'Israël voit la présence divine» (pp. 167-8). Autre beau passage, tout de même, que celui où Yannick Haenel imagine que les anges immobiles des cathédrales parisiennes se parlent durant la nuit, et que leur récit, «chaque nuit tricoté sur les toits, compose une étoffe aussi solide qu'insaisissable et qui soutient le temps» (p. 134).
(5) «[...] c'était l'époque où je participais à l'insurrection des Renards pâles : nous étions masqués, nous n'avions plus d'identité car l'identité n'était qu'un piège, un consentement au contrôle; seule l'absence d'identité était révolutionnaire et à nos yeux l'avenir ne pouvait s'ouvrir qu'ainsi, à travers l'immensité d'un lâcher-prise où chacun, en se libérant de ses attaches, ferait revenir le temps; ç'avait été la dernière chance, la dernière joie collective avant l'aplatissement général. Aujourd'hui, Paris était en état de sommeil, comme la France entière, comme l'Europe; et tout était soumis à des intérêts qui nécessitaient que nous dormions, que nous n'arrêtions plus de consommer notre anesthésie, et que la politique et l'avenir aient lieu sans nous» (p. 254, l'auteur souligne). De tous les Yannick Haenel, le plus involontairement drôle est sans doute le penseur politique, que nous pourrions définir, à l'instar d'un Casas Ros, rival en cacographie de ce dernier, comme l'idiot utile du mondialisme migratoire. Ailleurs, là aussi sans rire, il évoque les Français dont les visages portent «des marques indélébiles, plus sombres que la fatigue, de ces marques qu'on voit sous les yeux des hommes dans les pays où la liberté n'existe plus» (p. 260). Il faut dire que la France vient de connaître, dans le roman de Yannick Haenel, un attentat meurtrier et que les policiers sont pour le moins fébriles. Nous ne serions pas exhaustifs sans évoquer la petite saynète ridicule où le narrateur, en compagnie d'Anouk, permet à deux réfugiés syriens d'échapper à la police, occasion de lacrymales déclamations sur la richesse de l'ouverture à l'autre.
(6) Voici de quelle façon, sans rire, Yannick Haenel nous présente son personnage, que nous aurons la liberté de confondre avec l'écrivain lui-même : «Je suis enchaîné depuis plusieurs années à vivre dans plusieurs dimensions à la fois; et si la vie de l'obsessionnel éméché peut faire de moi un personnage de roman éventuellement comique, s'y superpose une autre vie, tout aussi solitaire, mais plus mystique, où la recherche qui m'anime a décidé de figures moins pittoresques : la nuit, quand j'atteins le calme, une méditation s'enclenche» (p. 222). Yannick Haenel, ou son narrateur comme il vous plaira, est au moins lucide sur un point : c'est une épave voguant, à vue, sur un océan d'alcool.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, philippe sollers, pierre senges, yannick haenel, éditions gallimard, prix médicis, hermann melville, michel houellebecq, antoni casas ros, tiens ferme ta couronne |  |
|  Imprimer
Imprimer
