« Dans un cimetière, en Haute-Normandie | Page d'accueil | Post tenebras lux »
02/11/2016
2666 de Roberto Bolaño adapté au théâtre par Julien Gosselin, par Gregory Mion

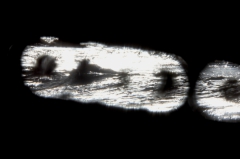 2666 dans la Zone.
2666 dans la Zone.Cette recension fait référence à la représentation du dimanche 9 octobre 2016 au théâtre de l’Odéon, à Paris, sur la scène des Ateliers Berthier.
Julien Gosselin à hauteur d’homme avec Roberto Bolaño
 Que Julien Gosselin se rassure d’emblée : toutes les critiques mitigées, exaspérées, rédigées ou prononcées avec le typique empressement du journalisme contemporain, toutes ces titubantes rédactions et ces paroles timorées ne valent rien. Ce sont des critiques tire-au-flanc qui révèlent non seulement la faiblesse de ceux qui les écrivent, mais elles nous montrent aussi leur confondante incapacité de se mettre à la hauteur du sujet, en l’occurrence, ici, l’œuvre romanesque magistrale de Roberto Bolaño, ce 2666 prodigieux qui constitue la última parada du romancier, venu au monde en 1953 au Chili, dans la ravine urbaine de Santiago, et mort à Barcelone en 2003, malade comme un chien qui n’avait cependant perdu aucune occasion d’aboyer sa vertu dans les couloirs pisseux de la littérature actuelle. Qu’on se le dise, pour ceux du moins qui l’ignoreraient encore, Bolaño n’avait pas en odeur de sainteté les gringalets de tout poil. Ainsi les splendides mensurations narratives de son 2666 permettent de faire un tri entre ceux qui pratiquent la littérature à l’instar d’une entrée en guerre contre un ennemi redoutable, prêts à mourir de mort violente, et ceux qui poussent des cris d’orfraie à la moindre commotion verbale, nourris à la puante tétine des cacographes et autres sommités de l’usurpation littéraire. C’est pourquoi le seul fait de se confronter à Bolaño lorsqu’on est un jeune metteur en scène qui n’a pas tout à fait trente ans suffit à nous donner une idée fidèle de la carrure du jeune homme. Qu’il se trouve dans notre pays malade, dont le corps artistique est recouvert d’escarres et de varices, un Julien Gosselin qui parvient à se tenir droit malgré la réception parfois inconséquente de sa dernière mise en scène, c’est une nouvelle franchement réjouissante. À vrai dire, Julien Gosselin peut laisser parler son travail pour lui, et ce ne sont pas les quelques ridicules nabots du Masque et la plume ou de tel hebdomadaire torche-cul qui feront trembler l’édifice de cette adaptation théâtrale de 2666. Ce ne sont que des caquetages de volailles efféminées, des poulets qui font hi-han, se prenant les ergots dans l’engrenage d’une machine qui les avale et qui en fait des vol-au-vent.
Que Julien Gosselin se rassure d’emblée : toutes les critiques mitigées, exaspérées, rédigées ou prononcées avec le typique empressement du journalisme contemporain, toutes ces titubantes rédactions et ces paroles timorées ne valent rien. Ce sont des critiques tire-au-flanc qui révèlent non seulement la faiblesse de ceux qui les écrivent, mais elles nous montrent aussi leur confondante incapacité de se mettre à la hauteur du sujet, en l’occurrence, ici, l’œuvre romanesque magistrale de Roberto Bolaño, ce 2666 prodigieux qui constitue la última parada du romancier, venu au monde en 1953 au Chili, dans la ravine urbaine de Santiago, et mort à Barcelone en 2003, malade comme un chien qui n’avait cependant perdu aucune occasion d’aboyer sa vertu dans les couloirs pisseux de la littérature actuelle. Qu’on se le dise, pour ceux du moins qui l’ignoreraient encore, Bolaño n’avait pas en odeur de sainteté les gringalets de tout poil. Ainsi les splendides mensurations narratives de son 2666 permettent de faire un tri entre ceux qui pratiquent la littérature à l’instar d’une entrée en guerre contre un ennemi redoutable, prêts à mourir de mort violente, et ceux qui poussent des cris d’orfraie à la moindre commotion verbale, nourris à la puante tétine des cacographes et autres sommités de l’usurpation littéraire. C’est pourquoi le seul fait de se confronter à Bolaño lorsqu’on est un jeune metteur en scène qui n’a pas tout à fait trente ans suffit à nous donner une idée fidèle de la carrure du jeune homme. Qu’il se trouve dans notre pays malade, dont le corps artistique est recouvert d’escarres et de varices, un Julien Gosselin qui parvient à se tenir droit malgré la réception parfois inconséquente de sa dernière mise en scène, c’est une nouvelle franchement réjouissante. À vrai dire, Julien Gosselin peut laisser parler son travail pour lui, et ce ne sont pas les quelques ridicules nabots du Masque et la plume ou de tel hebdomadaire torche-cul qui feront trembler l’édifice de cette adaptation théâtrale de 2666. Ce ne sont que des caquetages de volailles efféminées, des poulets qui font hi-han, se prenant les ergots dans l’engrenage d’une machine qui les avale et qui en fait des vol-au-vent.Nous savions depuis des mois que Julien Gosselin avait pour ambition de s’attaquer à 2666, aussi nous en avons profité pour relire l’œuvre intégrale, et nous avons eu l’opportunité, également, d’assister à la mise en scène américaine de Robert Falls et Seth Bockley au théâtre Goodman de Chicago en février de cette année. Cette conjonction d’événements majeurs autour de Bolaño ne pouvait qu’enchanter les horribles travailleurs à décupler leurs forces, et dans la mesure où nous n’avons pas l’honneur de participer au monde merveilleux du journalisme français, qui roucoule et s’enivre dans l’opium de ses accréditations, nous avons pris sur nos deniers pour assister à ces deux spectacles. Du reste, il ne s’agira pas, dans notre recension, de camper une molle comparaison entre ces deux propositions théâtrales, mais il nous faudrait signaler dès à présent que Julien Gosselin l’emporte en exubérance et en audace, quoique le texte de son adaptation n’effectue pas beaucoup de sorties de route par rapport au support original, là où les Américains ont misé sur une sobriété paradoxale eu égard à leurs habitudes et ont souvent procédé à une réécriture de l’immense matériau textuel de base. Au final, nous avons deux pièces de théâtre qui peuvent se considérer indépendamment l’une de l’autre, sans doute parce que le roman de Bolaño suggère tant de pistes qu’il est nécessaire d’établir des sélections, et s’il fallait souligner certains points de convergence pour ces deux projets, ce serait évidemment la durée chaque fois colossale des adaptations, ainsi que le choix de suivre l’ordre du roman qui se décline en cinq segments plus ou moins interconnectés. Ces partis pris de réalisation théâtrale prouvent, si l’on peut dire, que les metteurs en scène français et américains ont pris l’œuvre de Bolaño au sérieux. Il eût été indiscutablement suspect de vouloir condenser un tel roman en deux ou trois heures ou à vouloir en simplifier l’organisation intrinsèque, et nous irions même jusqu’à regretter que l’une et l’autre des équipes n’aient pas poussé le «vice» dramatique en nous soumettant une version encore plus longue. Peut-être en outre que ces trois réalisateurs reviendront à Bolaño (même si les Américains ne l’envisagent pas pour le moment), et Julien Gosselin, lui, serait un choix tout indiqué pour effectuer une adaptation des Détectives sauvages, l’autre grand roman de Bolaño, que l’on apprécie d’ordinaire comme une sorte d’antichambre folle de 2666.
Quoi qu’il en soit, redisons-le distinctement, l’affrontement avec une créature telle que 2666 ne peut que souligner le courage de celui qui prend la corde et le piolet pour en vaincre le sommet, à quoi il faudrait ajouter la mention d’un courage d’interpréter, la vaillance de rivaliser avec ces quelques mille pages assorties d’un langage impétueux, l’acmé de ce massif montagneux n’étant pas bercé par une brise apaisante ou par un je-ne-sais-quoi de sédatif. C’est l’énormité en toutes choses qui caractérise 2666 et plus généralement l’œuvre de Bolaño, aussi est-on contraint de préférer une voie d’accès plutôt qu’une autre, à l’image d’un alpiniste qui observe sa proie rocheuse et qui prépare mentalement une façon de la vaincre. En cela, toute sélection devient interprétation, et quand bien même Julien Gosselin s’est adossé volontiers à la source primordiale du texte, s’appuyant sur la traduction française superbe de Robert Amutio, il n’en a donc pas moins interprété l’œuvre, comme on dit d’un historien qu’il interprète déjà un événement en optant pour tel ou tel de ses aspects. Partant de là, ce serait une erreur de reprocher à Julien Gosselin de ne pas avoir tellement emprunté de routes secondaires par rapport à la trame identifiée du roman, d’autant que, nous le verrons, l’usage de la musique et de la vidéo vient accentuer le degré d’interprétation de l’œuvre, au même titre que l’utilisation sporadique des langues anglaise, espagnole et allemande renforce la richesse de la mise en scène. En ne se limitant pas seulement aux ressources classiques du théâtre, Julien Gosselin se range au plus près de Bolaño, parce que la frénésie romanesque de l’écrivain de 2666 exige une collaboration de tous les arts, ou, à tout le moins, elle exige qu’un art se fasse violence et qu’il soit d’office en capacité d’excéder sa méthodologie. Ceci explique éventuellement le désarroi des réfractaires, qui n’ont du théâtre qu’une opinion consensuelle et un peu rétrograde, et dès lors que l’adaptation de Julien Gosselin ne cessait de prendre du volume et de l’énergie, pour culminer terriblement durant la quatrième et avant-dernière partie, l’on pouvait observer des spectateurs quitter la salle en petites grappes psychiquement sonnées, contrariés par la générosité de ce théâtre qui semblait accoucher de bras et de jambes supplémentaires d’heure en heure, ceci en dépit de son corps déjà monstrueux, comme s’il s’était présenté à nous, d’abord, sous le profil d’un Hécatonchire, et qu’il avait ensuite pris congé sous la forme d’un être tuméfié par ses nouveaux appendices, par tout son fatras de membres neufs qui lui ont poussé de partout et sans la moindre scissiparité reposante, avec bubons et furoncles de surcroît. C’est précisément cette espèce terrifiante de théâtre que Julien Gosselin a dressée pour nous offrir une vision adéquate de 2666.
 Par conséquent, plutôt que d’écouter les jérémiades et les pépiements de quelque nain du journalisme endimanché, profitons pleinement de ce marathon théâtral qui nous maintient sur le qui-vive esthétique pendant une demi-journée, puis saluons cette performance d’interprétation (tant dans le sens de la lecture de Bolaño que dans le sens du jeu inassouvi des acteurs) comme il se doit, avec extravagance et retentissement, Bolaño ne pouvant tolérer la timidité et la retenue. À bien des égards, Julien Gosselin a compris que l’interprétation de Bolaño devait s’investir d’une dimension purement grotesque, de sorte à mobiliser différemment notre attention, et, surtout, afin d’optimiser notre goût. Kant lui-même le formulait déjà en son temps, dans la Critique de la faculté de juger, lorsqu’il évoquait le plaisir consécutif au « libre jeu des facultés » dans certaines situations particulières ou au contact de certains objets singuliers. Notre plaisir est d’autant plus grand et inattendu qu’il repose sur une expérience inédite, affranchie de la contrainte des règles et de toute forme de rigidité, autant de limites qui ont tendance à ralentir le développement du goût, et, partant, à réduire le plaisir d’imaginer ou d’interpréter ce à quoi nous sommes confrontés. C’est la raison pour laquelle l’adaptation d’un roman comme 2666 ne peut emporter les suffrages de notre goût qu’à la condition d’avoir été correctement appréhendée en amont, c’est-à-dire que le livre, dans cette optique, a été lu et relu comme un objet fondamentalement différent, sidérant et même invraisemblable, saisi en tant que matière susceptible de bousculer d’une part notre entendement, grâce à la perturbation du mobilier logique qui structure notre représentation de la réalité, et susceptible d’autre part de tourmenter notre imagination, grâce à la déstabilisation des images sensibles dont elle se sert pour se représenter également la réalité. Si nous nous laissons malmener par une œuvre en acceptant l’évidence de ses dérèglements fondateurs, a fortiori par une œuvre telle que 2666, alors il ne peut en résulter qu’un plaisir tout aussi évident, une joie d’être engagé dans un dédale esthétique dont le centre ne peut être occupé que par un minotaure avide de mettre nos repères à l’épreuve. Autrement dit, toute œuvre, pourvu qu’elle soit irrégulière et difforme, entraîne chez celui qui l’expérimente de bon gré une possible amélioration de son goût et un vif désir de l’interpréter. Ainsi n’importe quelle option scénique de Julien Gosselin traduit le plaisir d’interpréter le texte de Bolaño, d’être en quelque sorte égal à sa démesure, en plein cœur du cataclysme romanesque. Au fond les choses ne sont pas compliquées : Julien Gosselin a aimé Roberto Bolaño et tout son spectacle en constitue l’illustration.
Par conséquent, plutôt que d’écouter les jérémiades et les pépiements de quelque nain du journalisme endimanché, profitons pleinement de ce marathon théâtral qui nous maintient sur le qui-vive esthétique pendant une demi-journée, puis saluons cette performance d’interprétation (tant dans le sens de la lecture de Bolaño que dans le sens du jeu inassouvi des acteurs) comme il se doit, avec extravagance et retentissement, Bolaño ne pouvant tolérer la timidité et la retenue. À bien des égards, Julien Gosselin a compris que l’interprétation de Bolaño devait s’investir d’une dimension purement grotesque, de sorte à mobiliser différemment notre attention, et, surtout, afin d’optimiser notre goût. Kant lui-même le formulait déjà en son temps, dans la Critique de la faculté de juger, lorsqu’il évoquait le plaisir consécutif au « libre jeu des facultés » dans certaines situations particulières ou au contact de certains objets singuliers. Notre plaisir est d’autant plus grand et inattendu qu’il repose sur une expérience inédite, affranchie de la contrainte des règles et de toute forme de rigidité, autant de limites qui ont tendance à ralentir le développement du goût, et, partant, à réduire le plaisir d’imaginer ou d’interpréter ce à quoi nous sommes confrontés. C’est la raison pour laquelle l’adaptation d’un roman comme 2666 ne peut emporter les suffrages de notre goût qu’à la condition d’avoir été correctement appréhendée en amont, c’est-à-dire que le livre, dans cette optique, a été lu et relu comme un objet fondamentalement différent, sidérant et même invraisemblable, saisi en tant que matière susceptible de bousculer d’une part notre entendement, grâce à la perturbation du mobilier logique qui structure notre représentation de la réalité, et susceptible d’autre part de tourmenter notre imagination, grâce à la déstabilisation des images sensibles dont elle se sert pour se représenter également la réalité. Si nous nous laissons malmener par une œuvre en acceptant l’évidence de ses dérèglements fondateurs, a fortiori par une œuvre telle que 2666, alors il ne peut en résulter qu’un plaisir tout aussi évident, une joie d’être engagé dans un dédale esthétique dont le centre ne peut être occupé que par un minotaure avide de mettre nos repères à l’épreuve. Autrement dit, toute œuvre, pourvu qu’elle soit irrégulière et difforme, entraîne chez celui qui l’expérimente de bon gré une possible amélioration de son goût et un vif désir de l’interpréter. Ainsi n’importe quelle option scénique de Julien Gosselin traduit le plaisir d’interpréter le texte de Bolaño, d’être en quelque sorte égal à sa démesure, en plein cœur du cataclysme romanesque. Au fond les choses ne sont pas compliquées : Julien Gosselin a aimé Roberto Bolaño et tout son spectacle en constitue l’illustration. Une histoire et un appareil de mise en scène
Étant donné que nous avions établi une synthèse du roman dans notre recension du spectacle de Chicago, le lecteur peut s’y reporter au cas où il ne connaîtrait pas les contenus de 2666. Cela nous évitera des redites, en même temps que cela nous permet d’entrer dans le vif du sujet. En outre et pour nous accommoder d’un point de repère pratique, on peut se contenter d’écrire que 2666 est un roman qui poursuit deux fantômes et que ces fantômes, progressivement, perdent leur silhouette spectrale et s’habillent de quelques haillons qui nous les font connaître avec une meilleure netteté.
Le premier de ces fantômes est un écrivain connu sous le nom de plume de Benno von Archimboldi. C’est un auteur sur lequel se sont cristallisés plusieurs fantasmes critiques et dont la discrétion ne cesse d’agrandir le mystère. Quant au second fantôme, il s’agit des crimes sans coupable(s) de Santa Teresa, ville du Mexique rebaptisée pour les besoins de la fiction et qui est une référence transparente à la ville frontalière de Ciudad Juárez, réputée pour son irascibilité endogène, comme si gisait en son sein un dispositif insatiable d’agressivité, un insoutenable impératif s’emparant de tous ses administrés. Plus spécifiquement, Bolaño se focalise sur les crimes inexpliqués de femmes, épidémie de féminicides qui a pris de l’ampleur au début des années 1990 et dont personne à ce jour n’a pu fournir une explication sensée, d’où, probablement, la motivation de produire une enquête fictionnelle. S’emparant par conséquent de ce fait divers à rallonge, Bolaño a construit un livre qui ne craint pas d’aller au-devant de cet oppressant démon meurtrier, et il nous suggère un sordide profil de celui-ci au fur et à mesure que l’intrigue avance, mêlant aussi bien la recherche des causes qui président à la peste féminicide que la traque crispée de Benno von Archimboldi, soupçonné d’être de passage à Santa Teresa.
La fin du roman ne nous délivre pas un schéma circonscrit de réponses définitives, elle ne fait que nous renseigner avec davantage d’acuité sur l’existence d’Archimboldi, sans remplir les blancs profonds de cette vie épique, et elle nous laisse un peu plus désemparés encore vis-à-vis de l’abondance criminelle de Santa Teresa, laquelle, in fine, se lie d’une amitié méphistophélique avec le Mal historiquement recensé du XXe siècle, un Mal de malveillance sans réelle semence, un Mal de cadavres entassés qui nous montre que les charniers de Santa Teresa ne sont que les prolongements symboliques des atrocités d’Auschwitz.
 Conformément à ce résumé très artificiel de l’œuvre, le titre du roman est passible d’une double signification : 2666 peut évidemment signifier l’année de la Bête, l’avènement d’un millésime maudit où le Mal atteindra son paroxysme, toutefois ce nombre peut également correspondre au chiffrement des cadavres, comme si la ville de Sante Teresa avait exactement recraché 2666 corps de femmes, toutes mutilées par une force ineffable et sûrement irriguée par quelques abus du patriarcat mexicain.
Conformément à ce résumé très artificiel de l’œuvre, le titre du roman est passible d’une double signification : 2666 peut évidemment signifier l’année de la Bête, l’avènement d’un millésime maudit où le Mal atteindra son paroxysme, toutefois ce nombre peut également correspondre au chiffrement des cadavres, comme si la ville de Sante Teresa avait exactement recraché 2666 corps de femmes, toutes mutilées par une force ineffable et sûrement irriguée par quelques abus du patriarcat mexicain. Quoique ce panorama du livre soit extrêmement insatisfaisant au regard de ce qu’il charrie de complexités et de récits enchâssés, il n’en révèle pas moins le vaste défi de Julien Gosselin, ne serait-ce déjà que par la sensation constante d’avoir affaire à des fantômes, à des genres de fondations spectrales qui s’abattraient sur le monde pour le féconder d’une calamité fatale, faisant de la réalité «une pute sidéenne en rut» (dixit Bolaño), une salope d’une férocité impitoyable, prête à coucher avec n’importe qui et à transmettre des syphilis, des herpès et des chancres mous, mais aussi des folies furieuses qui transforment leurs hôtes en assassins et en dignes fils de pute. Ainsi l’allure fantomatique de la menace caractérise d’emblée une première difficulté pour le metteur en scène (comment représenter la main invisible du Mal ?), et cette difficulté se complète du mouvement tout aussi fantomal d’Archimboldi, un mouvement dont il faut parvenir à rendre la clandestinité, mais encore l’attraction qu’il exerce sur les gens qui sont fascinés par lui.
Conscient plus qu’un autre de ces fantastiques enjeux, Julien Gosselin a fait appel au talent d’Hubert Colas afin de nous offrir une brillante scénographie. Elle consiste essentiellement en trois blocs de décor qui se composent et se recomposent à l’envi, se disant et se dédisant selon les exigences du propos à tenir. Chacun des blocs est facilement déplaçable sur la scène et ils sont manipulés discrètement par des techniciens avisés. Ce sont des sortes de containers qui peuvent figurer tantôt un intérieur d’appartement bourgeois, une chambre, des abysses où se dandine un proto-Archimboldi adamite attiré par les profondeurs marines (dans ce cas des fumigènes blancs envahissent l’espace confiné et simulent la densité abyssale), tantôt encore une boîte de nuit, un confessionnal inquiétant où vient se justifier un soldat allemand qui nous avoue ses vertiges antisémites, tantôt enfin un piédestal furtif où un homme nu apparaît puis disparaît aussitôt, la peau écarlate, peau rouge de cauchemar, de la rougeur d’un diable, bien pire qu’un indien belliqueux, et ainsi de suite au fil des situations, au fil des modulations dont peuvent s’imprégner ces composants du décorum.
Cette variété de moments confirme l’efficacité du procédé scénique d’Hubert Colas, et nous ne sommes même pas exhaustif dans notre compte-rendu ! À cela nous pouvons additionner que la scène n’est pas systématiquement occupée par ces trois ensembles amovibles. En effet ces unités de décor sont souvent disposées en U, à l’endroit ou à l’envers, pour mettre l’accent sur un espace central, tantôt fosse de night-club, terrasse ensoleillée ou spacieux living-room. Enfin, notons que sur l’un de ces blocs réside un orchestre électronique qui joue en direct et que l’on ne découvre pas tout de suite. Bien que l’orchestre soit fréquemment tapi dans l’obscurité, les furtives diodes de chaque instrument, ainsi que l’anatomie nuitamment dessinée des musiciens, dégagent une impression de puissance tranquille. Par ailleurs, l’omniprésence de la musique, qui alterne entre de très sobres pulsations et des raffuts souverains, érige cet orchestre en personnage à part entière. C’est même la musique, par certains côtés, qui matérialise la menace qui court d’un bout à l’autre de l’œuvre, tout comme c’est elle qui sait impliquer la ligne de fuite d’Archimboldi lorsqu’elle s’interrompt brusquement ou lorsqu’elle s’inflige une succession de bémols.
En sus de ces agencements, signalons un important matériel vidéographique. Les zones de projection sont multiples et peuvent aussi bien viser l’arrière de la scène que le flanc d’un élément de décor, voire la surface d’un écran géant épisodiquement employé. La vidéo n’est pas une facilité ou une solution pour dissoudre telle proposition du roman, elle est au contraire un perpétuel redéploiement de l’action par le biais de différents points de vue qui s’enrichissent mutuellement. Parfois elle est aussi le seul point de vue disponible, délibérément imposé par la mise en scène qui souhaite ostensiblement instruire notre vigilance ou créer un effet de clair-obscur (par exemple un visage en gros plan, opposé aux ténèbres d’un environnement hostile – à moins que le visage en question ne se nourrisse directement à la source de ce contexte enténébré s’il s’agit d’un personnage interlope). Précisons du reste que toutes les vidéos sont tournées en direct, sur le motif, et qu’elles sont recueillies par un cameraman visible des spectateurs. Alors que l’on pourrait penser que cette présence est parasite, elle est rapidement occultée par la projection simultanée de la vidéo, et même elle devient amusante parce que l’on finit par guetter le point de vue qui sera adopté, espérant tel ou tel angle d’attaque oculaire. De plus, étant donné que le caméraman est visible et que nous voyons assez distinctement ce qu’il filme sans passer par un écran, cette technique suscite un dédoublement de notre œil : non seulement nous avons accès au grossissement de l’image par l’entremise de l’écran, mais nous avons aussi accès à l’image réelle, à la scène qui se déroule quelque part en toute limpidité et que notre œil saisit en retrait. Par ce processus assez récurrent de dissociation des représentations, avec d’un côté la matière brute et de l’autre la matière récupérée par l’objectif partial de la caméra, la teneur de certaines scènes confère quelquefois à la suggestion érotique ou à l’insinuation monstrueuse. Par conséquent, si l’œil perçoit une donnée immédiate, c’est la caméra, en fin de compte, qui achève de sculpter cette donnée et qui en fait une représentation exploitable. Et lorsque l’œil a saisi les deux, il voyage ensuite d’un point de vue à un autre, comme pour homologuer la nature achevée de la représentation, qu’elle soit donc érotique, monstrueuse ou prosaïque. Ce procédé persistant de prolifération des images consacre définitivement la générosité de cette pièce de théâtre.
L’association minutieuse de ces techniques amplifie considérablement la scène. Elle devient un lieu sensuellement accru, un territoire de synesthésie où toute notre sensibilité converge et descend dans le précipice romanesque de Bolaño. En cela même, nous sentons l’atmosphère viciée de Santa Teresa, nous goûtons aux canicules du Mexique, nous scrutons Archimboldi et les cadavres putatifs de ses placards, nous tâtons les macchabées de femmes, et, par-dessus tout peut-être, nous entendons la cadence de «la pute sidéenne», la tonitruante foulée de cette infernale réalité qui nous transmet sa maladie. Sans doute est-ce là l’épreuve de force que désirait Julien Gosselin pour le public. Nous sommes littéralement embarqués sur une nef des fous, et le navire tangue dangereusement, secoué de toutes parts, juché sur des eaux qui le rejettent, tant et si bien que le sentiment de malaise s’accroît en proportion du trou noir qui se creuse dans le roman et sur la scène. C’est un bateau de Thésée qui démâte dans le quatrième acte, après avoir nous avoir mis le nez dans la merde insensée de la nécropole féminine, et qui lentement se reconstruit dans un cinquième temps, lorsque la vie d’Archimboldi trouve ses points de suture avec l’histoire du XXe siècle et le drame de Santa Teresa. Aussi, pour résumer la pièce, nous avons quatre temps affolés qui vont crescendo, quatre triangles des Bermudes qui dévalent vers l’horrible nécrologie féminine de Santa Teresa, après quoi nous avons une reprise de respiration toute relative, un ultime temps où les flux narratifs concordent et nous apportent une représentation moins passionnée du Mal.
Quelques remarques chronologiques sur le déroulement de la pièce
Dans la mesure où les comédiens et toute l’équipe technique sont en pleine tournée (1), qu’ils sont pris dans une excitation semblable à celle de la fougueuse troupe que décrit Théophile Gautier dans Le Capitaine Fracasse, nous ne voudrions pas gâcher le plaisir de la découverte pour les futurs spectateurs en disséquant scrupuleusement toutes les parties de la pièce et en exhibant les plus ingénieux de ses choix de mise en scène. Nous nous contenterons ainsi de remarques générales inoffensives et suffisamment attractives afin, si possible, de transmettre aux lecteurs le désir d’en savoir davantage en prenant un billet pour 2666.
 Le premier acte (Les critiques) est un préambule de presque deux heures qui pose d’entrée de jeu toute l’intelligence de la mise en scène. Nous y suivons quatre universitaires capricieux et dépassés par l’ampleur de leurs investigations académiques, petits rats de bibliothèque tout à fait inadaptés au gigantisme littéraire de Benno von Archimboldi, qu’ils pourchassent avec une ardeur qui sent l’estrade et les pantalons de velours. Le comique le dispute à l’angoisse puisque la nullité de ces premiers de la classe, bientôt, se heurte à l’ambiance délétère de Santa Teresa, où l’écrivain aurait fait une halte. Le déplacement d’une tonalité à une autre, de même que le transfert de l’Europe à l’Amérique (qui pose une confluence historique), sont subrepticement amenés, nos universitaires étant peu à peu rabroués par des réalités renversantes, à tout le moins pour des individus qui n’ont jamais connu que des intrigues de colloque ou des manigances administratives. Par ailleurs, et c’est heureux que Julien Gosselin n’ait pas censuré ce trait de caractère si bien cultivé dans le roman, nos universitaires sont friands de coucheries utiles, à commencer par Liz Norton, la seule femme du groupe, qui paraît clairement redevable de ce putanat. Les séances de sexualité sont exposées telles quelles, sans fard ou moralité cosmétique, comme Bolaño aurait probablement voulu qu’on le fasse parce que ce petit « milieu » des universités regorge de putains et de maquereaux. Aussi ne faut-il pas se cantonner à la surface de l’intrigue car ce que sous-entend Bolaño, et ce que Julien Gosselin fait fructifier, c’est une déchéance des intellectuels modernes qui tuent les ultimes bastions de la littérature. En d’autres termes, la littérature, véritablement soutenue par l’introuvable Archimboldi, nous incite à penser qu’elle s’évertue à fuir ceux qui la massacrent, faute de délicatesse et de compétence, faute aussi de posséder la hardiesse de ceux qui se battent authentiquement avec les grands textes.
Le premier acte (Les critiques) est un préambule de presque deux heures qui pose d’entrée de jeu toute l’intelligence de la mise en scène. Nous y suivons quatre universitaires capricieux et dépassés par l’ampleur de leurs investigations académiques, petits rats de bibliothèque tout à fait inadaptés au gigantisme littéraire de Benno von Archimboldi, qu’ils pourchassent avec une ardeur qui sent l’estrade et les pantalons de velours. Le comique le dispute à l’angoisse puisque la nullité de ces premiers de la classe, bientôt, se heurte à l’ambiance délétère de Santa Teresa, où l’écrivain aurait fait une halte. Le déplacement d’une tonalité à une autre, de même que le transfert de l’Europe à l’Amérique (qui pose une confluence historique), sont subrepticement amenés, nos universitaires étant peu à peu rabroués par des réalités renversantes, à tout le moins pour des individus qui n’ont jamais connu que des intrigues de colloque ou des manigances administratives. Par ailleurs, et c’est heureux que Julien Gosselin n’ait pas censuré ce trait de caractère si bien cultivé dans le roman, nos universitaires sont friands de coucheries utiles, à commencer par Liz Norton, la seule femme du groupe, qui paraît clairement redevable de ce putanat. Les séances de sexualité sont exposées telles quelles, sans fard ou moralité cosmétique, comme Bolaño aurait probablement voulu qu’on le fasse parce que ce petit « milieu » des universités regorge de putains et de maquereaux. Aussi ne faut-il pas se cantonner à la surface de l’intrigue car ce que sous-entend Bolaño, et ce que Julien Gosselin fait fructifier, c’est une déchéance des intellectuels modernes qui tuent les ultimes bastions de la littérature. En d’autres termes, la littérature, véritablement soutenue par l’introuvable Archimboldi, nous incite à penser qu’elle s’évertue à fuir ceux qui la massacrent, faute de délicatesse et de compétence, faute aussi de posséder la hardiesse de ceux qui se battent authentiquement avec les grands textes. Cette trahison perpétrée à l’encontre de la littérature s’atténue un tant soit peu dans le deuxième acte (Amalfitano), où nous sommes immergés moins dans la ville de Santa Teresa que dans l’esprit contorsionné d’Amalfitano, un professeur de philosophie qui résiste à la saloperie féminicide en y opposant un blitzkrieg d’érudition. En dépit de sa vie de famille accidentée (sa femme Lola est morte du sida et sa fille Rosa risque à tout moment d’être ingurgitée par le ventre noir de Santa Teresa), Amalfitano tient la corde de ses obsessions, au propre comme au figuré à vrai dire, puisqu’il va jusqu’à suspendre à la corde à linge un livre de sa collection, sorte de happening qui rend hommage à Marcel Duchamp. L’anecdote du livre épinglé est du reste très célèbre pour les lecteurs de Bolaño, et la façon dont Julien Gosselin la retranscrit est d’une justesse exemplaire (il n’en fait pas un point d’orgue (2), mais un maillon parmi tant d’autres sur la chaîne excessivement sophistiquée du professeur). En outre, par contraste avec les universitaires du début, Amalfitano personnifie le savant tel qu’on se l’imagine : un homme hanté par la connaissance et assujetti à un isolement paradigmatique, un homme qui n’a pas besoin de coucher, de palabrer ou faire semblant pour asseoir la qualité de ses travaux. Il est d’une certaine manière une espèce de reflet d’Archimboldi, un être d’une force spirituelle indéniable qui ne se laisse pas amadouer par le Mal. Son lexique est d’ailleurs le plus approprié pour évoquer le Mal de Santa Teresa, et, par extension, toute la désolation qui a enveloppé le monde. Il n’a pas besoin d’en dire énormément pour signifier énormément : alors que les universitaires s’égaraient en monologues et en harangues d’opérette, Amalfitano est le véhicule d’une parole lapidaire qui touche immédiatement à l’essentiel. C’est grâce à lui que nous pouvons irrévocablement certifier le Mal qui suinte dans les rues de Santa Teresa et dont la substance dégouline sur le cadastre entier du monde.
Dès lors que les deux premiers actes sont terminés, Julien Gosselin a fermement installé la matrice du roman : une ville maudite où tout a l’air de transiter et des personnages plus ou moins à la hauteur de cette malédiction faramineuse. C’est ainsi que le troisième acte (Fate) nous raconte une autre polarisation, une nouvelle attirance, le journaliste américain Oscar Fate étant fortuitement envoyé à Santa Teresa pour y couvrir un accessoire combat de boxe. Quoique le spectateur sache dorénavant les épouvantables événements qui défraient la chronique de cette calamiteuse ville, il sera malgré tout saisi par le réseau causal qui conduit Fate à comprendre que la boxe est beaucoup moins qu’un épiphénomène, ceci en comparaison de ce qui se joue socialement et philosophiquement à travers les meurtres de femmes. Cette partie s’ouvre donc avec une performance scénique et volontairement intempestive de Barry Seaman (3), ex-membre des Black Panthers, qui nous explique avec légèreté comment les côtes de porc peuvent avoir l’honneur d’être érigées en concept, en remèdes existentiels, et elle se termine dans la lourdeur du désordre mental de Fate, rattrapé par la consistance du réel qui écrase tous ceux qui s’approchent de Santa Teresa, et à plus forte raison tous ceux qui y séjournent un moment. Dans cette partie, Julien Gosselin oscille entre la fulgurance de l’humour et la déploration typique de la tragédie, cependant, plus on avance dans ce segment, plus le tragique domine, justifiant de ce fait le patronyme même de Fate, séquestré dans le boyau de son destin et dans les intestins tout aussi imparables de Santa Teresa. Cela s’apparente à une montée en puissance du Mal, comme une collision future dont on a la certitude et que pourtant l’on ne sera pas capable de contourner, nous préparant de la sorte au paroxysme du quatrième acte. Ce faisant, nous devons ici nous adapter à une forme de theatre bizarre.
Ce quatrième acte (Les crimes), par conséquent, nous fait dégringoler dans le caveau funéraire de Santa Teresa, qui, à certains égards, est aussi le caveau d’un monde défait. Julien Gosselin s’élève ici au pic de sa mise en scène, n’hésitant pas à faire de ce chapitre criminel la plus longue et la plus éprouvante section de la pièce (4). La litanie des crimes explose sur un écran géant (lettres blanches cocaïnomanes sur fond noir de finitude), prenant la configuration d’un enchaînement de petits récits qui relèvent soit du rapport de police, soit de l’analyse médico-légale. L’empilement de ces récits, harmonisé avec une musique tranchante et lancinante, nous administre une volée de gnons à chaque corps de femme recensé. Or bien que les motifs de ces assassinats soient indéterminés, le reste de la mise en scène, composé d’épisodes policiers et d’engloutissements prolongés dans les consciences amochées de plusieurs personnages au bout du rouleau, tout ceci, donc, tend à nous donner le pressentiment d’une crapulerie extraordinairement diffuse. Les femmes de Santa Teresa crèvent de l’incompétence masculine, des trafics de drogue et des intérêts poursuivis par d’infréquentables notabilités. Le Mal prendrait presque un visage, cependant il demeure éparpillé, insaisissable en totalité, voué à de regrettables et secrets pullulements. Dans cette perspective, Santa Teresa fait office d’épicentre planétaire maladif, comme une pieuvre éternelle dont les trois cœurs pomperaient un sang immodérément salopé et dont les tentacules, enserrant la Terre comme jadis le fit la pieuvre du pangermanisme, ne se lasseraient jamais d’infuser au monde cette indécrottable ciguë. Plus simplement encore, on pourrait affirmer que Santa Teresa est le cœur du problème, qu’elle est ce par quoi tout a commencé et ce par quoi tout finira probablement, un genre d’anus terrestre qui chie abondamment et qui recouvre de sa merde le nouveau siècle en gestation (le XXIe en l’occurrence). Tout cela est assurément présent dans les options scéniques de ce quatrième acte, point culminant du Mal et descente imprudente dans les entrailles de Santa Teresa.
Quant au cinquième acte (Archimboldi), il sollicite une reprise moins affective de tout ce qui précède, en cela qu’il est une relecture de l’histoire du XXe siècle par le truchement de la carrière littéraire de Benno von Archimboldi, dont la véritable identité sera révélée. La virilité et la véhémence de la mise en scène n’en sont pas moins préservées (5), toutefois, au lieu de se jucher sur le tempo d’une menace ou d’une absence, elles s’alignent sur les soubresauts concrets des événements historiques et elles nous montrent comment ils ont organisé la vie d’un écrivain, comment celui-ci, en quelque sorte, a répondu aux questions cruciales de son époque à l’aide de la littérature. Ce cinquième et dernier acte est riche en contenu, bien sûr, et il revient allègrement sur la dérive des fascismes. D’ailleurs, parmi les passages décisifs de ce grand terminus, on retiendra le monologue de Leo Sammer, interprété en allemand par l’excellent Frédéric Leidgens (6), long soliloque d’un homme dévasté qui n’est autre qu’un héraut de la banalité du Mal, antiquité humaine des rouages du nazisme qui voudrait qu’on lui accorde le pardon. Ne serait-ce que pour la qualité de ce moment, où Sammer s’exprime à voix nue, sans musique et sans iconographie, il vaut la peine de s’abandonner dans cette dizaine d’heures de représentation théâtrale. Que l’on soit un fervent lecteur de Bolaño ou un néophyte accompli, peu importe, car le travail effectué par Julien Gosselin, les acteurs et l’équipe technique constitue, disons-le une bonne fois pour toutes, une pièce maîtresse qui fera date dans les mémoires du théâtre français.
Notes
(1) Citons d’ailleurs les noms des comédiens en intégralité et par ordre alphabétique : Rémi Alexandre, Guillaume Bachelé, Adama Diop, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Carine Goron, Alexandre Lecroc-Lecerf, Frédéric Leidgens, Caroline Mounier, Victoria Quesnel, Tiphaine Raffier. Et précisons les dates restantes d’une tournée qui, nous l’espérons, pourra se prolonger : du 26 novembre au 8 décembre 2016 au Théâtre national de Toulouse, le 7 janvier 2017 au Quartz, sur la Scène nationale de Brest, du 14 au 15 janvier 2017 au MC2 de Grenoble, du 11 au 26 mars 2017 au Théâtre National de Strasbourg, le 6 mai 2017 à la Filature Scène nationale de Mulhouse, et du 17 au 21 mai 2017 au Stadsschouwburg à Amsterdam.
(2) La référence était en ce sens peut-être un peu trop appuyée dans la mise en scène américaine.
(3) Le personnage de Barry Seaman, dans le roman, est inspiré par la figure du véritable activiste noir américain Bobby Seale.
(4) C’est également le cas dans le roman.
(5) Ce serait sinon trahir le propos de Bolaño.
(6) Frédéric Leidgens interprète aussi le rôle d’Amalfitano.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, théâtre, 2666, roberto bolaño, julien gosselin, gregory mion |  |
|  Imprimer
Imprimer


























































