« Mauvaise passe : si Yannick Haenel, Clémentine Haenulle | Page d'accueil | Un fils de notre temps d'Ödön von Horváth »
29/09/2018
Les identités invisibles de Leo Perutz : Le Cavalier suédois, Le Judas de Léonard, Le Marquis de Bolibar

Photographie (détail) de Juan Asensio.
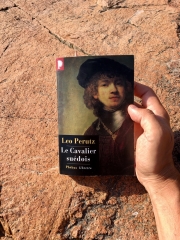 Acheter Le Cavalier suédois sur Amazon.
Acheter Le Cavalier suédois sur Amazon.Le Cavalier suédois (Der schwedische Reiter) (1) fut écrit par Léo Perutz en 1936 et aurait pu constituer l’une des truculentes histoires désobligeantes de Léon Bloy, non point tant pour ses qualités polémiques, encore que Perutz se montre dans son texte d’un humour cruel et, à l’occasion, ne dédaigne pas d’évoquer le gouvernement temporel de ce bas monde soumis à la rapine des brigands et à la cruauté des puissants, mais en raison de son sujet profond, essentiel, qui est moins la substitution d’identité que la certitude que nous ne savons pas qui nous sommes en réalité. Un brigand de grand chemin devient un maître respecté après avoir sauvé de la ruine une belle femme volée sur ses propres terres, mais en ayant pris la place d’un compagnon de voyage auquel cette même femme, dans leur jeunesse commune, avait juré fidélité et amour. Dieu, ses anges, le diable et ses serviteurs sont des personnages qui nous permettent de lire ce roman subtil comme une histoire picaresque haute en couleurs et en rebond, et il est évident qu’un bon réalisateur tirerait un excellent film de cette trame, romanesque à souhait, où l’homme, qu’il soit brigand devenu grand seigneur ou godelureau déserteur qui finira par montrer sa bravoure, semble condamné à devoir suivre un chemin duquel il ne pourra en aucun cas s’échapper. On songe à des mystères médiévaux où les pauvres âmes sont disputées par Dieu et son Adversaire, à un Julien Gracq qui ne serait point perclus d’esthétisme tournant à vide, au Jünger des Falaises de marbre mais surtout aux Fiancées sont froides du grand Guy Dupré, non point tant pour les thèmes qu’une étude comparée pointilleuse pourrait sans doute évoquer qu’en raison d’un paysage perpétuellement enneigé de Silésie où nos misérables personnages tentent de survivre, mais aussi d’une atmosphère commune, pesante, gonflée de maléfices et éclairée par une espèce de lumière chiche englobant bons et méchants, ou plutôt celles et ceux qui, comme ils le peuvent, au prix de mensonges et de renoncements mais aussi de fermes résolutions rachetant toutes les erreurs passées, cherchent à se frayer une voie sur une terre qui est peut-être sous le seul empire des puissances de la nuit, mais qui n’en servent pas moins, de façon parodique et torve, des puissances qui leur sont supérieures : «Car tout passe, la lumière elle-même ne dure qu’un temps, et nous ne sommes rien, qu’une balle aux mains de la Fortune changeante qui nous lance en l’air pour mieux nous faire sentir la chute» (1). Si tout passe en effet, y compris et surtout l’assurance vacillante des identités, le mal n’est pas victorieux car l’imposteur est peut-être racheté par la prière muette de sa fille saluant la dépouille d’un «homme sans nom» (p. 275).
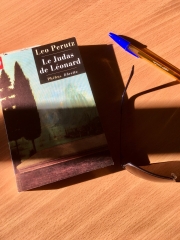 Acheter Le Judas de Léonard sur Amazon.
Acheter Le Judas de Léonard sur Amazon.Dans Le Judas de Léonard, le dernier roman auquel Leo Perutz eut le temps de travailler avant de mourir le 25 août 1957, c’est le marchand Joachim Behaim qui sert, à son corps défendant, les intérêts supérieurs qu’incarne l’art universel (2) du maître Léonard le Florentin, le savant et peintre ne parvenant pas à terminer l’un de ses tableaux les plus fameux, représentant le Christ réuni avec ses apôtres lors de son dernier repas, parce qu’il n’arrive pas à trouver un modèle suffisamment vil pour être digne d’incarner le traître Judas. Ce texte, bien qu'intéressant, me semble être le plus faible des trois, Leo Perutz ne s'enfonçant qu'assez superficiellement dans la psychologie des personnages, surtout dans celle du marchand qui servira de modèle idoine pour peindre l'apôtre traître. De façon assez traditionnelle également sinon résolument peu originale, le péché de Judas a été, aux yeux de Perutz faisant parler messire Léonard, «cet orgueil qui le conduisit à trahir l’amour qu’il éprouvait» (p. 35), le marchand Behaim n'hésitant pas à se débarrasser de celle qu'il prétendait aimer pour recouvrer son argent, cette dernière, à son tour, manquant de charité lorsqu'elle finit par voir, dans les traits de celui qui fut son promis, ceux de l'apôtre félon révélés par le peintre Léonard. Encore une fois, la vérité se tient au-delà des apparences et seul l'art semble capable de démasquer la vilenie et l'imposture tapis sous des dehors agréables.
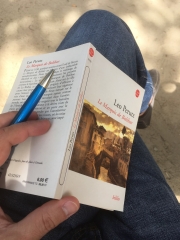 Acheter Le Marquis de Bolibar sur Amazon.
Acheter Le Marquis de Bolibar sur Amazon.C'est avec Le Marquis de Bolibar traduit en français en 1930 mais publié en Allemagne dix ans plus tôt (3), que le jeu entremêlant les identités est poussé à son comble, nul ne sachant exactement qui se cache derrière qui, une jeune beauté espagnole pouvant être prise pour une autre, morte, la belle Françoise-Marie qui naguère fut la maîtresse pour le moins industrieuse de plusieurs officiers de l'armée napoléonienne faisant le coup de feu en Espagne pour mater la guérilla. De la même manière, nous ne savons qui est le marquis de Bolibar, un homme qui ne demande rien, «si ce n'est d'être enterré sans être identifié et de perdre avec la vie le nom qui pour toujours est voué à la honte et au mépris» (p. 42) pouvant prendre les traits des différents personnages et même se confondant avec le narrateur, Jochberg, continuant même à influencer, une fois tué, comme en a l'assurance le narrateur (cf. p. 45), l'implacable destinée qui plie les personnages sous son joug et les enferme dans une destruction non seulement inéluctable, mais d'entrée de jeu indiquée par Perutz. Ce roman crépusculaire, hanté par les figures de l'Antichrist (cf. p. 167) et du Juif errant dont on ne sait s'il s'est dédoublé dans le marquis de Bolibar et dans son ennemi juré, Salignac, me semble supérieur aux deux autres, même si Perutz considérait Le Cavalier suédois comme sa plus belle réussite. C'est probablement dans Le marquis de Bolibar que Leo Perutz se montre le plus bloyen, puisque tous les personnages semblent être des pantins agités de quelques tics qu'ils confondent avec des actions d'éclat, alors que, pour eux, l'Histoire n'est rien de plus qu'une souricière de laquelle ils sont parfaitement incapables de s'échapper, puisqu'ils ne peuvent se libérer du mensonge qui les englue les uns aux autres et même, les fait payer les uns pour les autres, le marquis de Bolibar ayant par exemple «dû garder le masque et subir la mort destinée à un autre» (p. 73).
Il est donc parfaitement clair que dans ce jeu de dupes universels, la nature «se complaît souvent dans des jeux étranges» (p. 91) comme le déclare l'un des personnages, l'un de ces jeux ayant même pour nom reversi, une femme en étant une autre, une maîtresse une autre, une figure de sainte peinte par Don Ramon, le père de la Monjita, celle-là même qui prendra la place de Marie-Françoise, le calque transparent de cette même belle et jeune espagnole qui rendra fou de désirs les hommes auxquels Marie-François s'est copieusement donnée, etc.
Notes
(1) Texte français (et pourquoi pas, simplement, traduction ? Ce terme signifie-t-il que la traductrice a adapté le texte original bien plus qu’elle ne l’a traduit ?) de Martine Keyser, Phébus, coll. Libretto, 1999), p. 217.
(2) «Il [Léonard] est manifestement absorbé par ses réflexions, fit le Grec Lascaris. Peut-être médite-t-il sur la manière de peser en carats l’esprit de Dieu, où est enfermé l’univers…», Leo Perutz, Le Judas de Léonard (Der Judas des Leonardo, traduction de Martine Kayser, Phébus, coll. Libretto, 2009), p. 208.
(3) Le Marquis de Bolibar (Der Marques de Bolibar, traduction de l'allemand par Odon Niox Château, préface de Roland Stragliati, Le Livre de poche, coll. Biblio, 2003).































































 Imprimer
Imprimer