« Pas pleurer de Lydie Salvayre, le Goncourt de la vulgarité | Page d'accueil | «Une nuit libérée d’étoiles». Glose et gnose de Maurice Blanchot, par Baptiste Rappin »
12/09/2016
Les Verticaux de Romaric Sangars

Photographie (détail) de Juan Asensio.
Rappel
 Suffirait-il d'aller gifler Romaric Sangars pour arranger un peu la gueule du journalisme français ?
Suffirait-il d'aller gifler Romaric Sangars pour arranger un peu la gueule du journalisme français ?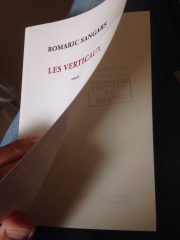 Les Verticaux de Romaric Sangars est le roman que tout gamin féru d'aventures romanesques et aimant beaucoup lire rêverait d'écrire avant ses 13 ans et dont il se dépêcherait ensuite d'acheter les derniers exemplaires invendus avant l'âge de 15 ans, de peur qu'un lecteur mal intentionné ne lui rappelle, devenu plus âgé, son forfait anodin, infantile bien plus qu'enfantin. Il illustre par ailleurs parfaitement, à sa façon comiquement sérieuse, le propos de ma dernière note : aussi vague et vide que nous paraisse la tentative pseudo-littéraire de Romaric Sangars, nous ne pouvons que saluer sa volonté, apparemment vive et même incontrôlable comme un priapisme, de puiser un ancrage dans un passé qui, à la différence de notre époque, permettrait l'honneur, puisqu'il s'agit «bien de redonner aux êtres et aux choses leur valeur absolue» (p. 158). Hélas : fixant l'absolu, désirant se gorger de lumière, de grandeur, de verticalité, appelant la grande vague du style, la vérité rimbaldienne dans une âme et un corps à étreindre, Romaric Sangars nous donne à lire un livre bavard, jaculatoire et pourtant étriqué, pleurnichard alors qu'il s'agit de se prétendre surhomme nietzschéen, sans beaucoup d'épaisseur ni même d'écriture, cette dernière apparemment tombée dans une flaque d'eau sale, comme nous en voyons à Paris très vite s'en former, après une averse rafraîchissante, où quelques animalcules sans nageoire ont tout de même le temps de barboter. Les Verticaux n'est rien de plus qu'un produit standardisé, en somme, qui s'oublie aussitôt que lu, ce qui est certes très appréciable, par ces temps de consommation effrénée de produits strictement fonctionnels, ce que ce roman ambitieux dans son propos et indigent dans son résultat, hélas, n'est même pas, sauf peut-être aux yeux de l'une des amies de l'auteur et habituée des petits raouts parisiens où une jeunesse moins sotte que profondément inculte croit refaire le monde en buvant des bières et en lisant, à voix basse, des lignes de Léon Bloy, laquelle, un temps, avait géré le site dédié à Maurice G. Dantec avec un amateurisme comique, Gersende Bessède, qui a dégouliné un article tout huileux d'une complaisance caricaturale.
Les Verticaux de Romaric Sangars est le roman que tout gamin féru d'aventures romanesques et aimant beaucoup lire rêverait d'écrire avant ses 13 ans et dont il se dépêcherait ensuite d'acheter les derniers exemplaires invendus avant l'âge de 15 ans, de peur qu'un lecteur mal intentionné ne lui rappelle, devenu plus âgé, son forfait anodin, infantile bien plus qu'enfantin. Il illustre par ailleurs parfaitement, à sa façon comiquement sérieuse, le propos de ma dernière note : aussi vague et vide que nous paraisse la tentative pseudo-littéraire de Romaric Sangars, nous ne pouvons que saluer sa volonté, apparemment vive et même incontrôlable comme un priapisme, de puiser un ancrage dans un passé qui, à la différence de notre époque, permettrait l'honneur, puisqu'il s'agit «bien de redonner aux êtres et aux choses leur valeur absolue» (p. 158). Hélas : fixant l'absolu, désirant se gorger de lumière, de grandeur, de verticalité, appelant la grande vague du style, la vérité rimbaldienne dans une âme et un corps à étreindre, Romaric Sangars nous donne à lire un livre bavard, jaculatoire et pourtant étriqué, pleurnichard alors qu'il s'agit de se prétendre surhomme nietzschéen, sans beaucoup d'épaisseur ni même d'écriture, cette dernière apparemment tombée dans une flaque d'eau sale, comme nous en voyons à Paris très vite s'en former, après une averse rafraîchissante, où quelques animalcules sans nageoire ont tout de même le temps de barboter. Les Verticaux n'est rien de plus qu'un produit standardisé, en somme, qui s'oublie aussitôt que lu, ce qui est certes très appréciable, par ces temps de consommation effrénée de produits strictement fonctionnels, ce que ce roman ambitieux dans son propos et indigent dans son résultat, hélas, n'est même pas, sauf peut-être aux yeux de l'une des amies de l'auteur et habituée des petits raouts parisiens où une jeunesse moins sotte que profondément inculte croit refaire le monde en buvant des bières et en lisant, à voix basse, des lignes de Léon Bloy, laquelle, un temps, avait géré le site dédié à Maurice G. Dantec avec un amateurisme comique, Gersende Bessède, qui a dégouliné un article tout huileux d'une complaisance caricaturale.Comme la majorité des livres édités par Léo Scheer sur lequel nous ne jetons aucune pierre puisqu'il ne fait rien de plus, en publiant de tels livres creux comme celui de l'oublié Karl Mengel qui ne faisait d'une certaine façon qu'annoncer Les Verticaux, que ce que font tous ses collègues éditeurs : publier ce qui mériterait de ne jamais l'être, Les Verticaux se lisent en quelques heures et cette concentration temporelle est je crois l'unique force de ce premier roman, dont on finirait par se demander si ce n'est pas le titre véritable, en constatant que le traditionnel bandeau publicitaire a été directement imprimé sur la première de couverture, qu'il enlaidit ainsi de façon irréversible. Si ce titre n'était plus réédité, le pauvre Romaric Sangars se verrait affublé d'un premier roman éternel ce qui, ma foi, à bien y réfléchir, ne serait peut-être point une mauvaise chose pour ses lecteurs, et figerait l'intéressé, devenu qui sait patron de Causeur ou des pages culturelles de Valeurs actuelles, dans la gloire prometteuse d'une éternité de rentrées littéraires, bien qu'une telle jeunesse soit plus vaine qu'un pet discret de Pierre Assouline le jour d'une délibération de prix Goncourt.
Le très navrant journaliste Philippe Nassif avec sa fort mauvaise Lutte initiale, bourrée de facilités comme un bolchevik l'est de grands principes humanitaires, qui comme Romaric Sangars prône, avant le Grand Soir, une réforme de notre propre esprit gorgé de tous les sucs de la force mais qui ne semble pouvoir produire qu'une rinçure, Maurice G. Dantec avec ses héroïnes de manga affublées de dialogues piqués à quelque épisode d'Albator, sa culture pop et sa recherche brouillonne d'une transcendance sous acide réactionnaire ou se voulant tel, Yannick Haenel encore, avec ses velléités melliflues de révolutionnaire de salon dans Les Renards pâles, mais aussi Antoni Casas Ros avec sa mysticaillerie pour attachée de presse et lecteur myope ou enfin Philippe Vasset avec sa Conjuration, un roman à peu près nul mais qui présente l'avantage de réunir les défauts éparpillés dans les livres de ces différents auteurs, autant de noms et d'exemples de romans qui me viennent immédiatement à l'esprit à propos des Verticaux de Romaric Sangars. Ce sont d'ailleurs peut-être des références trop écrasantes pour les frêles épaules de l'intéressé, qui ne s'est probablement approvisionné qu'à une seule source, si peu revigorante soit-elle, V for Vendetta de James McTeigue par exemple, en en inversant quand même le propos consciencieusement anarchiste. Notre fantassin de la rébellion germanopratine, notre agent infiltré dans tous les bons spots parisiens qui rêve de verticaliser notre déchéance et notre impuissance dont son livre prétentieux n'est pourtant qu'une flagrante illustration, aime voyager léger, puisque, dans son barda, nous aurions quelque peine à trouver autre chose qu'un disque des Cure ou des Smiths, voire des Pixies et un vieux numéro de Strange. Romaric Sangars, qu'on se le dise, s'il est anarchiste, est, ne peut être qu'un anarchiste chrétien voire christique, comme son apostolique ami Jacques de Guillebon, qu'il a d'ailleurs peut-être phantasmé sous les traits martiaux et néanmoins débiles d'Emmanuel Starck, aventurier prodigieusement convenu, «expert en hacking comme en arts martiaux» nous confie la quatrième de couverture d'un air aussi entendu que sot qui vaut tous les clins d’œil qu'échangeraient deux gamins en se mouchant le nez avec deux doigts.
Autant de rapprochements qui ne sont point tous flatteurs, loin s'en faut, mais le roman de Romaric Sangars néanmoins est supérieur à ces textes de peu de poids, ou même de poids nul, par deux traits significatifs : sa naïveté confondante, à moins qu'il ne s'agisse de sa franche mauvaise foi, qui toutes deux permettent à l'auteur d'aller jusqu'au bout d'une histoire sans le moindre intérêt que celui d'avoir récemment offert l'occasion à Olivier Maulin, compère cosaque de Romaric Sangars, de jouer dans le numéro du 1er septembre 2016 de Valeurs actuelles, au milieu d'un orchestre critique décidément très peu mélomane depuis que Bruno de Cessole a cessé d'en assurer la direction, la note unique que permet le pipeau consanguin. Ne doutons point que Romaric Sangars demandera à son ami de lui prêter son pipeau, lorsqu'il s'agira pour lui d'entonner le même air tranquille, après que ledit ami publiera son prochain livre à tropisme verticalisant, puisqu'il serait tout de même idiot de briser la chaîne d'une amitié aussi peu intéressée, qui permet, quelle que soit la qualité des livres en questions, d'en flûter l'indigence sur une seule note optimiste et toujours reprise.
 Si les phantasmes de force virile les plus communs pouvaient se matérialiser en un seul livre, ils débarqueraient sans ménagement comme une troupe plus chahuteuse que réellement inquiétante et s'installeraient fissa dans la sous-pente journalistique depuis laquelle Romaric Sangars prétend renverser l'ordre régnant, horizontal et non point, à son grand regret répété de page en page ennuyeuse et aussi plate qu'une pénéplaine égalisée par un glacier, vertical. Tout y passe à vrai dire, et nous pourrions, si nous étions maniaques, dresser un véritable catalogue de l'homme pressé et frustré qui vient de consulter son psychologue, mais qui, néanmoins tout désireux de contenir ses pulsions guerrières, promet qu'il ne reluquera pas les pistolets à eau derrière les vitrines, qu'il s'agisse ainsi de la célébration du courage d'un aviateur français jusqu'à la description du criard Emmanuel Starck, tout pressé de se dompter pour exécuter son petit rôle de figurant dans un film de Luc Besson, comme Mishima d'ailleurs cité (qui lui, tout de même, ne fit pas qu'écrire, mais agit) dans notre roman, en passant par de mignons actes terroristes (comme égorger un lapin en plein raout parisien, ou encore incendier une bâche publicitaire à la gloire d'Apple), de grandes déclarations martialo-apocalyptiques et, cerise sur le gâteau farineux qui flanqua une indigestion mémorable à Dantec, l'étalage d'un vocabulaire journalistique de transformation du vieil homme en surhomme brûlant d'ouvrir les yeux à ses congénères vivant en paisibles troupeaux, autrement dit, un gnosticisme mal assimilé ou même, carrément, point repéré par l'auteur lui-même. Ah, qu'elles sont dures, ces quêtes de béjaunes se prenant pour des hommes vers la sainte lumière : ils sont si peu cultivés que leur connaissance du christianisme tiendrait sur la surface d'une tête d'épingle, alors que la moindre lampe halogène, surtout si elle leur permet de parfaire leur teint de Manfred blafard, les en détourne.
Si les phantasmes de force virile les plus communs pouvaient se matérialiser en un seul livre, ils débarqueraient sans ménagement comme une troupe plus chahuteuse que réellement inquiétante et s'installeraient fissa dans la sous-pente journalistique depuis laquelle Romaric Sangars prétend renverser l'ordre régnant, horizontal et non point, à son grand regret répété de page en page ennuyeuse et aussi plate qu'une pénéplaine égalisée par un glacier, vertical. Tout y passe à vrai dire, et nous pourrions, si nous étions maniaques, dresser un véritable catalogue de l'homme pressé et frustré qui vient de consulter son psychologue, mais qui, néanmoins tout désireux de contenir ses pulsions guerrières, promet qu'il ne reluquera pas les pistolets à eau derrière les vitrines, qu'il s'agisse ainsi de la célébration du courage d'un aviateur français jusqu'à la description du criard Emmanuel Starck, tout pressé de se dompter pour exécuter son petit rôle de figurant dans un film de Luc Besson, comme Mishima d'ailleurs cité (qui lui, tout de même, ne fit pas qu'écrire, mais agit) dans notre roman, en passant par de mignons actes terroristes (comme égorger un lapin en plein raout parisien, ou encore incendier une bâche publicitaire à la gloire d'Apple), de grandes déclarations martialo-apocalyptiques et, cerise sur le gâteau farineux qui flanqua une indigestion mémorable à Dantec, l'étalage d'un vocabulaire journalistique de transformation du vieil homme en surhomme brûlant d'ouvrir les yeux à ses congénères vivant en paisibles troupeaux, autrement dit, un gnosticisme mal assimilé ou même, carrément, point repéré par l'auteur lui-même. Ah, qu'elles sont dures, ces quêtes de béjaunes se prenant pour des hommes vers la sainte lumière : ils sont si peu cultivés que leur connaissance du christianisme tiendrait sur la surface d'une tête d'épingle, alors que la moindre lampe halogène, surtout si elle leur permet de parfaire leur teint de Manfred blafard, les en détourne.Ce n'est ainsi pas un hasard si le narrateur, jeune paumé esthétisant, journaliste avachi et écrivain raté que nous n'irions bien sûr jamais jusqu'à confondre avec l'auteur, évoque «l'opportunité d'une purification», une «authentique extase» ne pouvant s'opposer qu'à la «nuit opaque pour l'esprit» (p. 9) que représente notre époque, ou encore la «zone essentielle» que le narrateur a «laissée s'obscurcir», alors qu'il lui faut à tout prix «remettre [s]on âme en amorce» (p. 10, une image répétée à la page 29), processus qui sera le gage d'un «vacillement intérieur» (p. 17) nécessaire qui seul permettra d'éviter «quelque flottement languide» (p. 18) et donnera ainsi la possibilité aux élus, car ce sont bel et bien des élus qui nous sont présentés, de retrouver «le temps où un homme pouvait mobiliser toute son énergie, où un homme pouvait consacrer une part importante de son existence à simplement ne pas faire mentir quelques mots, oui, quelques mots qu'un de ses aïeuls avait un jour assemblés dans le sens d'un défi» (p. 29).
Je ne cite que quelques exemples de ce vocabulaire significatif, qui infeste tout le roman et que nous pourrions fort utilement résumer en une noble action tenant en trois mots banals : «pénétrer l'infini» (p. 30). Le corollaire de ce tropisme gnostique est l'emploi, lui aussi pour le moins caractéristique, du pronom personnel préféré de Yannick Haenel et d'Antoni Casas Ros, nous, surtout lorsqu'il s'agit de s'inclure modestement dans la caste secrète de celles et ceux qui décident qu'un tel avachissement intellectuel, artistique et spirituel, vraiment, non, cela suffit, et passent en conséquence des belles paroles aux actes ou plutôt, rêvent d'actes comme ils rêvent de belles paroles : «Nous sommes quelques-uns à ne pas nous résoudre à ce que tout tourne à vide», noble mission me direz-vous quoique fort vague, et qui ne peut logiquement déboucher que sur le fait de «traquer encore la verticale» (p. 30) ou, nous assure le narrateur, vague scribouilleur comme... (non !, ne me suis-je pas promis de ne point facilement confondre la créature de papier et son créateur de papier mâché ?), reprenons : ou, nous assure le narrateur, «armer [s]a bouche» (p. 35), ce qui sans aucun doute nous permettra de percevoir, enfin, «l'avènement d'autre chose» (p. 37).
Notre narrateur a beau s'armer, y compris armer sa propre bouche, la litanie des questions pressantes n'en finit pas de s'étirer : «Comment dresser une vie au sein d'un tel limon ? Comment conférer à l'existence ne serait-ce qu'une forme acceptable ?», demande notre baratineur graphomane, qui estime que lui et les siens sont «acculés à l'héroïsme» (p. 51). Autant de questions vibrantes de lyrisme qui étaient au fond celles du texte ridicule intitulé Pneuma, sorte d'apostille au précédent texte de l'auteur, pensum lui-même gonflé à l'hélium de la nullité suffisante indiqué plus haut. Ce que cherche Romaric Sangars, comme tant d'autres d'ailleurs de sa génération dolente et vide, derrière son masque de minet de la réaction à petite moue significative et griffes translucides, c'est la possibilité d'une fondation, tout autre chose, en somme, que le fait de perdre son temps «dans les marges stériles de [s]on destin, autre chose que la platitude rationaliste de l'Europe» (p. 55) contemporaine. Il faut donc trouver une sortie, de préférence par le haut, «à rebours du monde tel qu'il s'était vautré dans la plus vertigineuse platitude», à savoir une «horizontalité binaire, sans vraies percées possibles» qui tente d'annexer «depuis plusieurs années» notre personnage principal, et contre quoi il doit se «révolter avec ce qu'il [lui] restait de fureur dans l'âme» (pp. 66-7).
Les moyens de creuser cette verticalité, si je puis dire, dans le béton d'une société tout entière dévorée par la prédation financière (cf. p. 154) sont assez limités, non seulement tels que Romaric Sangars les figure dans son roman pour mirliflore et demi-mondaine, mais de manière réfléchie, spéculaire : ils sont donc d'abord stylistiques puis, en un sens plus élevé qui ne peut que nous intéresser davantage, ils touchent à l'acte même d'écrire tel que le conçoit l'auteur.
Ne nous attardons point trop sur le style de l'ouvrage (1), grandiloquent et creux le plus souvent, même si, parfois, une ou deux fois plutôt tout au plus, il est capable de nous surprendre par une image non pas originale, mais moins banale que les autres (2). Il me semble plus instructif d'examiner le propos philosophique, si je puis dire, qui sous-tend l'ensemble de cette farce pour adolescent lecteur de bandes dessinées sur la chouannerie. Là aussi, car la profondeur métaphysique rêvée par Romaric Sangars peut aisément tenir en une ligne, ou même dans un seul slogan de Causeur, nous ne perdrons pas trop de temps, car il me presse de confronter le texte à son auteur, puisque je suis fidèle à l'excellent précepte bloyen (3) selon lequel il ne faut jamais perdre de vue que le coup de trique donné à un mauvais livre doit aussi (d'abord) tomber sur les épaules de celui qui l'a écrit. Quel serait ce slogan ? Ma foi, nous pourrions le trouver plaisamment signifié dans notre roman, en prenant ici ou là quelques termes et en les recomposant de la sorte : toi, inconnu, rejoins notre conjuration des insoumis pour t'épargner la désillusion de vivre «dans une époque où le libéralisme amoureux avait produit sur les cœurs autant de ravages que, dans la société civile, le libéralisme économique» (p. 42). Voilà qui ne ressemble guère à un slogan, me fera remarquer le lecteur qui, à tout le moins, aura flairé dans cette tirade quelque houellebecquisme mal digéré. Mon lecteur a raison mais, comme Romaric Sangars est un mauvais auteur, quoique gentil garçon fort serviable, voici qu'il s'est lui-même exécuté et qu'il nous apporte, sur le plateau encombré de glaçons qui fondent hélas trop vite, la courge déjà blette préparée par ses soins, ridicule mélange quoique bio, nous assure-t-il, d'un hermétisme d'un Paul Celan enrhumé qui aurait été traduit en haïku dans l'idiome bréhaigne d'une Christiane Taubira : «Méfiez-vous car nos pupilles méditent leurs fusées pâles», un slogan expéditif écrit «au feutre sur le pan gauche d'une vitrine [de chaîne américaine dégradant] nos rues par sa vulgarité de parc d'attraction», vitrine qui finira brisée grâce à l'athlétique Emmanuel Starck, ou encore, parce que la bêtise se renforce toujours d'être répétée : «Empruntons résolument les voies rouges et sans virage» (p. 146), un slogan au moins aussi allusif que le précédent et que le narrateur du livre nous avoue inscrire sur le ventre de sa conquête moins complexe que compliquée, «avec son lipstick» et non, banalement, son rouge à lèvres, avant tout de même, car on a beau être un sot à prétentions littéraires on n'en est pas moins un homme viril, «que de la pénétrer encore» (p. 146).
Cette plaisante évocation ne peut qu'en appeler une autre, qui lui est directement liée puisqu'il s'agit de la description, ô combien réussie, d'une scène d'amour entre le narrateur et sa dernière conquête, «jeune femme inspirée» nous dit la quatrième de couverture, Lia Silowsky, vague égérie tout droit sortie d'une ligne sous mauvais acide de roman de Maurice G. Dantec, voire tout bonnement connasse transgénique autour de laquelle enfle «comme une sphère d'altitude, de nuit, de feu» (p. 108), qui a besoin de fumer «des joints d'herbe pure» afin de «recalculer sa position terrestre» (p. 103), ce qui lui permettra, après moult atermoiement qu'on devine justifié par des préoccupations absolument hors de notre portée, de se refaire quand même pénétrer par le narrateur durant quelques jours d'orgie bien évidemment gnostique, donc sacrificielle, pure, lumineuse en un mot : «Lia flanchait dans des lueurs blêmes. Ses reins cambrés, ses seins vibrant, et puis ses hanches déclinaient leurs courbes; nos halètements, régulièrement, accéléraient; la salive, si souvent, luisait sur nos peaux; cuisses nouées pour nous assurer le long du vertige, nous basculions dans cette aspiration première, nous nous rattrapions désespérément l'un à l'autre alors que se précipitait l'ascension en chute libre» et, connerie finale de cette dégringolade (du style ?) ascendante ou l'inverse, «dents contre dents, nous murmurions des inepties au gouffre» (p. 130) ce qui, ma foi, ne peut que confirmer qu'il doit être difficile, pour un homme normalement constitué, de faire l'amour à une femme dont les seins vibrent. Une telle débauche d'effets pyrotechniques, même s'ils ne sont pas bien maîtrisés par notre amateur de pétards mouillés stylistiques, est après tout le minimum que nous puissions attendre de la collision entre deux âmes aussi complexes que celles de Vincent Revel et de la séraphique Lia Silowsky, n'est-ce pas ? En tout cas, la mission que se proposait le narrateur (je la rappelle : «pénétrer l'infini», cf. p. 30) a trouvé par ce biais sa réalisation la plus concrète, et c'est ainsi que nous pouvons saluer le fait que, après avoir été amorcée (cf. p. 10), l'âme du narrateur soit enfin rallumée (cf. p. 131) et qu'elle se mette même, à l'unissons de cette paire de seins vibratiles, à danser la gigue. Tout s'expliquerait, peut-être, à condition de supposer que Romaric Sangars ait pu si facilement confondre l'âme avec une pompe à vélo ou bien un réchaud à gaz.
Notre hypothèse se vérifie quelques lignes plus loin, puisque nous constatons que c'est bel et bien la «lampe centrale» du narrateur qui «semblait avoir emmagasiné de quoi [l']illuminer en toute circonstance» (p. 132) par le biais de cet accouplement avec un être visiblement supérieur, quelque créature eschatologique supra-sensible avec laquelle il lui est possible de se charger «réciproquement dans un débit exponentiel» (p. 140), de ne chercher «plus dans la femme qu'un genre d'autel où se tuer» (p. 99), de flotter tous deux «inertes au sein de quelque vide intermédiaire», le temps toutefois de se «remettre un rien» avant de reprendre «cette opération si obsédante que figurait pour [eux] le choc de [leurs] atomes» (p. 141), d'accélérer «les connexions mentales» aussi bien que «les fusions alchimiques», en vue, comme il se doit dans pareil couple stratosphérique et même extra-galactique, «de forcer la destinée» (p. 138) mais aussi, et je vous prie de croire que ma petite liste n'est absolument pas exhaustive, de «soumettre le temps à une scansion supérieure» (p. 166), d'autoriser «le grand tournoiement d'un mystère» (p. 168; Yannick Haenel, sors du pauvre corps martyrisé de Romaric Sangars !), afin, conclusion pour le moins provisoire à ce déchaînement cosmique ébranlant tous les éons et affectant les hiérarchies des anges depuis le trou puant de l'Enfer jusqu'au trône de lumière de Dieu, que «l'intime se télescop[e] au cosmique» (p. 169).
Nous pourrions continuer à nous amuser en relevant d'innombrables autres sottises, puisque Romaric Sangars, qui n'est pas l'ami de Jacques de Guillebon pour des nèfles ou des dragées de communion, a ouvert à fond le robinet des truismes et des fadaises grandiloquentes et sotériologiques mais, après tout, le lecteur assez fou pour aimer perdre son temps pourra acheter Les Verticaux, un premier roman qu'il est impossible de lire couché ou même assis tant il vous force à vous redresser, l'esprit concentré sur le déchaînement prochain de la foudre déclenchée par les Trônes et les Puissances invisibles qui gouvernent ce monde banal, et y compris même celui, absolument exceptionnel, comptant un nombre impressionnant de purs et de parfaits, des éditions Léo Scheer.
De peur d'égarer mon lecteur dans la jungle obscure dont la voie est plus qu'étroite, je vais à présent m'atteler à mon exercice préféré, qui consiste, somme toute, à placer la création sous les yeux de celui qui l'a créée, et à me borner à constater, en juge-pénitent camusien inflexible, de quelle façon la créature juge son créateur, et non l'inverse, car nous savons par avance qu'un fat est toujours fier de son éjaculat, fût-il incapable de fertiliser un pois chiche.
Nous avons affirmé plus haut que c'était la possibilité d'une fondation qui démangeait la joue imberbe de Romaric Sangars, comme le ferait un vilain bouton d'acné juvénile, lui qui ne cesse, par l'intermédiaire de ses personnages, de sonder les reins creux de notre époque tout entière soumise à «la farce multiculturelle» (p. 165), unique ciment, mais ô combien friable, de «cette espèce de conglomérat incohérent qui se fomente dans les Babylone mondialisées et que seul soude le commerce» (pp. 163-4). Il est intéressant de constater que le lien unissant nos conjurés métaphysiques, outre l'ennui qu'ils éprouvent devant «l'interchangeabilité mécanique où pourrit l'univers» (p. 16), tient d'abord à une notion que Romaric Sangars a bien raison de croire à peu près perdue, puisqu'il l'illustre lui-même de très piètre façon, je veux parler de l'honneur, un mot majestueux qui, dans le texte de l'auteur, exsude comme une olive son huile de mielleuses tirades sur la nécessaire compénétration entre icelui et les actes qui ne peuvent que logiquement s'ensuivre : «Or, l'honneur des mots, c'est qu'ils soient suivis d'actes» (p. 69), est-il ainsi pompeusement déclaré par l'auteur qui, sauf erreur de ma part, n'est toujours pas allé gifler le vieillard D'Ormesson pour redresser la gueule de la littérature française, et n'a même pas voulu me casser la figure pour avoir prétendu que son précédent livre, s'il était une gifle administrée à l'écriture, était aussi une claque magistrale, voire un franc coup de pied au séant de la vraie force pamphlétaire, cette chimère que jamais n'atteindra notre chasseur si inexpérimenté. Certes, aurez-vous beau jeu de me faire remarquer, cette action peu banale et peut-être même salutaire, c'est dire comme je suis prêt à comprendre le furieux désir de beignes et de coups de pied au cul dont témoigne le katanesque Romaric, certes, cette action n'était-elle prudemment envisagée que comme une interrogation, mais il n'en reste pas moins qu'il nous est parfaitement intolérable d'imaginer qu'un écrivain qui ne cesse d'appeler à une «révolution intérieure» (p. 82), qui manifeste chez son narrateur au moins par deux fois une sainte envie de gifler (un crétin cynique et l'immarcescible sphynge Lia), qui exige que nous tenions compte de «la vie dans toutes ses conséquences» et que nous dépensions moins de lest mais «plus de fuel» (p. 83), qui nous demande de prendre nos responsabilités plutôt que de mariner dans le fantasme (cf. p. 82), qui nous rappelle, presque toutes les pages de son laborieux roman, que «notre guerre [est] métaphysique» et que «notre puissance de feu, c'est de haut qu'elle [doit] s'exercer" (p. 87), qu'un tel écrivain donc, tout sonnant de mots gonflés aux stéroïdes d'un lyrisme à peine digne d'une foire des poètes chantant l'inauguration du rond-point de Boue-sur-Glaise, puisse se révéler largement au-dessous de l'exaltante et prométhéenne mission dont il nous bassine et serine les oreilles à longueur de textes sans pesanteur, comme éthérés d'avoir confondu la réalité rugueuse à étreindre avec ses phantasmes de renouveau.
Plusieurs indices, sous les caverneuses sentences marmoréennes, nous permettent toutefois de renifler l'odeur rance, aigre, caractéristique des imposteurs. Remarquons ainsi que les actions soi-disant révolutionnaires que mettent en branle nos conjurés à la petite semaine sont, bien davantage que des renversements de l'ordre honni établi, de pathétiques happenings (le terme est écrit quelque part) qui systématiquement jurent entre la noblesse des intentions et la maigreur des résultats : discours de Churchill que le grand conspirateur Emmanuel Stark parvient à diffuser à la place d'une programmation plus festive (cf. p. 85), lapin égorgé je l'ai déjà indiqué (cf. p. 49), publicité pour Apple détruite par le feu (cf. p. 124), intrusion lors d'une réception d'entreprise censée, criminellement, «célébrer ses ahurissants bénéfices» (cf. p. 149), etc. Il n'y a donc pas que l'héroïsme qui soit une ivresse (cf. p. 92), mais aussi l'imposture du poseur qui s'imagine un destin glorieux au travers d'un personnage caricatural, Emmanuel Starck, censé avoir «renoncé à la trajectoire d'une carrière pour évoluer dans une suite de cercles qui s'étaient faits concentriques» (p. 94; Yannick, encore toi !), et n'ayant à la bouche d'autres mots que ceux d'honneur, de force et de «gloire de se risquer» (p. 102).
Car enfin, qui peut défendre sérieusement la cause littéraire de Romaric Sangars, dandy nocturne habitué de tous les grégarismes consensuels à tropisme rebelle, cosaque mollasson de salon beige bien davantage que félin solitaire fulminant, avec pour seules griffes sa langue implacable, contre la veulerie de l'époque ? Qui pourrait affirmer que ce béjaune permanenté lorgnant un coup sur Des Esseintes (cf. p. 172) et Durtal découvrant les beautés du catholicisme, un autre sur Caïn Marchenoir fixant la mirifique laideur de sa promise (cf. p. 175), sans jamais nous convaincre dans l'un et l'autre cas de ses troubles intentions (4), qui pourrait croire que ce ravi permanent du faux style comme on l'est de la crèche, ce ventriloque de la solitude, de l'intelligence, de la force parodiée à toutes les lignes aussi légères que des bulles de ce lavement pour pucelle et demi-mondaine confondant Netchaïev et titi parisien et, le mot est lâché, bien que réduit par l'intéressé à un caniche exécutant son petit numéro savant, de l'honneur, qui peut affirmer sérieusement, sans rire immédiatement devant un conspirateur dont la planque est le très luxueux Bedford où Léo Scheer naguère tenait (tient encore ?) salon et l'arme préférée un repoudrage de nez, que Romaric Sangars, à l'enseigne fallacieuse de ses héros, évolue «à rebours de ce que l'époque affichait comme standard : l'être décontracté, modelable, pusillanime, sentimental, dissimulant sous des liquides sucrés un égo de glace» (pp. 121-2) ? Quel héraut point totalement soumis à l'impératif catégorique consanguin pour oser prétendre que Romaric Sangars fait partie de ce cercle de conjurés «nostalgiques des magies mortes» (p. 124) ne cherchant «aucune influence directe» mais simplement un bénéfice symbolique et un «scandale indéchiffrable» (p. 134), ou bien pour l'imaginer, tel son personnage Emmanuel Starck, marcher en effectuant «des katas, frappant l'air de coups de poings subits, nerveux, puissants» (p. 136) qui pourraient le réconcilier «avec des vitesses défuntes» (p. 137) ?
Il y a un gouffre entre la prétention de ce faiseur, pas même habile, qui clame s'opposer à la progression de «la dévastation» (p. 142), prétend considérer «les épaves de leur futur» comme «les matrices de notre avenir» (p. 143), indique veiller «simplement à ce que ne s'achève pas la fièvre» (p. 148), et ne parvient pourtant jamais à rendre crédible ses déplorations ou, encore plus banalement, à rendre sincère son texte, à l'incarner, à s'incarner, prendre corps et chair, dans ces mots pompeux et vides qu'il ne cesse de gauchir et faire mentir, les ayant dressés pour la parade sous quelques peu nombreux regards journalistiques qui eux, depuis toute éternité médiatique semble-t-il, ont parfaitement oublié le saint commandement selon lequel les mots doivent non seulement modeler «nos attitudes», mais risquer «nos corps» (p. 149). Que risque Romaric Sangars à aligner ses petites phrases, aussi peu inventives que ses poses de dandy caressant distraitement le dernier sceau de l'Apocalypse, sur le zinc d'un lyrisme en toc, où les plus mauvais cacographes de sa génération et de plus vieux que lui ont posé leur sirop d'orgeat ?
Quelle est encore la violence censée offrir à celui qui en use «un minimum d'attention», à condition, nous dit l'auteur, «qu'on eût vraiment quelque chose à exprimer» (p. 151), quelle est la violence symbolique d'un texte aussi peu profond que Les Verticaux, énumérant tous les poncifs d'un anticapitalisme bon teint (cf. p. 154), vieille rengaine déjà honorablement décrépite à l'époque où des hommes mouraient pour de bon afin d'instaurer le nouvel ordre marxiste, à celle encore où le sourd de Martigues appelait au coup de force et où d'autres hommes se réclamant de ses idées, incarnaient, eux, pour le coup, les grands mots par des actes, comme Paul Dungler que cite d'ailleurs Romaric Sangars (cf. p. 162) en guise de saint patron chargé de convertir pieusement sa tranquille hébétude en actions de grâce et formules pour catéchisme de scout d'Europe ?
«L'honneur», nous dit le narrateur, «voilà qui était essentiellement une question de langage, une garantie du langage, le sang à verser afin d'authentifier l'encre» (p. 157), pieuse intention vaguement nietzschéenne n'engageant à rien, corne de taureau en carton pâte qui fera frémir les freluquets dont les gosiers délicats sont rincés au Champomy et qui ne manqueront pas de saluer comme il se doit, d'une pétarade peu harmonieuse exhalant leur peur, le nouveau Gauvain des veuves et des orphelins minaudièrement révolutionnaires, Romaric Sangars, puisqu'il suffit, de nos jours, d'écrire le roman de la révolte pour paraître révolté, de la force pour sembler fort, de la détermination pour être considéré comme déterminé, puisqu'il suffit d'écrire un premier roman verbeux et soporifique, massicotant les truismes tant ils dépassent de toutes les pages, pour passer pour un écrivain de talent.
Nous aurions pu conclure notre longue note sur un roman consacré à la verticalité par cette chute, quitte à la compléter de quelques plaisantes notations sur ces «bouffons [qui] règnent en maîtres» «au sein du débat public» (p. 187), épingler telle tirade philosophique à usage des cœurs inconsolés («Tant il est vrai que dès lors qu'on n'arrive plus à vivre pour de vrai, on cherche systématiquement à se tuer pour de faux», p. 190), moquer, une fois de plus car l'occasion est trop belle, le ridicule Emmanuel Starck, jamais avare d'une consternante platitude, dont la complication elle-même factice est inversement proportionnelle à la réelle portée («Se ruer sur l'épreuve, afin de s'y parfaire. C'est ça, l'engrais de l'existence. L'obsession du confort a laissé l'homme moderne en friches», p. 193) et, de guerre lasse, renvoyer nos lecteurs à de mâles lectures, dont l'une a condensé et même, à coup sûr, épuisé dès sa première page tous les fantasmes de virilité et de force de Romaric Sangars (5), mais une dernière maladresse demande d'être examinée.
En effet, quelques pages avant que ne commence, heureusement, le dernier chapitre de son roman, Romaric Sangars croit utile d'évoquer, d'ailleurs assez efficacement, un attentat islamiste en plein Paris, occasion d'une analyse socio-politique de haut vol, que tout lecteur fût-il passable de Nabe, de Dantec ou de Muray, et même de Causeur, tiens, saurait répéter avant même de l'avoir lue, et que même une Louise Pasteau serait capable de comprendre (notons que je ne suis pas tout à fait certain de ce que j'avance imprudemment). Tout à fait banalement, nous découvrons ainsi que l'ennemi islamiste incarne le «négatif pur» de nos conjurés alors que, pour ma part, je ne vois qu'un même nihilisme à l’œuvre chez ceux qui ont «tout profané, tout ramené à la marchandise» et ceux qui sont prêts à «tout immoler, à tout offrir au néant par le feux de [leur] faux sacré» (p. 203). De sorte qu'il est impossible qu'Emmanuel Starck, restant il fallait s'en douter «éloquemment solaire» (p. 209) une fois qu'il a décidé de combattre les armes à la main, et dont «une rainure de lumière blanche lui faisait parfois l'équivalent d'une peinture de guerre» (p. 203), puisse affirmer que c'est face aux barbus fous de Dieu que l'honneur, «le sens fondamental d'une nation et la pérennité de ce sens» doivent être interrogés, et qu'il faille en conséquence se jeter dans cette réalité «comme des grenades», notre phraseur impénitent n'oubliant évidemment pas, pour bien nous montrer comme il est méchant, d'arracher «avec les dents le cellophane d'un paquet de cigarettes neuf, imitant l'acte de dégoupiller un engin explosif» (p. 205). Curieusement, le narrateur admet lui-même que les médiocres et les djihadistes ne sont les uns et les autres que des hommes creux (cf. p. 208) et même si «l'exigence de conclure» le presse, puisque «l'existence [doit] se déployer comme une phrase» (p. 208), il n'en peut néanmoins pas résister à la pente de la facilité, alignant les fadaises sur les «abandonnés du Verbe» (p. 209), rédigeant, on le devine fébrilement, un plaidoyer pro domo dont la substantifique moelle ferait d'office effet de consternant prérequis dans le plus miteux des forums d'extrême droite, sur la haine de la France inculquée au tueur islamiste par son ancien professeur (cf. p. 212) haïssant lui-même la France parce qu'il est un gauchiste, puis finissant par faire tuer son héros, Emmanuel Starck, d'une belle mort qui sera citée en chœur par tous les planqués d'Internet rêvant de bouter l'Arabe (l'Arabe, oui, l'islamiste n'étant qu'un commode paravent) hors de France, et qui sera peut-être même rapprochée, du moins par les plus audacieux, du spectaculaire suicide de Dominique Venner, Samouraï d'Occident dont s'est peut-être souvenu Romaric Sangars pour imaginer son paltoquet irrémédiablement bavard. Pour un peu, nous pourrions indiquer Les Verticaux dans la liste de ses romans plus ou moins récents qu'obsède la question du Grand Remplacement popularisée par le vieil hibou solipsiste de Plieux, Renaud Camus.
La suite du roman de Sangars ne vaut guère la peine d'être citée, mais faisons remarquer qu'elle contrevient à la règle fixée par l'auteur qui rêve d'une «formulation nette» (p. 208) donnant forme aux mots et aux actes, puisqu'il ne les sépare pas, à raison bien sûr. Romaric Sangars, expert en martialités, ne sait apparemment pas réparer un banal robinet qui fuit, ce qui provoque plusieurs débordements de bassine : ainsi notre paumé, Vincent Revel, paumatise donc, s'interroge avec force trémolos sur le sens du dernier acte de son ami samouraï, commence à voir son aimée, Lia internée chez les fous, de la même façon que Caïn Marchenoir lorgnait celle qui, avant de devenir sainte, fut pute, La Ventouse, même si Sangars, qui n'est pas Bloy nous l'avons bien remarqué, parle, lui, à propos de son héroïne de bande dessinée japonaise, de «quelque chose d'autre, de paranormal, d'étrange et mystique [passant] à travers elle» (pp. 215-6), ou bien tandis que l'auteur campe, la main en visière sur l'horizon rebelle, son personnage en porte-voix officiel de tous les héros de 12 ans, et le dresse face à toutes celles et tous ceux qui n'auront rien fait d'autre, de leur vie, que «vaseliner le désastre» ce qui est en effet peu de chose avouons-le, sans oublier de lui accorder quelques heures de méditation sur «l'épure du sabre» (p. 222) une fois qu'il occupera la cellule de feu son ami moine-soldat, Emmanuel Starck qui ne sera considéré comme un fou, un meurtrier ou un fanatique (ou bien les trois ensemble) que par le troupeau des Français ne perdurant plus «que dans la boue» (p. 221), lui faisant même prononcer une tirade, heureusement la dernière mais tout aussi convenue que toutes celles qui l'ont précédée, sur «la religion droit-de-l'hommiste, cette vague superstition terminale dénuée de fondements» (p. 225), lui prêtant encore l'intention d'écrire un livre, celui-là même que nous venons d'achever de lire, à la gloire de ses amis qui, «au sein de l'ère plongeante qui est la nôtre», lui sont apparus «comme les dernières allusions au soleil» (p. 226 et dernière), néon de prétention plutôt que rai de lumière, maigrement diffracté par un miroir assurément déformant, puisqu'il aura fait croire à Romaric Sangars, non pas archange mais palefrenier du fade (6), il est vrai influençable comme tout esthète de salle de rédaction, et à deux ou trois insignifiants imbéciles dont c'est l'habitude de parasiter et de flatter, qu'il est un écrivain.
Notes
(1) Puisqu'il paraît qu'il faut toujours observer une certaine mansuétude à l'égard d'un premier roman, nous ne relèverons pas l'ensemble des facilités et des clichés les plus jaunis qui figent le texte dans une curieuse ambivalence entre l'ambition du propos, absolument phénoménale, et les moyens dérisoires qui lui sont affectés, et ne noterons que tel ou tel exemple d'époustouflante banalité comme : «jeune couple hébété» (p. 10), ou encore les portes coulissant dans un très original «froissement de tôle» (p. 13), mais aussi une séance copulatoire où les personnages font «l'amour d'une manière ardente et désespérée» (p. 41), mais encore le sérieux du terroriste de papier Emmanuel Starck s'estompant, lui, «dans l'éclat enfantin de son sourire» (p. 47), ou aussi telle ignoble volonté de se «placer avec elle sur le plan de la séduction» (p. 57) voire, stochastiquement prélevé dans un champ textuel qui fourmille de courges et de navets arrosés d'engrais scheerien, très réputé lorsqu'il s'agit de faire pousser des plantes sans racines, «quelque chose de la souveraineté des grands fauves» (p. 160) que n'eût point dédaigné le commentateur d'un reportage animalier sur nos amis les félins. Nous aurions au moins pu espérer qu'un éventuel relecteur, officiant paisiblement à sa tâche en étant confortablement installé dans un profond fauteuil club du Bedford, un verre de bourbon à la main, un stylo rouge dans l'autre, supprime discrètement ces monstruosités que n'oseraient même pas les plus médiocres cracheurs de ligne de la série Harlequin ! Un bon relecteur à défaut d'un bon éditeur eût aussi pu faire réécrire à Romaric Sangars certaines scènes, comme celle où Emmanuel Starck, sorte de foyer concentrant les inepties, sabre «d'un revers de katana» le champagne (p. 91), où celle encore où Justine exprime le but de nos conjurés germanopratins «en ayant recours à une acrobatie : de la place où elle se tenait, elle se hissa au bout de ses bras pour exécuter un arbre droit, et elle avança jusqu'au milieu de nous en marchant sur les mains, son corps oscillant dans l'espace». Il est vrai, clame l'auteur, qu'il s'agit à toute force d'être «verticaux à leur en foutre le vertige» (p. 93), mais tout de même. Il est vrai aussi que cet hypothétique relecteur, à moins qu'il n'ait été totalement incompétent, a laissé passer un fâcheux «à proprement parlé» (p. 163) et un nombre important de ce que je tiens pour de vilains tics défigurant par exemple la prose eunuque d'un Yannick Haenel ou d'un François Meyronnis, à savoir les inversions (exemples : «Déjà se déroule-t-elle sous mes yeux à peine filtrée sépia, cette journée» (p. 69), «Et il était clair, le rire de Lia» (p. 125) ou bien «Ce temps libre que je me félicitais d'avoir su me réapproprier, il n'était plus qu'un champ vierge» (p. 97)). Il est vrai enfin que ce relecteur improbable eût également dû corriger cette curieuse manie, sans cesse répétée tout au long du texte de Sangars : «Rassure-toi, mon amour : pas le moindre risque.», lui avais-je répondu» (p. 43), où aucune raison, de quelque ordre que ce soit, n'explique la présence d'un point précédant des guillemets fermants, la convention étant au contraire de supprimer celui-ci lorsque la phrase ou le passage contenant la citation entre guillemets n'est elle-même point finie.
(2) J'avoue platement avoir aimé la métaphore comparant le temps libre du narrateur avec «un champ vierge que venait labourer le rotor de [s]on obsession» (p. 97), ou encore cette poétique «balle de l'espérance» (p. 117). C'est tout de même peu, pour sauver un texte de l'insignifiance.
(3) «Les œuvres et les hommes sont immédiatement solidaires, sous peine de néant, et quand l'œuvre mérite la trique, c'est sur les omoplates de l'homme que la trique doit tomber et, infatigablement, ressauter», Propos d'un entrepreneur de démolitions [1884], in Œuvres de Léon Bloy, t. II (Mercure de France, 1964), p. 77. Il va de soi, mais je me dois quand même de le préciser étant donné que plus personne ou presque ne sait lire, que je me contrefiche de la vie privée de Romaric Sangars qui, statistiquement, comme toutes les nôtres, doit avoir ses moments de grandeur ou de bassesse, ou même être tout bonnement médiocre, ce qui est le plus probable si j'en juge ses textes poussifs. Il pourrait être un saint ou un meurtrier, et même un journaliste parfaitement insignifiant comme l'indique sa biographie, que cela ne changerait absolument rien au jugement que je porte sur son roman, et à celui que son roman porte sur la production littéraire de Sangars.
(4) «Tu ne serais pas un peu réac ?», demande, mollement, Loreley au narrateur, qui se permet de lui répondre par un jeu de mots dont nous pouvons apprécier la prodigieuse saveur : «Un réacteur... lui répondis-je. Oui... Un putain de gros réacteur...» (p. 184), toutefois à pile catholique, et qui lorgne assez peu discrètement vers les beautés du christianisme, à condition qu'il soit esthétique et, bien sûr, infantilement martial : «Il y avait décidément dans le christianisme une poésie et une puissance de retournement paradoxal qu'on était bien en peine de trouver chez les sectateurs binaires du Vivre-Ensemble, lesquels ne paraissaient être, en fin de compte, que des illuminés pratiquant de manière béate une forme d'ingénierie ethno-sociale sur le bruit de fond des gigantesques dérèglements qu'engendrait le capitalisme global» (pp. 173-4). Le style en plus, Huysmans eût pu écrire la première partie de ce passage et, à style à peu près égal, Michel Houellebecq l'ensemble. Il est finalement assez drôle de voir de quelle manière nos esthètes retrouvent, peut-être même sans rien en savoir (je parle pour Romaric Sangars, Houellebecq étant un excellent lecteur, y compris de textes que jamais il ne cite), les débuts de l'exploration d'un Durtal, sans même se rendre compte qu'ils sont condamnés à l'échec de Des Esseintes. Nous suggérons à Romaric Sangars, jeune premier plein d'allant et surtout d'entregent, alors que Michel Houellebecq, bientôt, ne sera plus qu'un probable sujet de mémoire, de bien relire ou plutôt lire le plus possible de livres, avant que de rêver devenir une espèce de Muad'Dib de la réaction pour dunes de Paris Plage.
(5) Un lecteur pressé pourrait même se contenter d'une seule phrase écrite par Maurice Barrès dans le premier chapitre de ses Déracinés : «La grande affaire pour les générations précédentes fut le passage de l'absolu au relatif; il s'agit aujourd'hui de passer des certitudes à la négation sans y perdre toute valeur morale», in Les Déracinés (préface de François Broche, Bartillat, coll. Omnia, 2009), pp. 20-1.
(6) Rappelons que celui-ci a donné à Jean d'Ormesson de l'«Archange du tiède».




























































 Imprimer
Imprimer