« Enseigner la Shoah de Didier Durmarque, par Gregory Mion | Page d'accueil | Les Sommets du monde de Pierre Mari : lorsque le coq chante comme un cygne, par Gregory Mion »
10/05/2017
Defalvard dans le narthex, par Guillaume Sire

Rappel.
 Marien Defalvard dans la Zone.
Marien Defalvard dans la Zone. Guillaume Sire sur La Chanson d'amour de Judas Iscariote.
Guillaume Sire sur La Chanson d'amour de Judas Iscariote.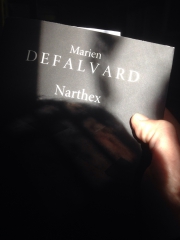 Je n’ai jamais su comment aborder un recueil de poèmes. Je ne sais pas l’attraper, quoi en faire, tourner les pages, pourquoi, jusqu’où. J’ignore s’il faut lire ou non le sommaire. Et la lumière, dites moi : quelle lumière faut-il ? L’ampoule ou la bougie, la braise, le radiateur ? Faut-il avoir froid ? Je sais lire un poème, naturellement, et si la modestie n’était pas de mise je me vanterais d’être un des meilleurs lecteurs de poème de ma région; mais je ne sais pas en lire plusieurs attachés ensemble, et si je ne sais pas faire cela c’est précisément parce que j’excelle en ceci. On ne peut pas avoir entre les mains plusieurs fois l’infini. Une seule ode de Claudel me suffit pour les cinq. Il y a dix millions d’odes de toute façon dans chacune et j’ai vécu grâce à elles environ cinq milliard d’années. La chair est triste, hélas ? Tant pis ! Lorsque je lis Le bateau ivre, tout se tait en moi. «Les cordes profondes», les appelait Novalis, s’unissent en silence, c’est à-dire que l’unité dans mon for intérieur a soudain lieu sans confusion. Et c’est cela la poésie, oui c’est exactement cela : du silence, autrement dit l’art «sous tout ce qui se dit, de tout ce qui se tait» (cet alexandrin, faut-il le préciser, vient de Péguy). Parfois, je n’arrive même pas à aller au bout du poème, le transport est trop grand, et je suis épuisé, détruit, défait. La chanson du Mal aimé, par exemple, dont il a fallu m’évacuer comme d’un champ de bataille. Bref, les recueils ne sont pas pour moi. Explosifs, trop dangereux. Editeurs, il me faudrait un livre de deux cent pages pour chaque sonnet de Shakespeare : le sonnet sur une page, mettons la dixième, un verso évidemment, et le reste pour éponger le sang, moucher la bête, sécher sur le tison les larmes et la semence. Si j’étais ministre de l’intérieur, je proposerais sans attendre que les pages blanches soient financées par le contribuable comme ces thérapies dont l’Etat gratifie les otages une fois libérés. N’est ce pas cela dont il s’agit : un enlèvement ? Hélas, j’ai bien peur que le recueil broché continue à être privilégié parce qu’il est plus intéressant du point de vue commercial. On rationnalise, sans doute parce qu’on n’a pas tout à fait oublié le déluge.
Je n’ai jamais su comment aborder un recueil de poèmes. Je ne sais pas l’attraper, quoi en faire, tourner les pages, pourquoi, jusqu’où. J’ignore s’il faut lire ou non le sommaire. Et la lumière, dites moi : quelle lumière faut-il ? L’ampoule ou la bougie, la braise, le radiateur ? Faut-il avoir froid ? Je sais lire un poème, naturellement, et si la modestie n’était pas de mise je me vanterais d’être un des meilleurs lecteurs de poème de ma région; mais je ne sais pas en lire plusieurs attachés ensemble, et si je ne sais pas faire cela c’est précisément parce que j’excelle en ceci. On ne peut pas avoir entre les mains plusieurs fois l’infini. Une seule ode de Claudel me suffit pour les cinq. Il y a dix millions d’odes de toute façon dans chacune et j’ai vécu grâce à elles environ cinq milliard d’années. La chair est triste, hélas ? Tant pis ! Lorsque je lis Le bateau ivre, tout se tait en moi. «Les cordes profondes», les appelait Novalis, s’unissent en silence, c’est à-dire que l’unité dans mon for intérieur a soudain lieu sans confusion. Et c’est cela la poésie, oui c’est exactement cela : du silence, autrement dit l’art «sous tout ce qui se dit, de tout ce qui se tait» (cet alexandrin, faut-il le préciser, vient de Péguy). Parfois, je n’arrive même pas à aller au bout du poème, le transport est trop grand, et je suis épuisé, détruit, défait. La chanson du Mal aimé, par exemple, dont il a fallu m’évacuer comme d’un champ de bataille. Bref, les recueils ne sont pas pour moi. Explosifs, trop dangereux. Editeurs, il me faudrait un livre de deux cent pages pour chaque sonnet de Shakespeare : le sonnet sur une page, mettons la dixième, un verso évidemment, et le reste pour éponger le sang, moucher la bête, sécher sur le tison les larmes et la semence. Si j’étais ministre de l’intérieur, je proposerais sans attendre que les pages blanches soient financées par le contribuable comme ces thérapies dont l’Etat gratifie les otages une fois libérés. N’est ce pas cela dont il s’agit : un enlèvement ? Hélas, j’ai bien peur que le recueil broché continue à être privilégié parce qu’il est plus intéressant du point de vue commercial. On rationnalise, sans doute parce qu’on n’a pas tout à fait oublié le déluge. Vous comprenez maintenant pourquoi je n’ai jamais donné mon sentiment sur un recueil. Et vous vous demandez peut-être pourquoi j’ai décidé de le faire pour le Narthex de Marien Defalvard. Disons que j’ai le sens de l’histoire. Tous ceux qui ont eu entre leurs mains Du temps qu’on existait savent que Defalvard est une des plus grandes voix de notre temps. C’est ce qui se fait de mieux dans une époque où il n’y a pas grand chose de bien. C’est pourquoi d’ailleurs les observateurs du sixième arrondissement se sont empressés de l’écarter. Leur instinct ici, et malgré eux – leur instinct de boutiquiers – ne s’y est pas trompé. Depuis Platon, on sait quel sort est réservé aux poètes. Defalvard sera moins gênant une fois mort. Pour l’instant, il est marginalisé et surveillé comme une espèce de terroriste. On attendra que ses tempes soient froides pour lui bâtir une statue dans le centre-ville de Clermont-Ferrand et faire l’apologie des crimes par lui commis contre l’humanité. Les pédagogues feront leurs pirouettes, la déesse enregistreuse publiera des rapports, et sans doute y aura-t-il une oraison et d’autres journées d’étude en Sorbonne; les maîtres de conférence ont besoin de manger.
Je n’ai pas l’impression de faire un compliment quand je dis que Defalvard est une des grandes voix sinon la plus grande d’un siècle qui maintenant a dix-sept ans et qui est sérieux au point d’être absurde et dangereux, pas plus que je n’aurais cette impression en relevant la taille d’un édifice dont j’aurais constaté dès mon arrivée que c’est le plus grand d’une ville ou d’un village où j’aurais prévu de séjourner quelques semaines – à Paris la Tour Montparnasse, ou bien chez Proust le clocher de Saint-Hilaire doré et cuit «par les égouttements gommeux du soleil». On n’admire pas forcément une telle agrafe, qui a l’air d’avoir été fixée pour aider l’horizon à cicatriser, mais on en mémorise le trait de manière à rentrer chez soi, même tard la nuit, ivre ou triste, en empruntant des rues qu’on ne connaît pas mais auxquelles la proéminence a donné un sens.
L’instinct d’avant-corps
Pardon si je commence par un peu de pédagogie, mais il faut bien que je vous dise ce qu’au juste est un narthex, car si vous l’ignorez vous ne comprendrez rien à ce qui suit. Le narthex dans une église, ou «avant corps», est un espace couvert situé avant l’entrée – on pourrait dire un «vestibule» ou pourquoi pas un «sas de décompression» – souvent large et haut, destiné à accueillir pendant l’office les païens, les réfractaires, les agnostiques ou les vicieux, qui avaient peur ou honte d’avancer plus loin mais avaient quand même besoin d’une sotériologie sur la tête; on y accueillait aussi ceux qui préféraient aimer Dieu de loin car de loin on choisit. C’est dans le narthex également que prient ceux qui se préparent au baptême : les catéchumènes, qui à tout moment pourront renoncer, sortir, oublier. Et c’est dans le narthex enfin que sont les fous et les pénitents. C’est le lieu même où se pose la question de Dieu, et où cette question repose comme une espèce de pâte ontique avant la cuisson – d’ailleurs la porte de l’église vue depuis le narthex ressemble à celle d’un four à pain, obscure et brûlée comme les vieux fours à pain –; c’est le lieu du doute et de la foi naissante, mais qui peut encore mourir, comme les premières flammes d’un feu de veillée quand on craint que le petit bois n’étouffe ce à quoi il est censé donner vie. C’est le lieu du paganisme aussi. Il faut avoir vu le narthex de Saint-Benoît sur Loire, celui de Moissac, et chez moi, à Toulouse, celui de Saint-Pierre les Chartreux, pour ressentir cette espèce d’entre-deux (entre Dieu, antre Dieu) séparant la lumière païenne du dehors – d’où Paul Celan a écrit que le Néant était «porté dans les bris des vents» – et l’obscurité de l’église, où les langues des bougies lèchent les pieds massacrés du Fils de l’homme – le secret d’Edith Stein, le château intérieur de Thérèse d’Avila; ressentir la possibilité de ce voyage vers une introspection parfaite, la grâce et sa couronne d’épines, le sang, les ronces, les fleurs. Le narthex est le lieu où Saint Jean de la Croix nous dit que «les cavaliers venaient / et à la vue des eaux ils descendaient», ces cavaliers qui symbolisent «les puissances de la partie sensitive, tant intérieures qu’extérieures», et qui posent le pied dans le narthex avant d’entrer dans l’église où la partie sensitive de l’âme sera «purifiée et spiritualisée»; c’est le lieu de la nuit de feu, un lieu situé entre la pesanteur et la grâce; le lieu de la conversion à chaque instant possible mais qui ne sera consommée que lorsque les cavaliers auront posé le pied et laissé leurs chevaux pour entrer dans l’église, humblement, absolument, éternellement.
Les statues et autres représentations n’ont pas l’air d’y être nécessaires, mais après quelques heures passées à les observer, et à condition de n’être pas entré dans l’église et de ne pas être sorti du narthex, elles finissent par sembler essentielles – sentinelles, cerbères d’un dieu d’amour – et comme entreposées ici en attendant le déménagement mystique, un jugement des choses. On a envie de les déplacer, et on comprend que dans ce lieu qui n’est pas sacré il ne sera pas impossible de commettre un sacrilège. Les plafonds sont haut, il y a encore la Nature. Le soleil, le vent s’invitent; l’homme est encore petit; il n’est rien encore; dans l’air le goût crayeux du cimetière lui prouve qu’il ne sera jamais très fort. Le tombeau de Jésus devait avoir quelque chose de similaire lorsque la pierre venait d’être roulée et que Saint Jean attendait sur le seuil le futur fondateur de l’Église. La chrétienté n’était pas encore là, mais tout était possible. L’histoire du monde attendait que Pierre arrive, et celui-ci faisait ce qu’il pouvait.
Les statues du narthex de l’abbaye de Fleury à Saint-Benoît sur Loire sont de petits lions et des santons perdus, qui ne savent pas, hésitent, se tordent, espèrent; ce sont des figures d’âmes qui cherchent. Les vers de Defalvard sont assez semblables à ces physionomies semi-incarnées portant la marque d’une sensibilité organique, qui saigne, la pierre tiède comme de la peau. Defalvard a écrit ses poèmes sans choisir de s’adresser à Dieu mais sans s’en éloigner, comme s’il avait eu besoin de la proximité de celui dont Hölderlin a prévenu qu’il était «tout proche et difficile à saisir», tout en ayant besoin précisément qu’il fût insaisissable.
 À bien y réfléchir, le narthex est le lieu même de la poésie, car la poésie aura toujours en elle quelque chose de païen. Il y aura toujours dans ses prières la voix de la Pythie, et un peu du dehors dans son intérieur, une horizontalité dans sa transcendance, parce qu’elle est un art du sensible. La poésie n’est pas pur langage quoi qu’on en dise, elle charrie avec elle le monde du dehors et le rend sensible à l’intérieur. Les mots existent dans la voix humaine, ils ont des visages, des odeurs, des nerfs, un son et une texture, un goût. Avec eux le poète convie dans le narthex le monde réel, les feuilles mortes, la poussière; le réel y secoue son manteau de beauté avant d’intégrer, peut-être, la vérité.
À bien y réfléchir, le narthex est le lieu même de la poésie, car la poésie aura toujours en elle quelque chose de païen. Il y aura toujours dans ses prières la voix de la Pythie, et un peu du dehors dans son intérieur, une horizontalité dans sa transcendance, parce qu’elle est un art du sensible. La poésie n’est pas pur langage quoi qu’on en dise, elle charrie avec elle le monde du dehors et le rend sensible à l’intérieur. Les mots existent dans la voix humaine, ils ont des visages, des odeurs, des nerfs, un son et une texture, un goût. Avec eux le poète convie dans le narthex le monde réel, les feuilles mortes, la poussière; le réel y secoue son manteau de beauté avant d’intégrer, peut-être, la vérité. Peut-on regretter que Defalvard ne soit pas allé plus loin vers l’église, comme l’a regretté le bizarre Maxence Caron dans La Quinzaine littéraire ? Peut-on reprocher au poète d’avoir ressenti cette «fatigue triste» (p. 63) ? Est-ce de la lâcheté ou même «une faute» prétend Caron, quand Defalvard écrit : «C’est la nécessité d’un dialogue avec Dieu. / Cette nécessité, je l’évite autant que je peux; / Je feins d’ignorer la nécessité de la nécessité» (p. 116) ? Peut-on reprocher à Defalvard d’être resté dans ce lieu où gronde une réalité à propos de laquelle il ne sait pas s’il faut parler de la «bénédiction du désastre» ou de «la punition des repentis» (p. 173) ? Je ne crois pas, car on ne peut pas entrer dans l’église et vraiment demeurer poète. Même Claudel n’est pas tout à fait entré, trop orgueilleux, trop poète, trop juif. Et même Jean de la Croix. Tout porte à croire en fin de compte que le narthex est le lieu même de la poésie : son lieu maximum.
Cartographies
Defalvard est cartographe. Ceux qui ont lu Du temps qu’on existait sont au courant. Ils retrouveront dans le Narthex son goût des lieux, mais cette fois-ci, poésie oblige, ceux-ci se fondent dans les noms qui les désignent davantage qu’ils ne s’y fondaient dans le roman (1). Par un mouvement qui passionnerait un heideggérien – un mouvement à la fois de «contre performation» et de «dé-performation» diraient les austiniens – le territoire s’unit à la carte et la carte au territoire au point de devenir quelque chose de mieux formulé que la carte et de plus insécable que le territoire. «Depuis la carte où le refus pénètre par la proportion» (p. 71), Defalvard décrit «les miracles muets de la cartographie» (p. 189), obsédé par ce qui, dans le langage, fera taire la langue en la situant et la fera oublier en la précisant. Sa poésie aspire au silence, mais le poète est trop attaché au langage pour s’avancer vers le silence, plus loin, entrer dans l’église. Dans le narthex, donc, c’est presque du silence, mais le vent en s’engouffrant apporte les bruits du dehors, une charrette qui passe, les cris des enfants au loin. Et Defalvard se rappelle, depuis ce poste d’observation, ce qui dans le Réel, une fois localisé et territorialisé par la mémoire, est silencieux, ou en tout cas compatible avec le silence, comme s’il voulait sauver ces lieux qu’il connaît, parce que seul le silence est éternel. Il déterre dans Pithiviers ce qui existerait si la ville et ses habitants étaient annihilés ou réintégrés par l’Œuf. C’est un des grands projets du recueil : sauver les choses que le poète connaît – le fruit de la connaissance – en les tirant depuis la réalité dans le narthex et vers la vérité du Verbe, celui-là même qui a demandé à Adam de nommer les choses, c’est-à-dire de leur donner un sens. C’est un sauvetage, donc; le narthex est une arche de Noé.
Contrairement à Du temps qu’on existait, il n’y a jamais de description précise des lieux, mais des noms qui portent leurs charges de sensualité et jouent au jokari avec les distances, dont la balle est le nom et la raquette le pronom : on passe de «la Beauce charitable» à «la Patagonie médiocre» (p. 233) et de la «Conque d’Or de Palerme» (p. 32) au lac de Servières (p. 46), ou encore des Monts de la Madeleine (p. 34) aux «improbables routes» (p. 37) et aux «saisons engelées» (p. 39) du Caucase. La France a ses pierres plus ou moins précieuses, mais que Defalvard compte bien déménager dans son narthex : Toulouse et les «friches de Haute-Garonne» (p. 29), Saint Just Saint Rambert, La Chapelle-Montligeon, Châtel-Montagne, Mouthe, le Viaduc du Blanc, Chambon-sur-Vouèze, l’église de Saint-Eutrope et Clermont-Ferrand – qui avec Pithiviers partage la tête d’affiche – où le crépi brun «existe pour lui seul» (p. 55), dont les façades sont «accoucheuses d’ombre» (p. 64) et où le rosebud, à défaut d’autre chose, se situe rue Bonnabaud (p. 60).
Defalvard nous dit qu’il a «avalé» les plans des «villes mineures» et autres «garnisons méticuleuses de sous-préfectures» ainsi que «les plans naïfs des bourgs» (p. 19). C’est ainsi qu’il les tire de la Réalité et les amène dans son narthex, près de la Vérité, à l’intérieur de lui, ni vu ni connu, dans son estomac, comme ces sachets de drogue que les passeurs ingurgitent avant de prendre l’avion. Il les fait passer en douce, contrebandier, poète. Et les «transsubstantie».
Pithiviers est au recueil ce qu’Ithaque est à L’Odyssée, marquant à la fois le début et la fin d’un voyage qui cela mis à part, disons-le, n’a pas vraiment de structure (Comment en aurait-il ? Décidément, je déteste les recueils !). Pithiviers est une commune du Loiret, bordée par une rivière au nom crypto-mythologique – «la veine d’eau noire de l’Œuf» (p. 234) – laquelle sert de Vivonne à Defalvard, le cours héraclitéen de ses souvenirs, charriant pour lui les nénuphars des mots à des rythmes différents, en leur faisant subir parfois des accélérations de torrent et d’autre fois traverser des plans calmes comme un désert pendant que les nénuphars fleurissent, pourrissent, jaunissent, se télescopent et s’évitent. Il y a un Pithiviers d’adolescence «intempérant» et «hors du langage» où le poète a été heureux et dont la voix est «simple, souple, diamantée» (p. 13). C’est là que le projet est né d’une «victoire vitaliste». Mais il y a aussi un Pithiviers fade et décevant, celui de la rue de l’Ancien Camp et de la «médiocrité triomphale», où l’Hôtel Dieu est une «Madeleine bourgeoise dans un virage gris», et d’où il m’a semblé qu’était venu le démon de l’ironie, qui parle trop souvent à la place de la pureté et empêche le poète de progresser dans le narthex. Enfin il y a un Pithiviers nettoyé des lieux et des dieux, des voix, des écrits, du langage, et en-cela sauvé par le poète, enfin mis à l’abri dans le narthex, où son nom est un «lys poétique» et «un fœtus immobile» (p. 234), inscrit dans le silence et fondé mythiquement.
La construction mythique de Pithiviers renvoie à la fondation mythique de Buenos Aires écrite en 1965 par Borges, et récusée par son auteur en 1980 : «Je crois que ce poème est essentiellement faux. Il aurait pu être écrit en se référant à une ville comme Genève, ou comme Edimbourg, mais pas à Buenos Aires que nous avons vu grandir, et qui continue de grandir». À Pithiviers, c’est l’inverse, la ville ne grandit pas, elle disparaît, démolie, nous raconte Defalvard, «au profit de non-lieux, blancs, des atomes blancs sans mémoire». C’est pourquoi il était urgent de la sauver. Et finalement, oui, Pithiviers est sauvée. Et protégée par le poète du poète lui-même, de son ironie, de sa faiblesse, de sa finitude.
Les portes réfléchissantes
La réalité pourrait dire à propos de Defalvard ce qu’Ophélie dit à propos d’Hamlet : «Il m’a prise par le poignet et m’a serrée très fort. Puis, il s’est éloigné de toute la longueur de son bras; et, avec l’autre main posée comme cela au-dessus de mon front, il s’est mis à étudier ma figure comme s’il voulait la dessiner. Il est resté longtemps ainsi. Enfin, secouant légèrement mon bras, et agitant trois fois la tête de haut en bas, il a poussé un soupir si pitoyable et si profond qu’on eût dit que son corps allait éclater et que c’était sa fin. Cela fait, il m’a lâchée; et, la tête tournée par-dessus l’épaule, il semblait trouver son chemin sans y voir, car il a franchi les portes sans l’aide de ses yeux, et, jusqu’à la fin, il en a détourné la lumière sur moi.» (Hamlet, Acte II, scène 1) (2).
Ophélie ici est la Réalité, le principe de réalité, le Réel, et en quelque sorte ce que plus tard sera l’âme des héros de Tolstoï par rapport à celle des héros de Dostoïevski; alors qu’Hamlet n’est concerné que par la Vérité et le Principe lui-même, le Vrai, et désire que la Vérité éclate en plein jour, quitte à tourner pour cela le dos à la Réalité. Ophélie et Hamlet sont à la fois unis et séparés par la pièce, la poésie, le narthex. Entre eux tout est possible mais rien ne survient. En lisant Defalvard, j’imaginais très bien cette Réalité prise par le poète et tirée jusqu’à l’avant-corps dans un lieu presque divin, près de la Vérité. Après avoir posé une main sur son poignet et l’autre au-dessus de son front, et avoir étudié sa figure, l’avoir dessinée (c’étaient les descriptions de Du temps qu’on existait), Defalvard avance vers l’intérieur sans l’aide de ses yeux (je le répète, dans le Narthex les lieux ne sont pas décrits) et détourne vers l’extérieur la lumière à laquelle il accède en progressant vers l’intérieur. Ainsi il donne au paradis un air de la rue Bonnabaud et pare cette dernière de rutilances provenues du paradis, ou en tout cas du monde d’avant Babel.
La parole créée
Est-ce que le langage tire le poète vers l’extérieur ou est-ce qu’il lui permet comme une torche de progresser sans trébucher vers l’intérieur du narthex, plus près du mystère de l’incarnation et de l’eucharistie ? C’est, je crois, la principale question du recueil. Le poète sait qu’il ne pourra communier avec le sens que s’il entre dans la chapelle, c’est-à-dire à l’intérieur du silence, et donc s’il renonce à la poésie, qui est orgueil, sensibilité et connaissance, une parade au sentiment de honte. Dans le narthex, il ne sera au mieux qu’à «mi distance» (p. 26), mais son trône est ici. Ici est son royaume : le royaume de la parole créée à propos duquel Claudel, dans la cinquième ode, écrit qu’il est ce lieu»en qui toutes choses créées sont faites à l’homme donnables». Chassé du Paradis, Adam n’a pas oublié le nom des animaux, des pierres et des grands arbres, ni sa capacité à les nommer, et s’il craint tant la mort, c’est parce qu’il a peur qu’on lui rende l’éternité sans lui rendre aussi le pouvoir de nommer. Il plante donc ses pénates dans le sas de décompression, où il ressent la présence réelle de la Vérité sans tout à fait renoncer à la fausse présence du Réel. Et finalement il se trouve dans l’espace même de la croyance où la carte et le territoire ne sont «plus-qu’un» et où la question qui se pose pourrait être formulée ainsi : ce «plus-qu’un» existe-t-il ? (Je ne suis pas un adepte de Sartre, mais il a eu cette belle phrase dans Les Mots : «je confondais les choses avec leur nom : c’est croire»).
La déficience du langage et la trahison des images
Defalvard, même si ce n’est certes pas là sa plus grande originalité ne cesse de constater l’imperfection du langage : «Tout porte la marque d’une déficience du langage» (p. 66). Il sent, dans le narthex, que le langage affaibli («Et le langage s’affaiblissait» (p. 98)) ne le conduira pas plus loin. Grâce à lui il a approché de Dieu et maintenant il doit abandonner le langage pour s’abandonner à Dieu. N’être qu’à Dieu. Vomir le fruit empoisonné. Et manger Dieu. C’est le Verbe en fin de compte qu’il faudrait «avaler». D’où le mystère de l’Eucharistie.
Évidemment, ce n’est pas, comme cette société l’a peut-être cru, avec des images qu’on sauvera quoi que ce soit. Elles ne permettent même pas d’entrer dans le narthex et sont tout juste bonne à en décorer l’extérieur. Les images sont faibles. Elles sont l’arme des faibles. Les yeux mentent. Ce sont les chaînes des esclaves. Defalvard écrit : «L’image a trahi et on a peu parlé de cette trahison infernale, / Les images ont gagné une guerre silencieuse et l’iconoclastie est punie au tombeau» (p. 160). Tout ce qui tient de l’image est en-dessous du langage. C’est pourquoi un seul vers de Michel Ange vaut mieux que la chapelle Sixtine, car celle-ci est païenne, les images sont toujours païennes, fausses par nature, tandis que les vers sont à mi-chemin, dans le narthex, entre Réel et Vérité. Michel-Ange le savait lorsqu’il écrivait dans un sonnet : «Peindre et sculpter n’ont plus le pouvoir d’apaiser mon âme, orientée vers ce divin amour qui, pour nous prendre, sur la Croix ouvrit les bras.»
Celui qui fut sans doute le plus grand artiste de tous les temps aspirait donc à cesser de peindre et de sculpter – cesser, autrement dit, de célébrer les images – pour finalement entrer tout à fait en Dieu, dans le langage, au fond du silence. Il n’achèvera pas la Rondanini… À propos de cet éclat de lucidité chez Michel Ange, nous pouvons dire, avec Defalvard, que «Peu de choses sont plus poétiques que le renoncement à sa propre liberté / Chez l’être qui était, plus que tout autre, fait pour elle» (p. 215). Et nous pouvons être certains que le Buonarroti a rejoint désormais la lumière infinie du Corps glorieux.
L’humour
J’ai été très étonné à l’époque de Du temps qu’on existait que personne n’ait relevé, parmi les critiques officiels, l’humour, le merveilleux humour, incarné entre d’autres par la figure de Paul Bonhomme. Dans ce recueil aussi, on retrouve l’humour de Marien Defalvard. Evidemment la hauteur du verbe, par rapport au rythme du roman, le permet moins, mais le poète ne peut s’empêcher d’être drôle. Et cet humour s’en prend notamment à ceux qui prétendent exercer l’autorité sur le narthex, c’est-à-dire sur la vie intérieure et sur le passage de l’extérieur à l’intérieur, tous ces moralistes d’aujourd’hui, ces journalistes et penseurs bêtes, que Defalvard appelle, évidemment, des «prêtres» : «des prêtres scientistes / Qui sont des femmes de lin maculé de viande / Des salopes inimitables aux harmonicas bouchés» (p. 211). Cela fait penser à ce qu’Empédocle dit au prêtre Hermocrate chez Hölderlin(3) : «Ah quand je n’étais qu’un enfant, mon cœur déjà / Pieusement vous fuyait, ô grands pervertisseurs… […] Loin d’ici ! Je ne peux devant moi voir un homme / Qui fait du sacré l’exercice d’un métier. / Son visage est faux, il est froid et mort / Comme sont ses Dieux…».
Autre exemple d’humour, cette pique adressée à Foucault : «Et qu’on atteint / Le plus haut degré de barbarie / Lorsque les plus éduqués parmi les hommes / Se mettent à dire «L’aliénation n’existe pas»» (p. 194). Que serait le poète sans de telles piques ? Un torero sans banderilles !
Dernier exemple : le sommeil de Dieu à propos duquel le poète finit par penser qu’il est si absolu que Dieu pourrait s’y être noyé (p. 181). Une fois à l’intérieur de l’église, l’humour devra cesser. Jésus, on l’a dit, ne rit pas. Et c’est peut-être donc pour continuer à rire que Defalvard reste dans le narthex où on joue la musique de Mozart (on garde Bach pour l’intérieur et Beethoven pour l’extérieur), et où les anges viennent rire après la messe.
Le Mal et le mal
Dans le narthex aussi se pose la question de la morale, car du côté intérieur du narthex se trouve le Bien, et du côté extérieur se trouve le libre-arbitre, c’est-à-dire le Bien et le Mal entremêlés, la conscience du bien, le désir du mal, la possibilité de l’un et de l’autre, les lignes de flottaison. Defalvard constate la présence du «cadran destinal, corrompu de l’Histoire» (p. 98) et du Mal, «le Mal et ses discours multiples / […] Le Mal que chacun a appris à aimer, tolérance oblige / Le Mal auquel il arrive de parler grec» (p. 15). Il entend frapper à la porte du narthex «ceux qui font du trafic de Mal» (p. 133), et il essaye de se purifier, comme s’il se préparait à franchir le seuil du côté intérieur alors même qu’il se sait trop attaché à la liberté pour décider d’y pénétrer avant la mort. Il gratte «les ongles sales / De la morale prostrée» (p. 142). Et constate : «Et si j’ai tant de mal c’est parce que le mal m’a blessé» (p. 162).
Defalvard semble avoir réfléchi au mal, en moraliste presque mais d’un genre particulier, sans moralisation, un moraliste d’instinct; il regrette qu’on ait dévoyé le Mal avec nos petits maux, nos petits vices, cette société fourvoyée dans «la haine de la liberté» (p. 74); or il semble qu’il y ait aussi un Mal choisi, un Mal volontaire, un Mal d’homme libre que le poète ne peut pas détester tout à fait. «Il y a un beau Mal, nous dit Defalvard, cela ne fait pas de doutes. / Un Mal sans verbe, très pur et sans mélange. / […] Qui entrouvre sa vareuse, sans cesser de naître. / Il y a un mal, aussi, habitants sans mémoire, Aux paroles somptueusement tendues comme des filets» (p. 161). Il le répète encore : le Mal, le vrai Mal, est beau, «avec son couteau à lame étincelante, son œil bleu profond / et ses grandes mains blanches comme du beurre» (p. 195). Et Defalvard, pris dans l’entre-deux du narthex, et dans cette redécouverte du Mal, tout en refusant de céder à sa lumière (p. 174), lui demande de détruire le petit mal de rien, la petite tolérance méchante, qui est le vrai nazisme à ses yeux, la véritable fin du monde : «Viens, Mal, saboter la ruine intime, y faire / Une patrie ronflante de carnage attendri – / Pour qu’enfin ce dessaisissement cesse» (p. 171).
La solitude
Naturellement, Defalvard est seul dans le narthex. Mais il s’est isolé en y pénétrant et non pas pour y pénétrer. Il y est seul parce que ce monde ignore qu’il faudrait le suivre. Il ne s’en réjouit pas mais constate, et nous le constatons hélas, avec lui : il a «scié le lien» (p. 148). «Je n’agrippe plus le langage de mon semblable; / À peine si je le regarde fuir sous moi, parfois, / Comme une laine défilée, un écoulement abstrait» (p. 137). Et il ne voit dans le rosebud d’autrui qu’une «caricature systématique» (p. 61) et dans leur chère communication globale une «communion manquée» (p. 68). Comment ne pas être seul quand autour de soi les hommes «lèchent le sceau du Mal» (p. 174) ? Nous n’avons pas encore bien compris la punition qui nous fut infligée à Babel. Le langage, qui devait permettre de communiquer, au contraire, le vrai langage – le «lasso précis» de Malherbe (p. 209) – isole. Alors Defalvard, si jeune, se met à penser à ce jour où il fuira enfin «dans le silence, généreusement invoqué par l’homme vieux» (p. 133) qui n’est autre que le jour de sa mort. Heureusement pour nous, la phrase est au futur : «Nous fuirons dans le silence…». Cruel paradoxe, dont la solitude est le cruel résultat : Defalvard est lucide mais n’est pas suicidaire.
La sortie du Narthex : de quel côté ?
Une fois dans le narthex, «la construction mythique commence», et «tout ne sera pas résolu» (p. 185). Defalvard répète : «Ce ne sera pas simple. Ce ne sera pas simple. / Oh non, d’écrire un poème / Sur la cause de tous les autres poèmes, / Sur leur attente apprivoisée» (p. 45).
Non, ce ne sera pas simple. Car rester dans un entre-deux – alors même que le silence est «la fourche caudine de la pensée» (p. 157) – n’est jamais simple. A tout moment l’extérieur peut vous reprendre, et l’intérieur vous absorber. Se pose alors la question du courage («suis-je courageux ?»). C’est ici, en proie à une angoisse sans pareille, que Pascal a commencé sa vie. Defalvard y est à son tour, dans son Clermont Ferrand intérieur, «sous le regard démobilisé de Blaise Pascal» (p. 54) où «se brisent vite les prétextes de chaque religion» (p. 73). En plus d’y côtoyer «la précarité» et «l’impuissance» de son compatriote clairmontois (4) (p. 60), il a une pensée pour Heidegger, qui lui aussi y a passé, à Délos, «devant l’absence de Christ révélé» (p. 159).
On le sait, Pascal fut effrayé par le silence éternel qui se trouve au-delà du seuil intérieur du narthex. Heidegger y fut en définitive assez indifférent. Defalvard quant à lui en a peur oui et non, parfois il voudrait avoir peur, parce qu’il est «naturel que le dernier homme ait peur de Dieu» (p. 162), mais s’il a peur c’est du Mal plutôt que de Dieu, et de l’extérieur du narthex : Defalvard a peur de ce qu’il connaît. Pourquoi n’avance-t-il pas, donc ? Pourquoi ne pas se convertir, poussé par cette peur ? Parce que je vous l’ai dit, les poètes sont orgueilleux. Defalvard ne veut pas s’abandonner à Dieu, car il ne veut pas devenir insignifiant; il est persuadé que rejoindre la Vérité obligera à renoncer au sens de soi-même pour soi-même – et il nous le dit clairement : «Parfois je fus insignifiant / Comme un violon cassé. / C’est là que le chant devenait biblique !» (p. 128). Il reste donc dans le narthex à peine réchauffé par «les braises gelées et la philosophie» (p. 136), et où l’on sent une présence comme un chant venu de l’intérieur mais où en définitive «Dieu manque, Dieu défaille, Dieu a la bouche coupée» (p. 181), alors que le Mal lui ne manque pas, il ne défaille pas. L’extérieur, et le Mal à l’extérieur, appellent Defalvard, et il semble parfois que Defalvard voudrait retourner à eux : alors que le narthex est pour lui «l’oubli de la langue» (p. 200), il se prend «à espérer l’oubli de l’oubli / Le deuil du deuil» (p. 47), ouvrir le sas de décompression et retourner en arrière, dans la réalité, où tout sera plus facile parce que tout sera faux.
Aménagement du territoire
Le dernier morceau du dernier vers du Narthex annonce le commencement de «la construction mythique» (p. 235). Souvenez-vous : Borges disait que son poème à propos de Buenos Aires était devenu faux parce que la ville avait continué de grandir. Eh bien, Defalvard compte faire l’inverse, c’est-à-dire continuer de faire grandir Pithiviers à l’intérieur de lui-même au point que celle-ci transcendera définitivement celle-là. Autrement dit, alors que Pithiviers est enfin devenue une île entre le Vrai et le Réel, où peuvent se réunir Hamlet revenu d’entre les vivants et Ophélie revenue d’entre les morts, Defalvard nous prévient qu’il a choisi de s’installer dans le narthex et qu’il compte y faire des travaux. Après l’emménagement, l’aménagement : ouvrir deux ou trois fenêtres pourquoi pas, agrandir la porte étroite du côté intérieur et construire une mezzanine, une cheminée, mettre du parquet flottant, se payer une cuisine américaine, rehausser la toiture. Au moins les maîtres de conférence de la Sorbonne pourront lui rendre visite sans se geler les pieds. C’est le défi, je crois, pour l’avenir de cette construction mythique : devenir accueillant, plus accueillant, accueillir, attirer, conduire. Nous ne rencontrerons Defalvard que si d’abord il l’a souhaité.
Notes
(1) Il est intéressant de noter au passage que si Defalvard a été romancier, il nous annonce qu’il ne l’est plus («Le romancier a rangé avec minutie chaque lame de rasoir dans le buffet armori»). L’exercice du roman semble l’avoir blessé, ou en tout cas déréglé : «Je me suis senti comme l’aiguille déréglée d’une boussole» (p. 29). Cela, à vrai dire, ne m’étonne pas. Les poètes se blessent il me semble quand ils jouent les romanciers (souvent attirés par le roman pour des raisons pécuniaires), car un roman est à la poésie une espèce de sous-produit vaguement alcoolisé, déjà du divertissement, certainement pas de quoi tabularaser.
(2) On notera au passage que, même si c’est loin d’être dominant sur l’ensemble du recueil, certains vers ont des accents très shakespeariens : «La vie ? Un long jugement confus et triste / Pour un crime qu’on n’est pas certain d’avoir commis» (p. 152).
(3) Les ponts sont nombreux entre Defalvard et Hölderlin, plus nombreux qu’avec Shakespeare et qu’avec les poètes français il me semble. Mais Defalvard est drôle, ce qu’Hölderlin n’était pas.
(4) Au temps de Pascal, on écrivait «Clairmont», une orthographe à mon avis autrement plus pascalienne et defalvardienne que le «Clermont» positiviste.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, marien defalvard, narthex, guillaume sire |  |
|  Imprimer
Imprimer


























































