« Il n'y a que la mauvaise presse qui sauve ou Philippe Muray ressuscité | Page d'accueil | L'âme charnelle. Journal 1953-1978 de Guy Dupré »
16/10/2010
L'avenir de la littérature de Frédéric Badré

Crédits photographiques : Aris Messinis (AFP).
Le Christ Sollers et ses rares apôtres dans la Zone.
Frédéric Badré est le directeur de la revue Ligne de risque, et c'est sans doute l'unique raison pour laquelle les années qui viennent mentionneront son existence comme illustration du bavardage pseudo-savant.
Frédéric Badré est aussi, ou peut-être même en premier lieu, un voyant. Je n'ai, sur ce point, pas le moindre doute.
Nul autre qu'un voyant, et du plus beau binocle, ne serait capable d'écrire une phrase aussi profonde, apparemment née sous l'influence de sa rencontre avec le bizarre suicidé qu'était Bernard Lamarche-Vadel : «La littérature est une opération magique, une opération de réengendrement de l'écrivain dans son écriture» (p. 182).
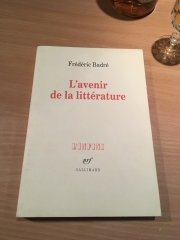 Une autre phrase me semble être d'une profondeur abyssale. C'est bien simple, la vérité qu'elle révèle peut être comparée à celle que ferait exploser quelque évangile inconnu que les savants viendraient d'exhumer d'une grotte hermétiquement fermée par un bouchon deux fois millénaire : «Pas de littérature sans une sorte de violence» (p. 192).
Une autre phrase me semble être d'une profondeur abyssale. C'est bien simple, la vérité qu'elle révèle peut être comparée à celle que ferait exploser quelque évangile inconnu que les savants viendraient d'exhumer d'une grotte hermétiquement fermée par un bouchon deux fois millénaire : «Pas de littérature sans une sorte de violence» (p. 192).Parfois, Badré écrit des choses simplement justes mais d'une telle évidence que d'autres que lui, bien avant lui, mieux que lui, les ont mille et mille fois répétées : «Une rupture dans l'histoire littéraire s'est produite, aggravée par le règne exclusif de la rentabilité économique. Nous posons qu'un livre ne vaut que par la pensée qu'il met en œuvre, et par sa force poétique. Et qu'il doit être dorénavant arraché aux conditions qui le rendent impossible. Or les écrivains font rarement ce travail de résistance. Ils commencent par accepter servilement le cadre qui leur est donné. À partir de là, ils ne pensent plus. Ils ne sont portés que par leur acceptation» (p. 121).
Je ne voudrais point avoir l'air d'être désobligeant en faisant remarquer à l'auteur qu'être publié par Gallimard, qui plus est dans la collection que dirige Philippe Sollers, n'est pas exactement la preuve la plus flagrante d'un crâne refus du cadre donné.
Un homme libre n'a que faire de prendre pour alliés, peut-être même amis, des Meyronnis, des Haenel, des Sollers, des Guest.
Un homme libre pense tout autant qu'il écrit contre ces auteurs dénués de talent et même, de livres véritables.
On a beau être un voyant, pardon, Voyant, on n'en est pas moins homme, avec ses goûts et ses dégoûts.
Frédéric Badré aime sa revue, Ligne de risque, qu'à vrai dire il est probablement l'une des trois ou quatre personnes à lire, tout du moins à Paris et peut-être même dans le monde entier, s'il est vrai que Paris continue d'être son phare et que la lumière que répand sur l'univers Ligne de risque est aussi puissante que celle émise par un quasar.
Ligne de risque est une «revue révolutionnaire» (p. 23) et même une «centrale d'énergie» (p. 24; je doute fort que Badré ait lu le roman du même titre, signé John Buchan) ayant provoqué le surgissement miraculeux des livres de deux de ses amis trentenaires, Yannick Haenel et François Meyronnis.
Frédéric Badré aime les livres de ses amis et il l'écrit : ce sont même, ces livres infinis, les premiers indices d'une «refondation de la littérature» (p. 24) qui manifeste le «resurgissement, quand on ne l'attendait pas, de l'être vif du langage», selon la formule de Michel Foucault (Ibid.).
Frédéric Badré aime Yannick Haenel, qualifié de «déserteur» (p. 24) et il l'écrit mais ce point n'est pas évident dès les premières pages de son ouvrage. Nous devons attendre, impatients, la trop lointaine page 172 de son livre pour que Frédéric Badré nous dise tout le bien qu'il pense de Yannick Haenel qui, paraît-il, trame ses phrases «à partir de ses expériences extatiques du vide» (p. 174).
Frédéric Badré aime le frère jumeau de Yannick, François (Meyronnis), qualifié d'«étranger» (p. 24) et il l'affirme sans craindre une seule seconde de se tromper : «Le temps manifestera le caractère décisif de cet essai [L'axe du néant] de plus de six cents pages, qui revient sur le rapport entre langage et nihilisme» (p. 25).
L'une des preuves indiscutables de l'amitié, consiste, sans le moindre doute, à risquer en toute connaissance de cause, pour son ami même, de sombrer dans le ridicule. À cette aune, nous pouvons affirmer que Frédéric Badré est, de très loin, le meilleur ami de François Meyronnis alias Simon Malve, dont il nous dresse un portrait en André Breton réincarné ou en Lautréamont redivivus (cf. pp. 167-171). Le comble du ridicule est atteint lorsque Badré, indigent de plume puisqu'il ne sait point faire le portrait d'un auteur de cinquante-huitième sous-sol, fait de Meyronnis, cet «homme-cerveau», une combinaison de Daniel d'Arthez (les Illusions perdues) et de Louis Lambert, «une sorte de sorcier qui approche de la sainteté» (p. 171).
Frédéric Badré aime Philippe Sollers, ce «Raminagrobis de comédie» au «regard complice d'un vieux politicard jésuite» selon l'excellent Matthieu Galey et il l'exalte : «Philippe Sollers est le quatrième jeune homme. Un jeune homme né en 1936 à Bordeaux» (p. 24).
Nous rendons grâce à Frédéric Badré d'avoir chanté les louanges de Sollers en aussi peu de répons.
Frédéric Badré aime aussi ces hauts monuments, ces bornes dispersées sur la longue route de la refondation du monde que sont «l'existentialisme (1945), «le Nouveau Roman» (1953), «l'avant-garde articulée autour de Tel Quel» (1968) et «la fin du littéraire» (1983) (p. 23).
Frédéric Badré, et nous le comprenons, n'aime pas, mais alors pas du tout notre monde vendu au simulacre capitalistique, celui du «nihilisme accompli» (p. 13), arraisonné par le virtuel (Ibid.), notre époque étant, pour sa part, qualifiée de triomphe du «faux accompli».
On aura compris, d'après les quelques termes que j'ai utilisés, que Frédéric Badré aime beaucoup Martin Heidegger, Guy Debord, Roland Barthes, Jean Baudrillard, Maurice Blanchot et Jacques Derrida.
Et bien sûr, je l'ai dit, Philippe Sollers, dont le portrait chinois le présente en initiateur gidien qui indique, «comme ça, en passant, une voie, qu'on est libre ensuite de suivre ou non», mettant «ainsi à l'épreuve la nature du désir de son interlocuteur» (p. 36).
Rendons grâce, une nouvelle fois, à Frédéric Badré d'avoir si sobrement chanté la louange du directeur de la collection L'Infini, dans laquelle le livre de Badré a eu l'insigne honneur de paraître.
Frédéric Badré aime aussi Jean Paulhan, auteur secret et trop précieux pour être honnête auquel il a consacré un essai que je n'ai pas (encore) lu, Paulhan le juste paru en 1996 et qu'il n'en finit pas d'évoquer tout au long de son ouvrage et surtout dans son point trop mauvais deuxième chapitre intitulé La fin du littéraire.
Frédéric Badré, à la différence de Yannick Haenel et François Meyronnis, ses deux amis, sait écrire et, même, il sait construire un livre d'une façon assez rigoureuse, analysant la faillite de la littérature française à partir de l'après-guerre en l'articulant sur les quelques grandes étapes que j'ai indiquées plus haut.
Nous nous trouvons donc, avec L'avenir de la littérature, à quelques salutaires lieues des inepties mal écrites, des insignifiances prétentieuses des pseudo-essayistes Meyronnis et Haenel, mais cette distance ne suffit point, tout de même, pour faire du livre de Badré autre chose qu'un plaidoyer aussi poussif que ridicule pour une littérature moisie, celle, justement, que défendent les amis de notre auteur.
Juste retournement des choses : à force de lécher, avec force volupté, les fins chaussons de soie anti-nihilistes que les pieds de ces lamentables cacographes que sont Haenel, Meyronnis et Sollers ont l'honneur de revêtir, il fallait tout de même s'attendre à ce qu'un panégyrique sombre dans l'ornière du bavardage le plus caractéristique plutôt que dans la défense d'une thèse d'un peu de consistance intellectuelle.
Attardons-nous quelque peu, d'ailleurs, sur la principale faiblesse, son défaut d'être en somme, du livre de Badré, que je nommerai : l'inaboutissement bavard, ou bien le fourmillement anecdotique de constats soutenus par une colonne vertébrale intellectuelle inexistante, ou bien la citation compulsive de noms que les critiques littéraires du demi-siècle prochain auront toutes les peines du monde à ne point croire, en guise de canular, avoir été inventés par quelque facétieux plumitif.
Car enfin, s'il s'agit de servir une thèse, fidèlement résumée de la façon suivante : la littérature française n'était pas grand-chose, peut-être même rien, avant la création de la revue Ligne de risque, par un certain nombre d'exemples que Badré considère comme n'étant finalement que des précurseurs des propres textes du mirifique trio de Voyants que sont Sollers, Meyronnis et Haenel, je ne comprends pas vraiment quel intérêt l'auteur éprouve à bavarder, certes agréablement, en convoquant les ombres de Sade, Lautréamont, Sartre, Paulhan et Blanchot.
Il eût mieux valu approfondir le constat (sans se contenter de citer Debord), effectivement accablant, d'une littérature devenue tout entière marchandise et même putain, bien que Badré passe sous silence tout un tas de grands écrivains qui continuent à bellement écrire et surtout, il eût mieux valu défendre et illustrer les propos du Trismégiste Auteur sollerso-meyrono-haenélien en montrant comment, paraît-il, celui-ci a ou aurait révolutionné le cours des astres et même celui de la littérature et, aussi, en quoi ces insignes triplés sortis d'un même ventre apocalyptique ne seraient absolument rien s'ils n'avaient, à leur disposition, quelques auteurs qu'ils citent vaguement et dont ils pervertissent les textes, comme récemment Melville fut à peine gauchi par leurs creuses, et ineptes, et lamentables lectures.
Je reproche donc à Frédéric Badré, lequel parvient toutefois, par son livre, à montrer qu'il est moins radicalement nul que François Meyronnis et Yannick Haenel, de confondre juxtaposition de petits textes pas forcément inintéressants (ont-ils préalablement paru en revue ou plutôt, en Revue, l'unique, Ligne de risque donc, je ne sais) et essai véritable, qui ne souffre guère les deux tares affligeant le texte de Badré, lesquelles sont l'imprécision, le vague de l'impression plutôt que de la démonstration et le bavardage.
Telle notation, assez juste au demeurant (1), ne nous empêchera pas, chaque fois que nous aurons terminé de lire un des chapitres de l'ouvrage de Badré, de nous demander : Oui, et alors ? Badré tourne-t-il autour du pot de miel collaborationniste sans oser l'écrire trop clairement, dans lequel la France a trempé son groin gourmand pour ne plus jamais oublier l'exquise saveur qu'a la corruption des esprits et des âmes ?
Sans doute, mais on s'étonne que Badré, plutôt que Drieu la Rochelle et même Céline qui «installe l'événement dans une langue qui lui correspond, et qui le sublime» (p. 90), ne cite point, afin d'illustrer une mort de la littérature se nourrissant de l'effacement de la France, les magnifiques textes de Guy Dupré.
On s'étonne encore qu'il ne paraisse pas s'être rendu compte que l'une des plus terribles et profondes analyses spectrales de la déroute, intellectuelle, morale et même spirituelle de la France, nous a été donnée par Georges Bernanos peignant la paroisse morte de Fenouille dans Monsieur Ouine. Comment prendre au sérieux, face à une telle plongée dans ce que nos petits sollersiens nomment un peu trop rapidement le nihilisme ou, pour le dire avec Badré, «l'infernal» (p. 89), les petits jeux du Nouveau Roman qui seraient nés, selon Badré, de la défaite française face aux Allemands ?
Ce n'étaient du reste que quelques pages, sinon chapitres, aux intuitions trop vite esquissées, mal prises, comme Albert Camus parlait dans La Chute je crois des femmes que son personnage avait mal prises. La troisième partie, intitulée Tout reprendre, du reste annoncée par la fin de la deuxième qui nous vaut un éloge particulièrement ridicule de Philippe Sollers, sollersien jusqu'au bout de sa langue boursouflée lorsqu'il déclare que «Tout être d'apparence humaine qui n'a pas pris sa distance avec son intégrale autoterrorisation par rapport au Dieu social, n'a pas lieu de se présenter où que ce soit» (p. 116), Sollers égal à lui-même dans l'insignifiant le plus profond et prétentieux; éloge aussi de son Femmes que l'on nous présente comme un roman-voyant, cette troisième partie donc est inepte, qui se contente de régler de petits comptes avec Houellebecq, Beigbeder, Naulleau ou encore Jourde, apparemment détesté par Badré.
Tout reprendre ? Non : tout médire plutôt, d'abord au sens étymologique du verbe, mal dire, et ce ne sont pas les pages pitoyables où Badré évoque, pompeusement, lamentablement, le rôle qu'il assigne à sa revue Ligne de risque (qui ambitionne de «rouvrir l'histoire de la littérature» et opérerait «un court-circuit dans l'histoire des avant-gardes», p. 122, qui voudrait «inventer une littérature d'après le krach de toutes les valeurs», p. 144, ) qui risquent de nous faire changer d'avis.
Amusons-nous, enfin, d'une contradiction, pas franchement subtile du reste. Frédéric Badré, conséquent avec sa logique de cacographe qui se paie de grands mots, ne cesse de répéter qu'il ne sert absolument à rien de s'attaquer à des «semblants de noms propres», puisque cela empêche de penser «le système d'asservissement du verbe» (Ibid.) et que, de toute façon, «Il n'y a pas d'alternative sérieuse au monde actuel» (p. 164).
Fort bien, il est d'ailleurs parfaitement vrai de constater que s'attaquer à un mauvais critique littéraire, surtout s'il n'est qu'un pigiste, est une phénoménale perte de temps.
Mais dans ce cas, Frédéric Badré, pourquoi donc réserver votre petit bol de salive aigrie pour en badigeonner, par exemple, la face d'un Pierre Jourde (cf. pp. 143-5) ? Pourquoi, encore, donner à Maurice G. Dantec l'occasion de s'exprimer (cf. pp. 155-61), d'une façon que l'on reconnaîtra bien volontiers infiniment plus claire que celle de Philippe Sollers, pour conclure bêtement, sur son cas, de cette façon : «Alors, qui parle ? Un serial killer ou un écrivain ? À sa façon violente, provocatrice, ambiguë, Dantec est une sorte de voyant. Il voit la nature du crime sauvage qui détruit tout. Ses livres explorent l'envers de l'histoire contemporaine, dans la conscience aiguë du nihilisme» (p. 161) ?
Enfin, comment ne pas hurler de rire lorsque nous lisons que ce sont justement les écrivains qui participent à Ligne de risque, les Sollers, Haenel, Meyronnis et même Gérard Guest, qui, parce qu'ils travaillent sur le Néant, permettent la création d'un «accès libre, dans le langage, afin de mener une contre-attaque» (p. 164) contre le Nihilisme partout triomphant, lesquels encore, parce qu'ils créent du secret, cachent, voilent au lieu d'élucider (cf. p. 166) selon le pitoyable manifeste de notre revue publié en 1997 ?
Ah oui, nous avions déjà remarqué de quelle singulière façon ces cuistres pompeusement bavards étaient démangés par le prurit d'un gnosticisme de plateau de télévision et un ésotérisme de sous-Matin des magiciens !
Rassurez-vous, mes chers lecteurs, le présent et même l'avenir de la littérature française n'ont pas de quoi s'inquiéter puisque notre pays, enfoui jusqu'aux narines dans la vase saumâtre du nihilisme indépassable sauf à boire la tasse et peut-être, comme dans Abyss de James Cameron, à faire de l'homme un poisson, peut compter sur des écrivains aussi exceptionnels que Philippe Sollers, François Meyronnis et Yannick Haenel.
Des imposteurs, je l'ai suffisamment écrit, qui tentent de se donner des airs de conspirateurs de «la révolution permanente du style» (p. 175), de terroristes, de maillons crypto-tartufes d'une société secrète disposant, comme il se doit, d'«agents dormants» (Ibid.), qui osent écrire que la littérature n'est point, depuis sa première efflorescence plutôt que depuis le jour où nos apprentis scribouilleurs ont décidé de lui redonner vie, contenance, futur et même passé, «au cœur du destin humain, dans la mesure où il recèle ce qui sauve» (p. 191), qui osent affirmer que, «pour faire pièce [au] désastre [de la destruction du langage], la forme-convention de la vieille littérature ne convient plus. D'autant qu'elle vire à la forme-déchet avec la Nouvelle Tendance. Un livre de littérature requiert une forme-énergie» (p. 193).
Rappelons tout de même à Frédéric Badré que ses amis, sauf erreur de ma part, n'ont écrit que de monstrueuses insignifiances : ils ne pensent pas, ils n'écrivent pas, ils ne plongent dans rien d'autre, certainement pas dans le négatif !, que les petits réseaux d'influence sollersiens (si j'en juge par la couverture médiatique accordée à la dernière imposture commise par Yannick Haenel, Jan Karski), ils ne révolutionnent rien, ils ne cachent rien, ils ne révèlent rien, ils ne complètent rien, ils ne secrètent rien d'autre que de l'ennui, bref, nous nous trouvons là, face à ces professeurs Tournesol du verbe, en présence d'un des plus comiques rhizomes du nihilisme galopant.
Ce nihilisme prenant conscience de son propre vide n'est en aucun cas le gage d'une résurrection de la littérature que, du reste, tout grand écrivain fait jaillir hors de son tombeau pour le débarrasser, comme Lazare, de ses bandelettes puantes.
Conrad, Faulkner, Penn Warren, Quincey, Borges, Gadenne, Bernanos, Dupré, une bonne centaine d'autres au moins, y compris des vivants, français ou étrangers, mais certainement pas Meyronnis, certainement pas Haenel, certainement pas Sollers, certainement pas Guest, absolument pas Badré, qui, tous, ne sont que de minuscules bouches d'ombre.
Nous n'avons pas fini, j'en ai peur, de forer le dur granit du négatif, surtout armés des dents de lait et des toutes petites griffes de ces animalcules se piquant de littérature, et qu'une gouttelette d'acide réduira, un jour, à un peu de fumée malodorante.
Note
(1) «Avec son mysticisme à rebours, Blanchot est le ciment de la religion du littéraire français. Dans l'ésotérique, il exerce sa fascination. Drieu, quant à lui, s'est substitué dans d'autres secteurs de cette religion, aux quatre M de Grasset des années trente (Maurois, Montherlant, Morand, Mauriac), par les effets d'une projection imaginaire», p. 88. Les pages entre parenthèses renvoient à L'avenir de la littérature (Gallimard, coll. L’Infini, 2003).






























































 Imprimer
Imprimer