« 2666 de Roberto Bolaño, 3 : hommes sans qualités et femmes sans destin, par Grégory Mion | Page d'accueil | Dans le Haut-Pays d'Artois, sur les traces de Georges Bernanos »
01/03/2014
Vertiges de W. G. Sebald

 W. G. Sebald dans la Zone.
W. G. Sebald dans la Zone.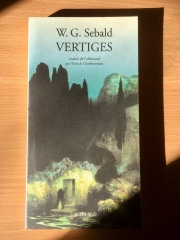 Acheter Vertiges sur Amazon.
Acheter Vertiges sur Amazon.Bien plus que l'amour indiqué dans le titre du texte d'ouverture évoquant Stendhal, c'est le souvenir qui est le sujet véritable des différents récits qui constituent le second beau livre d'importance (après D'après nature) de Sebald, Vertiges (1). Le souvenir ou plutôt ses altérations et ruptures, que le long et lent déploiement de l'écriture doit tenter de combler, du moins partiellement : «Les notes dans lesquelles Beyle, âgé de trente-cinq ans [...] essaie d'extraire de sa mémoire les tribulations d'alors, révèlent diverses difficultés où achoppe l'exercice du souvenir» (p. 10), alors même que, bien souvent, c'est la «violence de l'émotion» qui semble avoir conduit «à anéantir celle-ci» (p. 11), les dessins mais aussi les photographies qui émaillent le texte de l'auteur, et qui constitueront bien vite une de ses marques de fabrique, se proposant de compenser ces éclipses.
C'est de fait la césure qui pourrait assez fidèlement caractériser l'art de Sebald, césure inséparable d'une forme de déroute de la pensée, de commotion ou, pour le dire dans un vocabulaire qui ne heurtera pas les lecteurs habitués à l'odieuse prose socio-pyschanalytique actuellement à la mode, au mal-être. Ainsi, l'écriture du deuxième texte de Vertiges, intitulé All'estero s'ouvre-t-elle par l'évocation, toujours pudique sous la plume de l'auteur, d'une «passe particulièrement difficile» ayant commencé à la fin de l'année 1980, l'humeur de l'auteur semblant de fait assez bien correspondre avec la description de la météorologie qui caractérise le comté anglais où il vit «la plupart du temps enfoui sous les nuages gris» (p. 35).
Plus loin, Sebald parle de la «paralysie de [sa] mémoire» (p. 108), comme si le travail de son esprit ne pouvait être fondamentalement opposé, tentant de faire effort contre lui et de le remonter, au temps qui modèle tout, non seulement la réalité mais aussi, donc, ce qui ne peut qu'y être enté plus ou moins directement, c'est-à-dire les souvenirs. C'est le progrès qui a ainsi régularisé le cours d'un fleuve qui «offre maintenant un spectacle auquel la force du souvenir ne résistera plus longtemps» (p. 43) et qu'il faut, à tout prix et, toujours chez Sebald, dans l'urgence face à la catastrophe qui n'est jamais loin (2), tenter de maîtriser par l'écriture, laquelle obéit, nous déclare l'auteur, à une «pensée concentrique dont les cercles tantôt s'étrécissent, tantôt s'élargissent» (p. 63) et qui peut, parfois, assez souvent même, être cernée par le néant.
De fait, l'écriture peut être contrainte de créer des digues, face à la puissance d'un souvenir qui, en dépit de ses irrégularités et éclipses plus ou moins partielles, peut gronder parfois comme un flot en colère (cf. p. 78), et ces digues peuvent consister en des comparaisons inattendues, comme si l'esprit, en établissant des rapprochements originaux entre des réalités qui semblent ne présenter aucun point commun entre elles, en contenait finalement la puissance élémentaire, sauvage, la puissance de l'écriture qui coule «de la main avec une facilité» étonnant l'auteur lui-même (cf. p. 89) et qui contrebalance la force des souvenirs tour à tour pressants ou mystérieusement enfuis (cf. p. 97).
W. G. Sebald n'a ainsi pas tort de rapprocher son travail poétique de l'élaboration d'un roman policier (cf. p. 89), lui qui souvent se demande «quel rapport établir» (p. 100) entre différents événements ou personnages dont il retrace minutieusement la survenue ou les destinées, humbles mais universelles, tellement humbles que celle de Kafka peut se trouver suggérée en post-scriptum du texte, alors qu'une fois de plus Sebald évoque l'une de ces terribles occultations de ses souvenirs, liés cette fois-ci à «une représentation d'Aïda en plein air», à laquelle il avait assisté avec sa mère à Augsbourg et dont il n'a pas «gardé le moindre souvenir» (pp. 124-5), tout comme il ne parvient plus à se souvenir, dans le dernier texte de Vertiges si, enfant, avec son grand-père qui l'emmenait partout, il est venu «à la chapelle du Krummenbach» (p. 162).
Sebald utilise un autre procédé pour battre en brèche ce que nous pourrions appeler, en somme, la force centrifuge des souvenirs, afin de les rassembler en une cohérence organique, centripète, seule capable de contenir leur volonté infinie d'expansion et même de fuite. Le motif dans le tapis de Vertiges est constitué par la vision répétée, à l'exclusion du deuxième texte, d'un corps d'homme «caché par un grand châle à fleurs en soie frangée» (p. 148), descendu d'une «barque au mât d'une hauteur inconcevable, gréée de voiles noires et pendantes», desquelles descendent un «marinier en blouse bleue» puis deux «autres hommes en redingote foncée et décorée de boutons d'argent» qui suivent «le second maître», portant une civière sur laquelle se trouve l'homme en question (pp. 147-8).
Dans le premier texte, consacré je l'ai dit aux tourments amoureux de Henri Beyle dit Stendhal, l'attention de Mme Gherardi, dont l'identité réelle est sujette à caution selon Sebald, est attirée par «une vieille et lourde embarcation dont les voiles brun-jaune pendaient au grand mât cassé dans son tiers supérieur; elle avait apparemment accosté depuis peu et en descendaient maintenant deux hommes en redingote foncée à boutons d'argent portant à terre une civière où, sous un grand châle de soie à franges et motif floral, était visiblement allongée une forme humaine» (p. 27).
C'est dans le dernier texte de Vertiges, intitulé Il retorno in patria, que le motif réapparaît le plus mystérieusement, sous la forme du corps d'un chasseur mort : «Depuis un certain temps déjà, j'avais entendu le léger tintement des grelots d'un attelage, puis je vis surgir au milieu de la grisaille et des flocons dansants, tirée par la jument pommelée du propriétaire de la Pfeiffermühle, la schlitte sur laquelle était étendue une forme humaine dissimulée sous une couverture de cheval couleur lie-de-vin» (p. 219), cette vision ne pouvant nous rappeler celles qui l'ont précédée par la mention d'un détail, «la présence d'une petite barque tatouée sur le bras gauche du mort» (p. 221).
Sebald ne nous livre aucune explication sur ce motif qui, bien qu'inquiétant, ne provoque pas dans son esprit le même effet «néfaste et dévastateur» (p. 187) que certaines des scènes de peinture qu'il a pu observer durant sa jeunesse. Peut-être faut-il alors nous contenter de ranger cette scène dans la catégorie de l'énigmatique qu'évoque l'auteur auprès d'un des habitants de W., la ville où il a passé son enfance : «En particulier, il m'approuva lorsque je lui dis qu'au fil des années je m'étais fait beaucoup d'idées, mais qu'au lieu de se décanter, les choses en étaient devenues encore plus énigmatiques qu'avant. Plus je rassemblais les images d'autrefois, lui dis-je, et plus il devenait invraisemblable que le passé se soit présenté sous cette forme, car rien ne pouvait y être qualifié de normal; au contraire, la majeure partie de ce qui était arrivé était ridicule, et quand ce n'était pas ridicule, c'était à frémir d'effroi» (p. 189).
Ridicule ou effrayant, c'est aussi le statut de la réalité qui est en cause, réalité que Sebald contemple et traverse, bien souvent comme une ombre anxieuse, et qui ne peut s'empêcher de voir, sous la déhiscence des anciennes images presque complètement effacées dont il s'agit de combler le manque (3), la montée spectrale et inquiétante de celles qui viendront, comme si, en quelque sorte, la volonté farouche de capter les images fuyantes de notre passé ne pouvait se passer de témoigner, à son corps défendant et comme l'ange de Paul Klee par un regard effrayé, des visions futures. Une fois de plus, c'est le spectacle de la circulation automobile dans une ville qui fait soupçonner à Sebald l'apparition d'une nouvelle espèce, alors que la nôtre, si tant est qu'on puisse la prétendre vivante, ne vit que «dans une sorte de captivité» (p. 225).
La vision de l'Apocalypse se précise, lorsque l'auteur, entrant en gare de Heidelberg, constate la présence d'une foule si importante qu'il ne peut manquer de penser que «les gens fuyaient une ville sur le point de sombrer ou même déjà anéantie» (ibid.), le texte se concluant, assez magnifiquement, et une fois de plus sans que cette vision ne nous soit expliquée, sur l'évocation d'un rêve fait par W. G. Sebald où, monté au sommet d'une montagne, l'auteur peut jouir de cette vision effrayante : «Il régnait un silence absolu, car les dernières traces de vie organique, le bruissement d'une dernière feuille, le fin craquement d'un fragment d'écorce, s'étaient depuis fort longtemps dissipées pour faire place à la torpeur du monde minéral. Des paroles résonnaient dans le vide, portées par un écho sur le point de s'éteindre – bribes d'un témoignage sur le grand incendie de Londres. Je le voyais prendre ampleur. Non point feu clair mais brasier mauvais, horrible et sanglant, chassé par le vent sur la ville. Pigeons morts par centaines, plumes roussies par les flammes, sur le noir pavé. Des hordes de pillards envahissent Lincoln's Inn. Bois et pierre, églises et maisons brûlent. Les buis, les cyprès, les ifs de l'enclos paroissial s'embrasent, torches éphémères et crépitantes jetant des gerbes d'étincelles aussitôt calcinées. Éventrée la tombe de l'évêque Braybrookes. Est-ce la dernière heure ? Un choc sourd. Une monstrueuse déflagration vrille les tympans de ses ondes vibrantes. L'arsenal a sauté. Bêtes et gens se réfugient sur l'eau. Ciel sombre. Rougeoyants reflets du mur de flammes crénelées rongeant les pentes des collines. Puis le lendemain retombe silencieuse et sinistre une pluie de cendres qui recouvre la ville, s'étale toujours plus loin - vers l'ouest, vers Windsor Park et au-delà» (pp. 231-2).
Notes
(1) Vertiges, superbement traduit de l'allemand par Patrick Charbonneau, Actes Sud, 2001. Toutes les pages entre parenthèses renvoient à cette édition. Rappelons que le texte original, intitulé Schwindel. Gefühle a été publié en 1990 par Eichborn Verlag. D'après nature a été publié en 1988. La bibliographie allemande de l'auteur indique la parution de plusieurs essais comme Carl Sternheim: Kritiker und Opfer der Wilhelminischen Ära paru en 1969 ou encore Der Mythus der Zerstörung im Werk Döblins en 1980.
(2) Le motif de l'effondrement ou de la catastrophe de type apocalyptique est essentiel dans chacun des ouvrages de Sebald et ceci, nous le voyons, dès celui qu'il a fait paraître en premier : «C'est donc cela, me disais-je alors, le nouvel océan. Sans relâche, en grandes fournées qui recouvrent toute la surface des cités, les vagues accourent, de plus en plus bruyantes, enflent et se cabrent, se brisent avec une sorte de frénésie au paroxysme de leur tumulte et courent sur les pierres et l'asphalte tandis qu'aux retenues des feux rouges d'autres lames se préparent déjà à déferler. Au fil des années, j'en suis arrivé à la conclusion que la vie désormais naît de tout ce fracas, celle qui vient après nous et qui lentement nous mènera à notre perte, comme nous menons lentement à sa perte tout ce qui a été là longtemps avant nous» (p. 62).
(3) Remarquons l'allusion à l'expression anglaise «Mind the gap» qu'entend l'auteur lorsqu'il prend le métro londonien, et qui résonne de curieuse façon dans le texte subtil de Vertiges.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, w. g. sebald, vertiges, éditions actes sud |  |
|  Imprimer
Imprimer





























































