« Le secret de René Dorlinde de Pierre Boutang | Page d'accueil | À la mémoire de Maurice G. Dantec »
18/06/2016
Solaris d’Andreï Tarkovski, par Francis Moury

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Andreï Tarkovski dans la Zone.
Andreï Tarkovski dans la Zone.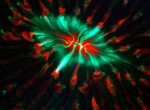 Solaris de Stanislas Lem et le Dieu incompréhensible.
Solaris de Stanislas Lem et le Dieu incompréhensible.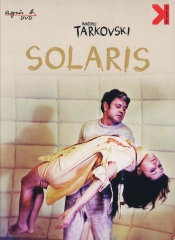 Acheter Solaris de Tarkovski sur Amazon.
Acheter Solaris de Tarkovski sur Amazon.Argument du scénario
Sur une station orbitale qui étudie la planète Solaris depuis des années, des phénomènes étranges se produisent au point que les responsables terrestres soviétiques du projet envoient le psychologue Kelvin enquêter sur place. Il découvre que son ami Gibarian (un des trois derniers occupants de la station) s’est suicidé et que les deux autres savants rescapés ont peur. Kelvin ne tarde pas à émettre l'hypothèse que Solaris est un gigantesque organisme vivant qui réagirait au psychisme humain en matérialisant ses désirs comme ses peurs.
 Solaris (URSS, 1972) d’Andreï Tarkovski fut récompensé par le Grand Prix Spécial du Jury du Festival de Cannes de 1972 et par celui du Centre International Évangélique du Film. Il fut exporté par la suite dans des dizaines de pays, comme une réponse soviétique au 2001 : l’odyssée de l’espace (USA, 1968) de Stanley Kubrick. Tarkovski dénia la valeur de ce rapprochement mais certains éléments ne laissent pas d’y faire néanmoins penser : le témoignage terrestre du cosmonaute qui a vu un enfant monstrueux devant un aréopage de scientifiques rappelle un peu la réunion internationale entre savants à laquelle on annonce la découverte d’un monolithe; l’idée même de l’enfant monstrueux correspond peut-être au bébé surhomme de la fin du film de Kubrick. C’est pourtant avec un titre plus ancien (et bien supérieur à celui de Kubrick qui demeure certes riche mais qui est, hélas, structurellement déséquilibré et intellectuellement insatisfaisant) que Solaris entretient des similitudes étroites : nous voulons parler du génial Planète interdite [Forbidden Planet] (USA, 1956) de Fred McLeod Wilcox. En 1956, une planète autrefois occupée par une race supérieure qui a réussi à matérialiser son propre inconscient et ses pulsions monstrueuses afin de les expulser au dehors sous une forme physique; en 1972, une planète elle-même vivante qui matérialise momentanément les désirs des hommes qui s’en approchent. C’est le fait que la planète soit elle-même vivante qui constitue la «différence spécifique» du film de Tarkovski. Il faut noter que l'idée d'une planète vivante avait été déjà illustrée d'une manière brève et percutante par une nouvelle du recueil de contes de science-fiction de Jacques Sternberg, Univers zéro (éditions André Gérard, coll. Bibliothèque Marabout, série science-fiction, Verviers, Belgique 1969).
Solaris (URSS, 1972) d’Andreï Tarkovski fut récompensé par le Grand Prix Spécial du Jury du Festival de Cannes de 1972 et par celui du Centre International Évangélique du Film. Il fut exporté par la suite dans des dizaines de pays, comme une réponse soviétique au 2001 : l’odyssée de l’espace (USA, 1968) de Stanley Kubrick. Tarkovski dénia la valeur de ce rapprochement mais certains éléments ne laissent pas d’y faire néanmoins penser : le témoignage terrestre du cosmonaute qui a vu un enfant monstrueux devant un aréopage de scientifiques rappelle un peu la réunion internationale entre savants à laquelle on annonce la découverte d’un monolithe; l’idée même de l’enfant monstrueux correspond peut-être au bébé surhomme de la fin du film de Kubrick. C’est pourtant avec un titre plus ancien (et bien supérieur à celui de Kubrick qui demeure certes riche mais qui est, hélas, structurellement déséquilibré et intellectuellement insatisfaisant) que Solaris entretient des similitudes étroites : nous voulons parler du génial Planète interdite [Forbidden Planet] (USA, 1956) de Fred McLeod Wilcox. En 1956, une planète autrefois occupée par une race supérieure qui a réussi à matérialiser son propre inconscient et ses pulsions monstrueuses afin de les expulser au dehors sous une forme physique; en 1972, une planète elle-même vivante qui matérialise momentanément les désirs des hommes qui s’en approchent. C’est le fait que la planète soit elle-même vivante qui constitue la «différence spécifique» du film de Tarkovski. Il faut noter que l'idée d'une planète vivante avait été déjà illustrée d'une manière brève et percutante par une nouvelle du recueil de contes de science-fiction de Jacques Sternberg, Univers zéro (éditions André Gérard, coll. Bibliothèque Marabout, série science-fiction, Verviers, Belgique 1969).Il faut cependant savoir que Tarkovski n’était pas intéressé par l’aspect «science-fiction» du roman de Stanislas Lem mais par son aspect moral et par l’histoire d’amour qu’il mettait en jeu, vision que Tarkovski n’a de cesse d’opposer à une vision scientifique et matérialiste de la réalité. On sait qu’il eût voulu tourner, à la limite, cette histoire sur la Terre. Évidemment tout eût été différent et nous n’aurions pas vu le même film. Cela dit, il faut aussi se méfier des déclarations a posteriori d’un cinéaste sur le film qu’il aurait voulu faire : ce qui compte c’est d’abord bel et bien le résultat filmé. Et de ce point de vue, il est évident qu’il y a une thématique intellectuelle commune aux trois films signés respectivement par McLeod Wilcox, Kubrick et Tarkovski : à savoir celle du «Connais-toi toi-même et tu connaîtras le reste de l’univers» de Socrate, formule philosophique qui est technologiquement médiatisée de la même manière. L’homme, dans les trois titres, obtient des révélations sur sa nature et ses virtualités prodigieuses en se confrontant avec l’altérité absolue : une planète interdite en 1956, un monolithe dispensateur d'intelligence en 1968, un océan intelligent et vivant chez Tarkovski.
Tarkovski n’a, de toute évidence, pas bénéficié du colossal budget de ses deux concurrents américains : Solaris est pauvre en maquettes comme en effets spéciaux. Les seuls éléments visuels ressortant vraiment de la science-fiction sont le décor du vaisseau, sa fusée fragmentaire, les plans de la planète elle-même. Le reste est terrestre. Solaris est épuré, relativement dénudé de toute séduction facile et spectaculaire : les plans de la planète sont répétitifs et volontairement «simples», bien qu’ils soient majestueux et d’une profonde beauté. Le décor intérieur de la station est, de même, minimaliste en comparaison de ce que les films américains de 1956 et 1968 nous montraient. Tarkovski filme une fable philosophique d’une manière réaliste, ni plus ni moins : on dirait presque d'une manière «réaliste soviétique» au sens sadoulien, mais ce serait une aberration du point de vue historique. C’est pourtant le terme qui nous vient spontanément à l’esprit.
Tarkovski débute son récit par une vision de la Terre différente de celle de 2001 : l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, et sans lien non plus avec les rapports sociologiques conventionnels de Planète interdite de Fred McLeod Wilcox. Le cheminement n’y est pas le même parce que, par-delà tout ce dispositif de science-fiction, l’homme est enraciné à sa situation humaine et l’altérité mystérieuse de Solaris ne concourt qu’à confirmer cette situation en la démultipliant dans le temps et l’espace. Solaris est la planète non pas d’un futur surhomme (possibilité ultime représentée par le bébé mutant aperçu à la fin de 2001 : l'Odyssée de l'espace) ou d’un homme accompli (ayant surmonté victorieusement le complexe d'Œdipe, contrairement au père maudit joué par Walter Pidgeon dans Planète interdite), mais la planète où l’homme se confirme comme inachevé essentiellement, comme essentiellement contingent et fini. Un détour lointain pour en revenir là... sans gain spécifique lié au déplacement : c’est toute l’ironie du traitement par Tarkovski de cette «grosse machine». C’est aussi toute sa poésie nue et évidente : la science-fiction est un moyen externe qui n’intéresse pas Tarkovski. Le héros revient à sa «datcha» qui est montrée en un très beau plan comme incorporée dans ce miroir actif qu’est, en somme, Solaris.
L’amour humain est, assurément, le thème central du film et son personnage principal est une femme, alors que la femme n’avait qu’une place parfaitement subalterne dans l’économie narrative de 2001 : l'Odyssée de l'espace, et que c’était bien davantage le rapport œdipien père-fille qui était l'objet de Planète interdite.
Solaris est, en somme, un curieux huis-clos déplacé qui, s’il s’était passé sur la Terre dans une maison isolée, aurait été considéré comme un film fantastique et non plus comme un film de science-fiction. C’est qu’au fond Solaris est à cheval entre les deux genres : esthétiquement impur même si filmographiquement cohérent avec la thématique générale de son réalisateur. Thématique qui est celle, métaphysique, de l’existentialisme chrétien tel qu’il s’est exprimé dans l’histoire de la philosophie depuis Kierkegaard jusqu'à Gabriel Marcel. Raison pour laquelle le film fut plébiscité, comme le signalait en 1999 sa vedette Natalia Bondartchouck, par les églises chrétiennes catholiques, protestantes et orthodoxes. Car Solaris fut d’abord reçu, en 1972, comme une preuve de la vitalité d’une spiritualité orthodoxe inquiète et contemplative en pleine période soviétique officiellement athée et «scientifique». Avec raison. Notons que la projection de Solaris à la Seconde Convention française du Cinéma Fantastique qui s’était tenue du 8 au 15 avril 1973 au cinéma Le Palace (rue Bergère, à Paris) constitua, passée sa première partie, une cruelle déception pour les inconditionnels du genre. L’importance des dialogues philosophiques de la seconde partie rendait le film trop statique à leurs goûts. Et cela se conçoit aisément : Solaris est une fable philosophico-théâtrale de 160 minutes simplement travestie en adaptation d’un roman de science-fiction. Sa mayonnaise ne prend pas, sur le plan de la science-fiction, parce que Tarkovski n’a pas jugé utile qu’elle prenne. Solaris est, avec le recul, devenu un étrange objet cinéphilique davantage qu’un film majeur du maître. Sa lourdeur démonstrative est, cependant, à plusieurs reprises, victorieusement annulée par le sens cinématographique visuel le plus pur de Tarkovski.
Nota Bene
Ce texte est une version revue et corrigée de ma critique parue le 14 juillet 2005 sur Stalker - Dissection du cadavre de la littérature. Cette critique était elle-même issue de la refonte de la section critique de mon test global du DVD zone 2 PAL édité en France par MK2 il y a dix ans. J'ai supprimé la fiche technique succincte du film (on en trouve de bien plus précises actuellement sur Internet) et j'ai, notamment, précisé davantage par rapport à la première version un certain nombre de points sur lesquels, selon moi, Solaris s'éloigne ou se rapproche de 2001 : l’Odyssée de l'espace et de Planète interdite.






























































 Imprimer
Imprimer