« Notre jeunesse de Charles Péguy | Page d'accueil | Le Paradis retrouvé de Halldór Laxness, par Gregory Mion »
19/12/2021
La Colline inspirée de Maurice Barrès

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Maurice Barrès dans la Zone.
Maurice Barrès dans la Zone.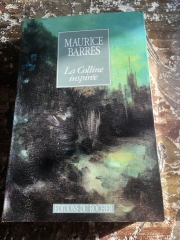 On sait peut-être qu'un écrivain atteint une couche profonde, assez mystérieuse de son art lorsque, à la surface de son texte, en apparence du moins, rien ne nous permet de déceler l'agitation des profondeurs, tout ce qui gronde et s'ébroue, flanc abrupt et colossal de monstre prodigieux, créatures privées de visions mais déterminées à atteindre l'air libre, océan de vase agité par des courants intérieurs, flot et même «avalanche de choses informes, obscures, enchevêtrées» (p. 225). Il est des lieux où souffle l'esprit, comme l'assure le fameux titre du premier chapitre de La Colline inspirée ici présentée dans la collection Alphée des éditions du Rocher (1) mais, à vrai dire, c'est sur ce beau roman que souffle l'esprit, gros d'une dimension qui l'excède, que ce dernier évoque pourtant, par une multitude de signes, d'abord naturels puisque les paysages y jouent un rôle essentiel (et, même, tiennent «au vieux prophète», Léopold Baillard, «de longs discours universels», p. 224) et en nous faisant voir, apercevoir du moins, la cohorte agitée, la «longue suite de héros qui trouvaient dans la pensée d'une alliance avec le ciel un principe d'action» (p. 18). Voici, au passage, quel aura été la seule affaire réelle de Barrès : dans la pensée d'une alliance avec le ciel le principe d'action. Quels que soient, donc, les reproches que nous pourrions adresser à Vintras et à ses suiveurs enthousiastes dont les frères Baillard, et Barrès ne manque pas de les moquer en les traitant de charlatans (2), nous devons reconnaître à tout le moins que ce sont, tous, des personnages qui «entreprennent de rétablir une magistrature spirituelle» et veulent de toutes leurs forces «raviver le surnaturel sur les cimes de leur pays» (p. 21) soit, autrement dit, unir ou plutôt réunir la terre et le ciel.
On sait peut-être qu'un écrivain atteint une couche profonde, assez mystérieuse de son art lorsque, à la surface de son texte, en apparence du moins, rien ne nous permet de déceler l'agitation des profondeurs, tout ce qui gronde et s'ébroue, flanc abrupt et colossal de monstre prodigieux, créatures privées de visions mais déterminées à atteindre l'air libre, océan de vase agité par des courants intérieurs, flot et même «avalanche de choses informes, obscures, enchevêtrées» (p. 225). Il est des lieux où souffle l'esprit, comme l'assure le fameux titre du premier chapitre de La Colline inspirée ici présentée dans la collection Alphée des éditions du Rocher (1) mais, à vrai dire, c'est sur ce beau roman que souffle l'esprit, gros d'une dimension qui l'excède, que ce dernier évoque pourtant, par une multitude de signes, d'abord naturels puisque les paysages y jouent un rôle essentiel (et, même, tiennent «au vieux prophète», Léopold Baillard, «de longs discours universels», p. 224) et en nous faisant voir, apercevoir du moins, la cohorte agitée, la «longue suite de héros qui trouvaient dans la pensée d'une alliance avec le ciel un principe d'action» (p. 18). Voici, au passage, quel aura été la seule affaire réelle de Barrès : dans la pensée d'une alliance avec le ciel le principe d'action. Quels que soient, donc, les reproches que nous pourrions adresser à Vintras et à ses suiveurs enthousiastes dont les frères Baillard, et Barrès ne manque pas de les moquer en les traitant de charlatans (2), nous devons reconnaître à tout le moins que ce sont, tous, des personnages qui «entreprennent de rétablir une magistrature spirituelle» et veulent de toutes leurs forces «raviver le surnaturel sur les cimes de leur pays» (p. 21) soit, autrement dit, unir ou plutôt réunir la terre et le ciel. L'exaltation de notre écrivain est bien réel, même s'il peut se montrer ironique, lorsqu'il écrit ainsi, en tête du chapitre 4 : «Arrière ces yeux médiocres qui ne savent rien voir, qui décolorent et rabaissent tous les spectacles, qui refusent de reconnaître sous les formes du jour les types éternels et, sous une redingote ou bien une soutane, Simon le magicien et le sorcier moyenâgeux» car, ceux-là, ces yeux si décidément médiocres qu'ils ne comprennent même plus ce qu'ils voient, «amoindriraient l'intérêt de la vie» (p. 61).
Ce qui importe en fait avant tout à Maurice Barrès, c'est la capacité consciente, la plus consciente possible à tout le moins, de comprendre qu'il fait office de messager, ou pour le dire d'une autre façon : qu'il remplit un rôle, comme Léopold Baillard, en finissant par découvrir le mage Vintras, comprendra quelle est sa mission terrestre, ayant reçu de l'hérésiarque «un mythe à sa portée, le mythe pour lequel il avait été conçu» (p. 115). La fin du roman, qui parvient à une espèce de dialogue pacifié entre ce que nous pourrions appeler l'esprit éternel de la nature et l'ordre imposé par une autorité spirituelle définie, en l'occurrence l’Église, ordre artificiel donc quoi qu'on en dise, montrant que l'ascension vers la colline inspirée est, aussi, une descente sous les différentes strates ayant constitué, au fil des âges, la terre lorraine, la profondeur de la très riche terre lorraine où s'enracinent nos personnages : «C'est un océan, une épaisseur d'âmes qui m'entourent et me portent comme l'eau soutient le nageur» (p. 286), belle image tout de même un peu inquiétante, qui charrie tout un tas de choses qui toutes ne portent pas forcément un nom.
La colline de Sion-Vaudémont est un de ces lieux où «notre nature produit avec aisance sa meilleure poésie, la poésie des grandes croyances», et cela alors même qu'un «rationalisme indigne de son nom veut ignorer ces endroits souverains» (p. 11). La colline est le lieu même du romanesque, des «sentiments romanesques, depuis longtemps perdus, [qui] se réveillent en nous : l'espoir de quelque inattendu, le souvenir d'images aimées bien effacées» (pp. 190-1) et nous aurions donc tort de nous étonner naïvement que soit là-bas «le lieu d'un grand épanouissement spirituel» (p. 191), ni même que Barrès fasse de sa chère colline le lieu de pèlerinage d'ombres célèbres, «Faust, Manfred, Prospero ! éternelle race d'Hamlet qui sait qu'il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel qu'il n'en est rêvé dans notre philosophie, et qui s'en va chercher le secret de la vie dans les songeries de la solitude !» (p. 287).
Le christianisme, finalement, n'est que l'un des maillons de la longue chaîne spirituelle dont la colline inspirée constitue l'attache, et rien ne nous indique, du reste, que ce maillon sera le dernier. Il n'est en tout cas pas du tout le premier, et c'est peut-être le sens sous-jacent du roman que d'interpréter l'hérésie vintrasienne comme quelque remontée des profondeurs, ou bien comme l'ondulation d'un des anneaux de l'immense animal, restant en partie inconnu, qui constitue «une expérience si vaste» et comme «les incidents d'une longue phrase de vérité» (p. 290). Le paganisme est l'un de ses anneaux, assurément antérieur au christianisme, même si nous ne savons là encore pas grand-chose, sinon strictement rien, des cultes, grotesques, orgiaques ou sanguinaires, qui ont précédé l'époque dont témoigne telle «petite statuette de bronze» (p. 231), Léopold lui-même, le téméraire Léopold pouvant à bon droit être considéré comme «ce suprême disciple qui, le dernier, posséda le dépôt d'une science divine», et qui «remonte jusqu'au bout la perspective ouverte sur le passé» puisqu'il «désire de recueillir les pépites d'or que roulent mystérieusement les ruisseaux de la colline», et parce qu'il s'échappe alors «d'un vol incertain, mal guidé, à travers les siècles» pour remonter «vers les autels indigènes, vers un monde inconnu qu'il ne sait pas nommer, mais qu'il aspire à pleine âme» (p. 233).
Il y a quelque chose, parfois, ô certes assez discrètement, de ce lourd tellurisme, attirant vers le sol, courbant les reins et même les esprits vers la terre grasse, comme une immense boule magnétique organisant la mystérieuse géographie des lignes de force, dans le premier roman de Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan (3) et, au cas où l'on trouverait le terme tellurisme trop fort, il y a quelque chose, dans les romans les plus inquiétants du Grand d'Espagne comme Monsieur Ouine de cette intime compénétration entre le charnel et même le humble (et non bas) matériel et le spirituel pour aboutir à une espèce de matérialisme surnaturel, il est vrai abondamment exploré par Huysmans : «Ce qui donne sa couleur unique et profonde au tableau, c'est que ces gens sont rassemblés pour débattre les intérêts matériels les plus terre à terre, en même temps que les plus folles aspirations religieuses» (p. 79).
Quoi qu'il en soit, quelque chose monte des profondeurs, gronde à la surface et se concentre, comme s'il s'agissait de la foudre attirée par un paratonnerre, sur la colline inspirée : «Est-ce une île nouvelle qui monte à la surface et que le vaste flot de l’Église officielle ne parviendra pas à submerger ?» (p. 116), et c'est encore une image d'excavation que Barrès emploie pour évoquer la résurgence du paganisme : «On voudrait s'arrêter; on se dit que personne ne vit d'un mensonge, qu'il y a là sans doute une réalité à demi recouverte, un terrain de tourbe où jadis un beau lac reflétait le ciel. On s'attarde auprès de cette vase, on rêve de saisir ce qui peut subsister d'un Verbe dans les bégaiements de Vintras. Ah ! si nous pouvions pénétrer en lui jusqu'à ces asiles de l'âme que rien ne trouble, où repose sans mélange, encore préservé des contacts de l'air et des compromis du siècle, ce que notre nature produit d'elle-même avec abondance !» (p. 144). Fous ou sains d'esprit, charlatans et imposteurs ou hommes de bonne foi, sincères, il n'en reste pas moins que Barrès ne cesse de nous montrer que ses personnages puisent à une réserve souterraine, cachée aux yeux de ceux qui, à la différence de nos fins sourciers, ne
 savent pas où chercher les veines profondes d'une eau d'autant plus vivifiante qu'elle reste à l'abri de toute forme de pollution. Voici encore un exemple de ce mouvement de descente irrésistible vers un gisement invisible puis d'extraction, de rapide remontée qui semble mimer l'exaltation contagieuse de cet étrange squelette point tout à fait minéral, de cet homme point complètement de chair pourrie que montre telle splendide sculpture de Bar-le-Duc (dite du Transi de René de Chalon) que cite notre roman ! : «L'univers est perçu par Vintras d'une manière qu'il n'a pas inventée, et qui jadis était celle du plus grand nombre des hommes. Il appartient à une espèce quasi disparue, dont il reste pourtant quelques survivants ! Quelle n'est pas leur ivresse ! Vintras est allé jusqu'à cette mélodie qu'ils soupçonnaient, dont ils avaient besoin. Il l'a reconnue, saisie, délivrée. Elle s'élève dans les airs. Ils palpitent, croient sortir d'un long sommeil, accourent. Vintras exprime l'ineffable» (p. 145).
savent pas où chercher les veines profondes d'une eau d'autant plus vivifiante qu'elle reste à l'abri de toute forme de pollution. Voici encore un exemple de ce mouvement de descente irrésistible vers un gisement invisible puis d'extraction, de rapide remontée qui semble mimer l'exaltation contagieuse de cet étrange squelette point tout à fait minéral, de cet homme point complètement de chair pourrie que montre telle splendide sculpture de Bar-le-Duc (dite du Transi de René de Chalon) que cite notre roman ! : «L'univers est perçu par Vintras d'une manière qu'il n'a pas inventée, et qui jadis était celle du plus grand nombre des hommes. Il appartient à une espèce quasi disparue, dont il reste pourtant quelques survivants ! Quelle n'est pas leur ivresse ! Vintras est allé jusqu'à cette mélodie qu'ils soupçonnaient, dont ils avaient besoin. Il l'a reconnue, saisie, délivrée. Elle s'élève dans les airs. Ils palpitent, croient sortir d'un long sommeil, accourent. Vintras exprime l'ineffable» (p. 145).Léopold, assurément, présente «un mélange de platitude et d'extravagance, mais en lui le passé était plein de vitalité» et c'est encore «en lui, comme des plus vieilles couches de la sensibilité et du tuf [Bernanos encore !] éternel de l'homme, [que] jaillissent des sources quasi taries» (p. 172). Ce «quelque chose d'antique» a tout intérêt à être maîtrisé par l’Église pesant de tout le poids de son autorité et de «toutes les forces de la hiérarchie échelonnées jusqu'à Rom» (p. 237), institution vers laquelle ne semble guère aller la sympathie profonde de l'écrivain Maurice Barrès, bien conscient qu'ils ne reviendront jamais, «les siècles de jadis» et que s'ils «sont blottis, tout fatigués et dénaturés contre nos âmes, et que dans un cri, dans un mot, dans un chant sacré, ils se lèvent d'un cœur sonore», alors ce sont tous les cœurs qui «en seraient bouleversés» (p. 232).
La question essentielles demeure, à mon sens du moins, posée, que nous pourrions figurer par cette alternative moins sommaire qu'il n'y paraît : est-ce que nous assistons à un mouvement de balancier finalement assez naturel en constatant la cavalcade furieuse des forces anciennes, qu'importe que pèse sur elles le couvercle du dogme chrétien, ou bien est-ce parce que la colline inspirée trône depuis longtemps déjà sur une paroisse morte, comme l'illustre le personnage de Léopold Baillard qui lui-même, nous dit Barrès, expérimente une lente dissolution de son christianisme que, «du fond de son être montent de vagues formes, tous les débris d'un monde» (p. 234) et que s'animent, comme le mouvement d'un «long serpent dont la tête s'avance et qui se coupe, disparaît par fractions dans les granges et les portes cochères, aussitôt refermées, sans que la marche de l'ensemble soit arrêtée un moment» (p. 241), «des parties obscures de l'âme» (p. 248), quelques signes néfastes de «l'attrait de ces régions délaissées qui subsistent toujours au fond de nos cœurs et de ces rêves brouillés auxquels personne aujourd'hui, dans notre monde intellectuel, ne donne plus de sens ni de voix» (pp. 261-2) ? Parier sur la première hypothèse serait affirmer que, en dépit de tant de coups, parfois rudes, reçus, la forteresse chrétienne tient encore à peu près debout, alors que le fait de privilégier la seconde interprétation, ce serait admettre que Barrès, comme plus tard Bernanos dans Monsieur Ouine a plus ou moins obscurément senti la vitalité nouvelle, peut-être même jamais réellement perdue mais atténuée pendant les siècles durant lesquels l’Église a étendu son rigide royaume terrestre, du Grand Dieu Pan célébré par Arthur Machen. Quelque confrontation plus poussée entre La Colline inspirée et le dernier roman de Bernanos pourrait, sur ce point d'une résurgence d'une «atmosphère magique, encore accrue par le thème énigmatique exhalé de la fosse d'où venait de surgir le petit dieu inconnu» (p. 236), devrait sans doute être menée.
Je n'oserais choisir entre ces deux voies interprétatives, mais Maurice Barrès, lui, semble estimer que c'est depuis bien trop longtemps que notre monde, débarrassé de ses légendes, de ses «fées au bord des fontaines», de ses fantômes rôdant dans les cimetières, est en train de mourir, Léopold Baillard, lui-même présenté comme «las d'une religion dont l'autel ne nourrissait plus ses prêtres» (p. 216), ayant en somme désappris ce que son éducation l'empêchait de voir, s'étant, contre vents et marées, insultes et railleries, tenu droit pour faire une place à ces esprits tourmentés qui néanmoins «flottent toujours sur leurs domaines, et que nous verrions si notre âme avait reçu l'éducation appropriée» (p. 227).
Notes
(1) Ce livre a été publié en 1993, le lieu d'édition étant Monaco. La copie du texte barrésien est assez soignée (cf. p. 67, un et non «une faible d'esprit»).
(2) Voici ce qu'il est dit, par exemple, de Léopold Baillard : «Du milieu de ses obscures redondances, assez pareilles aux orchestrations d'un charlatan de foire, il terrifiait son monde en prédisant la catastrophe finale, puis il le rassurait en offrant de donner après l'office, dans la sacristie, un mot de passe qui garantirait le salut» (p. 105).
(3) Notons d'ailleurs, ici ou là, un ton, moins même, une simple phrase, que l'on pourrait dire, rétrospectivement bien sûr, bernanosiens dans le texte de Barrès : ce n'est pas seulement «Et maintenant c'est l'heure intime, l'heure du crépuscule» (p. 77) qui annonce l'auteur de Sous le soleil de Satan, mais aussi ce genre de notation : «Est-ce l'aube déjà ou sa mémoire surexcitée qui lui fait distinguer vaguement sur les murailles, dans leurs grands cadres, les portraits des saints fondateurs d'ordres ?» (pp. 49-50). Remarquons que Bernanos, évoquant la présence maligne auprès de celui qui n'est pas encore le saint de Lumbres, saura être beaucoup plus explicite que Barrès décrivant la visite faite à Léopold, par une entité dont nous ne connaissons pas l'origine, divine ou infernale : «Soudain, il sentit quelque chose entrer dans sa chambre et s'arrêter auprès de son lit. Une sueur d'effroi couvrit tout son corps, mais il ne pensa pas à lutter, ni à appeler. Ce qu'il sentait là, près de lui, vivant et se mouvant, c'était abstrait comme une idée et réel comme une personne. Il ne percevait cette chose par aucun de ses sens, et pourtant il en avait une communication affreusement pénible» (p. 54). Nous pourrions également songer à Huysmans décrivant, dans En Route, l'expérience, comparable bien qu'évoquée beaucoup plus longuement, de Durtal. Nous retrouvons aussi dans La Colline inspirée l'idée chère à Huysmans puis à Massignon d'une substitution mystique lorsque le Père Aubry paie, en quelque sorte, pour le salut de Léopold Baillard (cf. p. 273), dont la déchéance est du reste comparée à la passion du Christ.





























































 Imprimer
Imprimer