« Anéantir Michel, ou Pour en finir avec les livres moches, 3 : l'impossibilité d'une oasys, par Thomas Savary | Page d'accueil | Anéantir Michel, ou pour en finir avec les livres moches, 4 : incurable incurie, par Thomas Savary »
24/06/2023
Le seigneur des porcheries de Tristan Egolf : savoir forcer et entendre son destin parmi les noirs oracles de l’Amérique, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Michael Probst.
 Le seigneur des porcheries de Tristan Egolf ou le péché de lèse-évolution.
Le seigneur des porcheries de Tristan Egolf ou le péché de lèse-évolution. «[…] comprendre que les plus hautes intuitions spirituelles semblent dériver des témoignages de ceux qui vacillent dans l’obscurité.»
Cormac McCarthy, Stella Maris.
«Il y a dans le monde des données accessibles seulement à ceux qui ont atteint un certain degré de détresse.»
Cormac McCarthy, Stella Maris.
L’invraisemblable Élu qui rachètera les Damnés de la Terre
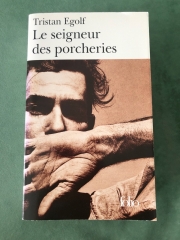 Long et scabreux fut le chemin qui permit à l’éphémère Tristan Egolf de publier Le seigneur des porcheries (1), si long et si scabreux, d’ailleurs, que son texte parut d’abord en traduction française avant de rencontrer le public de son pays, les États-Unis, dont les maisons d’édition, par grappes de dizaines et surtout par incapacité de reconnaître un véritable minerai de littérature, refusèrent le manuscrit, lequel fut sans doute jugé impubliable à cause de ses excès rabelaisiens, de sa complexité narrative et de son ampleur sociologique – une amplitude confondante de réalisme apocalyptique tant ces provocants feuillets, tant ces centaines de pages embrassaient de tout leur lyrisme affamé d’humanité l’une des racines les plus ancestrales et les plus révélatrices du sol américain, l’une des plus radicales fractions du peuple appartenant au Nouveau Monde tel qu’en lui-même, sur les lignes de cet abyssal rhizome, ce peuple radicalisé est reflété dans l’Archaïsante Mappemonde de la Création Primitive. Ce pénible parcours de publication, du reste, rappelle évidemment la mésaventure d’un autre prodige succinct de la littérature américaine, John Kennedy Toole, enfant mélancolique originaire de La Nouvelle-Orléans qui se suicida par désespoir, par lassitude neurasthénique, par dégoût de voir sa Conjuration des imbéciles aussi embarrassante pour les éditeurs, aussi hermétique pour ces décevants lecteurs de bureau, que justifiée dans son truculent constat d’une imbécillité exponentielle inhérente à l’Amérique de la mourante bannière étoilée. Ce n’est qu’un exorbitant concours de circonstances – et non un discernement bien établi – qui offrit à ce texte féroce et lucide la chance d’exister à titre posthume pour son auteur, grâce notamment au jugement assuré de l’écrivain Walker Percy, comme ce fut l’initiative quasiment inconcevable de Patrick Modiano, en France, qui contribua au lancement du jeune Tristan Egolf par le biais d’une recommandation décisive dans les officines népotistes de Gallimard. Et à l’instar de son aîné en férocité dont la silhouette fantomale ne cesse de circuler sur les écrans des spectrographes sondant les invisibles dimensions de la Louisiane, l’inénarrable Tristan Egolf, peut-être moins par consternation dépressive devant la médiocrité du monde que par un atavisme des plus fatidiques, se suicida également, le 7 mai 2005 à l’âge parfois invivable du Seigneur, à Lancaster (Pennsylvanie), se logeant une balle dans la tête, a self-inflicted gunshot wound déclarera la police locale, quand son prédécesseur suicidé natif de La Nouvelle-Orléans se donna la mort par asphyxie au gaz d’échappement, à Biloxi (Mississippi), le 26 mars 1969 à l’âge pré-christique de trente-et-un ans.
Long et scabreux fut le chemin qui permit à l’éphémère Tristan Egolf de publier Le seigneur des porcheries (1), si long et si scabreux, d’ailleurs, que son texte parut d’abord en traduction française avant de rencontrer le public de son pays, les États-Unis, dont les maisons d’édition, par grappes de dizaines et surtout par incapacité de reconnaître un véritable minerai de littérature, refusèrent le manuscrit, lequel fut sans doute jugé impubliable à cause de ses excès rabelaisiens, de sa complexité narrative et de son ampleur sociologique – une amplitude confondante de réalisme apocalyptique tant ces provocants feuillets, tant ces centaines de pages embrassaient de tout leur lyrisme affamé d’humanité l’une des racines les plus ancestrales et les plus révélatrices du sol américain, l’une des plus radicales fractions du peuple appartenant au Nouveau Monde tel qu’en lui-même, sur les lignes de cet abyssal rhizome, ce peuple radicalisé est reflété dans l’Archaïsante Mappemonde de la Création Primitive. Ce pénible parcours de publication, du reste, rappelle évidemment la mésaventure d’un autre prodige succinct de la littérature américaine, John Kennedy Toole, enfant mélancolique originaire de La Nouvelle-Orléans qui se suicida par désespoir, par lassitude neurasthénique, par dégoût de voir sa Conjuration des imbéciles aussi embarrassante pour les éditeurs, aussi hermétique pour ces décevants lecteurs de bureau, que justifiée dans son truculent constat d’une imbécillité exponentielle inhérente à l’Amérique de la mourante bannière étoilée. Ce n’est qu’un exorbitant concours de circonstances – et non un discernement bien établi – qui offrit à ce texte féroce et lucide la chance d’exister à titre posthume pour son auteur, grâce notamment au jugement assuré de l’écrivain Walker Percy, comme ce fut l’initiative quasiment inconcevable de Patrick Modiano, en France, qui contribua au lancement du jeune Tristan Egolf par le biais d’une recommandation décisive dans les officines népotistes de Gallimard. Et à l’instar de son aîné en férocité dont la silhouette fantomale ne cesse de circuler sur les écrans des spectrographes sondant les invisibles dimensions de la Louisiane, l’inénarrable Tristan Egolf, peut-être moins par consternation dépressive devant la médiocrité du monde que par un atavisme des plus fatidiques, se suicida également, le 7 mai 2005 à l’âge parfois invivable du Seigneur, à Lancaster (Pennsylvanie), se logeant une balle dans la tête, a self-inflicted gunshot wound déclarera la police locale, quand son prédécesseur suicidé natif de La Nouvelle-Orléans se donna la mort par asphyxie au gaz d’échappement, à Biloxi (Mississippi), le 26 mars 1969 à l’âge pré-christique de trente-et-un ans. Il ne fait décidément pas bon être un Américain vaticinateur et surdoué dans les États-Unis du XXe siècle aveugle de sa propre sottise rampante, et, l’un et l’autre de ces inconsolables romanciers ont érigé deux personnages immortels, prodigieux, anti-grégaires, deux hautes sensibilités perdues au milieu d’un pesant catafalque d’insensibilité, un binôme de surnaturelles consciences dont le paratonnerre neuronal ne pouvait guère s’adapter aux faibles intensités de leur temps et de leur environnement respectifs. On se souvient dès lors du paranoïaque Ignatius J. Reilly, créature fictive, délicieusement cynique et farouchement savante de John Kennedy Toole, comme on se souviendra de John Kaltenbrunner, autiste de haut niveau de la Corn Belt admirablement décrite par Tristan Egolf, fabuleux souffre-douleur de la douloureuse consanguinité du Midwest immuablement paysan et définitivement impitoyable, grand justicier opiniâtre et providentiel fauteur de troubles dans les eaux troubles de la modeste ville de Baker, le plus souvent rachitique mais motivé bras droit de Dieu, par surcroît incongru gisement du mystère génital des Appalaches endogamiques où l’on ne s’attend qu’à de mongoloïdes accouchements plutôt qu’à de saintes résurrections, en somme un parfait protagoniste pour légitimer le sous-titre eschatologique du roman qui le fait exister et où il est divinement question du temps venu de tuer le veau gras et d’armer les justes.
La tentation de faire de ce livre le bréviaire d’un vaincu revenu d’entre les morts – ou à tout le moins revenu des cénotaphes de la mémoire où gisent ceux que l’on a oubliés après les avoir méprisés ou à peine considérés – pour se venger de ses persécuteurs et faire étalage de sa victoire semble être une lecture acceptable bien que limitée. En effet le thème de la vengeance, tant dans sa manifestation explicite que dans son allusion constante, son insistant bruit de fond animant cette impressionnante machine romanesque, ravitaille assidûment cette histoire avec les toniques et les fanatiques nutriments de la rancune, non seulement parce que des hommes et des femmes se sont montrés odieux envers l’un des leurs et que l’idée de les punir paraît s’imposer, mais aussi parce que l’irréprochable plan de la cosmogonie, par l’intermédiaire d’un inadmissible ratage, par le truchement d’un mauvais pli sur la sublime reliure de l’univers, a l’air de s’en prendre strictement à une famille – rien qu’une famille – de notre vaste monde et encore plus exclusivement à un membre en particulier de cette lamentable souche appalachienne, autorisant alors par exception ce qui devrait être toujours défendu : la vendetta au nom d’une suprême vexation. Cela engendre une persécution complète où l’immanent et le transcendant paraissent conspirer afin qu’un individu dépose inévitablement les armes d’une juste aspiration à l’existence et prenne ainsi le maquis d’un injuste redressage de torts où ce qui n’a pu être vécu normalement le sera dorénavant pathologiquement, à l’encontre des lois de la société comme à l’encontre des lois non-écrites d’une céleste nomologie. Mais s’en tenir à ce facile contraste du tourmenté solitaire qui aurait la mission de corriger une immense association de tourmenteurs serait omettre que Tristan Egolf n’évoque pas une figure singulière de la justice ou un parcours spécifique de justice faite à soi-même – il évoque d’emblée un armement ou un réarmement des justes, en l’occurrence une remise à niveau générale des pauvres gens, avec, en parallèle, un esprit de festivité, un sacrifice du veau gras biblique officialisant un programme de réplétion pour ceux qui ont trop longtemps été vidés de leur substance.
C’est la raison pour laquelle il n’est pas si nettement question dans ce roman d’une incarnation du méritant va-nu-pieds qui résisterait à la bêtise congénitale d’une déplorable procession de va-nu-pieds indignes, ni, en outre, d’un infatigable abandonné de Dieu qui aurait trouvé le moyen de pratiquer un déicide et de s’en laver impunément les mains. Tout au contraire, au fur et à mesure que l’on avance dans le périlleux sillage de John Kaltenbrunner, l’on n’a de cesse de se rapprocher d’une volonté réparatrice en provenance d’une invisible et radieuse force régulatrice, comme si cet irradiant vouloir, finalement, voulait libérer sans plus tarder une communauté dérégulée d’hommes, de femmes et d’enfants devenus insupportablement souffrants pour l’œil de celui qui les a créés. De sorte que les actes de Kaltenbrunner ne sont qu’en apparence des actes de condamnation quand ils sont par essence des actes de réparation, des actes de subtile médiation au-delà des grossiers arbitrages, des actes secrètement commandés, souverainement décrétés, en vue de construire et non en vue de détruire, pour peu, assurément, que l’on pressente le dévalement de tous ces personnages sur une même pente de grâce alors qu’on les voyait au début dégringoler dans les escaliers de quelque satanique et disgracieux souterrain. Par conséquent, une fois réajustée la myopie d’une vision manichéenne où Kaltenbrunner tiendrait le rôle du Bien pendant que tous les autres ou presque se maintiendraient dans le rôle du Mal, il est indispensable, comme jadis l’apôtre Thomas, d’entendre la parole du Christ qui proclame que celui qui croit sans avoir vu sera celui qui sera heureux (tandis que celui qui croit aux plus visibles parties des phénomènes sera malheureux de ne pas s’exercer à fermer ses yeux physiques pour apercevoir en lui-même ce que ses yeux métaphysiques sont susceptibles de lui dévoiler). En d’autres termes, sans avoir vu la moindre empreinte de Dieu parmi les décombres mentaux et les ruines matérielles de cette furieuse et coupable Corn Belt, sans avoir serré ici la moindre main qui pût nous inspirer un élan de mansuétude, hormis celle, bien sûr, du stupéfiant John Kaltenbrunner, il nous incombe de saisir la direction majoritaire du probable projet rédempteur de Tristan Egolf : nous faire croire en cette Amérique indécelable et sacrée, nous prouver qu’il y a une forme de vie sous l’informe réalité des uncharted territories, exhumer cette Amérique de son étouffant sarcophage, de son fatal et proverbial déclassement, la détourner de l’aveuglante partialité des nantis qui ne croient qu’aux espèces sonnantes et trébuchantes, qui n’ont que de brillantes idoles à la bouche et autour de leurs cous de poulets en batterie, arrogante volaille de Wall Street maudissant les vigoureux animaux de Main Street, caquetants profanateurs qui ont éloigné du champ social les icônes vivantes de la nation, qui les ont reléguées du côté des déserts où l’on teste des bombes atomiques, et, en cela, nous faire croire, nous persuader ou nous convaincre qu’il y a de bonnes raisons d’espérer de tous les parias, de tous les crasseux, de tous les désaxés de l’axe diffamateur de la moralité hygiéniste du capitalisme, nous rappeler que c’est le moment, enfin le moment, de repérer l’insoupçonnable vérité du divin au milieu du prétendu malin, et, plus que tout, plus que n’importe quelle prophétie qu’il faudrait apprendre par cœur, nous faire croire davantage en ceux que tout semble mener à la décroissance plutôt qu’en ceux qui habitent au sein de l’Amérique aisément décelable des méchants barons de la croissance. Donc au lieu de croire à ceux que l’on ne voit que trop souvent, il serait préférable de croire à ceux que l’on ne voit que rarement ou jamais, à ceux dont l’impuissance temporelle est une puissance spirituelle et qui subissent l’occultation – et même la guerre – de ceux dont la puissance tangible est une impuissance vis-à-vis de l’intangible, ceux dont le faste aggrave l’atmosphère néfaste des États-Unis, ceux qui ne savent pas qu’ils sont petits et qui savent encore moins que les authentiques grands hommes séjournent là où des voyants tels que James Agee et Walker Evans (2), prédécesseurs de Tristan Egolf au registre des bienheureux qui savaient croire sans avoir vu d’abord, ont exigé qu’on les loue séance tenante.
 Selon cet angle d’attaque qui se rapproche d’une homélie célébrant la pâque des sacrifiés, le redressement des brisés, l’élévation des abaissés, selon cette prédication que nous assumons de plein gré, quoi que l’on puisse dire ou médire de Ford Kaltenbrunner, nonobstant les bruits qui courent sur le paternel de John, à la fois vénérable et discrédité former local boy, nous aimons que la rumeur populaire ait principalement fait de sa défunte personne un «seigneur des bouseux» (p. 45), une préfiguration des indigentes seigneuries de sa descendance. Quelque chose de la folle semence de ce père aura fécondé l’avenir d’une postérité qui ne pouvait qu’être que la sultane des ramasseurs d’ordures et l’eucharistie des anémiés dont le sang a été sucé par les vampires du libéralisme. Si donc la naissance de John a pu avoir lieu malgré d’infâmes conjonctures d’incubation des premiers jours de sa vie, c’est qu’elle devait ultérieurement, dans un mouvement fédérateur et salvateur, s’affirmer en tant qu’aboutissement d’une sibylline concorde des gueux par-delà toutes les physionomies d’une franche discorde. Nous le répéterons : les victimes et les bourreaux de Baker ne sont opposés qu’à un niveau superficiel alors même qu’ils sont rassemblés à un niveau fondamental de martyrologie universelle, et, de fil en aiguille, l’on ressent le tissage approfondi de ce motif de fraternité des accablés pendant que les draconiennes initiatives de John contribuent à détisser les motifs secondaires de l’hostilité. Quels qu’ils soient, tous les citoyens de Baker et de la banlieue de ce godforsaken hole, les complices ou les ennemis de John, ses officieux biographes et ses plus farouches calomniateurs, même le narrateur qui ressemble à une collective présence homérique retraçant l’Iliade et l’Odyssée d’un héros mythologique de la malpropreté américaine, toutes et tous, dans cette cité aux allures de pandémonium, ne sont que des frères et des sœurs de l’ordure subie, des familiers d’une méphitique et fortuite turpitude, unis et valétudinaires sous un oppressant climat humain qui fonde l’espérance d’une surnaturelle délivrance ou d’une omnipotente considération de leurs malheurs d’impotents pour lesquels la déchéance est un absolu et l’avancement une chose très relative. En cela nous allons plus loin que les récits des exploits et des résiliences de John Kaltenbrunner qui souhaitent éviter le révisionnisme acharné de ses détracteurs, car, en effet, nous supposons qu’il y a encore du révisionnisme dans la version la plus objective, la plus fiable du point de vue de l’historiographie de Baker et de son présumé justicier autistique, d’où notre parti pris argumenté de suggérer que les châtiments vindicatifs fomentés par le frappant condottiere de ce livre sont autant de manières de mettre un terme à la guerre de tous contre tous et de nous inciter à penser que cette polémologie des miséreux relève moins d’une aberration locale que d’une aberration nationale – d’un interminable déficit de démocratie qui a permis la liberté pour quelques privilégiés et la servitude pour une masse atomisée dont Baker n’est qu’un échantillon. Pour l’exprimer scandaleusement et laconiquement, les misérables de Baker ne le sont qu’accidentellement alors que les lointains responsables de cette misère le sont essentiellement et consciemment, semeurs consentants des germes du démon dont les récoltes s’organisent toujours à bonne distance de leurs bases, à l’endroit précis où l’on ne croit pas qu’une vaillante patrie d’hommes et de femmes existe puisqu’elle n’est pas vouée à être vue ni même entraperçue.
Selon cet angle d’attaque qui se rapproche d’une homélie célébrant la pâque des sacrifiés, le redressement des brisés, l’élévation des abaissés, selon cette prédication que nous assumons de plein gré, quoi que l’on puisse dire ou médire de Ford Kaltenbrunner, nonobstant les bruits qui courent sur le paternel de John, à la fois vénérable et discrédité former local boy, nous aimons que la rumeur populaire ait principalement fait de sa défunte personne un «seigneur des bouseux» (p. 45), une préfiguration des indigentes seigneuries de sa descendance. Quelque chose de la folle semence de ce père aura fécondé l’avenir d’une postérité qui ne pouvait qu’être que la sultane des ramasseurs d’ordures et l’eucharistie des anémiés dont le sang a été sucé par les vampires du libéralisme. Si donc la naissance de John a pu avoir lieu malgré d’infâmes conjonctures d’incubation des premiers jours de sa vie, c’est qu’elle devait ultérieurement, dans un mouvement fédérateur et salvateur, s’affirmer en tant qu’aboutissement d’une sibylline concorde des gueux par-delà toutes les physionomies d’une franche discorde. Nous le répéterons : les victimes et les bourreaux de Baker ne sont opposés qu’à un niveau superficiel alors même qu’ils sont rassemblés à un niveau fondamental de martyrologie universelle, et, de fil en aiguille, l’on ressent le tissage approfondi de ce motif de fraternité des accablés pendant que les draconiennes initiatives de John contribuent à détisser les motifs secondaires de l’hostilité. Quels qu’ils soient, tous les citoyens de Baker et de la banlieue de ce godforsaken hole, les complices ou les ennemis de John, ses officieux biographes et ses plus farouches calomniateurs, même le narrateur qui ressemble à une collective présence homérique retraçant l’Iliade et l’Odyssée d’un héros mythologique de la malpropreté américaine, toutes et tous, dans cette cité aux allures de pandémonium, ne sont que des frères et des sœurs de l’ordure subie, des familiers d’une méphitique et fortuite turpitude, unis et valétudinaires sous un oppressant climat humain qui fonde l’espérance d’une surnaturelle délivrance ou d’une omnipotente considération de leurs malheurs d’impotents pour lesquels la déchéance est un absolu et l’avancement une chose très relative. En cela nous allons plus loin que les récits des exploits et des résiliences de John Kaltenbrunner qui souhaitent éviter le révisionnisme acharné de ses détracteurs, car, en effet, nous supposons qu’il y a encore du révisionnisme dans la version la plus objective, la plus fiable du point de vue de l’historiographie de Baker et de son présumé justicier autistique, d’où notre parti pris argumenté de suggérer que les châtiments vindicatifs fomentés par le frappant condottiere de ce livre sont autant de manières de mettre un terme à la guerre de tous contre tous et de nous inciter à penser que cette polémologie des miséreux relève moins d’une aberration locale que d’une aberration nationale – d’un interminable déficit de démocratie qui a permis la liberté pour quelques privilégiés et la servitude pour une masse atomisée dont Baker n’est qu’un échantillon. Pour l’exprimer scandaleusement et laconiquement, les misérables de Baker ne le sont qu’accidentellement alors que les lointains responsables de cette misère le sont essentiellement et consciemment, semeurs consentants des germes du démon dont les récoltes s’organisent toujours à bonne distance de leurs bases, à l’endroit précis où l’on ne croit pas qu’une vaillante patrie d’hommes et de femmes existe puisqu’elle n’est pas vouée à être vue ni même entraperçue. Il vaut ainsi la peine de s’attarder sur les vérités drainées par l’incroyable parcours de John Kaltenbrunner, précoce orphelin de père, autodidacte génial et forcené parmi les travaux herculéens du modique domaine agricole familial. Il vaut largement la peine d’interroger, de sonder, de radiographier l’anatomie externe et interne de cette «merveille phénoménologique» (p. 60) qualifiant le charisme et l’individualité proprement messianiques de John, miracle vivant, dynamisme paranormal, ressort d’une machinerie suprasensible qui passe outre les cécités anesthésiées en sachant que son heure viendra au cœur même du malveillant troupeau. Il faut s’imaginer ce collégien puis ce lycéen écrasé par toutes les nuances de l’infortune mais acharné dans sa tâche d’administration du microcosme agronomique où il baptisera son tracteur Bucéphale et l’une de ses brebis du prénom d’Isabelle, la plus galeuse et la plus robuste d’entre toutes. Contre les vents et les marées de la médisance hargneuse, John, inlassablement, apporte le démenti et renverse les pronostics qui le voyaient sombrer dans la précarité ou dans les catacombes de son cerveau réputé «détraqué» (p. 61). Son intelligence pratique est un symptôme de son intelligence conceptuelle et la coalition de ces deux pôles de perspicacité lui confère un don exceptionnel des situations, une faculté hallucinante de déchiffrer l’indéchiffrable écheveau de ses problèmes agraires et de ses tribulations publiques. Dépourvu d’amis, de relations basiques et tout entier dévoué à son obsession de la liturgie laborieuse sur ses terres infra-pastorales, plus souvent tourmenté que traversé par la tranquillité des orants, John se tue à la tâche, gisant prématuré mais palpitant, talonné par une envahissante nécessité, sorte de moujik indomptable et quasi impassible, prêt à tous les sacrifices pour aménager un paradis en plein centre de l’enfer. Et ses succès empiriques – c’est-à-dire son arrimage au vibrato des arcanes rustiques – font contrepoids à l’insuccès de sa démentielle scolarité. Sa cancrerie académique se trouve continûment transfigurée par son génie des choses quotidiennes et sa compréhension des rythmes naturels. Que son père fût un premier de la classe et accessoirement un meneur d’hommes (du moins selon le compte-rendu avantageux de son itinéraire) n’empêche pas John de profiter du génome patriarcal afin de traduire différemment le talent des Kaltenbrunner et d’accomplir médiatement ce que l’ancêtre paracheva dans une séduisante immédiateté. Du reste, l’adaptabilité du père au système scolaire de Baker pourrait constituer un point de critique, une sérieuse réserve, car, effectivement, le barème de scélératesse inhérent aux autorités enseignantes de la ville ne fait que participer à la perpétuation «des perversions intrinsèques à la région» (p. 67). Dès lors John se découvre sous des traits beaucoup plus individuels que ceux qui appartinrent à l’idiosyncrasie semi-générique de Ford Kaltenbrunner. Il est hermétique là où son père pouvait être perméable, il est inflexible là où la flexibilité de son aïeul pouvait être sujette à caution, incapable de céder un pouce de terrain aux passions tristes de cette province de Satan, incorruptible parmi les corruptions d’ici et d’ailleurs, tout simplement parce que la «royauté [de John Kaltenbrunner] n’est pas de ce monde» (3). Non pas que John soit un roi prétentieux ou un Christ à la phrase relâchée, mais, pour adhérer à notre audacieuse comparaison, en toute rigueur, il est indispensable de se figurer que si le plus opprimé des ressortissants de Baker mérite les attributs d’un prophète supra-régalien, c’est qu’il ne sera jamais pris en défaut comme le sont tant de monarques aux royaumes discriminatoires et aux caractères instables. Point de tout cela pour John Kaltenbrunner qui prépare à sa façon la survenue du Royaume de Dieu et qui enseigne fort paraboliquement l’abolition des frontières et l’équanimité d’un gouvernement de la sagesse, dût-on accepter à cet égard des expédients violents, des interventionnismes musclés ou retors, seules solutions pour déjouer la musculature et la malice du diable, incandescence ou froideur christique ne pouvant nullement s’encombrer d’une détestable tiédeur quand il s’agit de compromettre l’un des nombreux épanchements de l’anti-Christ.
 Dans la lignée de ce qui précède, réaffirmons que le royaume de John est celui de toutes les communions, de toutes les vulnérabilités relevées, ne serait-ce déjà que par son souci accentué du règne animal. Sa misanthropie apparente lui permet de piloter une Arche de Noé dont les cales toutefois s’agrandiront pour laisser embarquer les frères humains dénigrés. Cela dit, l’événement fondateur de l’extrême observance de John envers les animaux remonte à un abject épisode de cour de récréation, lorsqu’un chiot de l’accorte race des cockers a été abattu devant les enfants par une police bovine, au fallacieux motif que l’animal suscitait du remous et surtout du bruit qui agaçait le crapuleux directeur de l’école (cf. p. 67). Ce carnage établit ainsi le commencement de quelque chose, le temporaire et progressif repliement de John à l’intérieur de sa conscience, son divorce avec un certain contexte, son schisme papal, seigneurial, qui le conduira aux sommets de la répugnance peu à peu convertie en paradoxale attirance, en résolution du Mal par davantage de Mal, comme on a besoin de connaître le précipice pour deviner une éminence à gravir. Et qui pouvait mieux que John Kaltenbrunner assimiler la dégradation ontologique de ses proches, de ses voisins et de tous les autres faubouriens de Baker ? Principe de descente et axiome du délabrement, tautologie de la chute et alphabet de toutes les décrépitudes, la vie effondrée de John contient en elle-même toutes les vies qui s’effondrent ou qui sont engagées sur les voies épuisantes du nihilisme. C’est parce qu’il est un fidèle amant de la Descente que John est un sauveur de tous ceux qui descendent vers les mêmes ravins de Babi Yar. Et Baker dans sa totalité n’est qu’un ravin de ce genre sordide. Mais quel que soit le degré de fureur de la Descente, quel que soit le quotient d’abomination de la Catabase, l’on doit se souvenir que c’est toujours par l’intercession d’un mouvement extrêmement descendant que l’on se met à la portée de la rencontre avec Dieu et que l’on peut ensuite initier un mouvement ascendant de salvifique Anabase. C’est pourquoi nous choisissons de lire Le seigneur des porcheries à l’instar d’un implacable précis de la Descente, corrélé en ce sens à une pérenne ambiance pentecôtiste, qui laisse ultimement se profiler une étoile de l’Ascension. Tant et si bien que le désespoir amoncelé de cette chronique du calvaire n’abîme en rien le sourire de l’espérance qui s’extrapole derrière les interpolations d’une opiniâtre grimace existentielle. Quelles que soient les épreuves endurées par John Kaltenbrunner, elles sont consubstantielles à la réalisation d’un sauvetage énigmatique – impénétrable parce que dépendant d’un seigneur et du Seigneur – par des moyens qui ont pourtant l’air d’être des synonymes du naufrage.
Dans la lignée de ce qui précède, réaffirmons que le royaume de John est celui de toutes les communions, de toutes les vulnérabilités relevées, ne serait-ce déjà que par son souci accentué du règne animal. Sa misanthropie apparente lui permet de piloter une Arche de Noé dont les cales toutefois s’agrandiront pour laisser embarquer les frères humains dénigrés. Cela dit, l’événement fondateur de l’extrême observance de John envers les animaux remonte à un abject épisode de cour de récréation, lorsqu’un chiot de l’accorte race des cockers a été abattu devant les enfants par une police bovine, au fallacieux motif que l’animal suscitait du remous et surtout du bruit qui agaçait le crapuleux directeur de l’école (cf. p. 67). Ce carnage établit ainsi le commencement de quelque chose, le temporaire et progressif repliement de John à l’intérieur de sa conscience, son divorce avec un certain contexte, son schisme papal, seigneurial, qui le conduira aux sommets de la répugnance peu à peu convertie en paradoxale attirance, en résolution du Mal par davantage de Mal, comme on a besoin de connaître le précipice pour deviner une éminence à gravir. Et qui pouvait mieux que John Kaltenbrunner assimiler la dégradation ontologique de ses proches, de ses voisins et de tous les autres faubouriens de Baker ? Principe de descente et axiome du délabrement, tautologie de la chute et alphabet de toutes les décrépitudes, la vie effondrée de John contient en elle-même toutes les vies qui s’effondrent ou qui sont engagées sur les voies épuisantes du nihilisme. C’est parce qu’il est un fidèle amant de la Descente que John est un sauveur de tous ceux qui descendent vers les mêmes ravins de Babi Yar. Et Baker dans sa totalité n’est qu’un ravin de ce genre sordide. Mais quel que soit le degré de fureur de la Descente, quel que soit le quotient d’abomination de la Catabase, l’on doit se souvenir que c’est toujours par l’intercession d’un mouvement extrêmement descendant que l’on se met à la portée de la rencontre avec Dieu et que l’on peut ensuite initier un mouvement ascendant de salvifique Anabase. C’est pourquoi nous choisissons de lire Le seigneur des porcheries à l’instar d’un implacable précis de la Descente, corrélé en ce sens à une pérenne ambiance pentecôtiste, qui laisse ultimement se profiler une étoile de l’Ascension. Tant et si bien que le désespoir amoncelé de cette chronique du calvaire n’abîme en rien le sourire de l’espérance qui s’extrapole derrière les interpolations d’une opiniâtre grimace existentielle. Quelles que soient les épreuves endurées par John Kaltenbrunner, elles sont consubstantielles à la réalisation d’un sauvetage énigmatique – impénétrable parce que dépendant d’un seigneur et du Seigneur – par des moyens qui ont pourtant l’air d’être des synonymes du naufrage.
La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.






























































 Imprimer
Imprimer