« Eschaton, un recueil de textes de Vincent La... Sylvia Massias | Page d'accueil | Solénoïde de Mircea Cărtărescu : où l’enfant est à la fois un guérisseur et un législateur de l’avenir, par Gregory Mion »
10/11/2022
Discours sur les sciences et les arts de Jean-Jacques Rousseau : une objection au siècle des Lumières et une préfiguration de nos médiocrités, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Kelly Dallas (LPP Awards).
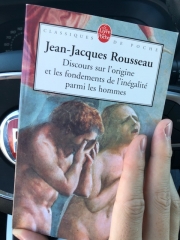 «Qu’une recherche de pointe soit associée à une véritable menace à la survie de l’humanité, une menace même à la vie tout court sur la planète, ce n’est pas une situation exceptionnelle, c’est une situation qui est de règle.»
«Qu’une recherche de pointe soit associée à une véritable menace à la survie de l’humanité, une menace même à la vie tout court sur la planète, ce n’est pas une situation exceptionnelle, c’est une situation qui est de règle.»Alexandre Grothendieck.
«Si le Poète n’avait eu affaire qu’à des imbéciles sans bonté, ils l’eussent acquitté probablement. Mais le jury avait été trié, comme par un démon, dans le tas des commerçants les plus honorables. L’Espérance, tuée par le souffle de la Marchandise, reposait dans un cimetière lointain.»
Léon Bloy, Exégèse des lieux communs.
Aux sources turbulentes du Discours sur les sciences et les arts (1) qui fut pour Jean-Jacques Rousseau un levier de célébrité à l’exact mitan du XVIIIe siècle, il y a une belle question de l’Académie de Dijon, un concours où les candidats étaient tenus de réfléchir à ce problème : «Si le rétablissement des Sciences et des Arts a contribué à épurer les mœurs». Lauréat de ce concours prestigieux, Rousseau a pris le contre-pied de l’époque des Lumières qui était la sienne tout en étant paradoxalement un spécimen assez incontestable de ce courant de pensée. Tout au long de cette brève et tonique réflexion fondatrice, il a défendu avec détermination une thèse que l’on retrouvera plus ou moins dans toute son œuvre ultérieure : le progrès des connaissances humaines engendre simultanément une régression de la vie morale, comme si le développement de l’esprit devait nécessairement provoquer une dépravation du cœur, comme si la bonté originelle des hommes (du moins selon Rousseau) était invariablement corrompue par un haut niveau de civilisation. Autrement dit, en adhérant à la colonne vertébrale du rousseauisme, on doit assumer l’idée que l’homme vient au monde avec un cœur pur et que ce cœur est avili au prorata des conditions de perfectionnement d’une société. C’est le prix à payer de l’humanité constituée en civilisation : parce que les hommes sont perfectibles et parce qu’ils ne sont pas des animaux, ils sont parvenus à sortir de leur état primitif dépourvu de qualités, mais en s’élevant de cette façon au-dessus de leur situation initiale, en justifiant qu’ils valaient davantage que des animaux, ils se sont éloignés de leur mythique innocence (2) et ils ont semé parmi eux le chaos, «[retombant] ainsi plus bas que la bête» (3).
La composition de ce texte programmatique de 1750 est d’autant plus habile qu’elle commence par valoriser les efforts de la civilisation, la manière dont les hommes se sont efforcés d’abandonner les ténèbres de la barbarie pour entrer dans la lumière du raffinement et de l’humanité complète, la manière, finalement, dont nous sommes passés du néant de l’ignorance furieuse à la plénitude de l’encyclopédisme serein. À ce mouvement d’inflation de la connaissance (ou de croissance de la vie intelligible) s’est greffé un mouvement d’inflation de la vie sensible par le biais «du commerce des Muses» qui a pour fonction de «rendre les hommes plus sociables en leur inspirant le désir de se plaire les uns aux autres par des ouvrages dignes de leur approbation mutuelle». Ainsi l’esprit et le corps de l’homme éclairé sont censés bénéficier de tous les avantages pour bien vivre et pour entretenir une saine émulation créatrice tant dans le domaine des sciences que dans le domaine des arts. Mais à en croire les observations et les sentiments de Rousseau, les choses n’ont pas pris cette tournure, et plutôt que de fortifier la vertu, c’est-à-dire plutôt que de renforcer les dispositions à faire le Bien et à contourner le Mal, tous les éléments de connaissance et d’agrément de la société des Lumières n’ont fait que promouvoir «les apparences de toutes les vertus sans en avoir aucune». Autrement dit un hygiénisme de surface dissimulerait au sein même des Lumières une corruption profonde, les sciences et les arts n’étant que des vêtements attractifs qui serviraient à cacher la dimension répulsive de ce que l’homme moderne incarnerait en réalité : l’individu intégré à une société apparemment bonne mais qui a désintégré en lui ce qu’il avait de meilleur et donc de plus humain. En des termes encore plus durs, plus pessimistes aussi, on pourrait affirmer que Rousseau dénonce le progrès excessif de son temps qui va de pair avec la démesure des âmes monstrueuses qui alimentent la course en avant de ce progrès, et, ce faisant, il semble que le brûlant natif de Genève considère que la barbarie de jadis a ressuscité sous une forme séductrice mais probablement plus destructrice que celle des hordes de Wisigoths qui procédèrent au sac de Rome en l’an 410 de notre ère. De telle sorte que Rousseau dirait volontiers que les loups ne sont pas à nos portes – et même qu’ils ne l’ont jamais vraiment été – mais qu’ils sont toujours déjà parmi nous et qu’ils ont certainement des visages de scientifiques et d’artistes.
Les nombreuses accusations que formule Rousseau sur un plan spéculatif ne sont pas non plus sans conséquences visibles et néfastes sur le plan de l’anthropologie voire de l’anatomie (du moins si l’on s’en tient à une optique strictement partiale et rousseauiste) : alors même que tout indique pendant la période des Lumières un affermissement de l’homme ou un perfectionnement total de la nature humaine, tout n’est au fond que décomposition, ramollissement de l’homme, ralentissement palpable de la vitalité, la profanation de la vie morale inorganique entraînant inévitablement une atrophie de la vie dans son registre concrètement organique. À bien des égards, si Rousseau devait s’adonner à une longue description des hommes et des femmes sous l’emprise croissante des sciences et des arts, il décrirait assurément des corps malingres, des corps dévitalisés, des corps uniquement relevés par la cosmétique du savoir et des objets d’art, mais des corps dissociés de l’épaisseur cosmologique (car toute cosmétologie est incompatible avec tout ce qui est cosmique – tout ce qui est artificiel ne pouvant plus s’assimiler à ce qui est infiniment et puissamment naturel).
Et si l’on s’amusait à comparer Rousseau avec quelques juges sourcilleux de nos sociétés très avancées, si l’on essayait de lui trouver un équivalent de sévérité ou de misanthropie, le nom de Thomas Bernhard conviendrait à merveille tant ce dernier a fustigé l’hypocrisie et la scélératesse de Vienne, tant il a condamné cette ville aux pires malédictions, ne fût-ce qu’une fraction de cette capitale autrichienne dévorée de sournoises ambitions artistiques, une fraction qui suffit malheureusement à corrompre toute une métropole et même tout un pays si l’on accepte sans réserve les conclusions du procureur Bernhard telles qu’elles sont vigoureusement réunies dans Des arbres à abattre (4). Il ne fait aucun doute que Rousseau eût détesté la Vienne du XXe siècle autant que Bernhard l’a détestée, non seulement parce que le spectacle des bourgeois satisfaits diffuse toujours un relent de décadence, une odeur de vieille Rome dévergondée, mais aussi parce que les sciences et les arts qui sont arrivés jusqu’au sommet des sociétés les plus élaborées ont installé une espèce de conformisme social qui réduit la possibilité de voir émerger un véritable génie autonome et révolutionnaire. En effet (et pour peu que l’on fasse crédit à l’idée d’une anthropologie négative), puisque ce sont les plus faibles qui décident de ce qui est bon et qui distribuent les récompenses, puisque ce sont les cœurs les moins vivants et les moins vertueux qui s’expriment sur les sujets d’importance que sont les sciences et les arts, alors on ne voit pas comment les plus forts en énergie vitale et en génie authentique pourraient se frayer un chemin parmi ces âmes moralement défaillantes. De là découle une platitude à la fois cognitive et affective : les pensées et les sentiments d’une telle société reposent sur une basse fréquence et nous font oublier la haute fréquence de nos origines naturelles, l’intensité véridique et primordiale, comme si, en fin de compte, un substantiel degré de culture ne pouvait que trahir les configurations initiales et idéales de la nature. Aux yeux impitoyables de Rousseau, donc, tout ce qui faisait la force et la bonté de l’homme au temps imaginaire précédant l’avènement des sociétés s’est progressivement perdu dans la force artificielle du monde cultivé, tout ce que l’homme possédait en excellences innées s’est peu à peu dégradé dans les acquis de la culture, et, au registre des pertes les plus graves, les hommes ont égaré leur «liberté originelle», leur puissance créatrice de possibles, dorénavant prisonniers des consensus et des petits jugements de leurs experts attitrés ou de leurs artistes dûment recommandés. Cette intransigeance de Rousseau peut évidemment nous faire sourire quand on évalue avec objectivité le mérite des arts et des sciences au moment des Lumières, mais ramenée au climat de notre siècle où l’économie de marché décide d’à peu près tout, où l’argent fait et défait les initiatives scientifiques de même que les réputations artistiques, la fermeté rousseauiste d’autrefois prend alors certaines allures de prophétie en nous exposant par avance la médiocrité du cœur occidental. Un exemple suffira pour les sciences contemporaines : la radicale remise en question personnelle d’Alexandre Grothendieck quand celui-ci s’est avisé du lien de plus en plus insoutenable entre la science et l’idéologie de la guerre, ce qui, de jour en jour, l’a poussé hors du périmètre de la recherche institutionnelle. Quant aux arts ou ce qu’il en reste à notre époque, il n’est que de voir ce qu’on appelle désormais littérature en France pour se convaincre du désastre moral que Rousseau avait identifié.
Il résulte de tout cela un paradoxe classique et déjà pressenti dans nos analyses : croyant s’élever, les hommes se sont définitivement et lamentablement abaissés, or c’est en acceptant de s’abaisser, de se mettre au niveau des choses les plus simples que les hommes s’élèveraient, comme le Christ s’est élevé au summum de la fraternité en approuvant la descente, en s’imprégnant de cette vérité spéciale qui soutient que toute trajectoire ascendante ne peut s’initier qu’à partir d’une trajectoire descendante. Néanmoins ce n’est pas du tout l’intention des apologistes du progrès qui prennent une distance considérable avec ce qui est simple et ancestral en portant aux nues les nouvelles formes complexes, les pratiques superflues de la complexité, recouvrant le monde d’un voile sophistiqué de connaissances et de parures qui fait écran à toute espèce de réciprocité immédiate avec l’univers en tant que tel, avec la nature telle qu’elle est apparue aux premiers temps de la vie, avec ce mystère archaïque de la création naturelle qu’il ne faudrait pas chercher à connaître ou à représenter de fond en comble, ceci dans la mesure où un rapport de co-naissance (5) serait plus adéquat (en l’occurrence, ici, une volonté de vivre avec la Nature, avec sa rythmique pertinente, comme si sa présence était fonction de notre présence, comme si l’on ressentait à chaque instant que notre élan vital est tributaire d’un élan vital plus grand que le nôtre) (6). Ce qui pourrait alors être bienvenu, c’est de briser l’esprit et de régénérer le cœur, de faire descendre l’esprit dans le cœur, de s’apercevoir que la perfection réside moins dans les innovations théoriques (la science) et les évolutions esthétiques (l’art) que dans les fébriles replis de notre sensibilité pure (tout ce qui nous encourage à l’amour humain sans le moindre intermédiaire). Dans cette perspective éventuelle, il s’ensuivrait que «nos âmes [cesseraient d’être] corrompues à mesure que nos sciences et nos arts [s’avancent] à la perfection». En d’autres termes, si nous nous rendions compte que ce que nous entendons communément par perfection masque une imperfection, si l’on voyait que l’ordre façonné par nos sciences et nos arts induit un désordre dans nos âmes et dans nos relations, nous irions peut-être vers ce que nous évitons communément (les résistants et impénétrables arcanes de la nature) pour rétablir en nous les fondations écroulées de la vertu et de la modestie. Ce serait donc par le biais d’une diminution volontaire de nos pouvoirs de penser et de créer que l’on amorcerait une sincère amélioration de nos cœurs contaminés par la fausse monnaie des sciences et des arts.
En cela il est évident pour Rousseau que «les sciences et les arts doivent [ainsi] leur naissance à nos vices», d’où sa prédilection pour Sparte contre Athènes, sa préférence d’une certaine vigueur contre une perfide rationalité et une trompeuse finesse. Ce que Rousseau reproche à l’Athènes de naguère, c’est d’avoir condamné à mort le plus sage de ses citoyens, le plus respectable de ses hommes : Socrate. Les tribunaux athéniens soi-disant instruits et honnêtes sont passés à côté de celui qui faisait profession d’ignorance («Ce que je sais, c’est que je ne sais rien» (7)) et qui s’évertuait à sculpter les âmes, à les délivrer de ce qui les encombrait, à les préparer à la rectitude morale par l’intermédiaire du compas et de l’équerre philosophiques. C’est pourquoi le procès organisé à l’encontre de Socrate peut servir la cause rousseauiste : la société d’Athènes aurait de bon gré admis qu’elle avait atteint une très haute altitude en matière de connaissances et de bonnes mœurs, elle aurait même ajouté qu’elle était loin devant Sparte et sa mauvaise renommée de violence, mais, quoi qu’il en soit, ce sont malgré tout les autorités athéniennes qui ont exercé une injustice à l’égard de Socrate et qui ont par conséquent révélé le persistant défaut d’un régime se voulant démocratique – à savoir : la rage de l’égalité qui se convertit en dispositifs pour éliminer toutes les têtes qui dépassent et la «fureur de se distinguer» entre médiocres en dépit du mot d’ordre égalitariste structurant telle ou telle démocratie. Ce naufrage d’Athènes envers la sagesse de Socrate est bien sûr un écho anticipé de ce que Rousseau déduit et observe de son siècle avec sa singulière et déconcertante subjectivité, une réfraction, en somme, de ce que le philosophe genevois soupçonne d’aberrant dans les contextes politiques dont il est le contemporain (8). Et maintenant, du reste, à l’heure de nos démocraties totalement dysfonctionnelles où les valeurs s’inversent dangereusement, à l’heure où les masses de la faiblesse ont pu se venger de ce qui est réellement fort et grand, nous vivons les tristes prolongations d’un jacobinisme qui multiplie les guillotines symboliques et décapite les hommes et les femmes d’envergure. Encore une fois, tout ce qui paraissait exagéré ou sujet à caution sous la plume paranoïaque de Rousseau relève à présent d’un quasi diagnostic sur le flagrant délit de nos médiocrités assouvies.
En outre, toujours selon les visées rousseauistes, la supériorité de Sparte sur Athènes se vérifie également par le fait que les Spartiates ont su pratiquer la vertu, qu’ils ont su en être l’exemple, tandis que les Athéniens n’ont fait que théoriser une vertu qu’ils n’appliquaient pas pour eux-mêmes. Or en pratiquant la vertu au lieu de l’étudier comme des savants, nous serions peut-être capables de réintégrer «l’heureuse ignorance» où la «sagesse éternelle» nous avaient déposés, et, par ce rapatriement inespéré au sein de nos premières naïvetés, nous pourrions rejoindre un genre de matin du monde, une sorte d’aurore enfantine, recouvrant ainsi la vue pour voir la partie du monde qui nous a été confiée avant que nous ne l’abîmions, que nous nous en détournions par l’orgueil de savoir, par une curiosité malsaine et par l’inaptitude à repérer les vraies richesses (pour parler le langage de Jean Giono (9)).
On comprend dès lors que Rousseau puisse être si amer vis-à-vis de la science qu’il accuse d’oisiveté et d’inutilité. En accumulant des erreurs et des informations stériles, la science se fait complice de la quantité et non de la qualité. Il en va de même pour les artistes qui vivent sur le dos des forces essentielles en produisant des œuvres inessentielles. En suivant cette logique, les scientifiques et les artistes que Rousseau a en ligne de mire seraient des falsificateurs de l’ordre juste et ils inciteraient même la politique à sombrer dans les plus triviales préoccupations. En effet, par leur souci du luxe et de l’argent, par leur soif de triomphe aussi, les érudits et les créateurs à la mode profanent le sanctuaire de la nature et détruisent le sentiment du sacré. L’exemple qu’ils donnent est un contre-exemple et cela participe d’une accélération de l’avilissement du peuple. En souhaitant plaire à la majorité, l’artiste doit séduire ce qu’il y a de plus vil et de plus petit chez le peuple, il doit flatter ses bas instincts, il doit cultiver sa faiblesse en le déportant le plus loin possible de toutes les inspirations naturelles de la force vive. Et le peuple n’a aucun mal à se soumettre puisqu’il s’agit d’un peuple policé dont les reliefs potentiels ont été laminés par le catéchisme de la tolérance et par tant d’autres appareils à construire des sommeils dogmatiques. Ce dressage qui ne dit pas son nom aboutit non seulement à une déchéance de l’âme, mais, de surcroît, il aboutit à une déperdition du jugement de goût puisque les œuvres les plus aimées devraient être les moins aimables (du moins pour un peuple qui n’aurait pas été dévoyé et qui ne se serait pas laissé dévoyer). Quant aux scientifiques de renom ou protégés par quelque rempart universitaire, ils ne font que s’infatuer de leurs vaines découvertes, nullement concernés par l’urgence de réveiller le peuple et de lui réapprendre à redevenir humain. Aussi l’argent des sciences et des arts ne saurait acheter ni la vertu ni une nation exemplaire – il ne fait que répandre les ténèbres et il prépare le cataclysme éventuel de la civilisation occidentale tel qu’a pu l’annoncer René Guénon au XXe siècle en soulignant l’inanité d’une civilisation qui aurait tout misé sur le progrès et sur une systématique vision instrumentale de la réalité (10). Dans le fond, Rousseau devance un peu les travaux de Guénon en s’alarmant d’une société de plus en plus matérialiste, de plus en plus décevante dans ses crédos, une société saturée d’idées et de repères artistiques mais une société fatalement déracinée du sens magique de la terre et du ciel, une société inéluctablement arrachée des traditions vivantes et des principes supérieurs qui sont susceptibles de fonder un peuple solide, un peuple ouvert et transitif, relié à une solide mystique l’empêchant de croire qu’il peut tout dominer et tout comprendre. En quoi nous dirons que Rousseau entrevit à son époque les irréductibles dérives d’un monde qui devait se précipiter deux siècles plus tard dans son accablante version tératologique, dans sa phase terminale que Guénon qualifia de «monstruosité» (11) et qui de nos jours semble se poursuivre en d’insupportables et interminables péroraisons.
Le corollaire d’une société qui dégénère au point de chute où la saisit Rousseau s’explique encore avec le passage de la simplicité à la fatuité (de l’humilité à l’arrogance). En des pages dont il est coutumier, l’auteur de ce Discours critique publié en 1751 rebrousse le chemin de l’existence et nous remémore l’utopie de la vie pacifique et tout à fait harmonieuse, la fiction d’une vie où les dieux étaient penchés sur le monde et où les hommes regardaient ces divinités avec la crainte et le respect qui leur étaient dus, puis, après cette incursion dans ce Pays de Cocagne, nous revenons à la destination d’où nous étions partis et nous ne voyons plus qu’un monde dévasté, un monde où les dieux se sont éclipsés parce que les individus eux-mêmes ont choisi de se déifier, les uns logeant dans des maisons plus vastes que des églises et instaurant de la sorte un laïcisme agressif, les autres avides de s’engager sur cette pente mortelle. On assiste ici à la disparition de toute transcendance et à l’inauguration d’un cycle d’humanisme déréglé où l’homme se situe tellement au centre de la vie qu’il en oublie la vie même et ses mystérieux infinis. Plus personne ne bâtit quoi que ce soit de charitable parce que chacun est soucieux de bâtir son propre monument de gloire. Et cette invincible dégradation du mouvement centrifuge qui est à la base de toute société féconde se traduit infailliblement par une démission des convictions patriotiques et des tendances à se sentir uni à quelque chose de suprêmement unificateur : le courage, la force et la virilité ne sont plus nécessaires dans une société prétendument libérée des guerres et des barbares mais où les hommes se font constamment la guerre avec des moyens nouveaux, des moyens détournés, des moyens adaptés à la lâcheté, à la malignité, à la médiocrité. C’est sans doute la raison pour laquelle Rousseau suspecte la science de détruire les «qualités morales» parce que celle-ci n’est plus que le repaire des corrupteurs qui travaillent exclusivement à fournir les outils pour encore et encore posséder le monde, posséder la nature, posséder les avantages de semer le désavantage chez tous ceux qui n’ont pas pris le train de cette délirante modernité en marche. Et quels enseignements dispense-t-on en de telles circonstances de dissolution des cœurs ? On apprend aux jeunes générations à manipuler le langage, à substituer ce qui est grand par ce qui est petit, ce qui est haut par ce qui est bas – en un mot on ne leur apprend pas à être des hommes mais à être des sous-hommes d’une incomparable perfidie.
À l’avenant de ces effondrements, il est normal que la société s’acharne à récompenser ce qui est méprisable et à dédaigner ce qui est noble et généreux. C’est pourquoi Rousseau insiste tant sur les gratifications qui vont aux talents plutôt qu’aux vertus (et même aux faux talents des plus vicieux d’entre les hommes). Plus précisément, au gré d’une éloquente distinction, Rousseau déplore que les «talents agréables» supplantent les «talents utiles», c’est-à-dire que les démagogues des sciences et des arts aient plus de poids que les consciences qui pourraient nous ramener dans le giron de quelque transcendante manière de vivre. Alors que peut-on espérer ? Ne faudrait-il pas laisser un tel monde mourir en attendant qu’un autre lui succède ? Peut-on oser envisager un changement de paradigme quand on se hasarde à plonger dans les eaux si marécageuses de l’examen rousseauiste ? Est-ce que nous n’aurions pas dépassé depuis longtemps le point de non-retour ? Rousseau fait pourtant le pari d’une probable évolution en stipulant que l’on pourrait réorienter les sciences et les arts afin qu’ils œuvrent en synergie avec «la félicité du genre humain». Mais au-delà de cette espérance relativement généraliste, Rousseau exige que les meilleures âmes se recrutent parmi les sciences et les arts, et que, par voie de conséquence, les âmes les plus basses soient écartées de ces domaines et qu’elles puissent atterrir en des endroits qui leur seraient plus seyants. Ce n’est là ni plus ni moins qu’un désir de réformer en profondeur une société malade de ses impostures et se moquant de ses génies ou de ses âmes aristocratiques. Tout ce qui est vulgaire devrait ainsi être maintenu dans l’obscurité et tout ce qui a vocation à édifier le cœur humain devrait apparaître aux étages décisifs de la civilisation. Une telle transaction des positions sociales, selon toute vraisemblance, susciterait des concurrences loyales et profitables, allant jusqu’à modifier le devoir du politique en l’obligeant à persévérer dans l’appétit d’accomplir de grandes choses, à commencer par la volonté de faire reculer la corruption et de propager l’esprit de justice. Reste qu’une aussi belle espérance collective se ne réalisera que si les individus eux-mêmes acceptent d’abord de s’examiner avec justesse, de mesurer l’ampleur ou la maigreur de leurs qualités respectives indépendamment de ce que leurs passions leur murmurent, à dessein ensuite de se diriger vers les strates sociales qui répondront le mieux à leurs besoins et à ceux de l’intérêt général et d’où ils ne sortiront possiblement qu’après avoir dûment progressé. Ceci étant posé, il serait vain pour finir de résumer l’impasse de notre monde actuel par rapport aux ultimes espoirs de Rousseau.
Notes
(1) Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts (1750). Toutes les citations de l’article sont issues de ce discours (sauf celles accompagnées par une note qui en précise la référence).
(2) Nous faisons ici allusion à l’état de nature : il s’agit en philosophie d’une hypothèse de travail qui renvoie à une situation imaginaire pendant laquelle les hommes n’ont pas encore abouti à l’organisation sociale. Pour Rousseau cet état de nature représente le site du bonheur originel que les hommes vont perdre en accédant à la vie civilisée.
(3) Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755).
(4) Ce livre est d’ailleurs assorti d’un sous-titre fabuleux : Une irritation. Il faut peut-être le lire comme une extension du domaine de l’irritation autrichienne telle qu’elle a pu être pratiquée avant Thomas Bernhard par quelqu’un d’aussi prodigieusement irrité – et visionnaire – que Karl Kraus.
(5) Pour reprendre une expression canonique de Paul Claudel dans son Art poétique.
(6) Rousseau se livre explicitement à ce rapport de co-naissance dans ses beaux textes issus des Rêveries du promeneur solitaire.
(7) Cette célèbre maxime socratique est rapportée plusieurs fois par Platon. On la retrouve notamment délayée dans l’Apologie de Socrate (21-d) au moment justement où Socrate se défend contre ses accusateurs.
(8) C’est la raison pour laquelle Rousseau entreprendra de penser un idéal de la politique avec Du contrat social qui sera publié en 1762.
(9) Cf. Jean Giono, Les vraies richesses.
(10) Cf. René Guénon, Orient et Occident (1924) et La crise du monde moderne (1927).
(11) René Guénon, La crise du monde moderne (cf. le premier chapitre : L’âge sombre).



























































 Imprimer
Imprimer