Rechercher : francis moury george romero
La vie et la mort du système de G. W. F. Hegel, par Francis Moury
 Voici une étude fouillée de deux ouvrages consacrés à Hegel, par Francis Moury. Je signale que mon ami a reçu gratuitement ces deux livres de la part de Gallimard. J'ai décidé, par unique souci de transparence (et aussi, bien sûr, pour moquer les radins, comme l'impécunieux Fayard), de marquer systématiquement au moyen des signes RSP (reçu en service de presse) tous les ouvrages que mes amis ou moi-même aurons acquis par ce biais.
Voici une étude fouillée de deux ouvrages consacrés à Hegel, par Francis Moury. Je signale que mon ami a reçu gratuitement ces deux livres de la part de Gallimard. J'ai décidé, par unique souci de transparence (et aussi, bien sûr, pour moquer les radins, comme l'impécunieux Fayard), de marquer systématiquement au moyen des signes RSP (reçu en service de presse) tous les ouvrages que mes amis ou moi-même aurons acquis par ce biais.À propos de :
 - Karl Rosenkranz, Vie de Hegel [1844] suivi de Apologie de Hegel contre le docteur Haym [1858] et Annexes [1831, 1835].
- Karl Rosenkranz, Vie de Hegel [1844] suivi de Apologie de Hegel contre le docteur Haym [1858] et Annexes [1831, 1835].1 vol. de 735 pages in-8° traduit, présenté et annoté par Pierre Osmo (Gallimard, coll. Bibliothèque de philosophie, 2004).
 - Rudolf Haym, Hegel et son temps. Leçons sur la genèse et le développement, la nature et la valeur de la philosophie hégélienne [1857].
- Rudolf Haym, Hegel et son temps. Leçons sur la genèse et le développement, la nature et la valeur de la philosophie hégélienne [1857].1 vol. de 598 pages in-8° traduit, présenté et annoté par Pierre Osmo (Gallimard, coll. Bibliothèque de philosophie, 2008).
Préliminaire symphonique : dialogue des citations
1 – Le système de Hegel se veut système de la totalité du réel :
«Il est vrai que la guerre apporte de l'insécurité aux propriétés, mais cette insécurité réelle n'est que le mouvement qui est nécessaire. Dans les chaires on ne cesse de parler de l'insécurité, de la fragilité, de l'instabilité des choses temporelles, mais chacun pense, si ému soit-il, qu'il conservera pourtant ce qui lui appartient ; que cette insécurité apparaisse effectivement sous la forme des hussards sabre au clair, et que tout cela cesse d'être une plaisanterie, alors ces mêmes gens édifiés et émus qui avaient tout prédit se mettent à maudire les conquérants. Cependant les guerres ont lieu quand elles sont nécessaires, puis les récoltes poussent encore une fois et les bavardages se taisent devant le sérieux de l'histoire.»
G. W. F. Hegel, Principes de la philosophie du droit et science de l'État en abrégé, remarque annexée au §324, citée et traduite de l'édition allemande Lasson, tome VI, p. 369 par Jean Hyppolite in Introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel (éd. Marcel Rivière et Cie, coll. Bibliothèque philosophique, 1948).
2 – Hegel devenu figure philosophique d'un Christ platonicien :
«Semblable à notre sauveur, dont il n'a cessé, dans sa pensée comme dans son action, de vénérer le nom, dans la doctrine divine duquel il a reconnu l'essence la plus profonde de l'esprit humain, et qui s'est lui-même abandonné, en tant que Fils de Dieu, à la douleur et à la mort pour faire éternellement retour comme esprit dans sa communauté, voici qu'il est, lui aussi, retourné dans sa vraie patrie et qu'il a traversé la mort pour ressusciter en majesté.»
P.K. Marheineke, Oraison funèbre de Hegel prononcée dans le grand amphithéâtre de l'Université le 16 novembre 1831, in Rosenkranz, op. cit., p. 706.
3 – La tombe de Hegel comme matrice et comme giron :
«Comment ? Cette sombre excavation, ce tombeau exigu seraient censés enfermer celui qui nous a conduits à travers les espaces célestes ? Cette main emplie de poussière serait censée recouvrir celui qui nous a ouverts aux secrets de l'esprit, aux merveilles de Dieu et du monde ? Non, mes amis, laissez les morts enterrer leurs morts, c'est le vivant qui nous appartient, celui qui, rejetant les entraves célestes, célèbre sa transfiguration et convoque avec la voix du maître les puissances élémentaires qu'il a domptées et vaincues : Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ?»
F. Förster, Oraison funèbre prononcée sur la tombe de Hegel le 16 novembre 1831, in Rosenkranz, op. cit., p. 707
4 – La logique rationnelle de Hegel repose sur un socle irrationnel :
«La philosophie de Hegel ne peut pas être réduite à quelques formules logiques. Ou plutôt ces formules recouvrent quelque chose qui n'est pas d'origine purement logique. La dialectique, avant d'être une méthode, est une expérience par laquelle Hegel passe d'une idée à une autre. La négativité est le mouvement même d'un esprit par lequel il va toujours au-delà de ce qu'il est. Et c'est en partie la réflexion sur la pensée chrétienne, sur l'idée d'un Dieu fait homme, qui a mené Hegel à la conception de l'universel concret. Derrière le philosophe, nous découvrons le théologien, et derrière le rationaliste, le romantique.»
Jean Wahl, Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel [1929] (deuxième édition aux P.U.F, coll. B.P.C., 1951), p. V.
5 – La sphère de la philosophie de la religion comme problème ultime de l'hégélianisme ?
«Un chrétien admet par exemple une révélation particulière de Dieu qui constitue une réalité irréductible à la pure pensée, une sorte de donné irrationnel qui est à la fois un donné pour la raison et un phénomène historique. Si l'on approfondit tant soit peu le problème de la positivité on y découvre le problème philosophique du réalisme et de l'idéalisme. Qu'est-ce que le positif en effet, si ce n'est le donné, ce qui paraît s'imposer de l'extérieur à la raison; et ce donné étant un donné historique, la question qui se pose ici est bien celle des rapports de la raison et de l'histoire comme celle de l'irrationnel et du rationnel. [...] C'est que, pour Hegel, l'opposition essentielle n'est pas celle de la raison pure et de l'élément empirique, mais plutôt celle de la vie et du statique, du vivant et du mort. En ce sens, le jugement qu'on doit porter sur une religion n'est plus aussi sommaire.»
Jean Hyppolite, op. cit., pp. 34-37
Présentation allemande des choses
Nous disposons à présent de trois traductions différentes de la Phénoménologie de l'Esprit, et c'est peut-être une caractéristique de la légèreté française : traduire trois fois en presque un demi-siècle le même texte alors qu'on aura attendu plus d'un siècle et demi la traduction d'autres textes non moins essentiels. Non moins essentiels, disons-nous, puisqu'ils nous révèlent ce que les contemporains avaient perçu d'emblée : la totalité riche et la singularité unique du système hégélien, dont Kierkegaard a critiqué certains aspects mais dont il a approfondi d'autres aspects (remarque valable pour Schopenhauer et Nietzsche), qui poursuit le mouvement de la pensée allemande qui part du mysticisme de Jacob Boehme et de la Réforme de Luther pour aboutir notamment à Nietzsche, mouvement déjà parfaitement étudié, en 1934, par un Jean-Edouard Spenlé.
Ces autres choses si longtemps attendues, les voici donc et voici résumée leur histoire. Karl Rosenkranz fait paraître en 1844 une monumentale biographie positive – c'est la thèse : le moment individuel, celui de l'identité – intitulée Vie de Hegel, treize ans après la mort de Hegel [1770-1831]. Rudolf Haym fait paraître en 1857 la sienne, négative – c'est une tentative avouée de liquidation par l'auteur de son hégélianisme de jeunesse, l'antithèse, le moment de l'universalité historique, de la différence – intitulée Hegel et son temps. Leçons sur la genèse et le développement, la nature et la valeur de la philosophie hégélienne. Rosenkranz, scandalisé par l'absence de réaction de la Société de Philosophie de Berlin alors présidée par l'hégélien Karl-Ludwig Michelet, réfute cette biographie critique d'une manière cinglante en 1858 : c'est l'Apologie de Hegel contre le docteur Haym, presque la synthèse de l'identité et de la différence, une identité de l'identité et de la différence. Le même Rosenkranz publie également en 1870 un Hegel en tant que philosophe allemand de la nation qu'il aurait fallu traduire pour compléter ladite synthèse de 1858... de son point de vue qui est un point de vue intéressé (subjectif) et intéressant (objectif) puisqu'il est celui d'un témoin allemand agissant et réagissant, celui d'un «hégélien très singulier», comme le définit ici heureusement Pierre Osmo.
Le couple naturel formé par ces deux biographies classiques de Hegel par Rosenkranz et par Haym, autant une histoire de sa pensée qu'une histoire de sa vie, est donc enfin traduit en français après un siècle et demi durant lesquels il n'aura été accessible qu'aux germanistes érudits et aux hégéliens germanistes, autant dire à une infime fraction du public francophone cultivé. Cette traduction qui paraît dans une collection fondée par Jean-Paul Sartre et Maurice Merleau-Ponty, deux lecteurs de Hegel, est soigneusement présentée par Osmo, augmentée d'annexes rares (un passionnant portrait posthume de Hegel publié en 1835 par son plus jeune contemporain, Hotho, les deux oraisons funèbres de Hegel prononcées le 16 novembre 1831) et très précisément annotée (1) d'une manière qui interdit de confondre les notes du traducteur français avec les notes originales des auteurs allemands. Elle constitue une sorte de double stèle ornant dialectiquement une unique tombe. Avouons notre fascination pour cette ironie du destin : que la littérature biographique consacrée à Hegel ait reproduit en son développement, treize ans et vingt-six ans respectivement après la mort subjective de son objet, le mouvement même de sa philosophie propre. Et tirons derechef certaines conséquences historiques et philosophiques de son contenu à présent enfin accessible.
Représentation française des choses
D'abord une remise à l'heure des pendules s'impose : ce ne sont ni Kojève ni Jean Hyppolite qui ont révélé Hegel en France, comme le croyaient les incultes journalistes français des années 1970-1980 mais bel et bien, pour ne citer que les plus importants, Victor Cousin, Émile Boutroux et ses admirables Études d'histoire de la philosophie allemande, Victor Delbos, Émile Bréhier, Émile Meyerson, Victor Basch et surtout Jean Wahl. On ne parle pas des traductions d'Hyppolite et de Bourgeois qui furent aussi décisives et importantes pour le vingtième siècle que les premières traductions françaises de la Grande logique le furent pour le dix-neuvième, on parle ici simplement d'une introduction contenant de nombreux morceaux traduits de première main, et persistant à faire sens encore aujourd'hui. La véritable introduction française, stricto sensu, à la pensée de Hegel, à son intuition métaphysique au sens que Bergson donnait à ces termes dans son article de La pensée et le mouvant, celle qui pénètre au fond du problème, c'est bien le grand livre de Jean Wahl, Le Malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, paru chez Rieder en 1929 et dont la deuxième édition (P.U.F., 1951) ne se distingue que par une note bibliographique supplémentaire très succincte, d'ailleurs fièrement succincte, et à juste titre. Les enjeux profonds de l'hégélianisme sont là, introduits par Wahl. Et ils sont là parce que Wahl a lu – et traduit d'assez nombreux passages – les livres de Rosenkranz, Haym, et aussi de Dilthey, Rosenzweig, Royce, Sterling et ceux des autres sources allemandes et anglaises les plus pertinentes. Lorsque Hyppolite ou Kojève furent pertinents, ils ne firent que répéter ce que leurs prédécesseurs avaient déjà dit, à commencer par ce que Jean Wahl avait écrit dans ce livre précis de 1929. Un livre paru, peut-on savoureusement rappeler, alors que le monde vivait une crise financière, politique, économique et sociale mémorable. Un livre qu'on peut relire en 2009 par conséquent, puisque 2009 s'inscrit dans une telle lignée, et s'y inscrit pour le moment à une puissance X encore impossible à calculer.
Représentation allemande des choses
Ensuite une précision en forme d'évaluation critique : si nous, lecteurs français, sommes mis en demeure de choisir, on doit choisir Rosenkranz plutôt que Haym même si on peut, même si on doit, compléter parfois l'un par l'autre. Rosenkranz était francophone sinon francophile et cultivé : il a écrit une biographie de Voltaire et une autre de Diderot, en deux volumes. Certes Haym est riche d'aperçus critiques très remarquables mais en règle générale, ils ont déjà été exprimés par Rosenkranz. Car c'est bien Rosenkranz qui le premier a détaillé le cheminement de la pensée hégélienne : Tübingen, Berne et sa si belle correspondance avec Hölderlin et Schelling, Francfort sur Main, Iéna et sa «catastrophe» contenant au paragraphe 14 (pp. 376-377) la traduction complète de la célèbre lettre où Hegel détaille sa vision de Napoléon le jour de l'assaut français sur Iéna, et qu'il a perçu comme «âme du monde» en ce moment et en ce lieu précis, Bamberg, Nuremberg, Heidelberg, enfin Berlin. Simplement Haym les détaille d'une manière davantage critique, et parfois donne à sa critique une saisissante valeur analytique (cf. Haym sur la Vie de Jésus par Hegel, p. 112 par exemple, considérée comme le lieu où on aperçoit à nu la méthode hégélienne de saisie de la réalité) et d'une manière régulièrement génétique, bénéficiant d'un recul favorisant cela. En France, seuls des universitaires tels que Jean Wahl, Jean Hyppolite ou François Chatelet, avant l'avancée décisive représentée par Bourgeois, donnent l'impression d'avoir saisi cela. C'est pourquoi, tout compte fait, la meilleure introduction au système de Hegel demeure encore aujourd'hui l'admirable Hegel par lui-même de Chatelet qui retrouve à l'occasion et tout naturellement des éléments rosenkranziens et haymiens que seul un connaisseur attentif de Hegel pouvait saisir. On peut porter au crédit de Rosenkranz un autre élément qui est la puissance de sa positivité historique : certes il fait l'impasse sur le fils naturel de Hegel, sur sa dépression nerveuse à Francfort, sur ses rapports avec la Franc-maçonnerie, sur sa correspondance avec son amie catholique Nanette Endel mais il décrit d'une manière hallucinante et quasi clinique la névrose suicidaire de sa sœur Christiane, pose l'importance théorique des premiers opuscules religieux et historiques, notamment de la Vie de Jésus, en les situant exactement dans leur relation au catholicisme et au protestantisme, enfin fournit en annexe une foule d'inédits (qu'Osmo n'a pas traduit pour la raison qu'ils sont déjà connus en France car intégrés dans des traductions d'autres textes de Hegel) qui éclairent d'un jour nouveau la genèse que Haym peignit simplement d'une manière un peu plus informée, rectifiant quelques détails.
Ce ne sont au demeurant plus du tout les raisons positives ou négatives invoquées subjectivement par Rosenkranz ou Haym qui nous intéressent : on sait que Hegel fut interprété par un hégélianisme de droite et par un hégélianisme de gauche; que la révolution de 1848 en France comme en Europe modifia momentanément la donne contre lui : au nom du retour à Kant, au nom d'un national-libéralisme que Haym représente politiquement, Hegel fut attaqué. On sait aussi que certains hégéliens eurent à cœur d'améliorer le système du maître au lieu de se contenter de l'éditer. On sait d'ailleurs que certains furent à la fois ses éditeurs et ses admirateurs critiques, voire ses prolongateurs-réformateurs tels que Rosenkranz. N'était-ce pas illusoire de penser qu'on pouvait prolonger, ajouter quelques chose, modifier quelque chose à un système si parfait qu'il est devenu le paradigme absolu de toute idée d'un système en philosophie ? Chatelet avait pris la mesure de l'ampleur d'un système dont on trouve dans son petit livre une admirable et très précise description : ce système se déploie à la manière d'une des symphonies d'Anton Bruckner, à la manière dont la parole de Hegel se déployait, selon Hotho, durant ses cours : «Et ainsi, en revenant toujours soigneusement sur les antécédents pour, après les avoir transformés en les approfondissant, en développer les conséquences dans des scissions croissantes et pourtant constamment réconciliatrices, le plus merveilleux des flux de pensée, tantôt isolant, tantôt pratiquant de vastes synthèses, hésitant par endroits, entraînant par à-coups, s'enroulait, pressait, luttait en avançant irrésistiblement. [...] La pensée était précipitée dans de tels abîmes, déchirée entre de telles oppositions infinies; on avait l'impression toujours renouvelée qu'on perdait les conquêtes déjà faites et que tout effort était vain, car même la puissance suprême de connaître, parvenue aux frontières de son pouvoir, semblait contrainte à l'immobilisation silencieuse.»
Si on veut saisir pareil phénomène il faut d'ailleurs écouter Bruckner dirigé par Wilhelm Furtwangler (par exemple la Huitième symphonie enregistrée en mono à Vienne le 17 octobre 1944 et la Quatrième symphonie enregistrée mono le 22 octobre 1951 à Stuttgart) ou bien par Karl Boehm (enregistrements plus récents, donc stéréophoniques) qui furent sans doute les deux seuls chefs d'orchestre à avoir véritablement respecté le tempo original de ces symphonies. C'est avec toute l'œuvre de Bruckner, esthétiquement autant sinon davantage qu'avec le mouvement final de la Neuvième symphonie de Beethoven (souvent cité historiquement pour sa référence à Schiller qu'on trouve aussi à la fin de la Phénoménologie de l'Esprit, citée par Wahl, op. cit., p.117) qu'on doit comparer l'œuvre de Hegel.
Destinée du système comme équation tragique
On a parlé – et ratiociné sur elle – d'une révolution copernicienne induite par le kantisme, mais la révolution authentique, le «suprême accomplissement du système kantien» fut bel et bien, par un retournement rusé de l'histoire, le système de Hegel. Il suffit de mesurer la place et le sens de l'œuvre d'art dans son système par rapport à la place de celle-ci dans le système de Platon pour mesurer le chemin parcouru, sans même mesurer cet autre chemin bien connu qui mène de Kant aux post-kantiens, déjà décrit par Delbos. Hegel est le post-kantien supérieur qui a posé, après l'idéalisme transcendantal de Kant, après l'idéalisme subjectif de Fichte, après l'idéalisme objectif de Schelling, un idéalisme absolu, c'est entendu. Hegel est aussi, peut-être, l'aboutissement retourné du platonisme, la réconciliation introuvable de Parménide et d'Héraclite, p
15/02/2009 | Lien permanent
Ma nuit chez Maud d'Éric Rohmer, par Francis Moury

21/01/2010 | Lien permanent
Pauline à la plage d'Éric Rohmer, par Francis Moury

15/02/2010 | Lien permanent
Sur le désastre de l’Asie : Eschatologie et Sauvegarde par Francis Moury

 Voici le message que j’ai reçu hier soir de la part de mon ami Francis Moury. Sa méditation m’a immédiatement fait songer à la catégorie du supraliminaire forgée par Günther Anders, catégorie sur laquelle, donc, je ne reviens pas. Je me suis également souvenu d’une très vieille lecture, Semailles humaines de James Blish. On jugera mes propos futiles devant l’ampleur et l’horreur de la catastrophe, comme le sont ceux de Francis qui, évoquant le désastre, ne peut s’empêcher de nous citer quelques œuvres cinématographiques, parfois bien oubliées. C’est bien pourtant la grandeur et la misère de notre pensée, incapable, comme le disait Macduff dans la tragédie la plus sombre de Shakespeare, Macbeth, de concevoir l’étendue innommable du Mal, que de ne pouvoir se résoudre à abdiquer devant lui. Voici, donc, le texte de Francis, que je remercie.Un dernier mot : j'ai jugé utile de faire suivre le texte de Francis Moury par un autre, superbe et frémissant d'une sainte colère, rédigé spontanément par Serge Rivron, en fait une réaction, que je crois définitive, aux lignes de Francis Moury.
Voici le message que j’ai reçu hier soir de la part de mon ami Francis Moury. Sa méditation m’a immédiatement fait songer à la catégorie du supraliminaire forgée par Günther Anders, catégorie sur laquelle, donc, je ne reviens pas. Je me suis également souvenu d’une très vieille lecture, Semailles humaines de James Blish. On jugera mes propos futiles devant l’ampleur et l’horreur de la catastrophe, comme le sont ceux de Francis qui, évoquant le désastre, ne peut s’empêcher de nous citer quelques œuvres cinématographiques, parfois bien oubliées. C’est bien pourtant la grandeur et la misère de notre pensée, incapable, comme le disait Macduff dans la tragédie la plus sombre de Shakespeare, Macbeth, de concevoir l’étendue innommable du Mal, que de ne pouvoir se résoudre à abdiquer devant lui. Voici, donc, le texte de Francis, que je remercie.Un dernier mot : j'ai jugé utile de faire suivre le texte de Francis Moury par un autre, superbe et frémissant d'une sainte colère, rédigé spontanément par Serge Rivron, en fait une réaction, que je crois définitive, aux lignes de Francis Moury.  Je tente à présent de penser l'effroi eschatologique – et le sentiment de deuil puisque je suis lié à l'un des pays touchés (la Thaïlande) – qui me saisit depuis le désastre de dimanche dernier.Je relis la fin du Poème sur le désastre de Lisbonne, ou examen de cet axiome : Tout est bien (1756) que Voltaire avait écrit à la suite de ce tremblement de terre mémorable qui frappa alors les savants comme les philosophes. Le désastre d'Asie auquel on vient d'assister serait passible, fût-il arrivé à cette époque, de la même controverse sur la Providence à laquelle Leibniz avait déjà répondu par avance dans ses Essai de Théodicée en 1710, immédiatement suivis par l'opuscule latin Causa Dei [La cause de Dieu défendue par la conciliation de sa justice avec ses autres perfections et toutes ses actions] édité puis traduit par l'excellent Paul Schrecker.Mais ces vers de Voltaire,«Que peut donc de l'esprit la plus vaste étendue ?Rien : le livre du sort se ferme à notre vue.L'homme, étranger à soi, de l'homme est ignoré.Que suis-je ? où suis-je ? où vais-je, et d'où suis-je tiré ?Atomes tourmentés sur cet amas de boue,Que la mort engloutit, et dont le sort se joue,Mais atomes pensants, atomes dont les yeux,Guidés par la pensée, ont mesuré les cieux, Au sein de l'infini, nous élançons notre être,Sans pouvoir un moment nous voir et nous connaître.»nous touchent encore par leur pessimisme lucide, en cette occurrence eschatologique renouvelée, même s'ils se rapportent à des termes et à un débat oublié, sauf par ceux qui n'oublient rien (je sais que le Stalker est de ceux-là !) et pour qui l'homme est en effet un seul être vieillissant avec le temps de l'histoire. Akira Kurosawa avait réalisé Ikimono no kiroku [Si les oiseaux savaient / Je vis dans la peur / I Live in Fear / Record of A Living Being] (Japon, 1955), admirable film eschatologique à partir du thème de l'angoisse atomique en 1955 qui surpassait peut-être en force les films en ayant témoigné directement dans l'histoire du cinéma japonais. Mais ce thème d'une fin du monde artificielle, produite par la technique humaine, nous avait fait perdre de vue la possibilité encore plus terrifiante car plus ancienne et primitive d'une auto-destruction naturelle.
Je tente à présent de penser l'effroi eschatologique – et le sentiment de deuil puisque je suis lié à l'un des pays touchés (la Thaïlande) – qui me saisit depuis le désastre de dimanche dernier.Je relis la fin du Poème sur le désastre de Lisbonne, ou examen de cet axiome : Tout est bien (1756) que Voltaire avait écrit à la suite de ce tremblement de terre mémorable qui frappa alors les savants comme les philosophes. Le désastre d'Asie auquel on vient d'assister serait passible, fût-il arrivé à cette époque, de la même controverse sur la Providence à laquelle Leibniz avait déjà répondu par avance dans ses Essai de Théodicée en 1710, immédiatement suivis par l'opuscule latin Causa Dei [La cause de Dieu défendue par la conciliation de sa justice avec ses autres perfections et toutes ses actions] édité puis traduit par l'excellent Paul Schrecker.Mais ces vers de Voltaire,«Que peut donc de l'esprit la plus vaste étendue ?Rien : le livre du sort se ferme à notre vue.L'homme, étranger à soi, de l'homme est ignoré.Que suis-je ? où suis-je ? où vais-je, et d'où suis-je tiré ?Atomes tourmentés sur cet amas de boue,Que la mort engloutit, et dont le sort se joue,Mais atomes pensants, atomes dont les yeux,Guidés par la pensée, ont mesuré les cieux, Au sein de l'infini, nous élançons notre être,Sans pouvoir un moment nous voir et nous connaître.»nous touchent encore par leur pessimisme lucide, en cette occurrence eschatologique renouvelée, même s'ils se rapportent à des termes et à un débat oublié, sauf par ceux qui n'oublient rien (je sais que le Stalker est de ceux-là !) et pour qui l'homme est en effet un seul être vieillissant avec le temps de l'histoire. Akira Kurosawa avait réalisé Ikimono no kiroku [Si les oiseaux savaient / Je vis dans la peur / I Live in Fear / Record of A Living Being] (Japon, 1955), admirable film eschatologique à partir du thème de l'angoisse atomique en 1955 qui surpassait peut-être en force les films en ayant témoigné directement dans l'histoire du cinéma japonais. Mais ce thème d'une fin du monde artificielle, produite par la technique humaine, nous avait fait perdre de vue la possibilité encore plus terrifiante car plus ancienne et primitive d'une auto-destruction naturelle. Crack in the World [Quand la terre s'entrouvrira] (États-Unis, 1965) d'Andrew Marton, East of Java [Krakatoa, à l'Est de Java] (États-Unis, 1968) de Bernard Kowalski – dont la direction artistique avait été assurée dans les deux cas par le grand Eugène Lourié – et quelques autres titres me viennent en mémoire. Enfants ils m'avaient terrifié, tous sans exception, qu'ils fussent inspirés de faits réels comme le film de Kowalski ou de pure fiction comme celui de Marton. Et depuis dimanche dernier, la réalité les rattrape : la terre s'entrouvre sur 250 voire 1 000 kilomètres suivant les géologues, son axe se modifie momentanément ! Les moyens de mesure technique, les moyens de communication médiatique renforcent ma terreur proprement métaphysique, puisque métaphysique peut étymologiquement renvoyer à l'idée d'une pensée « au-delà » de la physique, voire donc, si on suit la courbe de ce déplacement un cran plus loin (au-delà du déplacement de vingt mètres d’une île de la Mer Andaman) à la pensée d'un monde physique détruit.La réalité comme l'art ne cessent de concourir à nous confirmer cette terrible évidence – en dehors de toute eschatologie théologique, par ailleurs – et j'en viens à l'idée que tu évoquais dans ton message de nouvel an 2005. Que resterait-il de ton blog dans cinq, dix ou quinze ans, te demandais-tu ? J'étends le domaine d'extension de ta question : si un cataclysme semblable mais plus important en puissance faisait bel et bien craquer la terre jusqu'à l'entrouvrir puis la casser – ou la faisait dévier de son axe pour la rapprocher du soleil : hypothèse du terrifiant The Day the Earth Caught Fire [Le jour où la terre brûlera] (GB, 1962) de Val Guest – que resterait-il de la culture humaine des origines à nos jours ?
Crack in the World [Quand la terre s'entrouvrira] (États-Unis, 1965) d'Andrew Marton, East of Java [Krakatoa, à l'Est de Java] (États-Unis, 1968) de Bernard Kowalski – dont la direction artistique avait été assurée dans les deux cas par le grand Eugène Lourié – et quelques autres titres me viennent en mémoire. Enfants ils m'avaient terrifié, tous sans exception, qu'ils fussent inspirés de faits réels comme le film de Kowalski ou de pure fiction comme celui de Marton. Et depuis dimanche dernier, la réalité les rattrape : la terre s'entrouvre sur 250 voire 1 000 kilomètres suivant les géologues, son axe se modifie momentanément ! Les moyens de mesure technique, les moyens de communication médiatique renforcent ma terreur proprement métaphysique, puisque métaphysique peut étymologiquement renvoyer à l'idée d'une pensée « au-delà » de la physique, voire donc, si on suit la courbe de ce déplacement un cran plus loin (au-delà du déplacement de vingt mètres d’une île de la Mer Andaman) à la pensée d'un monde physique détruit.La réalité comme l'art ne cessent de concourir à nous confirmer cette terrible évidence – en dehors de toute eschatologie théologique, par ailleurs – et j'en viens à l'idée que tu évoquais dans ton message de nouvel an 2005. Que resterait-il de ton blog dans cinq, dix ou quinze ans, te demandais-tu ? J'étends le domaine d'extension de ta question : si un cataclysme semblable mais plus important en puissance faisait bel et bien craquer la terre jusqu'à l'entrouvrir puis la casser – ou la faisait dévier de son axe pour la rapprocher du soleil : hypothèse du terrifiant The Day the Earth Caught Fire [Le jour où la terre brûlera] (GB, 1962) de Val Guest – que resterait-il de la culture humaine des origines à nos jours ? Paul Valéry, Émile Meyerson et bien d'autres esprits de l'entre-deux guerres mondiales ont été préoccupés par cette question. La revue française Dieu vivant - perspectives religieuses et philosophiques (aux éditions du Seuil) était, au lendemain de la Seconde guerre mondiale, animée d'une même angoisse éminemment eschatologique. Il faut d'ailleurs lire ses trois premiers numéros pour avoir une idée de ce qu'elle pouvait être, en particulier la note liminaire anonyme du premier numéro (deuxième semestre 1945) dont était collégialement responsables son comité directeur (Maurice de Gandillac, Louis Massignon, Marcel Moré et le secrétaire de rédaction Pierre Leyris) et son comité de lecture (Jean Hyppolite, Vladimir Lossky, Gabriel Marcel) :«Les Cahiers DIEU VIVANT naissent dans un temps qui fait songer aux pages les plus sombres de l'Apocalypse par la violence et l'ampleur des cataclysmes déchaînés comme par l'atmosphère de mort spirituelle dans laquelle étouffe le monde. Où est le mal qui cherche à s'opposer à la victoire du Christ ? Dans le mécanisme aveugle des forces de destruction ? Dans le désespoir d'un certain nihilisme qui refuse la lumière de la foi ? Dans la déification de l'État avec les conséquences que l'on sait pour la liberté et l'épanouissement de la personne humaine ? Dans les doctrines matérialistes et l'idolâtrie de l'argent ? Sans doute. Mais ce mal ne réside-t-il pas avant tout dans le cœur des chrétiens, dans l'affadissement du sel que le Christ avait confié à son Église ? Dieu est mort, nous avons tué Dieu ! Ne peut-on accuser les chrétiens eux-mêmes d'avoir participé à ce meurtre ? En refusant de scruter le mystère de Dieu par l'intelligence, de le vivre avec le cœur, ils ont crée en eux-mêmes une zone opaque dont les ténèbres mortelles se sont répandues sur le monde.»Tout cela en introduction à des articles de Jean Daniélou sur Le symbolisme des rites baptismaux, de Jules Monchanin sur La spiritualité du désert, de Hans von Balthazar sur Kierkegaard et Nietzsche, de Vladimir Lossky sur La théologie de la lumière chez saint Grégoire de Thessalonique, d'une page de Newman sur L'humiliation du fils éternel puis d'une revue des livres dont on ne rêve presque plus aujourd'hui tant le niveau est supérieur : Eros et Agapé d'Anders Nygren, Corpus mysticum d'Henri de Lubac, Initiation à la vie mystique de Jean Gerson, Pages de prose de Paul Claudel, deux textes de Karl Barth...Enfin bref... très pragmatiquement, je fais une suggestion technique pour sauvegarder la culture humaine (culture religieuse, philosophique, scientifique, littéraire, artistique) – suggestion qui me semble depuis dimanche la seule absolument viable. Puisque la terre ne garantit pas la persistance de notre héritage, il faut éloigner ce dernier de celle-ci. Ce qui signifie qu'il faut numériser tout ce qui mérite de l'être, et préserver le contenu de cette numérisation en l'expédiant sur une station spatiale – sur plusieurs stations spatiales afin d'éviter les risques induits par les météorites ou d'éventuelles collisions avec d'autres objets – dans lesquelles des savants et des techniciens vivraient en permanence, veillant à la maintenance des machines, à leur mémoire et à leur capacité de lecture, à l'enrichissement et au classement constant de ces banques de données, se relayant de même en permanence afin qu'aucune station ne soit délaissée. De telles stations spatiales (qui à terme pourraient être placées en orbite dans des zones situées loin de la terre, pour peu qu’il y ait là l’occasion d’un gain avéré de sécurité) ou même non-orbitales (elles pourraient être aussi installées sur des astres calmes comme la lune, proche de nous et donc commode d’accès) devraient être autonomes, un peu comme la station botanique du Silent Running (États-Unis, 1972) de Douglas Trumbull. La comparaison avec ce film-ci amène une autre question : la possibilité inhumaine de la destruction de telles stations au nom d’intérêts économiques aberrants. On croit avoir résolu un problème que déjà, un nouveau vient au jour : telle est la dure vie de l’homme…
Paul Valéry, Émile Meyerson et bien d'autres esprits de l'entre-deux guerres mondiales ont été préoccupés par cette question. La revue française Dieu vivant - perspectives religieuses et philosophiques (aux éditions du Seuil) était, au lendemain de la Seconde guerre mondiale, animée d'une même angoisse éminemment eschatologique. Il faut d'ailleurs lire ses trois premiers numéros pour avoir une idée de ce qu'elle pouvait être, en particulier la note liminaire anonyme du premier numéro (deuxième semestre 1945) dont était collégialement responsables son comité directeur (Maurice de Gandillac, Louis Massignon, Marcel Moré et le secrétaire de rédaction Pierre Leyris) et son comité de lecture (Jean Hyppolite, Vladimir Lossky, Gabriel Marcel) :«Les Cahiers DIEU VIVANT naissent dans un temps qui fait songer aux pages les plus sombres de l'Apocalypse par la violence et l'ampleur des cataclysmes déchaînés comme par l'atmosphère de mort spirituelle dans laquelle étouffe le monde. Où est le mal qui cherche à s'opposer à la victoire du Christ ? Dans le mécanisme aveugle des forces de destruction ? Dans le désespoir d'un certain nihilisme qui refuse la lumière de la foi ? Dans la déification de l'État avec les conséquences que l'on sait pour la liberté et l'épanouissement de la personne humaine ? Dans les doctrines matérialistes et l'idolâtrie de l'argent ? Sans doute. Mais ce mal ne réside-t-il pas avant tout dans le cœur des chrétiens, dans l'affadissement du sel que le Christ avait confié à son Église ? Dieu est mort, nous avons tué Dieu ! Ne peut-on accuser les chrétiens eux-mêmes d'avoir participé à ce meurtre ? En refusant de scruter le mystère de Dieu par l'intelligence, de le vivre avec le cœur, ils ont crée en eux-mêmes une zone opaque dont les ténèbres mortelles se sont répandues sur le monde.»Tout cela en introduction à des articles de Jean Daniélou sur Le symbolisme des rites baptismaux, de Jules Monchanin sur La spiritualité du désert, de Hans von Balthazar sur Kierkegaard et Nietzsche, de Vladimir Lossky sur La théologie de la lumière chez saint Grégoire de Thessalonique, d'une page de Newman sur L'humiliation du fils éternel puis d'une revue des livres dont on ne rêve presque plus aujourd'hui tant le niveau est supérieur : Eros et Agapé d'Anders Nygren, Corpus mysticum d'Henri de Lubac, Initiation à la vie mystique de Jean Gerson, Pages de prose de Paul Claudel, deux textes de Karl Barth...Enfin bref... très pragmatiquement, je fais une suggestion technique pour sauvegarder la culture humaine (culture religieuse, philosophique, scientifique, littéraire, artistique) – suggestion qui me semble depuis dimanche la seule absolument viable. Puisque la terre ne garantit pas la persistance de notre héritage, il faut éloigner ce dernier de celle-ci. Ce qui signifie qu'il faut numériser tout ce qui mérite de l'être, et préserver le contenu de cette numérisation en l'expédiant sur une station spatiale – sur plusieurs stations spatiales afin d'éviter les risques induits par les météorites ou d'éventuelles collisions avec d'autres objets – dans lesquelles des savants et des techniciens vivraient en permanence, veillant à la maintenance des machines, à leur mémoire et à leur capacité de lecture, à l'enrichissement et au classement constant de ces banques de données, se relayant de même en permanence afin qu'aucune station ne soit délaissée. De telles stations spatiales (qui à terme pourraient être placées en orbite dans des zones situées loin de la terre, pour peu qu’il y ait là l’occasion d’un gain avéré de sécurité) ou même non-orbitales (elles pourraient être aussi installées sur des astres calmes comme la lune, proche de nous et donc commode d’accès) devraient être autonomes, un peu comme la station botanique du Silent Running (États-Unis, 1972) de Douglas Trumbull. La comparaison avec ce film-ci amène une autre question : la possibilité inhumaine de la destruction de telles stations au nom d’intérêts économiques aberrants. On croit avoir résolu un problème que déjà, un nouveau vient au jour : telle est la dure vie de l’homme… Enfin, si nous nous en tenons strictement à celui qui nous est dramatiquement posé ici, ces cellules de mémoire toutes positivistes au sens comtien, dans leur essence comme dans leur finalité, me semblent une hypothèse de solution cruellement d'actualité. En attendant qu’une telle sauvegarde matérielle soit techniquement possible – la numérisation a commencé d’ailleurs, heureusement –, on remarquera l'unité humaine engendrée par ce nouveau fléau : solidarité entre les peuples, entre les classes sociales et les cultures les plus diverses. Cette solidarité universelle est le point positif absolu (le seul, mais il faut le mentionner) qui se dégage de cette terrible expérience, le second – ma modeste hypothèse de sauvegarde – n’étant que relatif.Voici la réponse de Serge Rivron, envoyée par courriel, au texte de Francis Moury :«Tout ce qui arrive est adorable» : cette phrase, qui revient en écho plusieurs fois dans le journal de Léon Bloy et dans quelques de ses livres, et qu'il a reprise, je crois, à Anne-Catherine Emmerich, aurait singulièrement mérité d'être re-méditée par Francis Moury avant que le désespoir et l'impuissance qu'on est obligé de ressentir face à la catastrophe qui vient de frapper en Asie ne lui suggère qu'il faille absolument sauvegarder la culture humaine. Quelle idée !Car imaginons qu'on en arrive, que la terre en arrive, du fait des hommes ou des puissances de la nature, à se fendre et à s'effondrer sous nos pieds. Si ce désastre-là devait se produire, quelle est donc cette «culture humaine» qui mériterait qu'on la sauve, puisque la terre qui est le lieu même des hommes, leur glaise et leur image, serait engloutie par la création ? Le Parthénon, la Forêt noire, les bassins de Versailles, le Taj Mahal, ou même la moindre toile du plus petit maître de la peinture de tous les siècles, un meuble breton en bois passé au sang de bœuf, une canne, sont-ils numérisables et surtout : pour qui ? si la terre venait à engloutir les hommes passés, présents et à venir ?Cher Francis Moury, vous parlez d'Eschatologie : de quelle Eschatologie s'agit-il, si les fins dernières dont elle entend discourir ne sont pas mises en perspective avec la notion de Jugement DERNIER ? Et quelle résurrection de la CHAIR peut espérer un homme qui ne verrait sa sauvegarde qu'en la capacité de sa culture à être numérisée ?«Tout ce qui arrive est adorable» : Dieu que cette phrase est difficile à entendre, insupportable, au moment où le malheur frappe, où l’incompréhensible Justice de Dieu, qui se manifeste presque toujours parle feu de l'Esprit, s'abat sur ce qui reste toujours en l'homme d'innocence DERNIÈRE dans le mirage de sa quotidienne insouciance ! Et pourtant, ne pas l'entendre, croire qu'on peut s'en abstraire, revient exactement à désespérer l'humain et à désespérer Dieu. Pour vous paraphraser, cher Francis Moury, si la terre ne garantit pas la persistance de notre héritage, c'est que notre héritage ne mérite pas de persister. Et s'il faut vraiment éloigner ce dernier de la terre, si on PEUT le faire, alors la terre n'a plus qu'à s'effondrer.Mais plaise à Dieu que cette Eschatologie-là Lui soit encore adorable !Bien à vous.
Enfin, si nous nous en tenons strictement à celui qui nous est dramatiquement posé ici, ces cellules de mémoire toutes positivistes au sens comtien, dans leur essence comme dans leur finalité, me semblent une hypothèse de solution cruellement d'actualité. En attendant qu’une telle sauvegarde matérielle soit techniquement possible – la numérisation a commencé d’ailleurs, heureusement –, on remarquera l'unité humaine engendrée par ce nouveau fléau : solidarité entre les peuples, entre les classes sociales et les cultures les plus diverses. Cette solidarité universelle est le point positif absolu (le seul, mais il faut le mentionner) qui se dégage de cette terrible expérience, le second – ma modeste hypothèse de sauvegarde – n’étant que relatif.Voici la réponse de Serge Rivron, envoyée par courriel, au texte de Francis Moury :«Tout ce qui arrive est adorable» : cette phrase, qui revient en écho plusieurs fois dans le journal de Léon Bloy et dans quelques de ses livres, et qu'il a reprise, je crois, à Anne-Catherine Emmerich, aurait singulièrement mérité d'être re-méditée par Francis Moury avant que le désespoir et l'impuissance qu'on est obligé de ressentir face à la catastrophe qui vient de frapper en Asie ne lui suggère qu'il faille absolument sauvegarder la culture humaine. Quelle idée !Car imaginons qu'on en arrive, que la terre en arrive, du fait des hommes ou des puissances de la nature, à se fendre et à s'effondrer sous nos pieds. Si ce désastre-là devait se produire, quelle est donc cette «culture humaine» qui mériterait qu'on la sauve, puisque la terre qui est le lieu même des hommes, leur glaise et leur image, serait engloutie par la création ? Le Parthénon, la Forêt noire, les bassins de Versailles, le Taj Mahal, ou même la moindre toile du plus petit maître de la peinture de tous les siècles, un meuble breton en bois passé au sang de bœuf, une canne, sont-ils numérisables et surtout : pour qui ? si la terre venait à engloutir les hommes passés, présents et à venir ?Cher Francis Moury, vous parlez d'Eschatologie : de quelle Eschatologie s'agit-il, si les fins dernières dont elle entend discourir ne sont pas mises en perspective avec la notion de Jugement DERNIER ? Et quelle résurrection de la CHAIR peut espérer un homme qui ne verrait sa sauvegarde qu'en la capacité de sa culture à être numérisée ?«Tout ce qui arrive est adorable» : Dieu que cette phrase est difficile à entendre, insupportable, au moment où le malheur frappe, où l’incompréhensible Justice de Dieu, qui se manifeste presque toujours parle feu de l'Esprit, s'abat sur ce qui reste toujours en l'homme d'innocence DERNIÈRE dans le mirage de sa quotidienne insouciance ! Et pourtant, ne pas l'entendre, croire qu'on peut s'en abstraire, revient exactement à désespérer l'humain et à désespérer Dieu. Pour vous paraphraser, cher Francis Moury, si la terre ne garantit pas la persistance de notre héritage, c'est que notre héritage ne mérite pas de persister. Et s'il faut vraiment éloigner ce dernier de la terre, si on PEUT le faire, alors la terre n'a plus qu'à s'effondrer.Mais plaise à Dieu que cette Eschatologie-là Lui soit encore adorable !Bien à vous.
30/12/2004 | Lien permanent
Qui est contre l'Europe ? Réponse à Francis Moury, par Serge Rivron

01/04/2005 | Lien permanent
Pro Europa 3 : l'Europe et sa médiatisation, par Francis Moury

 «On peut distinguer, dans l’idée que saint Paul se fait du vouloir humain, deux aspects qui correspondraient assez bien à ceux que nous retrouvons dans notre psychologie vulgaire. Le premier auquel nous pensons, en parlant d’un «homme de volonté», est celui d’un vouloir toujours en acte, en tension d’effort pour atteindre un but. Cette notion est encore peu consciente à la Grèce de l’âge classique […]. On me propose donc le thème de Rom., 7, là où Paul se plaint que l’homme n’ait à sa disposition, pour vouloir le bien, qu’un vouloir affaibli, peut-être blessé. Quelle est sur ce sujet la vraie pensée de l’Apôtre ?»Mgr Lucien Cerfaux, La volonté dans la doctrine paulinienne (1956) in Qu’est-ce que vouloir ? ([Actes du colloque de Bonneval de 1956], Les éditions du Cerf, 1958).
«On peut distinguer, dans l’idée que saint Paul se fait du vouloir humain, deux aspects qui correspondraient assez bien à ceux que nous retrouvons dans notre psychologie vulgaire. Le premier auquel nous pensons, en parlant d’un «homme de volonté», est celui d’un vouloir toujours en acte, en tension d’effort pour atteindre un but. Cette notion est encore peu consciente à la Grèce de l’âge classique […]. On me propose donc le thème de Rom., 7, là où Paul se plaint que l’homme n’ait à sa disposition, pour vouloir le bien, qu’un vouloir affaibli, peut-être blessé. Quelle est sur ce sujet la vraie pensée de l’Apôtre ?»Mgr Lucien Cerfaux, La volonté dans la doctrine paulinienne (1956) in Qu’est-ce que vouloir ? ([Actes du colloque de Bonneval de 1956], Les éditions du Cerf, 1958). «Est-à dire que l’État socialiste ne doit jamais recourir à la répression ? Certes non. Condamner la répression injuste, la répression inutile ou la répression fautive, ne signifie pas que toute répression est fautive en toute circonstance et que le seul recours de l’État socialiste est sa force de conviction. […] On peut donc dire que si les deux types d’État comportent leur raison d’État, la nature de la raison d’État de l’État capitaliste est répressive, alors que la nature de la raison d’État de l’État socialiste est de conduire le plus rapidement possible à des rapports de confiance, à des rapports «libérés» d’identification de l’État et des masses.»Roland Weyl, Réflexions sur la raison d’État, in La Nouvelle critique – Revue du marxisme militant, n° 151, 1963.
«Est-à dire que l’État socialiste ne doit jamais recourir à la répression ? Certes non. Condamner la répression injuste, la répression inutile ou la répression fautive, ne signifie pas que toute répression est fautive en toute circonstance et que le seul recours de l’État socialiste est sa force de conviction. […] On peut donc dire que si les deux types d’État comportent leur raison d’État, la nature de la raison d’État de l’État capitaliste est répressive, alors que la nature de la raison d’État de l’État socialiste est de conduire le plus rapidement possible à des rapports de confiance, à des rapports «libérés» d’identification de l’État et des masses.»Roland Weyl, Réflexions sur la raison d’État, in La Nouvelle critique – Revue du marxisme militant, n° 151, 1963.  «L’article de Kanapa traite «des rapports entre les intellectuels et le communisme». De ce point de vue – et si nous laissons les anticommunistes de côté – il y a trois sortes d’intellectuels : ceux qui sont inscrits au Parti, ceux qui y songent et ceux qui n’y songent pas. Kanapa est un représentant du premier groupe, il s’adresse au second et lui parle du troisième. […] Colette Audry a pris position avec beaucoup d’autres intellectuels contre la C.E.D. et les accords de Bonn et de Paris, contre le Pacte Atlantique, pour l’ouverture immédiate des négociations en Indochine, pour la défense des libertés démocratiques ; quant aux Temps Modernes, on connaît assez leur point de vue. Or vous tolérez qu’on embarque Colette Audry dans le même fond de cale que Raymond Aron, qui écrit les leaders du Figaro et qu’on brûle dans un même autodafé Les Temps Modernes et «la revue américaine en France, Preuves.» Qu’avons-nous fait ? […] Si je suis un flic, vous êtes des crétins. Et si les communistes que j’ai rencontrés et que j’estime ne sont pas des imbéciles, si, en particulier, le Parti doit être «une source de renouvellement pour les intellectuels» alors je ne suis pas un flic ni Colette Audry une «révisionniste blumiste» et le seul crétin, c’est Kanapa.»Jean-Paul Sartre, Opération Kanapa (in Les Temps Modernes, n°100, Paris, mars 1954) repris in Situations VII – Problèmes du marxisme 2 (Gallimard, coll. N.R.F., 1965).
«L’article de Kanapa traite «des rapports entre les intellectuels et le communisme». De ce point de vue – et si nous laissons les anticommunistes de côté – il y a trois sortes d’intellectuels : ceux qui sont inscrits au Parti, ceux qui y songent et ceux qui n’y songent pas. Kanapa est un représentant du premier groupe, il s’adresse au second et lui parle du troisième. […] Colette Audry a pris position avec beaucoup d’autres intellectuels contre la C.E.D. et les accords de Bonn et de Paris, contre le Pacte Atlantique, pour l’ouverture immédiate des négociations en Indochine, pour la défense des libertés démocratiques ; quant aux Temps Modernes, on connaît assez leur point de vue. Or vous tolérez qu’on embarque Colette Audry dans le même fond de cale que Raymond Aron, qui écrit les leaders du Figaro et qu’on brûle dans un même autodafé Les Temps Modernes et «la revue américaine en France, Preuves.» Qu’avons-nous fait ? […] Si je suis un flic, vous êtes des crétins. Et si les communistes que j’ai rencontrés et que j’estime ne sont pas des imbéciles, si, en particulier, le Parti doit être «une source de renouvellement pour les intellectuels» alors je ne suis pas un flic ni Colette Audry une «révisionniste blumiste» et le seul crétin, c’est Kanapa.»Jean-Paul Sartre, Opération Kanapa (in Les Temps Modernes, n°100, Paris, mars 1954) repris in Situations VII – Problèmes du marxisme 2 (Gallimard, coll. N.R.F., 1965). «Or quel est ce «principe», si contraire à la nature même des choses, qui fait que le législateur se trompe dans son objet ? Rien d’autre que le principe de la souveraineté populaire, principe commun à Montesquieu, à Rousseau, à Hobbes, à tant d’autres, qui voient dans la société une création, ou mieux, une production humaine, quelque chose d’artificiel (et c’est pour cela que tous les philosophes opposent l’état social à l’état naturel), au lieu de comprendre que c’est la société qui est, en vérité, l’état naturel de l’homme. »Alexandre Koyré, Louis de Bonald (1946) in Études d’histoire de la pensée philosophique (1961) (éd. posthume Gallimard, coll. Bibliothèque des Idées, 1971).Le hasard et l’histoire à la télévision françaiseLe hasard de la télévision française fait bien les choses, l’histoire chronologique du monde aussi. Cet après-midi, cher Juan, à l’occasion de notre sympathique rencontre avec l’incarnation de ton «lien» Fin de Partie (le blog du Transhumain), tu nous as demandé notre avis tant sur le débat télévisé l’autre soir sur TF1 entre le Président de la République et de jeunes Français (et de moins jeunes «animateurs» français) au sujet de la Constitution européenne que sur le fait qu’à la suite de ce débat, le «non» à l’Europe a statistiquement encore monté d’un cran. Ce soir je songeai pour ma part écrire quelque chose sur ce phénomène en effet intéressant. Or je viens par hasard d’assister à un autre débat, organisé sur I-Télé, autour du Centenaire de Sartre auquel étaient conviés des intervenants divers : M.A. Burnier et un professeur de lettres supérieures qui a supervisé un Cahier de l'Herne sur Jean Baudrillard ainsi que quelques autres participants du même calibre intellectuel. Bien sûr la question «- Sartre eût-il voté «oui» ou «non» au prochain référendum sur l’Europe ?» n’a pas manqué d’être anachroniquement posée par le présentateur et on n’a pas manqué d’y répondre à la place de Sartre. La télévision française sait faire parler les vivants mais elle sait aussi faire parler les morts : cela n’étonne plus personne.Ces deux débats sont caractérisés par un point commun : l’impossibilité totale de marier tant la pensée (de la politique) que la politique (de la pensée) et leurs médiatisations respectives. Je vais tenter de la repérer et de la penser, cette impossibilité, dans ces deux cas d’espèce, d’autant qu’on a y parlé de l’Europe (notre Président vivant) ou fait parler de l’Europe (un de nos philosophes morts).Le débat pédagogique télévisé du Président Chirac sur l’EuropeLe Président Jacques Chirac a trouvé en face de lui de jeunes Français terrifiés par le chômage, la crise économique et sociale vécue par les classes moyennes (fourchette haute comme fourchette basse, diraient les parasites technocrates de l’I.N.S.E.E.) toujours sur le fil du rasoir ou bel et bien en voie de paupérisation. Voter «oui» pour l’Europe allait-il leur permettre de trouver du travail, d’éviter de s’expatrier pour ne pas devenir fous à force d’envoyer des C.V. sans succès et de vivre avec 300 euros par mois ? Sa réponse était en substance : «- L’Europe c’est une chose, le chômage une autre». L’Europe allait-elle mieux garantir leur protection sociale ? «- L’Europe garantira les valeurs fondamentales à partir desquelles cette protection sociale s’est construite mais pas forcément la protection sociale elle-même sujette à variation nationale.» L’Europe sauverait-elle nos entreprises ? «L’Europe ne supprime pas l’économie de marché, elle peut atténuer ses effets mais la libre entreprise demeure un risque.» Et ainsi de suite.«Déception !», comme disait Régis Debray dans un autre contexte à propos d’autre chose il y a quelque temps. Déception d’autant plus vive que le Président leur a dit plusieurs fois qu’il ne comprenait pas pourquoi ni de quoi ils avaient peur. Or, ils ont peur. Et il est normal qu’ils aient peur ! Ma génération est davantage blindée : nous vivons avec la crise et le chômage et l’inhumanité qu’elle engendre depuis 30 ans. Eux ils la découvrent et commencent à en subir les conséquences. Mais avouons que ces conséquences nous horrifient également et qu’on se réveille chaque matin la peur au ventre tout de même : va-t-on en sortant dans la rue voir un «S.D.F.» (ce terme technocratiquement ignoble inventé par un technocrate de l’ère Mitterrand) de plus mourir de faim lentement, recroquevillé sur une bouche de chaleur, devant les grilles des locaux des ASSEDICS de l’Avenue de Clichy ? Tout un symbole tout de même ! Le changement dans la continuité ? Quelle honte pour notre pays ! Comment nos pères qui avaient construit les «trente glorieuse» ont-ils pu laisser s’installer une telle gangrène ruineuse de toute cohésion sociale ? Faute d’une Europe suffisamment forte qui nous a laissés à la merci des affairistes sans scrupules alors que paradoxalement on craint qu’elle ne les favorise. Si nous n’y sommes plus pour vérifier ce qui s’y passe, ils auront beau jeu d’y régner : cela est certain, en revanche.Sans aucun doute sur TF1 : reportages sur le mal françaisComment ne pas avoir peur, comment ne pas être terrifié en voyant une émission hebdomadaire comme l’admirable Sans aucun doute sur TF1 qui a le mérite de brosser en temps réel un tableau exact (ô combien davantage que celui dressé statistiquement par l’I.N.S.E.E. !) des atrocités juridico-administratives et socio-économiques dans lesquelles se débattent nos concitoyens ? «Cela peut nous arriver demain» pense-t-on. Et on a raison de le penser : un rien suffit, dans la France actuelle et en Europe, pour basculer des classes moyennes dans les classes pauvres puis de celles-ci dans la mendicité, la folie ou la mort. Vendredi soir le cas aberrant de cette mère d’un enfant handicapé classé «de 50 à 79%» de taux de handicap alors que l’indemnisation débute à un taux de 80% ; ces taux ne veulent strictement rien dire : un taux d’intérêt veut dire quelque chose mais pas un taux de handicap ! Ce scandale administratif que connaissent très bien les dizaines de milliers de séropositifs français sous traitement lourd depuis des dizaines d’années (certains se sont même vus rétrogradés de 80% à 79% par la COTOREP de tel ou tel département, car cela varie d’un département à l’autre) semble (cf. infra – vous verrez qu’on reste prudent) en voie d’être résolu. Mais il aura fallu qu’ACT-UP PARIS (dont on doit saluer l’inlassable combat, depuis près de vingt ans en l’occurrence, contre cette ignominie administrative) envahisse les locaux parisiens de la COTOREP plusieurs fois au cours de son histoire associative, que des rapports soient amassés sur bien des bureaux administratifs et ministériels, que des histoires dramatiques comme celle-ci et tant d’autres surviennent et que les pages Google consacrées à la COTOREP soient de plus en plus nourries de critiques justifiées et de témoignages hallucinants pour qu’enfin un tel scandale soit en passe – on dit bien encore une fois «en passe» : on demeure d’autant plus prudent que la loi réformant cette aberration faite institution vient paraît-il d’être votée – d’être du domaine du passé. Une économie libérale déréglée et mortifère, tueuse d’emploi et de santé, une administration parfois paranoïaque ou kakfkaïenne achevant par la mort sociale et la marginalisation financière les personnes précaires ou handicapées, une administration parfois heureusement plus humaine mais dénuée de moyen : chaque Français est pris dans l’étau. Qu’il commence à s’ouvrir, on respirera mieux.Pourtant…Pourtant le point de vue du Président était, est et demeure rationnel. En effet, ces maux pèsent sur nous : il le sait et comme il n’est pas un tyran antique, il ne peut pas tout changer brusquement par sa seule volonté. Face à lui, existent des intérêts, des pesanteurs, des forces obscures qu’il doit prendre en compte. Comme il sait que davantage d’Europe ne peut qu’améliorer notre situation, pas l’empirer. S’il y a un mal français, on peut tenter de le guérir mais un remède européen plutôt que national paraît plus radical. C’est peut-être parce que nous n’avons pas fait cette Europe plus tôt que ces maux nous accablent encore autant. On peut raisonner en effet à l’inverse : c’est même probablement d’un déficit d’Europe dont nous souffrons ! Et il est évident qu’une organisation européenne renforcera notre puissance nationale comme internationale. L’histoire veut des structures puissantes : malheur aux faibles et aux isolés. Les relations diplomatiques et financières internationales sont des relations – Jean-Baptiste Duroselle l’écrivait noir sur blanc en 1974 et tous les diplomates le savent depuis des siècles – qui reposent sur le chantage, le rapport de force, jamais sur la morale.Si le Président veut rassurer les jeunes Français, il faut qu’il leur garantisse qu’ils pourront vivre «sans aucun doute» décemment quels que soient les aléas de leurs vies. Il faut, de toute évidence, organiser au niveau national un système permettant à chacun de nos citoyens de disposer de 1 000 euros par mois. Avec ces 1 000 euros, on consommera, vivra décemment et on fera tourner la machine économique. Cela créerait un cycle économique vertueux. Ford savait qu’il ne servait à rien de fabriquer des voitures si ses ouvriers ne pouvaient pas se les acheter eux-mêmes, faute d’argent. On a oublié cette leçon qui venait du pragmatisme anglo-saxon le meilleur, le mieux compris : c’était la voix du bon sens. Simple suggestion qui en vaut bien d’autres et qui n’est pas irréalisable financièrement puisque la France est un pays riche. D’ailleurs c’est au niveau européen qu’une telle mesure devrait s’appliquer progressivement, à mesure que la richesse globale générée par notre puissance commune serait redistribuée.Dans ce débat-ci, c’était donc «La Vie quotidienne dans le monde moderne» contre la «nécessité formelle». Points de vue irréconciliables par nature et que même un expert en communication ne pouvait réconcilier. On a passé son temps à comprendre qu’on n’était pas en train de parler de la même chose. Signer un traité n’est pas trouver du travail. Mais pour l’homme de la rue, cela devrait être lié.Cette contradiction savoureuse étant entendue et analysée, reste que le débat, la pédagogie du débat furent un bel effort présidentiel. Il était voué à décevoir puisque la réalité est décevante. Seule la peur d’une pire réalité a modifié finalement un peu la donne : c’est l’argument qui porte le mieux en ce qui concerne la masse. Il fallait le lui asséner. Mais la colère étant une passion, la peur en étant une autre, on verra quelle passion l’emporte le jour du vote. Il ne faut pas espérer d’une masse démocratique qu’elle vote majoritairement pour des raisons : la raison est le privilège d’une élite raisonnablement pessimiste mais courageuse.Le centenaire de Sartre sur I-TéléQuant au beaucoup plus court débat sur le Centenaire de Sartre, c’est l’inverse qui s’est produit : tous parlaient en connaissance de cause de la même chose, enfin de la même personne, du même penseur, de la même œuvre et de la même vie. Le présentateur avait lu son Sartre par lui-même avant de venir animer le débat : il était honnêtement au courant. On trouvait un compagnon de Sartre de l’époque maoïste ultra-communiste finale des années 1970-1975, on trouvait un M.A. Burnier (c’est lui qui a le mieux parlé, qui a parlé le plus justement tout compte fait), on trouvait d’autres sartriens émérites, témoins ou commentateurs autorisés et tous d’ailleurs intéressants d’un pur point d’histoire de la philosophie française. Mais aucun n’a dit que «Sartre politique» a souvent fait les pires choix : compagnon de route des communistes, pro-viêtcong, anti-européen, j’en passe et des pires… On l’a en revanche critiqué comme philosophe hégélianisant en osant ironiser sur la précision de ses citations de Hegel dans le texte : quelle outrecuidance, quel irrespect pour cet ancien normalien agrégé d’avant-guerre ! On l’a critiqué comme résistant avorté ayant inventé en 1945 l’idée de l’intellectuel devant vivre «en situation» en guise de compensation. À l’issue de cette sympathique discussion, Sartre était donc finalement et respectivement «un grand acteur politique» alors que ce fut précisément son point faible, un «philosophe intéressant mais inégal» alors que c’est son inégalité même qui le rend intéressant, un romancier dont seule une partie de l’œuvre peut parler à la jeunesse d’aujourd’hui mais on ne cite pas La Nausée, son meilleur roman et la matrice comme le résultat de son œuvre philosophique antérieure et postérieure (mise à part la Critique de la raison dialectique, ce texte ahurissant qu’il faudrait exposer au musée des Khmers rouges ou sur la tombe des fondateurs du Sentier Lumineux péruvien), tout autant. En 30 minutes Sartre était donc démonté, reconstruit, défiguré et restitué en morceaux : chaque partie n’était pas fausse mais il manquait le restant et aucune n’était à sa place. Et cela nullement du fait d’une partie ou de la totalité des participants au débat qui tentaient tous pour leur part bravement de verser leur fragment de la vérité de cette totalité au débat. Simplement par le débat lui-même dans sa conception : on ne parle pas de Sartre en trente minutes car c’est impossible sans le trahir. C’est une insulte à l’intelligence que de prétendre restituer la vérité d’un penseur tel que Sartre en trente minutes. Le drame est que personne ne voulait ce résultat : ni l’animateur du débat, ni les participants. C’est un résultat structurel : sui generis. Il y a malheureusement quelque chose de pourri au royaume de la télévision du fait de la nature et des moyens mêmes de ce média. Encore une fois il faut relire d’urgence les textes médiologiques de Régis Debray. Il faut aussi relire, car ce n’est pas mal même si antérieur et écrit d’un
«Or quel est ce «principe», si contraire à la nature même des choses, qui fait que le législateur se trompe dans son objet ? Rien d’autre que le principe de la souveraineté populaire, principe commun à Montesquieu, à Rousseau, à Hobbes, à tant d’autres, qui voient dans la société une création, ou mieux, une production humaine, quelque chose d’artificiel (et c’est pour cela que tous les philosophes opposent l’état social à l’état naturel), au lieu de comprendre que c’est la société qui est, en vérité, l’état naturel de l’homme. »Alexandre Koyré, Louis de Bonald (1946) in Études d’histoire de la pensée philosophique (1961) (éd. posthume Gallimard, coll. Bibliothèque des Idées, 1971).Le hasard et l’histoire à la télévision françaiseLe hasard de la télévision française fait bien les choses, l’histoire chronologique du monde aussi. Cet après-midi, cher Juan, à l’occasion de notre sympathique rencontre avec l’incarnation de ton «lien» Fin de Partie (le blog du Transhumain), tu nous as demandé notre avis tant sur le débat télévisé l’autre soir sur TF1 entre le Président de la République et de jeunes Français (et de moins jeunes «animateurs» français) au sujet de la Constitution européenne que sur le fait qu’à la suite de ce débat, le «non» à l’Europe a statistiquement encore monté d’un cran. Ce soir je songeai pour ma part écrire quelque chose sur ce phénomène en effet intéressant. Or je viens par hasard d’assister à un autre débat, organisé sur I-Télé, autour du Centenaire de Sartre auquel étaient conviés des intervenants divers : M.A. Burnier et un professeur de lettres supérieures qui a supervisé un Cahier de l'Herne sur Jean Baudrillard ainsi que quelques autres participants du même calibre intellectuel. Bien sûr la question «- Sartre eût-il voté «oui» ou «non» au prochain référendum sur l’Europe ?» n’a pas manqué d’être anachroniquement posée par le présentateur et on n’a pas manqué d’y répondre à la place de Sartre. La télévision française sait faire parler les vivants mais elle sait aussi faire parler les morts : cela n’étonne plus personne.Ces deux débats sont caractérisés par un point commun : l’impossibilité totale de marier tant la pensée (de la politique) que la politique (de la pensée) et leurs médiatisations respectives. Je vais tenter de la repérer et de la penser, cette impossibilité, dans ces deux cas d’espèce, d’autant qu’on a y parlé de l’Europe (notre Président vivant) ou fait parler de l’Europe (un de nos philosophes morts).Le débat pédagogique télévisé du Président Chirac sur l’EuropeLe Président Jacques Chirac a trouvé en face de lui de jeunes Français terrifiés par le chômage, la crise économique et sociale vécue par les classes moyennes (fourchette haute comme fourchette basse, diraient les parasites technocrates de l’I.N.S.E.E.) toujours sur le fil du rasoir ou bel et bien en voie de paupérisation. Voter «oui» pour l’Europe allait-il leur permettre de trouver du travail, d’éviter de s’expatrier pour ne pas devenir fous à force d’envoyer des C.V. sans succès et de vivre avec 300 euros par mois ? Sa réponse était en substance : «- L’Europe c’est une chose, le chômage une autre». L’Europe allait-elle mieux garantir leur protection sociale ? «- L’Europe garantira les valeurs fondamentales à partir desquelles cette protection sociale s’est construite mais pas forcément la protection sociale elle-même sujette à variation nationale.» L’Europe sauverait-elle nos entreprises ? «L’Europe ne supprime pas l’économie de marché, elle peut atténuer ses effets mais la libre entreprise demeure un risque.» Et ainsi de suite.«Déception !», comme disait Régis Debray dans un autre contexte à propos d’autre chose il y a quelque temps. Déception d’autant plus vive que le Président leur a dit plusieurs fois qu’il ne comprenait pas pourquoi ni de quoi ils avaient peur. Or, ils ont peur. Et il est normal qu’ils aient peur ! Ma génération est davantage blindée : nous vivons avec la crise et le chômage et l’inhumanité qu’elle engendre depuis 30 ans. Eux ils la découvrent et commencent à en subir les conséquences. Mais avouons que ces conséquences nous horrifient également et qu’on se réveille chaque matin la peur au ventre tout de même : va-t-on en sortant dans la rue voir un «S.D.F.» (ce terme technocratiquement ignoble inventé par un technocrate de l’ère Mitterrand) de plus mourir de faim lentement, recroquevillé sur une bouche de chaleur, devant les grilles des locaux des ASSEDICS de l’Avenue de Clichy ? Tout un symbole tout de même ! Le changement dans la continuité ? Quelle honte pour notre pays ! Comment nos pères qui avaient construit les «trente glorieuse» ont-ils pu laisser s’installer une telle gangrène ruineuse de toute cohésion sociale ? Faute d’une Europe suffisamment forte qui nous a laissés à la merci des affairistes sans scrupules alors que paradoxalement on craint qu’elle ne les favorise. Si nous n’y sommes plus pour vérifier ce qui s’y passe, ils auront beau jeu d’y régner : cela est certain, en revanche.Sans aucun doute sur TF1 : reportages sur le mal françaisComment ne pas avoir peur, comment ne pas être terrifié en voyant une émission hebdomadaire comme l’admirable Sans aucun doute sur TF1 qui a le mérite de brosser en temps réel un tableau exact (ô combien davantage que celui dressé statistiquement par l’I.N.S.E.E. !) des atrocités juridico-administratives et socio-économiques dans lesquelles se débattent nos concitoyens ? «Cela peut nous arriver demain» pense-t-on. Et on a raison de le penser : un rien suffit, dans la France actuelle et en Europe, pour basculer des classes moyennes dans les classes pauvres puis de celles-ci dans la mendicité, la folie ou la mort. Vendredi soir le cas aberrant de cette mère d’un enfant handicapé classé «de 50 à 79%» de taux de handicap alors que l’indemnisation débute à un taux de 80% ; ces taux ne veulent strictement rien dire : un taux d’intérêt veut dire quelque chose mais pas un taux de handicap ! Ce scandale administratif que connaissent très bien les dizaines de milliers de séropositifs français sous traitement lourd depuis des dizaines d’années (certains se sont même vus rétrogradés de 80% à 79% par la COTOREP de tel ou tel département, car cela varie d’un département à l’autre) semble (cf. infra – vous verrez qu’on reste prudent) en voie d’être résolu. Mais il aura fallu qu’ACT-UP PARIS (dont on doit saluer l’inlassable combat, depuis près de vingt ans en l’occurrence, contre cette ignominie administrative) envahisse les locaux parisiens de la COTOREP plusieurs fois au cours de son histoire associative, que des rapports soient amassés sur bien des bureaux administratifs et ministériels, que des histoires dramatiques comme celle-ci et tant d’autres surviennent et que les pages Google consacrées à la COTOREP soient de plus en plus nourries de critiques justifiées et de témoignages hallucinants pour qu’enfin un tel scandale soit en passe – on dit bien encore une fois «en passe» : on demeure d’autant plus prudent que la loi réformant cette aberration faite institution vient paraît-il d’être votée – d’être du domaine du passé. Une économie libérale déréglée et mortifère, tueuse d’emploi et de santé, une administration parfois paranoïaque ou kakfkaïenne achevant par la mort sociale et la marginalisation financière les personnes précaires ou handicapées, une administration parfois heureusement plus humaine mais dénuée de moyen : chaque Français est pris dans l’étau. Qu’il commence à s’ouvrir, on respirera mieux.Pourtant…Pourtant le point de vue du Président était, est et demeure rationnel. En effet, ces maux pèsent sur nous : il le sait et comme il n’est pas un tyran antique, il ne peut pas tout changer brusquement par sa seule volonté. Face à lui, existent des intérêts, des pesanteurs, des forces obscures qu’il doit prendre en compte. Comme il sait que davantage d’Europe ne peut qu’améliorer notre situation, pas l’empirer. S’il y a un mal français, on peut tenter de le guérir mais un remède européen plutôt que national paraît plus radical. C’est peut-être parce que nous n’avons pas fait cette Europe plus tôt que ces maux nous accablent encore autant. On peut raisonner en effet à l’inverse : c’est même probablement d’un déficit d’Europe dont nous souffrons ! Et il est évident qu’une organisation européenne renforcera notre puissance nationale comme internationale. L’histoire veut des structures puissantes : malheur aux faibles et aux isolés. Les relations diplomatiques et financières internationales sont des relations – Jean-Baptiste Duroselle l’écrivait noir sur blanc en 1974 et tous les diplomates le savent depuis des siècles – qui reposent sur le chantage, le rapport de force, jamais sur la morale.Si le Président veut rassurer les jeunes Français, il faut qu’il leur garantisse qu’ils pourront vivre «sans aucun doute» décemment quels que soient les aléas de leurs vies. Il faut, de toute évidence, organiser au niveau national un système permettant à chacun de nos citoyens de disposer de 1 000 euros par mois. Avec ces 1 000 euros, on consommera, vivra décemment et on fera tourner la machine économique. Cela créerait un cycle économique vertueux. Ford savait qu’il ne servait à rien de fabriquer des voitures si ses ouvriers ne pouvaient pas se les acheter eux-mêmes, faute d’argent. On a oublié cette leçon qui venait du pragmatisme anglo-saxon le meilleur, le mieux compris : c’était la voix du bon sens. Simple suggestion qui en vaut bien d’autres et qui n’est pas irréalisable financièrement puisque la France est un pays riche. D’ailleurs c’est au niveau européen qu’une telle mesure devrait s’appliquer progressivement, à mesure que la richesse globale générée par notre puissance commune serait redistribuée.Dans ce débat-ci, c’était donc «La Vie quotidienne dans le monde moderne» contre la «nécessité formelle». Points de vue irréconciliables par nature et que même un expert en communication ne pouvait réconcilier. On a passé son temps à comprendre qu’on n’était pas en train de parler de la même chose. Signer un traité n’est pas trouver du travail. Mais pour l’homme de la rue, cela devrait être lié.Cette contradiction savoureuse étant entendue et analysée, reste que le débat, la pédagogie du débat furent un bel effort présidentiel. Il était voué à décevoir puisque la réalité est décevante. Seule la peur d’une pire réalité a modifié finalement un peu la donne : c’est l’argument qui porte le mieux en ce qui concerne la masse. Il fallait le lui asséner. Mais la colère étant une passion, la peur en étant une autre, on verra quelle passion l’emporte le jour du vote. Il ne faut pas espérer d’une masse démocratique qu’elle vote majoritairement pour des raisons : la raison est le privilège d’une élite raisonnablement pessimiste mais courageuse.Le centenaire de Sartre sur I-TéléQuant au beaucoup plus court débat sur le Centenaire de Sartre, c’est l’inverse qui s’est produit : tous parlaient en connaissance de cause de la même chose, enfin de la même personne, du même penseur, de la même œuvre et de la même vie. Le présentateur avait lu son Sartre par lui-même avant de venir animer le débat : il était honnêtement au courant. On trouvait un compagnon de Sartre de l’époque maoïste ultra-communiste finale des années 1970-1975, on trouvait un M.A. Burnier (c’est lui qui a le mieux parlé, qui a parlé le plus justement tout compte fait), on trouvait d’autres sartriens émérites, témoins ou commentateurs autorisés et tous d’ailleurs intéressants d’un pur point d’histoire de la philosophie française. Mais aucun n’a dit que «Sartre politique» a souvent fait les pires choix : compagnon de route des communistes, pro-viêtcong, anti-européen, j’en passe et des pires… On l’a en revanche critiqué comme philosophe hégélianisant en osant ironiser sur la précision de ses citations de Hegel dans le texte : quelle outrecuidance, quel irrespect pour cet ancien normalien agrégé d’avant-guerre ! On l’a critiqué comme résistant avorté ayant inventé en 1945 l’idée de l’intellectuel devant vivre «en situation» en guise de compensation. À l’issue de cette sympathique discussion, Sartre était donc finalement et respectivement «un grand acteur politique» alors que ce fut précisément son point faible, un «philosophe intéressant mais inégal» alors que c’est son inégalité même qui le rend intéressant, un romancier dont seule une partie de l’œuvre peut parler à la jeunesse d’aujourd’hui mais on ne cite pas La Nausée, son meilleur roman et la matrice comme le résultat de son œuvre philosophique antérieure et postérieure (mise à part la Critique de la raison dialectique, ce texte ahurissant qu’il faudrait exposer au musée des Khmers rouges ou sur la tombe des fondateurs du Sentier Lumineux péruvien), tout autant. En 30 minutes Sartre était donc démonté, reconstruit, défiguré et restitué en morceaux : chaque partie n’était pas fausse mais il manquait le restant et aucune n’était à sa place. Et cela nullement du fait d’une partie ou de la totalité des participants au débat qui tentaient tous pour leur part bravement de verser leur fragment de la vérité de cette totalité au débat. Simplement par le débat lui-même dans sa conception : on ne parle pas de Sartre en trente minutes car c’est impossible sans le trahir. C’est une insulte à l’intelligence que de prétendre restituer la vérité d’un penseur tel que Sartre en trente minutes. Le drame est que personne ne voulait ce résultat : ni l’animateur du débat, ni les participants. C’est un résultat structurel : sui generis. Il y a malheureusement quelque chose de pourri au royaume de la télévision du fait de la nature et des moyens mêmes de ce média. Encore une fois il faut relire d’urgence les textes médiologiques de Régis Debray. Il faut aussi relire, car ce n’est pas mal même si antérieur et écrit d’un
18/04/2005 | Lien permanent
L'Enfance d'Ivan de Tarkovski, par Francis Moury

 Fiche technique succincteRéalisation : Andreï TarkovskiProduction : MosfilmScénario : Vladimir Bogomolov d’après son roman, Mikhail Papava et Andreï TarkovskiDirecteur de la photographie : Vadim IoussovMusique : Viatcheslav Ovtchinnikov.Casting succinctNikolaï Bourliaev, Valentin Zoubkov, Evguéni Jarikov, Valentina Maliavina, Stépan Krilov, Nikolaï Grinko, etc.Résumé du scénario«Grande Guerre patriotique», pendant l’offensive de 1943 contre l’armée nazie : le jeune Ivan a rejoint l’armée régulière stalinienne pour venger le meurtre de ses parents gardes-frontières. Il exécute héroïquement des missions dangereuses qu’un homme adulte ne pourrait accomplir. Et il se remémore ou rêve fugitivement ce qui fut son enfance. Un jeune lieutenant préservera en lui le souvenir de cet enfant à l’issue de la guerre.CritiqueL’enfance d’Ivan (Ivanovo detstvo, URSS, 1962) d’Andreï Tarkovski (1932-1986) fut une révélation mondiale lors de sa distribution en dehors d’URSS. Il fut récompensé du Lion d’or du Festival de Venise, du Golden Gate de la mise en scène au Festival de San Francisco et par de nombreux autres prix. Paradoxalement, il fut mis sous le boisseau dans son propre pays car Kroutchev avait déclaré, après l’avoir visionné, qu’il n’était pas conforme à la vérité historique de montrer l’Armée rouge utiliser des enfants pendant les combats bien que le fait soit avéré par de nombreuses sources filmées, écrites et parlées. Le président Kroutchev ne voulait pas que l’Armée rouge puisse être confondue avec les armées spontanées de partisans pour des raisons internes à l’histoire du stalinisme qu’il serait fastidieux d’expliquer ici. Quoi qu’il en soit, c’est bien l’armée régulière qui est celle d’Ivan, pas les autres.Contingence historique étrange jusqu’au bout : un autre cinéaste avait commencé à tourner L’enfance d’Ivan avec d’autres acteurs mais Mosfilm, la célèbre firme étatique mécontente du résultat initial, proposa à Tarkovski qui venait d’obtenir son diplôme de fin d’étude brillamment de le reprendre… avec la moitié du budget encore disponible et pas encore gaspillée par son prédécesseur. Il accepta immédiatement. Et probablement pour deux raisons : d’une part le film de guerre patriotique était véritablement le genre par lequel il fallait passer en URSS communiste si on voulait avoir la reconnaissance administrative et l’éloge des autorités de tutelle du cinéma soviétique ; d’autre part, le roman de Bogomolov contenait un certains nombres d’éléments qui intéressaient Tarkovski. L’occasion était donc parfaite : sa propre inspiration pouvait s’épanouir au sein du genre alors le plus respecté.On voit bien rétrospectivement ce qui a passionné Tarkovski là-dedans : la possibilité de mélanger peinture phénoménologique subjective d’une conscience hésitant entre passé, présent, rêve, réalité, fantasme et une peinture strictement objective mais assez symbolique tout de même de l’événement le plus tragique qui ait marquée l’histoire de son pays au XXe siècle. Cette Seconde guerre mondiale que les Russes nomment encore aujourd’hui «Grande Guerre patriotique» leur a coûté probablement 20 millions de morts et peut-être deux fois plus de blessés. Tarkovski comme une partie de ses collaborateurs étaient adolescents pendant l’invasion allemande de 1941 puis la contre-offensive stalinienne victorieuse en 1943 : ils en furent naturellement marqués à vie par les pertes familiales et les images d’horreur qu’ils avaient en mémoire et il fallait bien qu’ils en parlassent. Le film a donc une double nature : objective et subjective. Expérimentations graphiques narratives avec le temps et l’espace coïncident avec une narration classique d’un sujet global qui ne l’est pas moins. Il n’est en somme pas mauvais de commencer par ce Tarkovski-là. Car c’est par ce long métrage qu’il a lui-même commencé, que ses premiers spectateurs mondiaux l’ont découvert et admiré, et les vertigineuses plongées métaphysiques qui feront sa réputation restent encore disciplinées par la nature même du sujet : l’histoire contemporaine récente vue à travers, il est vrai, un cas déjà très particulier poussé presque à la limite de ses possibilités internes. C’est déjà, en dépit de son sujet, un film alliant introspection et contemplation d’une manière nerveuse, profondément métaphysique au sens le plus étymologique de ce terme.
Fiche technique succincteRéalisation : Andreï TarkovskiProduction : MosfilmScénario : Vladimir Bogomolov d’après son roman, Mikhail Papava et Andreï TarkovskiDirecteur de la photographie : Vadim IoussovMusique : Viatcheslav Ovtchinnikov.Casting succinctNikolaï Bourliaev, Valentin Zoubkov, Evguéni Jarikov, Valentina Maliavina, Stépan Krilov, Nikolaï Grinko, etc.Résumé du scénario«Grande Guerre patriotique», pendant l’offensive de 1943 contre l’armée nazie : le jeune Ivan a rejoint l’armée régulière stalinienne pour venger le meurtre de ses parents gardes-frontières. Il exécute héroïquement des missions dangereuses qu’un homme adulte ne pourrait accomplir. Et il se remémore ou rêve fugitivement ce qui fut son enfance. Un jeune lieutenant préservera en lui le souvenir de cet enfant à l’issue de la guerre.CritiqueL’enfance d’Ivan (Ivanovo detstvo, URSS, 1962) d’Andreï Tarkovski (1932-1986) fut une révélation mondiale lors de sa distribution en dehors d’URSS. Il fut récompensé du Lion d’or du Festival de Venise, du Golden Gate de la mise en scène au Festival de San Francisco et par de nombreux autres prix. Paradoxalement, il fut mis sous le boisseau dans son propre pays car Kroutchev avait déclaré, après l’avoir visionné, qu’il n’était pas conforme à la vérité historique de montrer l’Armée rouge utiliser des enfants pendant les combats bien que le fait soit avéré par de nombreuses sources filmées, écrites et parlées. Le président Kroutchev ne voulait pas que l’Armée rouge puisse être confondue avec les armées spontanées de partisans pour des raisons internes à l’histoire du stalinisme qu’il serait fastidieux d’expliquer ici. Quoi qu’il en soit, c’est bien l’armée régulière qui est celle d’Ivan, pas les autres.Contingence historique étrange jusqu’au bout : un autre cinéaste avait commencé à tourner L’enfance d’Ivan avec d’autres acteurs mais Mosfilm, la célèbre firme étatique mécontente du résultat initial, proposa à Tarkovski qui venait d’obtenir son diplôme de fin d’étude brillamment de le reprendre… avec la moitié du budget encore disponible et pas encore gaspillée par son prédécesseur. Il accepta immédiatement. Et probablement pour deux raisons : d’une part le film de guerre patriotique était véritablement le genre par lequel il fallait passer en URSS communiste si on voulait avoir la reconnaissance administrative et l’éloge des autorités de tutelle du cinéma soviétique ; d’autre part, le roman de Bogomolov contenait un certains nombres d’éléments qui intéressaient Tarkovski. L’occasion était donc parfaite : sa propre inspiration pouvait s’épanouir au sein du genre alors le plus respecté.On voit bien rétrospectivement ce qui a passionné Tarkovski là-dedans : la possibilité de mélanger peinture phénoménologique subjective d’une conscience hésitant entre passé, présent, rêve, réalité, fantasme et une peinture strictement objective mais assez symbolique tout de même de l’événement le plus tragique qui ait marquée l’histoire de son pays au XXe siècle. Cette Seconde guerre mondiale que les Russes nomment encore aujourd’hui «Grande Guerre patriotique» leur a coûté probablement 20 millions de morts et peut-être deux fois plus de blessés. Tarkovski comme une partie de ses collaborateurs étaient adolescents pendant l’invasion allemande de 1941 puis la contre-offensive stalinienne victorieuse en 1943 : ils en furent naturellement marqués à vie par les pertes familiales et les images d’horreur qu’ils avaient en mémoire et il fallait bien qu’ils en parlassent. Le film a donc une double nature : objective et subjective. Expérimentations graphiques narratives avec le temps et l’espace coïncident avec une narration classique d’un sujet global qui ne l’est pas moins. Il n’est en somme pas mauvais de commencer par ce Tarkovski-là. Car c’est par ce long métrage qu’il a lui-même commencé, que ses premiers spectateurs mondiaux l’ont découvert et admiré, et les vertigineuses plongées métaphysiques qui feront sa réputation restent encore disciplinées par la nature même du sujet : l’histoire contemporaine récente vue à travers, il est vrai, un cas déjà très particulier poussé presque à la limite de ses possibilités internes. C’est déjà, en dépit de son sujet, un film alliant introspection et contemplation d’une manière nerveuse, profondément métaphysique au sens le plus étymologique de ce terme.
23/06/2005 | Lien permanent
L'unique pensée de Jules Lequier, par Francis Moury

 Le nom sous lequel nous connaissons Lequier est déjà un résultat de ce que désigne le titre de cet article : la liberté. Il s’est librement et tardivement renommé Lequier. Son nom pour l’état civil était Joseph Louis Jules Léquyer. Un tel résultat – passer de Jules Léquyer à Jules Lequier – n’épuise pas sa cause mais il participe déjà à la plus célèbre formule en laquelle on a souvent résumé sa philosophie : «Faire, non pas devenir mais faire et en faisant, se faire». Formule qui n’est qu’un autre résultat du même cheminement volontaire. Volontaire ? Dans le cas de l’adoption du nom nouveau, assurément oui. Dans celui du cheminement, la contingence la plus terrible a eu son mot à dire. Lequier est un philosophe de plus à verser au contingent de ceux dont la philosophie est inexplicable, voire incompréhensible si on ne connaît pas leur biographie.La vie du penseur et ses trois défaites
Le nom sous lequel nous connaissons Lequier est déjà un résultat de ce que désigne le titre de cet article : la liberté. Il s’est librement et tardivement renommé Lequier. Son nom pour l’état civil était Joseph Louis Jules Léquyer. Un tel résultat – passer de Jules Léquyer à Jules Lequier – n’épuise pas sa cause mais il participe déjà à la plus célèbre formule en laquelle on a souvent résumé sa philosophie : «Faire, non pas devenir mais faire et en faisant, se faire». Formule qui n’est qu’un autre résultat du même cheminement volontaire. Volontaire ? Dans le cas de l’adoption du nom nouveau, assurément oui. Dans celui du cheminement, la contingence la plus terrible a eu son mot à dire. Lequier est un philosophe de plus à verser au contingent de ceux dont la philosophie est inexplicable, voire incompréhensible si on ne connaît pas leur biographie.La vie du penseur et ses trois défaites Il faut donc d’emblée savoir que rien ne prédestinait en fin de compte ce jeune homme catholique breton renommé par lui-même «Jules Lequier» à la recherche philosophique d’une première vérité. Né à Quintin (Côtes du Nord) en 1814, polytechnicien de la même promotion que Charles Renouvier (le futur fondateur du «criticisme»), sous-lieutenant (décembre 1836), stagiaire pendant deux ans à l’École d’Application d’État-Major, il ne put obtenir d’y être versé. Ses années d’études et son avenir professionnel étaient sérieusement compromis. Il s’en plaignit en 1839 au Ministre de la Guerre, s’estimant victime d’une injustice. C’est à cette occasion qu’il fait appel à son cousin François Palasne de Champeaux qui était secrétaire de Lamartine. Le poète-politique influent écouta celui qui se nommait encore «Joseph Louis Jules Léquyer» et fut convaincu de plaider à son tour sa cause : en vain. Il se mit en demi-solde puis démissionna le 06 juin 1839 : première défaite. Deuxième défaite : il se présente aux élections en 1848 dans son département – une terre acquise à Lamartine et aux lamartiniens – mais ne sera pas élu. Et son état de santé psychique donne des inquiétudes à sa famille (tant qu’elle vit mais bien sûr, elle meurt…) et à ses amis. Renouvier fut ainsi le témoin de sa crise majeure. Troisième défaite : alors qu’il est déjà franchement pauvre et isolé, il tombe amoureux d’une demoiselle Deszille à qui il propose deux fois le mariage à quelques années d’intervalle, sans succès. Le 11 février 1862, il marche vers la mer de Saint Brieuc (Plérin-sur-Mer) et y nage en direction du large jusqu’à épuisement. Comme il était, paraît-il, bon nageur rompu à nager même l’hiver, on discute pour savoir si sa mort est accidentelle ou suicidaire et cette discussion est importante quand on la rapporte à sa pensée : nous y reviendrons. C’est Renouvier qui publia en 1865 les premières pages connues et essentielles de Lequier qui n’a rien publié de son vivant mais montrait parfois ses écrits à ceux qu’il en jugeait dignes.Le point commun entre deux penseursLa biographie de Lequier comporte un point commun frappant avec celle d’Auguste Comte : tous deux auront passé quelques temps dans un asile d’aliénés dont l’activité thérapeutique couvre aussi bien, à l’époque, les troubles psychiques que les troubles neurologiques ou mentaux. Comte en sortit, comme on sait, avec la mention «non guéri» signée par son médecin Esquirol tandis que la rapidité de rétablissement de Lequier surprit agréablement ses médecins qui le jugèrent probablement guéri. Dans les deux cas, ces crises psychiques furent concomitantes avec l’inspiration philosophique, si on étudie la chronologie de leurs écrits en relation avec leurs biographies respectives. Mais Comte fonde d’abord une philosophie positiviste puis une Religion de l’Humanité qui la coiffait organiquement ou la défigurait (selon les héritiers divers) tandis que Lequier trouve sa première vérité qu’il cherchait sans pour autant fonder le moindre système dessus. Ses écrits sont ensuite un travail de questionnement non moins constant. Quelle est-elle, au fait, cette première vérité ?La pensée et les pensées sur la pensée… puis retourTout le monde l’a remarqué explicitement ou implicitement (Renouvier, Delbos, Bréhier, Wahl, Grenier, et les commentateurs postérieurs à eux) la démarche de Lequier est métaphysiquement cartésienne : c’est une méditation cartésienne en apparence qui aboutit d’ailleurs positivement à l’un des fondements du cartésianisme. Résumée en son résultat immédiat et tangible, La recherche d’une première vérité semble simple : si je ne me contente pas des préjugés et que l’inquiétude philosophique la plus pure m’amène à rechercher une première vérité, c’est que je suis libre absolument d’effectuer cette recherche. En la cherchant – alors que je jugeais insuffisants toutes les réponses et tous les socles sur lesquels m’appuyer à mesure que ma recherche progressait – je l’ai donc finalement trouvée : c’est ma liberté.Bien. Effectivement, il suffisait de faire, et en faisant, on découvrait qu’on se faisait. Du même coup on découvrait qu’on n’était pas soumis à un devenir déterminé mais renvoyé à la contingence. Car l’angoisse première née de la célèbre Feuille de charmille est une angoisse absolue qui s’élève à une métaphysique de la contingence. Comme le sera celle de l’arbre noir à demi-mort dont coule la résine lumineuse dans un de ses ultimes textes les plus franchement hallucinés et qu’il faudrait comparer avec la future nausée sartrienne éprouvée devant la racine d’un arbre. Donc faire et, en faisant non pas devenir ou demeurer un élément passif du devenir et d’une interaction aberrante mais se faire. Immédiatement, naît un second problème inévitable car toujours déjà là.Autant de libertés interactives existent que d’êtres humains : comment envisager le monde et l’idée de Dieu compte tenu de cela ? Dieu lui-même se fait-il dans le temps par sa créature ? À mesure qu’on lit ces textes d’une étrange beauté, très inconfortable en dépit de la perfection de sa syntaxe qui se souvient de la rigueur d’un Maine de Biran et qui annonce la profondeur d’un Proust, on constate que Lequier, dès le départ de sa méditation qu’il a baptisée recherche et non pas méditation, nous a fait glisser dans une dimension étrange pour l’époque qui le rattache autant à saint Augustin qu’à F. W. Schelling, autant à Kierkegaard et Nietzsche (le fragment sur l’interaction infinie des actes au sein du cosmos dans Humain trop humain) qu’à Freud («là où ça était, je dois devenir») mais en fait, lui Jules Lequier, un parfait météore, non moins chu qu’Edgar A. Poe d’un désastre obscur.Certes, théoriquement, on peut dérouler la pelote du fil rouge qui relie Lequier à ses prédécesseurs : son angoisse est d’essence augustinienne. D’Augustin à Descartes puis Maine de Biran à Lequier, la conséquence est bonne : à partir de la liberté donnée enfin à la conscience comme fait inexplicable mais assuré, contingent mais certain, il s’agit de construire une anthropologie comme philosophie religieuse qui prenne en compte la situation de l’homme dans le monde, situation tragique par essence. Pourtant ce qui est remarquable en fin de compte, c’est que Lequier ait exprimé le premier d’une manière moderne l’angoisse métaphysique, la déréliction, la peur (au sens où Hobbes disait : «la grande passion de ma vie aura été la peur») qui présidaient déjà intimement aux intuitions géniales de ses prédécesseurs et l’ait fait à ce point précis de la chronologie philosophique française. Ces intuitions donnaient naissance ailleurs qu’en France à des pensées comme celles de Schopenhauer, de Nietzsche et de Kierkegaard qui pensent déjà l’angoisse elle-même comme facteur absolument positif, concret absolu. Le problème vital de Lequier est qu’il ne domine pas ce fil rouge : il l’appréhende, davantage que comme nœud gordien, comme une circularité oppressante qu’il faudrait théoriquement rompre et qu'il est pourtant absolument impossible de rompre. Il développe un aspect nouveau en France d’une intuition métaphysique aux facettes anciennes.Le déterminisme scientiste para-comtien et post-comtien, cette dégénérescence annoncée dès l’antiquité du positivisme, ne lui pose pas de problème particulier. Son compte est réglé depuis longtemps : il est réglé et bien réglé, à sa juste place, celle de la cuisine dont le XVIIIe siècle l’a fait émerger un moment. Oui il y a des lois, commodes et fonctionnant apparemment assez régulièrement pour que l’homme puisse dominer relativement la nature matérielle, biologique un peu moins, morale, sociale, économique et religieuse pas du tout. Mais elles n’expliquent rien. Auguste Comte lui-même, aussi ex-polytechnicien pauvre, radié lui aussi des cadres, répétiteur une année ou deux puis vivant de cours particuliers et enfin du fameux «subside positiviste» ne cesse de le répéter dans ses Cours de philosophie positive qui sont l’alpha et l’oméga de la France pensante de l’époque. Les positivistes comme Littré et Renan, les positivistes spiritualistes et les critiques de la science (Ravaisson, Boutroux, Lachelier, Poincaré, Le Roy, Duhem, Bergson, Meyerson) enfonceront le clou : l’idéalisme allemand kantien et post-kantien est connu et apprécié d’eux en raison, d’abord et surtout, de cet argument que le déterminisme de la science fonctionne mais qu’il ne sera jamais fondé. En matière de fondement, il faut trouver autre chose. Lequier le sait très bien. Il sait aussi, comme un Léon Chestov ou plus tard un Heidegger, qu’on a trouvé dans l’antiquité classique et au moyen-âge des fondements bien plus intéressants. Et il sait – d’une connaissance philosophique – comme eux qu’entre l’antiquité et le moyen-âge, il s’est produit un phénomène historique inédit après lequel rien ne saurait être comme avant et qu’il n’est pas sérieux de prétendre penser sans vouloir se risquer à le penser lui aussi. Surtout quand on a été élevé en Bretagne au début du XIXe siècle : il suffit de lire les Souvenirs d’enfance et de jeunesse de Renan pour en être convaincu !La recherche lequierienne de Dieu, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, n’est pourtant nullement assurée de trouver un terme défini métaphysiquement d’une manière satisfaisante: la créature posée libre, reste le problème du créateur et Lequier envisage, contemple, tourne autour des différents problèmes classiques de la théologie sans pouvoir trancher. D’où le ton authentiquement impressionnant de ses textes : une inquiétude individuelle exacerbée, une angoisse cosmique toute pascalienne face à l’aporie de la temporalité de la liberté qui pourrait aller jusqu’à introduire une temporalité dans Dieu lui-même en considérant le problème de la succession contingente des actions humaines sous le point de vue de l’éternité. Lequier esquisse régulièrement une admirable théologie dialectique qui retrouve certes saint Augustin et Pascal mais annonce non moins régulièrement l’existentialisme catholique moderne et sa vision tragique de la condition humaine. Il y a aussi chez lui des traces annexes de pragmatisme volontariste, de néo-criticisme, mais elles sont secondaires en valeur comme en importance théorique. Lequier regarde la ligne d’horizon du XXe siècle avec des yeux venus du passé le plus lointain et le plus originaire : il a d’ailleurs fallu attendre 1952 pour que les œuvres complètes de ce «Descartes tragique», révélées fragmentairement en 1865, soient éditées. Et leur édition confirme que le fragment (même étendu aux dimensions d’un livre) est bien la dimension naturelle, anti-systématique de sa pensée.La mort du penseur ou bien le suicide du penseur ?On mesure donc seulement après avoir lu ce qui précède l’importance de la signification de son geste final : un de ses proches pense qu’il ne se suicida nullement mais nagea en espérant un miracle (qui ne vint pas) et qu’il est donc mort accidentellement. D’autres la rabaissent au suicide athée. Cette ambivalence dialectique et existentielle de sa «mort-suicide» impossible à trancher qui demeure telle une contradiction possible, un acte manqué ou bien pleinement assumé, n’est-ce pas un saisissant résumé de ce qui fut, peut-être, l’unique pensée de Jules Lequier ?NB : on a jugé inutile de fournir une bibliographie, tant de Jules Lequier lui-même que des études partielles ou totales de sa vie et de sa pensée parues en France et à l’étranger, sur papier comme sur Internet : le lecteur en trouvera sans peine, ne serait-ce que par la grâce des moteurs de recherches. Qu’il se méfie simplement de la précision parfois vraie mais parfois absolument erronée de ce qu’il y verra du premier coup d’œil et veuille bien d’abord se référer aux meilleurs historiens de la philosophie, rompus aux méthodes de cette histoire et à sa rigueur. On en a cité supra qui n’épuisent pas la liste mais fournissent d’excellents points de départ. Ajoutons simplement que notre crainte (la crainte du vaillant varan Juan Asensio, qui fut ensuite seulement la mienne exprimée-reprise sur son beau site Internet, Stalker, deux craintes traçables dans son billet préfaçant ma critique cinématographique de Miracle en Alabama) que la mémoire de Lequier ne fût perdue s’avère heureusement et tout compte fait sans objet. À défaut d’être connue ou même reconnue largement du grand public, elle persiste encore récemment dans le cercle naturel qui est le sien, celui des travaux d’histoire de la philosophie.J'ajoute que plusieurs ouvrages de Jules Lequier sont en cours de numérisation par les éditions de
Il faut donc d’emblée savoir que rien ne prédestinait en fin de compte ce jeune homme catholique breton renommé par lui-même «Jules Lequier» à la recherche philosophique d’une première vérité. Né à Quintin (Côtes du Nord) en 1814, polytechnicien de la même promotion que Charles Renouvier (le futur fondateur du «criticisme»), sous-lieutenant (décembre 1836), stagiaire pendant deux ans à l’École d’Application d’État-Major, il ne put obtenir d’y être versé. Ses années d’études et son avenir professionnel étaient sérieusement compromis. Il s’en plaignit en 1839 au Ministre de la Guerre, s’estimant victime d’une injustice. C’est à cette occasion qu’il fait appel à son cousin François Palasne de Champeaux qui était secrétaire de Lamartine. Le poète-politique influent écouta celui qui se nommait encore «Joseph Louis Jules Léquyer» et fut convaincu de plaider à son tour sa cause : en vain. Il se mit en demi-solde puis démissionna le 06 juin 1839 : première défaite. Deuxième défaite : il se présente aux élections en 1848 dans son département – une terre acquise à Lamartine et aux lamartiniens – mais ne sera pas élu. Et son état de santé psychique donne des inquiétudes à sa famille (tant qu’elle vit mais bien sûr, elle meurt…) et à ses amis. Renouvier fut ainsi le témoin de sa crise majeure. Troisième défaite : alors qu’il est déjà franchement pauvre et isolé, il tombe amoureux d’une demoiselle Deszille à qui il propose deux fois le mariage à quelques années d’intervalle, sans succès. Le 11 février 1862, il marche vers la mer de Saint Brieuc (Plérin-sur-Mer) et y nage en direction du large jusqu’à épuisement. Comme il était, paraît-il, bon nageur rompu à nager même l’hiver, on discute pour savoir si sa mort est accidentelle ou suicidaire et cette discussion est importante quand on la rapporte à sa pensée : nous y reviendrons. C’est Renouvier qui publia en 1865 les premières pages connues et essentielles de Lequier qui n’a rien publié de son vivant mais montrait parfois ses écrits à ceux qu’il en jugeait dignes.Le point commun entre deux penseursLa biographie de Lequier comporte un point commun frappant avec celle d’Auguste Comte : tous deux auront passé quelques temps dans un asile d’aliénés dont l’activité thérapeutique couvre aussi bien, à l’époque, les troubles psychiques que les troubles neurologiques ou mentaux. Comte en sortit, comme on sait, avec la mention «non guéri» signée par son médecin Esquirol tandis que la rapidité de rétablissement de Lequier surprit agréablement ses médecins qui le jugèrent probablement guéri. Dans les deux cas, ces crises psychiques furent concomitantes avec l’inspiration philosophique, si on étudie la chronologie de leurs écrits en relation avec leurs biographies respectives. Mais Comte fonde d’abord une philosophie positiviste puis une Religion de l’Humanité qui la coiffait organiquement ou la défigurait (selon les héritiers divers) tandis que Lequier trouve sa première vérité qu’il cherchait sans pour autant fonder le moindre système dessus. Ses écrits sont ensuite un travail de questionnement non moins constant. Quelle est-elle, au fait, cette première vérité ?La pensée et les pensées sur la pensée… puis retourTout le monde l’a remarqué explicitement ou implicitement (Renouvier, Delbos, Bréhier, Wahl, Grenier, et les commentateurs postérieurs à eux) la démarche de Lequier est métaphysiquement cartésienne : c’est une méditation cartésienne en apparence qui aboutit d’ailleurs positivement à l’un des fondements du cartésianisme. Résumée en son résultat immédiat et tangible, La recherche d’une première vérité semble simple : si je ne me contente pas des préjugés et que l’inquiétude philosophique la plus pure m’amène à rechercher une première vérité, c’est que je suis libre absolument d’effectuer cette recherche. En la cherchant – alors que je jugeais insuffisants toutes les réponses et tous les socles sur lesquels m’appuyer à mesure que ma recherche progressait – je l’ai donc finalement trouvée : c’est ma liberté.Bien. Effectivement, il suffisait de faire, et en faisant, on découvrait qu’on se faisait. Du même coup on découvrait qu’on n’était pas soumis à un devenir déterminé mais renvoyé à la contingence. Car l’angoisse première née de la célèbre Feuille de charmille est une angoisse absolue qui s’élève à une métaphysique de la contingence. Comme le sera celle de l’arbre noir à demi-mort dont coule la résine lumineuse dans un de ses ultimes textes les plus franchement hallucinés et qu’il faudrait comparer avec la future nausée sartrienne éprouvée devant la racine d’un arbre. Donc faire et, en faisant non pas devenir ou demeurer un élément passif du devenir et d’une interaction aberrante mais se faire. Immédiatement, naît un second problème inévitable car toujours déjà là.Autant de libertés interactives existent que d’êtres humains : comment envisager le monde et l’idée de Dieu compte tenu de cela ? Dieu lui-même se fait-il dans le temps par sa créature ? À mesure qu’on lit ces textes d’une étrange beauté, très inconfortable en dépit de la perfection de sa syntaxe qui se souvient de la rigueur d’un Maine de Biran et qui annonce la profondeur d’un Proust, on constate que Lequier, dès le départ de sa méditation qu’il a baptisée recherche et non pas méditation, nous a fait glisser dans une dimension étrange pour l’époque qui le rattache autant à saint Augustin qu’à F. W. Schelling, autant à Kierkegaard et Nietzsche (le fragment sur l’interaction infinie des actes au sein du cosmos dans Humain trop humain) qu’à Freud («là où ça était, je dois devenir») mais en fait, lui Jules Lequier, un parfait météore, non moins chu qu’Edgar A. Poe d’un désastre obscur.Certes, théoriquement, on peut dérouler la pelote du fil rouge qui relie Lequier à ses prédécesseurs : son angoisse est d’essence augustinienne. D’Augustin à Descartes puis Maine de Biran à Lequier, la conséquence est bonne : à partir de la liberté donnée enfin à la conscience comme fait inexplicable mais assuré, contingent mais certain, il s’agit de construire une anthropologie comme philosophie religieuse qui prenne en compte la situation de l’homme dans le monde, situation tragique par essence. Pourtant ce qui est remarquable en fin de compte, c’est que Lequier ait exprimé le premier d’une manière moderne l’angoisse métaphysique, la déréliction, la peur (au sens où Hobbes disait : «la grande passion de ma vie aura été la peur») qui présidaient déjà intimement aux intuitions géniales de ses prédécesseurs et l’ait fait à ce point précis de la chronologie philosophique française. Ces intuitions donnaient naissance ailleurs qu’en France à des pensées comme celles de Schopenhauer, de Nietzsche et de Kierkegaard qui pensent déjà l’angoisse elle-même comme facteur absolument positif, concret absolu. Le problème vital de Lequier est qu’il ne domine pas ce fil rouge : il l’appréhende, davantage que comme nœud gordien, comme une circularité oppressante qu’il faudrait théoriquement rompre et qu'il est pourtant absolument impossible de rompre. Il développe un aspect nouveau en France d’une intuition métaphysique aux facettes anciennes.Le déterminisme scientiste para-comtien et post-comtien, cette dégénérescence annoncée dès l’antiquité du positivisme, ne lui pose pas de problème particulier. Son compte est réglé depuis longtemps : il est réglé et bien réglé, à sa juste place, celle de la cuisine dont le XVIIIe siècle l’a fait émerger un moment. Oui il y a des lois, commodes et fonctionnant apparemment assez régulièrement pour que l’homme puisse dominer relativement la nature matérielle, biologique un peu moins, morale, sociale, économique et religieuse pas du tout. Mais elles n’expliquent rien. Auguste Comte lui-même, aussi ex-polytechnicien pauvre, radié lui aussi des cadres, répétiteur une année ou deux puis vivant de cours particuliers et enfin du fameux «subside positiviste» ne cesse de le répéter dans ses Cours de philosophie positive qui sont l’alpha et l’oméga de la France pensante de l’époque. Les positivistes comme Littré et Renan, les positivistes spiritualistes et les critiques de la science (Ravaisson, Boutroux, Lachelier, Poincaré, Le Roy, Duhem, Bergson, Meyerson) enfonceront le clou : l’idéalisme allemand kantien et post-kantien est connu et apprécié d’eux en raison, d’abord et surtout, de cet argument que le déterminisme de la science fonctionne mais qu’il ne sera jamais fondé. En matière de fondement, il faut trouver autre chose. Lequier le sait très bien. Il sait aussi, comme un Léon Chestov ou plus tard un Heidegger, qu’on a trouvé dans l’antiquité classique et au moyen-âge des fondements bien plus intéressants. Et il sait – d’une connaissance philosophique – comme eux qu’entre l’antiquité et le moyen-âge, il s’est produit un phénomène historique inédit après lequel rien ne saurait être comme avant et qu’il n’est pas sérieux de prétendre penser sans vouloir se risquer à le penser lui aussi. Surtout quand on a été élevé en Bretagne au début du XIXe siècle : il suffit de lire les Souvenirs d’enfance et de jeunesse de Renan pour en être convaincu !La recherche lequierienne de Dieu, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, n’est pourtant nullement assurée de trouver un terme défini métaphysiquement d’une manière satisfaisante: la créature posée libre, reste le problème du créateur et Lequier envisage, contemple, tourne autour des différents problèmes classiques de la théologie sans pouvoir trancher. D’où le ton authentiquement impressionnant de ses textes : une inquiétude individuelle exacerbée, une angoisse cosmique toute pascalienne face à l’aporie de la temporalité de la liberté qui pourrait aller jusqu’à introduire une temporalité dans Dieu lui-même en considérant le problème de la succession contingente des actions humaines sous le point de vue de l’éternité. Lequier esquisse régulièrement une admirable théologie dialectique qui retrouve certes saint Augustin et Pascal mais annonce non moins régulièrement l’existentialisme catholique moderne et sa vision tragique de la condition humaine. Il y a aussi chez lui des traces annexes de pragmatisme volontariste, de néo-criticisme, mais elles sont secondaires en valeur comme en importance théorique. Lequier regarde la ligne d’horizon du XXe siècle avec des yeux venus du passé le plus lointain et le plus originaire : il a d’ailleurs fallu attendre 1952 pour que les œuvres complètes de ce «Descartes tragique», révélées fragmentairement en 1865, soient éditées. Et leur édition confirme que le fragment (même étendu aux dimensions d’un livre) est bien la dimension naturelle, anti-systématique de sa pensée.La mort du penseur ou bien le suicide du penseur ?On mesure donc seulement après avoir lu ce qui précède l’importance de la signification de son geste final : un de ses proches pense qu’il ne se suicida nullement mais nagea en espérant un miracle (qui ne vint pas) et qu’il est donc mort accidentellement. D’autres la rabaissent au suicide athée. Cette ambivalence dialectique et existentielle de sa «mort-suicide» impossible à trancher qui demeure telle une contradiction possible, un acte manqué ou bien pleinement assumé, n’est-ce pas un saisissant résumé de ce qui fut, peut-être, l’unique pensée de Jules Lequier ?NB : on a jugé inutile de fournir une bibliographie, tant de Jules Lequier lui-même que des études partielles ou totales de sa vie et de sa pensée parues en France et à l’étranger, sur papier comme sur Internet : le lecteur en trouvera sans peine, ne serait-ce que par la grâce des moteurs de recherches. Qu’il se méfie simplement de la précision parfois vraie mais parfois absolument erronée de ce qu’il y verra du premier coup d’œil et veuille bien d’abord se référer aux meilleurs historiens de la philosophie, rompus aux méthodes de cette histoire et à sa rigueur. On en a cité supra qui n’épuisent pas la liste mais fournissent d’excellents points de départ. Ajoutons simplement que notre crainte (la crainte du vaillant varan Juan Asensio, qui fut ensuite seulement la mienne exprimée-reprise sur son beau site Internet, Stalker, deux craintes traçables dans son billet préfaçant ma critique cinématographique de Miracle en Alabama) que la mémoire de Lequier ne fût perdue s’avère heureusement et tout compte fait sans objet. À défaut d’être connue ou même reconnue largement du grand public, elle persiste encore récemment dans le cercle naturel qui est le sien, celui des travaux d’histoire de la philosophie.J'ajoute que plusieurs ouvrages de Jules Lequier sont en cours de numérisation par les éditions de
07/02/2010 | Lien permanent
Contre Gilles Grelet, Théorie-rébellion. Un ultimatum, par Francis Moury

 Voici l'article (sous-titré : Exégèse d'un non-sens (presque) commun) rédigé par Francis Moury sur le livre polyphonique dirigé par Gilles Grelet (Théorie-rébellion. Un ultimatum, L’Harmattan, coll. Nous, les sans-philosophies, septembre 2005) auquel j'ai bien modestement participé, sous la forme d'un texte, publié dans la Zone il y a bien des mois, consacré au 11 septembre et, plus largement, à la question du Mal. Il va de soi que j'ai laissé, comme toujours d'ailleurs lorsque je lui demande d'écrire pour la Zone, une entière liberté de ton à mon ami. Le moins que l'on puisse dire, dès lors, est qu'il a su en user !
Voici l'article (sous-titré : Exégèse d'un non-sens (presque) commun) rédigé par Francis Moury sur le livre polyphonique dirigé par Gilles Grelet (Théorie-rébellion. Un ultimatum, L’Harmattan, coll. Nous, les sans-philosophies, septembre 2005) auquel j'ai bien modestement participé, sous la forme d'un texte, publié dans la Zone il y a bien des mois, consacré au 11 septembre et, plus largement, à la question du Mal. Il va de soi que j'ai laissé, comme toujours d'ailleurs lorsque je lui demande d'écrire pour la Zone, une entière liberté de ton à mon ami. Le moins que l'on puisse dire, dès lors, est qu'il a su en user !Bonne lecture de ce texte sans concessions auquel Gilles Grelet ou n'importe lequel des contributeurs de cet ouvrage (dont certains membres de l'ONPhi) pourra répondre, ici même, puisque je m'engage à publier ladite critique de la critique.
I - RAPPEL SPECTRAL DU SENS DE LA PHILOSOPHIE
«Il est de tradition, et pas seulement en philosophie, d’opposer la vérité aux nombreuses opinions, la réalité aux diverses apparences, l’objectivité aux impressions fugitives.»
Ch. Perelman, Opinions et vérité in Les Études philosophiques, Nouvelle série dirigée par Gaston Berger, quatorzième année, N°2, La vérité (P.U.F., avril-juin 1959), p. 131.
«Nous ne pensons pas encore de façon assez décisive l’essence de l’agir. On ne connaît l’agir que comme la production d’un effet dont la réalité est appréciée suivant l’utilité qu’il offre. Mais l’essence de l’agir est l’accomplir. Accomplir signifie : déployer une chose dans la plénitude de son essence, atteindre à cette plénitude, producere. Ne peut donc être accompli proprement que ce qui est déjà.»
Martin Heidegger, Lettre sur l’humanisme [suivie d’une seconde lettre également adressée à Jean Beaufret], texte établi et traduit par Roger Munier (nouvelle éd. bilingue revue Aubier-Montaigne, 1964 (réimpression, 1977)), pp. 27-185.
«Platon ne cesse de nous transmettre, ne saurait nous faire oublier l’originalité de l’opinion: inhérente à notre condition empirique elle est par-là même déchue; mais en même temps, elle a comme une priorité sur la science, non point essentielle (ni en valeur, ni par nature l’opinion n’égale la science) mais existentielle : si l’être ne nous apparaissait pas originellement dispersé et comme réfracté dans l’extériorité indéterminée de la «Chôra» aurions-nous besoin de le récupérer par la science ? […] Marque de notre condition, elle est aussi le principe initial de son dépassement.»
J.F. Chaumeil, La doctrine de l’opinion vraie selon Platon, sous la direction de M. le professeur Joseph Moreau, exemplaire relié souple, dactylographié + manuscrit pour les termes grecs (Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Bordeaux, s.d. mais terminus a quo 1967 assurément), p. 110.
«[…] H. Gouhier, partisan de l’attention portée à l’individualité de la mise en forme d’un problème métaphysique, rend une philosophie inséparable de son cheminement historique et personnel. M. Guéroult recherche dans toute philosophie authentique l’adéquation d’une intuition séminale originelle et de son actualisation dans un système strictement architecturé. F. Alquié, écartant la menace d’une double réduction à l’origine individuelle ou à l’impersonnalité du système privé de ses conditions d’élaboration, définit une méthode qui part à la recherche de l’intuition propre au système et des servitudes philosophiques qu’il lui faut observer, et qui tiennent à la pérennité de certaines déterminations conceptuelles qui détiennent une vie indépendante des systèmes où elles ont pu figurer.»
Marie-Hélène Gauthier-Muzellec, Aristote et les commencements de la Métaphysique (Métaphysique A2) : méthode dialectique et paradigme méthodologique, in Les Études philosophiques, 71ème année, N°3, Philosophie ancienne (éd. P.U.F., juillet-septembre 1997), p. 321.
II - CRITIQUE DE LA RÉBELLION DES «SANS-PHILOSOPHIES»
A) PRÉSENTATION
Ironie de l’histoire : en septembre 2001, certains voulaient tuer une culture; en septembre 2005 certains autres proposent de tuer la culture et osent fièrement convier à ce sombre projet des contributeurs. Le XXIe siècle commence mal, décidément. Que cela nous motive à résister à cette décadence barbare avec toujours plus de détermination : c’est le bon côté de la chose. Après tout, nous aussi, nous appartenons dorénavant à ce siècle même si ce sont les précédents qui nous ont formé. Notre noble tâche est donc de défendre leur acquis contre ceux qui veulent les détruire. Ils veulent détruire la civilisation occidentale : nous voulons la maintenir. Les siècles suivants se souviendront de nos efforts méritants, nous l’espérons.
Venons-en au livre lui-même. Sa présentation esthétique, son titre, celui du nom la collection à laquelle il appartient, enfin son résumé en quatrième de couverture ne laissaient pas de nous inquiéter : on a vérifié les raisons qu’on avait de l’être.
Grelet est un disciple de François Laruelle, Principes de non-philosophie (1996) et un certain nombre de contributions réunies dans ce livre se revendiquent de la même source. Grelet a demandé à une quarantaine d’auteurs très variés un article n’excédant pas trois pages, donc forcément dense, pouvant s’insérer dans ce livre qui est en somme une tentative multidisciplinaire d’application concrète. Les 42 fiches bio-bibliographiques présentées en fin de volume ne précisent pas les dates de naissance des auteurs mais donnent une bonne idée de la variété de l’ensemble : philosophes, sociologues, géographes, écrivains et poètes, artistes, psychologues de générations diverses s’y croisent.
On peut distinguer trois catégories de contributions :
* Sur ces 42 textes que nous venons d’achever en cette nuit momentanément bruyante du 31 décembre 2005, disons tout de suite que cinq textes seulement trouvent entièrement grâce à nos yeux et à notre intellect, d’un point de vue strictement philosophique.
** Certains autres sont intéressants partiellement puis s’effondrent ou se brisent brusquement : par exemple celui sur la philosophie brésilienne (qui n’évoque pas un instant la devise positiviste comtienne «Ordem y progresso» pourtant inscrite sur son drapeau national : il faut tout de même le faire !) ou celui sur la philosophie de la culture nous ont laissé cette impression.
*** Enfin le restant se revendique du néo-structuralisme, du néo-marxisme, de l’anarchisme stirnérien, voire du féminisme ! On cite comme d’habitude avec emphase certains philosophes allemands mineurs contemporains, les Français Lacan, Foucault, Deleuze, Derrida, et quelques illustres inconnus récents qui sont écologistes, géographes ou économistes : ces trois disciplines sont à la mode, on dirait. On cite aussi quelques penseurs de la science comme René Thom ou Michel Serres (qui avait fait capoter, selon Pierre Boutang qui nous l’avait confié oralement en 1983, le projet d’édition par Pierre Arnaud des œuvres d’Auguste Comte à la Pléiade pour pouvoir imposer sa propre édition annotée mais discutable du Cours de philosophie positive chez Hermann) et quelques logiciens classiques du siècle dernier. Un poète aussi écrit un poème : bien écrit d’ailleurs mais la poésie philosophique commence avec Le Poème de Parménide (cf. sa présentation-traduction publiée par Jean Beaufret dans la collection Épiméthée dirigée par Jean Hyppolite aux P.U.F., 1955) et celui-ci ne soutient pas la comparaison conceptuelle avec son aîné. À gratter ce joli vernis, on n’atteint pourtant que rarement une véritable culture philosophique riche de son histoire. «Vers le concret» comme disait ce pauvre Jean Wahl qui doit se retourner dans sa tombe de temps en temps. Il faut dire qu’une des contributions se permet de critiquer en une phrase L’Être et le Néant de Sartre – à ce niveau de désinvolture, tout est permis, n’est-ce pas ? – auquel nous pensons parce qu’il avait dit son admiration pour ce titre précis de Wahl mais son mépris pour le contenu proposé, dans le beau documentaire cinématographique Sartre par lui-même filmé par Alexandre Astruc et Michel Contat de 1972 à 1976.
B) CRITIQUE DES CONTRIBUTIONS ESSENTIELLES (POSITIVES COMME NÉGATIVES)
Nous critiquons les textes sélectionnés parmi les trois catégories décrites ci-dessus en les replaçant dans l’ordre de lecture, donc dans l’ordre où ils apparaissent au sein du volume. Cette méthode respecte la variété de l’ensemble et en donne une honnête idée.
§ 1.1.2 (p. 18) : Infréquentable [texte repris sur ce blog sous le titre De l'horreur dénudée] de Juan Asensio
Il se trouve que notre ami Juan est le premier chronologiquement mais il se trouve aussi qu’on y a retrouvé des morceaux (sinon la totalité ? Peut-être, de mémoire...) parus vers 2004 nous semble-t-il sur le Stalker qui nous avaient déjà frappé par leur justesse lors de leur première lecture. L’ironie est que Juan est l’un des rares, sinon même le seul, à défendre par sa contribution l’idée d’ontologie (science maîtresse parmi les sciences métaphysiques, comme on sait) et à expliquer qu’il a voulu constituer une ontologie du mal qui n’a pas trouvé réception cordiale chez la plupart des philosophes qui furent ses lecteurs. Ceux-là étaient-ils des «sans-philosophie» greletiens ? Cela nous paraîtrait après-coup plausible mais le paradoxe est que ce sont eux qui publient sa défense d’une ontologie du mal alors qu’ils crachent cordialement sur la métaphysique et l’ontologie, l’idée de vérité, l’idée de morale et de mal aussi en général. Savoureux tout de même ! Juan se plaint que des philosophes (qui n’en sont pas, on le rassure) n’aient pas aimé sa démarche pourtant authentiquement philosophique : il a raison de s’en plaindre. Vouloir tenter de dire la réalité du mal (à l’occasion du «9/11») en visant à une ontologie du mal est un projet authentiquement philosophique, riche et pas seulement réussi par l’art ou la littérature. Vouloir viser un réel (une partie du réel) par la raison est un projet philosophique. Il n’y en a, d’ailleurs, jamais eu d’autre ! Juan traite le sujet greletien là où «ça» fait «mal» justement : en son noyau de négation de l’idée même de philosophie. On félicite cependant Grelet d’avoir publié ce texte qui est un cinglant désaveu de sa propre thèse centrale.
§ 1.2 (p. 22) : Un papier pour les sans-philosophies de Laurent Carraz
C’est un cas d’espèce : l’auteur manifeste une bonne connaissance de l’histoire de la philosophie, convient que l’appel lancé par Laruelle et Grelet est peut-être triste mais s’y rallie explicitement en méprisant ouvertement les plus grands philosophes tout de même. On n’y croit qu’à moitié et… c’est bien écrit : ressaisissez-vous M. Carraz ! Ne vous laissez pas charmer par le chant des sirènes de 1996 (date des Principes de non-philosophie de François Laruelle). Vous valez mieux que ça visiblement !
§ 1.2.2 (p. 28) : Rébellion de non-philosophie de Jean-Pierre Faye
Faye est un spécialiste de Nietzsche qui n’aime pas l’interprétation heideggérienne de Nietzsche. C’est son droit et ce n’est pas pour ça, évidemment, qu’il faut se passer de la connaître ni de la méditer. Il ressort donc ici les vieux journaux : on avait pourtant déjà lu son article Heidegger, le «trou noir» et le futur paru dans Le Monde du 25 mars 1988. Faye y surfait sur le succès mérité du célèbre livre de Victor Farias, publié en 1987 aux éd. Verdier. Sa contribution à charge était intéressante mais il la résume ici d’une manière encore plus succincte et agressive donc encore moins pertinente. Suivez donc le guide Faye au musée des horreurs de la philosophie : 1) Heidegger était national-socialiste. 2) Heidegger est l’héritier de l’histoire de la philosophie occidentale. 3) Donc mort à la philosophie occidentale à cause de Heidegger ! La visite était courte, moins drôle et pertinente que celle visible dans le savoureux et désormais classique film fantastique Horrors of the Black Museum [Crimes au musée des horreurs] (G.B., 1958) d’Arthur Crabtree. C’est entendu : Heidegger fut la matière du dernier vrai, grand, authentique débat philosophique et d’histoire de la philosophie du XXe siècle. On l’a, pour notre part, vécu en temps réel et passionné, ce débat. On a lu Farias, lu les articles dessus, lu les comptes rendus des livres-procureurs (Bourdieu par exemple, lamentable comme d’habitude), des livres-défenseurs (François Fédier, par exemple) que celui de Farias a suscités. L’histoire remonte aux attaques contre Jean Beaufret, aux Temps modernes d’après-guerre et même antérieurement encore : elle est parallèle aux deux derniers tiers du XXe siècle, pour tout vous dire. Mais enfin ce n’est pas en une demi-page écrite en septembre 2005 qu’on va revenir là-dessus correctement non plus. Et encore moins de cette manière péremptoire, presque délirante.
Faye accuse en outre la philosophie antique grecque d’avoir été misogyne : on s’en balance comme de notre première chemise, que la philosophie antique soit misogyne ou pas. C’est le cadet de nos soucis, on vous le dit franchement ! Ah ! Autre chose : le parallèle entre «l’effet Goering-Guernica» et la guerre en Irak ! Un peu court aussi, celui-là… Une guerre fait des morts : quel scandale ! On tue des gens sur Terre pour des motifs religieux, et même… moraux ou philosophiques. Eh bien : quelle nouvelle ! On ignorait tout ça : vous aussi ? Et c’est pour ces raisons qu’il faut nier l’histoire de la philosophie, la noblesse des génies de l’humanité ! Ce n’était tout de même pas la peine de lire Nietzsche toute sa vie comme Faye l’a fait pour en arriver là, même pendant un instant d’humeur qu’on suppose évidemment bien noire.
§ 2.1 (p. 32) : La privation se dit de façon multiple de Jacques Colette
Le titre de Colette est une allusion que seuls ceux qui sont familiers de la philosophie aristotélicienne comprendront, notamment les lecteurs de Heidegger et Pierre Aubenque. Mais citant Platon et Kant aussi pertinemment qu’Aristote, Colette répond simplement par une affirmation négative ou une négation gentiment affirmative, tranquille et mesurée à la crétinerie initiale de l’entreprise : nier la philosophie c’est déjà en faire, nolens volens, donc l’admirer nolens volens aussi, donc l’aimer nolens volens derechef. Et certains en font qui croient n’en pas faire. Et certains pensent qui n’en font pas profession quand d’autres dont c’est pourtant la profession scient l’arbre qu’ils devraient cultiver. Alain et bien d’autres avant lui l’ont vu, pensé et dit et écrit. Il fallait tranquillement le répéter.
On va le dire franchement comme Colette n’a pas osé le dire pour que les choses soient bien claires: prétendre nier la philosophie comme résultat d’une histoire de la philosophie, prétendre «faire tomber l’arbre lui-même» (quatrième de couverture) et lui substituer une pensée neuve, vierge qui la remplacerait est une entreprise barbare par essence, ignare par vocation comme par origine. Vous voulez penser par vous-mêmes, messieurs les «sans-philosophie» ? Commencez par savoir puis comprendre puis méditer puis commenter ce qu’ont pensé vos prédécesseurs ! Respectez-les comme des maîtres indistinctement – la tradition vous le commande de toute manière, la science aussi : nulle philosophie en dehors de l’histoire de la philosophie ! – et ensuite seulement tentez de vous élever à leur cheville avant de trop (on allait écrire «l’ouvrir») parler/écrire/éructer de telles insanités !
§ 3 (p. 45) : Entre sophistes et sages de Gilbert Kieffer
Ça commence mal : on nous cite Lévi-Strauss (quand finira-t-on de nous fatiguer les oreilles avec ce sinistre sophiste : qui va enfin reconsidérer la pauvreté insigne de son Le Totémisme aujourd’hui ? Dès les années 1950, on savait que Lévi-Strauss était un pauvre d’esprit : il ne faut pas se lasser de le répéter), Derrida et même un brave Milton Erickson dont le prénom fait penser à un garde du corps de Malko Linge ou à celui de l’économiste en chef de l’École de Chicago et dont nous n’avons jamais entendu parler de toute notre vie, au demeurant ! Kieffer emploie aussi une abréviation qu’on n’a pas comprise : «PNL». Quid ? Ensuite les choses se clarifient, se simplifient : deux attitudes possibles. La vie ou la raison. Air connu mais profond : opposition riche. Ne date pas d’hier bien sûr. Kieffer n’invente rien : il cite Saint-Exupéry et Quand dire, c’est faire [How to do things with words] d’Austin.
Cette dernière citation évoque un beau souvenir : notre jeunesse agrégative à Paris-IV. Inutile de vous dire qu’avec les correcteurs mitterrandiens mi-socialistes mi-communistes qu’on avait en 1983, on était quasiment certain de ne pas être davantage agrégé en 1983 que normalien en 1981 ! À un an près, ça n’eût rien changé d’ailleurs, en ce qui concerne l’agrégation : le ver marxiste-structuraliste-socialiste était dans le fruit depuis l’après-guerre, pleinement installé et infiltré dès 1955 au sein même de l’administration scolaire française. Il fallait bien le vérifier tout de même : notre aspect empiriste et pragmatique anglo-saxon et indo-européen nous le commandait. On a même voulu le re-vérifier en 1998 à Paris-I : même cause, même effet ! Les boules de billard de David Hume, comme si on y était ! Pas un secret de toute manière, la manière dont on recrute les professeurs dans ce pays ! «Aurea mediocritas» + «conformisme» + «absence de culture» (les professeurs ne veulent pas d’élèves professeurs cultivés, ils veulent juste des élèves-professeurs : la culture est leur ennemi intime puisqu’on peut se le procurer sans eux) + «obédience politique au pouvoir en place» ou «piston familial» ou «absence d’opinion politique» pour cause de vocation de fonctionnaire juvénile. Au choix.
Notre meilleur souvenir de ce point de vue sociologique : un jeune hom
27/01/2006 | Lien permanent
Surréalisme et réalisme dans le nouveau triptyque d’Alexandre Mathis, par Francis Moury

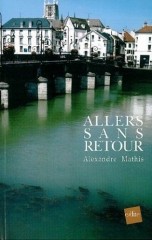 À propos de : Alexandre Mathis, Allers sans retour, roman-montage en deux volets : Le coup de folie de Roger Verdière et La mort mystérieuse d’Andrée Denis (éditions E-dite, novembre 2009).
À propos de : Alexandre Mathis, Allers sans retour, roman-montage en deux volets : Le coup de folie de Roger Verdière et La mort mystérieuse d’Andrée Denis (éditions E-dite, novembre 2009).Acheter cet ouvrage sur Amazon.
Présentation de l'éditeur
Allers sans retour est inspiré par deux faits divers. À Caudebec, près de Rouen, Roger Verdière, 18 ans, tue une sexagénaire pour la voler, afin de pouvoir aller au cinéma. Descendu à Paris, il passe le plus clair de son temps dans les salles obscures. Escapade de la durée d'un bal, dans les rues glacées de la butte Montmartre. Arrêté à la lisière de la jungle montmartroise, presque devant un de ces cinémas où il avait l'habitude d'aller, il est condamné à mort en 1939, à la veille de l'entrée en scène de l'armée allemande. Le lendemain du vendredi saint, à l'aube, Andrée Denis, une Parisienne de 17 ans, est retrouvée debout dans la Marne, tête émergeant de l'eau. Quelques heures avant, elle serait allée au cinéma, à Meaux, où elle ne connaissait personne. C'est ce que conclut une enquête rapide, à l'aide d'un billet de cinéma, au numéro irréaliste, optant, au bout de deux jours, pour un suicide dépourvu de tout mobile, et bien que personne ne vît la jeune fille au Majestic, et personne ne saura ce qu'elle était allée faire à Meaux. L'affaire n'aura pas de suite judiciaire. Une histoire survenue en 1936, à l'aube du Front populaire. Noyade qui pourrait rappeler celle de Mary Rogers, autre banal fait divers, qui avait inspiré à Edgar Poe Le Mystère de Marie Roget, jamais clairement éclairci. Différence de taille avec la mort de Marie Roget, personne n'a vu Andrée Denis, vivante, à Meaux. Deux allers sans retour... sur fond de cinéma.
Edgar Allan Poe, Ombre [1833], in Nouvelles histoires extraordinaires (Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, trad. Charles Baudelaire, éd. établie et annotée par Y.-G. Le Dantec, 1951-1979), p. 477.
«Mais les ténèbres sont elles-même des toiles
Où vivent, jaillissant de mon œil par milliers,
Des êtres disparus aux regards familiers.»
Charles Baudelaire, Obsession [ca 1860], in Les Fleurs du mal, Spleen et idéal (éd. illustrée Classiques Garnier, établie par Antoine Adam, 1961), p. 82.
«Jean Péloueyre ouvrit le livre de Nietzsche à une autre page; il dévora l’aphorisme 260 de Par delà le bien et le mal, – qui a trait aux deux morales, celle des maîtres et celle des esclaves. Il regardait sa face que le soleil brûlait sans qu’elle en parût moins jaune, répétait les mots de Nietzsche, se pénétrait de leur sens, les entendait gronder en lui, comme un grand vent d’octobre. Un instant, il crut voir à ses pieds, pareille à un chêne déraciné, sa Foi. Sa Foi n’était-elle pas là, gisante, dans ce torride jour ? […] Il était de ces esclaves que Nietzsche dénonce; il en discernait en lui la mine basse; il portait sur sa face une condamnation inéluctable; tout son être était construit pour la défaite, comme son père, d’ailleurs, comme son père, dévot lui aussi mais mieux que Jean instruit dans la théologie, et naguère encore lecteur patient de saint Augustin et de saint Thomas d’Aquin.»
François Mauriac, Le Baiser aux lépreux et Génitrix (éd. Oxford University Press conforme au texte des éditions originales Bernard Grasset parues en 1922 et 1923, Clarendon French Series, edited with an introduction and notes by R. A. Escoffey, London, 1970), pp. 50-51.
«Pendant que les aides-bourreaux, dans l’aube grelottante de Baudelaire, calaient, à l’aide du niveau d’eau, la grêle machine de mort, un merle, excité par la lumière des lanternes, se mit à pousser un chant magnifique, surnaturel, exalté, beethovenien. Il apparaissait en noir sur le fond du ciel, encore violet, comme le corbeau dessiné par Manet pour le poème de Poe. Si Edgar Poe lui-même avait été là, cette telle nuit, avec ses rythmes sublimes dans la tête et ses trois verres de gin dans le nez, il eût conçu un nouveau poème, aussi beau que The Raven et Ulalume sur ce deuxième «fatidique oiseau».»
Léon Daudet, Paris vécu, Deuxième série : Rive gauche, Du quartier latin à la Santé (quatorzième édition, Gallimard, coll. N.R.F., 1930), p. 82.
«Kafka me cita une phrase de Hoffmannsthal : «L’odeur de la pierre humide dans un vestibule.» Et il se tut longtemps, n’ajouta rien, comme si cette modeste impression de la vie familière devait parler d’elle-même. Cela me fit une si profonde impression que je sais encore aujourd’hui la rue et la maison devant laquelle nous nous entretenions. Il est beaucoup de lecteurs qui croient trouver dans les œuvres de Kafka des affinités avec celles où sont représentés «les côtés nocturnes de la vie», celles de Poe, de Kubin, de Baudelaire. Il pourra leur apparaître surprenant que mon ami m’ait précisément ramené à la simplicité et au naturel, qu’il ait peu à peu arraché mon esprit à la confusion et à la corruption où il était plongé, et qu’il l’ait dégagé de cette puérile présomption dont était empreinte ma fausse désinvolture.»
Max Brod, Franz Kafka – Souvenirs et documents (traduction de l’allemand par Hélène Zylberberg, Gallimard, coll. N.R.F. - Leurs figures, 1945), p. 59.
 Révélé par une trilogie romanesque parisienne alliant surnaturalisme et réalisme (Maryan Lamour dans le béton, Les Condors de Montfaucon, Chambre de bonnes – Le Succube du Temple) dont la singularité d’écriture lui méritait d’être comparé par les meilleurs critiques à Joyce et Céline, pour ne citer que deux de ses influences les plus évidentes, voici que paraissent, à un mois d’intervalle à peine, les deux premiers volumes d’une nouvelle trilogie, définie explicitement comme un second triptyque, tournant autour des pulsions autopunitives : Allers sans retour, inspiré par deux étranges affaires criminelles survenues en France en 1936 (la mort d’une jeune parisienne de 17 ans retrouvée, telle Ophélie chez Shakespeare, debout et à demi-nue dans la Marne : l’affaire sera classée, jamais élucidée) et 1939 (le jeune Verdière, 18 ans et vivant près de Rouen, assassine sa voisine rentière puis part à Montmartre où il passe les derniers jours avant son arrestation à visionner des films dans tous les cinémas de Clichy, Pigalle et Rochechouart), Edgar Poe dernières heures mornes relatant ce que furent peut-être les dernières heures du poète avant sa mort sur laquelle plane encore aujourd’hui un mystère. Le troisième volume enfin, pas encore paru mais dont le titre est déjà déterminé et annoncé dans les œuvres de Mathis à venir, sera consacré à l’histoire de Georges Rapin (un criminel qui fut guillotiné en 1960), sous le titre de M. Bill, R.N. 11.
Révélé par une trilogie romanesque parisienne alliant surnaturalisme et réalisme (Maryan Lamour dans le béton, Les Condors de Montfaucon, Chambre de bonnes – Le Succube du Temple) dont la singularité d’écriture lui méritait d’être comparé par les meilleurs critiques à Joyce et Céline, pour ne citer que deux de ses influences les plus évidentes, voici que paraissent, à un mois d’intervalle à peine, les deux premiers volumes d’une nouvelle trilogie, définie explicitement comme un second triptyque, tournant autour des pulsions autopunitives : Allers sans retour, inspiré par deux étranges affaires criminelles survenues en France en 1936 (la mort d’une jeune parisienne de 17 ans retrouvée, telle Ophélie chez Shakespeare, debout et à demi-nue dans la Marne : l’affaire sera classée, jamais élucidée) et 1939 (le jeune Verdière, 18 ans et vivant près de Rouen, assassine sa voisine rentière puis part à Montmartre où il passe les derniers jours avant son arrestation à visionner des films dans tous les cinémas de Clichy, Pigalle et Rochechouart), Edgar Poe dernières heures mornes relatant ce que furent peut-être les dernières heures du poète avant sa mort sur laquelle plane encore aujourd’hui un mystère. Le troisième volume enfin, pas encore paru mais dont le titre est déjà déterminé et annoncé dans les œuvres de Mathis à venir, sera consacré à l’histoire de Georges Rapin (un criminel qui fut guillotiné en 1960), sous le titre de M. Bill, R.N. 11.Bien qu'Edgar Poe dernières heures mornes et Allers sans retour aient tous deux été imprimés en septembre 2009, et bien que le premier ouvrage ait été déposé légalement en octobre 2009, alors que Allers sans retour l’a été en novembre 2009, on peut cependant considérer ce dernier livre comme le premier volume de ce triptyque, ne serait-ce que par l’ampleur romanesque et le nombre de pages : 555 pages alors qu'Edgar Poe dernières heures mornes n’en compte que 250 environs dont 30 pages de notes en polices de caractères très petites qui, imprimées en caractères de taille identique à ceux du premier volume, augmenteraient notablement, il est vrai, son volume paginé. Pourtant cet ordre n’est pas l’ordre chronologique de composition. Edgar Poe dernières heures mornes a été achevé le 17 octobre 2004 (1) alors qu'Allers sans retour a été rédigé en 2005 et 2006. À vrai dire, l’auteur lui-même se plaît, dans un courriel qu’il nous adresse, à brouiller les pistes que l’éditeur trace en quatrième de couverture : on peut placer l’histoire des dernières heures de Poe, celle des derniers jours de Roger Verdière, celle d’Andrée Denis, celle de M. Bill alias Georges Rapin sous le signe de Poe en raison de l’intérêt de ce dernier pour les criminels par sentiment préalable de culpabilité, pour le démon de la perversité autopunitive qui est fiévreusement analysé dans des contes tels que Le Chat noir ou Le Démon de la perversité. Mais ce n’est pour autant une «trilogie Poe». Elle n’a pas vraiment d’ordre non plus : on peut commencer indifféremment par un des trois livres (les deux parus ou le troisième à paraître), et poursuivre par les deux autres. Cela dit, si on veut suivre l’ordre historique réel des sujets, on peut commencer par Edgar Poe dernières heures mornes. Si on veut suivre l’ordre de l’éditeur, on peut commencer par Allers sans retour. On retombera, de toute manière, toujours sur son noyau central qui est aussi bien l’analyse par Freud des criminels par sentiment de culpabilité, dont un extrait est cité en exergue, parmi d’autres textes très brillants (écrits par des penseurs et des écrivains aussi divers que le psychologue Pierre Janet, le surréaliste André Breton, le philosophe Nietzsche) qui éclairent chacun d’une étrange lueur les enquêtes et les histoires – régulièrement commentées par l’auteur qui est actif durant chacun des deux récits, en notes ou dans le corps du texte, davantage dans la seconde partie que dans la première partie qui a un aspect fictif plus classique et d’une certaine manière plus intense aussi, doté de davantage de suspense) –, provenant de cette même pulsion incoercible, enchâssée dans un réalisme impressionnant.
Allers sans retour est placé sous le signe simultané du réalisme le plus méticuleux et du surréalisme le plus puissant. Son écriture est incomparablement plus aisée, simple, fluide que celle de la trilogie parisienne antérieure.
C’est aussi que durant toute la première partie consacrée au Coup de folie de Roger Verdière, on adopte son point de vue, celui d’un jeune homme de 18 ans qui est certes un criminel mais qui demeure un homme encore relativement innocent, fonctionnant par succession d’impressions, de perceptions qui ne forment jamais de courants de conscience excessivement emberlificotés. Nous voyons par ses yeux, nous pensons par son cerveau et de temps en temps, l’auteur commente telle pensée de Roger, tel fait observé par Roger. Mais le temps narratif des 300 premières pages de cette première partie est ici supérieurement traité en ce qu’il restitue tout l’univers mental, social, moral, esthétique, poétique de la France de 1938 en une période temporelle brève et précise qui va du 17 novembre 1938 au 31 décembre 1938. Le suspense est constant d’une page à l’autre, jusqu’à l’arrestation. Il rebondit ensuite car l’affaire Verdière est mise en perspective par Mathis, mise en relation aussi avec d’autres affaires, parallèles, connexes, voisines ou apparemment sans rapport mais participant pourtant du même univers, au même moment. Mathis recréé la solidarité ontologique du monde à travers la conscience marginale, fruste, de ce jeune homme. De janvier 1939 à août 1939, un nouveau suspense s’installe, levé in extremis. Il est nourri par la même technique, révélant des pans ahurissants d’inconscient individuel ou collectif : les faits divers rédigés par Francis Rico (Francis Carco ?) et recopiés par Mathis valent leur pesant d’or ! La lettre reçue par Céline après la parution de L’École des cadavres et l’article admirable intitulé Louis-Ferdinand Céline ou le Démon de la Pureté écrit par Marcel Sauvage, paru dans L’Intransigeant du 23 décembre 1938 aussi ! Le sommet de la première section d’Allers sans retour, ce ne sont pas les scènes d’action pure telle que la fuite de Roger lors d’une rafle près de la Place Clichy, décrite d’une manière pointilliste si fine qu’elle force l’admiration et l’identification, rafle qui s’achève par un rendez-vous manqué où il assiste à un meurtre. Ce sont au contraire les scènes contemplatives : celles des séances de projection des films, vus à travers le prisme de la sensibilité innocente, neutre, désirante pure, de Verdière qui reçoit chaque nouveau film comme un être réel, une découverte, une ouverture au monde en marge duquel il n’a pas encore absolument conscience de s’être mis. Évasion au double sens du terme : telle est l'odyssée de la conscience (2) de Verdière suivie presque heure par heure, mètre par mètre, par Mathis durant le temps qui précède son arrestation.
On n’oublie pas, ainsi, la projection de La Habanera (All., 1937) de Detlef Sierck (futur Douglas Sirk) – l’un des films préférés des Surréalistes ! – où il apprécie la description démentiellement littéraire de la neige – des larmes versées par les anges sur les hommes ! – faite par la sublime Zarah Leander à l’attention de son fils, ni celle de Les Dieux du Stade, qui produit sur Roger une impression viscérale. On n’oublie pas non plus celles, remises en situation, de Les Disparus de Saint-Agil ou de Police mondaine. Roger passe à un moment devant un cinéma dont la caissière semble être un fantôme et qui programme trois films fantastiques américains de James Whale : The Old Dark House (1932), L’Homme invisible (1933) et La Fiancée de Frankenstein (1935). Roger semble passer à côté du Styx symbolisant à la fois l’ancienne rivière des Grecs et le futur cinéma des années 1970 spécialisé dans le fantastique qui portera ce nom. Le Styx, le Colorado ou le Mexico, le Brady n’existent pas encore : leurs ancêtres sont déjà là et se nomment Gaité-Rochechouart, Delta, Studio 28, Clichy-Palace.
La seconde partie d’Allers sans retour consacrée à La mort mystérieuse d’Andrée Denis, est très étonnante par la volonté obsédante d’enquêter sur un fait au sujet duquel l’investigation se révèle in fine presque impossible alors qu’elle aurait dû avoir lieu : l’affaire avait été classée. Mathis se retrouve alors dans la situation de Dupin, le détective d’Edgar Poe, lorsqu’il enquête (deux ans après son éclaircissement du Double assassinat dans la rue Morgue) sur Le Mystère de Marie Roget, assez similaire à celui qui entoure la mort strictement véridique d’Andrée Denis, mystère qui constitue la première des Histoires grotesques et sérieuses. Accident, crime ou suicide ? On se souvient que Georges Bernanos faisait poser cette question à un journal en guise de conclusion à Un Crime en 1929. De fait, qui peut se targuer de jamais savoir la vérité ? Qui peut être certain de ne pas voir un jour sa vision du monde modifiée ? Le solide, concret, déterminé et rigide Léon Daudet emprisonné à la Santé (à côté de ceux qu’il nomme, et que tous nommaient, les «mains rouges») à l’âge de soixante ans, moralement décontenancé par l’assassinat irrésolu de son jeune fils Philippe, comprend brusquement que rien n’est simple : la manière dont il décrit la guillotine, ses préparatifs, sa mise en scène, à partir d’un souvenir identique, n’est plus tout à fait la même entre l’article qu’il donnait à L’Action française et qui est cité dans Allers sans retour, et le chapitre que Daudet lui consacre ensuite dans son mémorable Paris vécu.
Des pages 385 à 555, Mathis traque obstinément le moindre indice, refait les parcours possibles d’Andrée Denis, à partir d’une stricte analyse du réel de l’époque, et il arrive à nous faire éprouver une mauvaise conscience proche de celle du sentiment obsédant de culpabilité qui accable les héros criminels de Poe.
Si c’est un suicide, nos ancêtres de 1936 en furent obscurément responsables, comme c’est au fond le cas de chaque suicide. Comme disait, il me semble, l’écrivain Éric Orsenna, «À chaque fois qu’un de nos amis se suicide, nous nous posons la question : quel fut le cri que je n’ai pas su entendre ?».
Si c’est un meurtre, notre police est responsable de l’impunité du criminel, peut-être protégé à l’époque par sa situation, auquel cas ce sont les politiques qui en seraient responsables.
Si c’est un accident, de quelle obscure fatalité poursuivant la race humaine peut-il bien être la conséquence ?
Fatalité renvoyant à Poe – Poe dont Andrée lit, sans aucun doute possible, Double assassinat dans la rue Morgue tandis qu’elle se trouve dans un autobus ou dans le métro ! – et, par-delà Poe, à Shakespeare, et aux Tragiques grecs. Macbeth est cité en exergue dans une des pages de l’histoire de Verdière, et Hamlet l’est aussi dans une des pages de l’histoire de Andrée Denis.
Il reste enfin de La Mort mystérieuse d’Andrée Denis l’obsédante idée d’un portrait en creux, d’un absent insigne : le possible criminel peut-être coupable de la mort – ou responsable du suicide – d’une innocente. Absence-présence fantastique, en raison de la précision terrible qui imprègne le moindre indice concret, le moindre paysage contemporain ayant eu un lien avec l’affaire. Films, livres, publicités, rues, plans de métro, courrier administratif, articles de journaux (l’ahurissant, hallucinant article d’information écrit en forme de conte fantastique à la manière de Hanns Heinz Ewers ou de E. T. A. Hoffmann sur Sombre Dimanche, «la chanson qui tue» à Budapest en
15/12/2009 | Lien permanent

























































