« Fin de partie : TOUT VA BIEN | Page d'accueil | Consensuel ad nauseam : sur Immortel d'Enki Bilal »
05/04/2004
La revue Cancer ! est-elle immortelle ?
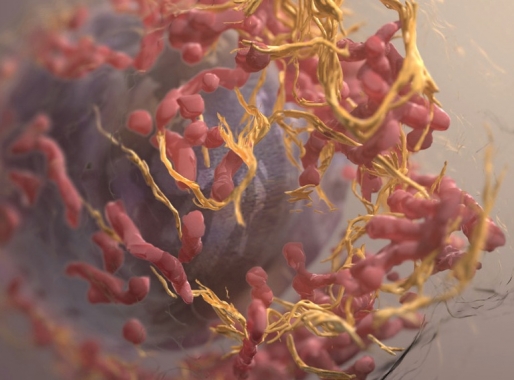
Mauvaise soirée hier, commencée en perdant deux heures devant le film le plus incroyablement nul de ces trente dernières années (j'ai sans doute eu tort de ne pas écrire demi-siècle...), Immortel de Bilal. Histoire ridicule et pontifiante, bien loin de la noirceur des albums du dessinateur, musique inepte et happy end grossier, effets spéciaux à la limite de la simple correction due au public me font penser qu’il faudrait pouvoir jeter un film aussi dramatiquement insignifiant et lorgnant vers la grosse caisse américaine (qui elle au moins ne lèse pas le spectateur et lui donne ce qu’il demande veulement : des images, de belles images…) à la poubelle, comme tout lecteur a le droit (le devoir) de jeter aux ordures un bouquin de Nothomb ou d’Angot. Hélas, ce n’est pas le cas et j’ai dû en plus constater que mon début de soirée, malencontreusement commencée, allait toutefois se poursuivre un peu moins piteusement avec la lecture du dernier numéro de Cancer !.
Allez, pour donner quelques cornichons à grignoter aux spécialistes des relations entre jeunes gens de lettres, je poursuis ma lecture critique du cancérigène numéro consacré en grande partie à la bien nommée affaire Dantec, comme on dit qu’il y a une affaire Seznec, le romancier ayant peut-être, en effet, été condamné lui aussi aux travaux forcés, d’une façon moins métaphorique qu’il n’y paraît. L’enfer de Dantec, sûrement moins innocent que le pauvre diable Seznec puisqu’il est, lui, écrivain, ne sera ni vert ni luxuriant mais gris, fuligineux comme l’était la vague et insignifiante zone dans laquelle Marlow, parti chercher aux Enfers le damné Kurtz, sombra avant de revenir à la lumière. Je doute aussi que quelque noble âme vienne le chercher lorsque Dantec s’enfoncera plus avant…
Sur ce dossier justement, je dois d’abord dire que l’intervention du conspué (à juste titre) Lindenberg n’est pas totalement dénuée d’intérêt, elle qui demande que soit étudiée l’œuvre de Dantec avec attention. Il est vrai que considérer le romancier Dantec pour autre chose qu’un clochard aviné ou, comme l’écrit Zagdanski, un «inépuisable plouc au cerveau vérolé par tant de rebuts science-fictifs», n’est pas à la portée du cerveau ombilicien d’un Arnaud Viviant par exemple, pour ne citer que le cas du plus illustre et savant critique français. Je ne sais trop pourquoi Zagdanski déteste aussi visiblement Dantec mais m’étonne de constater que, à fort juste titre il me semble, il affirme que l’universelle tromperie de notre société est entièrement due à des «raisons strictement métaphysiques». Que dit d’autre Dantec ? Justement que le travail de tout réel romancier est de dissiper les apparences médiatiquement entretenues par quelques bouches sales qui elles-mêmes postillonnent sur des miroirs qui ne réfléchiront jamais autre chose qu’une haleine fétide. C’est exactement ce que pense Philippe Muray qui, à mon sens, a écrit pour défendre Dantec le meilleur papier de ce dossier, rappelant, comme le fit Léon Bloy dans son Exégèse des lieux communs, que les imbéciles, à leur insu, ne pouvaient rien faire d’autre que d’exposer la vérité, qu’ils n’avaient pas assez de talent pour grimer convenablement. Le passage vaut d’être cité in extenso: «S’il y a donc bien une erreur chez Dantec, à mon sens […], c’est de chercher la vérité ailleurs que dans le désastre du discours manifeste des médiatiques, où pourtant elle éclate à chaque ligne, à chaque intonation […]. À la lettre, ils n’ont pas les moyens de cacher la vérité car ils n’ont pas les moyens de cacher leur propre hébétude : c’est ainsi que la vérité et l’hébétude se lisent non entre les lignes mais dans leurs lignes, où elles se confondent». Bernanos n’aurait pas écrit d’autres phrases, ni Chesterton, ni Unamuno : Boutang, dans son Précis de Foutriquet, rappelait que l’imbécile, par son imbécillité même, était le premier à se punir puisqu’il était incapable de voir que les mots, dans et par leur signification, constituaient un cruel démenti à ses mensonges, en clair, que la phrase du journaliste le plus pervers affirme encore et toujours la vérité qu’il s’acharne à grimer.
Je n’ai en revanche rien à dire sur la très mauvaise intervention du très piètre Michel Onfray, dont il faudrait publiquement conchier l’œuvre de pseudo-philosophe épicurien. Rien à dire ou écrire également sur celle de Pierre Jourde qui nous a servi la soupe aigre de la violence banlieusarde expliquée par les difficultés socio-économiques, sur celle de Beigbeder, à qui je recommande toutefois l’achat d’un Bled d’occasion (drôle de construction grammaticale que celle de la phrase suivante : «D’autres que lui ont évoqué avant Maurice», qui nous fait soupçonner une mystérieuse bilocation grammaticale), sur celle de Joffrin qui, le pauvre homme, croit que le communisme n’existe heureusement plus alors qu’il me semble au contraire que nous assistions à une véritable communisation des esprits, ni même sur celle de Tristan-Edern Vaquette qui, s’il avait mieux lu les pastiches bloyens (à ses yeux) qui ont tenté de défendre Dantec, aurait constaté que les textes d’un BDL, d’un James ou même celui de votre serviteur évoquaient une dimension ésotérique que sa vue de myope n’a pas même devinée.
Je disai il y a quelques jours que le bloc-notes de Bruno Deniel-Laurent me semblait un passage de lecture obligé : une fois de plus, je le répète, le portraitiste de Simone Weil ne démérite par car il y a dans ses lignes une ironique mise en perspective de ce qui tient lieu de débat intellectuel en France de nos jours, perspective (ânière plutôt que cavalière) dans laquelle les préoccupations de Dantec ne peuvent qu’effectivement faire une immense tache. Écoutons BDL nous rappeler opportunément que c’est «au nom d’une conception lumineuse de la transcendance, d’une réticence face à un exotérisme frigide exclusivement basé sur la Chariya>» que le romancier est justement entré en guerre contre l’islam politique, que nos petits crétins d’extrême gauche se plaisent à défendre criminellement (un crime de l’esprit certes mais y en a-t-il d’autre ?). Au papier corrosif de BDL s’ajoutent les trop courtes lignes d’un Cariou plus kremlinologue que jamais : si ces deux-là formaient une équipe, il y a fort à parier que le nain Marcelle (Libération) et la disgracieuse et inculte Aude Lancelin (Le Nouvel Observateur) ne soient tous deux solidement affligés de réjouissantes écrouelles.
Quoi de plus ? L’entretien avec Pierre Jourde, qui fait beaucoup de remarques de simple bon sens, voire assène quelque solide vérité lorsqu’il affirme que «la critique littéraire honorable est en grande partie effectuée par des gens qui ont à la fois un déficit de culture et, il faut l’avouer, un déficit d’intelligence». Seulement, le bon sens n’est en soi pas du talent, celui, absent je dois le dire, des pages de La Littérature à l’estomac consacrées aux écrivains contemporains que Jourde apprécie. Le critique a encore raison lorsqu’il corrige le pessimiste Clément Rosset qui admet et légitime l’existence d’une coupure ontologique entre le réel et le langage chargé de le dire, dans le droit fil d’un Foucault, d’un Canetti ou d’un Mauthner, rappelant au contraire que la tâche de la littérature (en fait, de l’art) est justement de combler, ou de tenter de combler, cette béance, citant les exemples d’un Conrad ou d’un Proust, auxquels j’aurais ajouté celui de l’œuvre méconnue d’Hermann Broch et de Paul Gadenne (voir le numéro à paraître de La Sœur de l’Ange).
La «trilogie» de Laurent Schang, plus que le texte très drôle de Matthieu Jung, est un régal, qui nous fait presque immédiatement comprendre ce que cherche l’un des meilleurs cancéristes (l’acception est certes réductrice, Schang ne m’en voudra pas de limiter ainsi son talent) : réconcilier la parole et l’action, à vrai dire faire que la parole, le verbe SOIT action, sur les brisées de Rimbaud bien sûr, mais aussi, à l’évidence, d’un Jean-René Huguenin ou d’un Dominique de Roux. On devine chez lui une inévitable nostalgie, marque de l’écrivain véritable, dans ces lignes qui, banalité de le dire, ne peuvent que se lamenter du triste constat, mille et mille fois répété : ce n’est que bien rarement, et c’est alors la marque la plus sûre du génie de l’auteur, que la parole nous donne à voir un réel qu’elle a ouvert, creusé, dans lequel elle a foré une rue (via rupta, l’étymologie est toujours éloquente) pour nous en dévoiler la profondeur insoupçonnée. Il est temps, il est grand temps d’écrire un roman cher Laurent Schang…
Je serai beaucoup moins élogieux, en revanche, sur le texte d’Isidora Pezard, truffé de fautes (ce qui est plus grave qu’il n’y paraît pour une amoureuse des lettres), qui ne se dépare pas, une fois de plus (voir ce que j’écrivais dans ma critique de la lecture faite par Isidora d’Alain Zannini) des habituels et palots clichés psychanalytiques, molles plates-bandes où poussent comme des radis (après les cornichons…) les attendus truismes sur le symbolisme, la schizophrénie, le «déploiement métaphorique de doubles», les «métamorphoses» et autre «jeu de miroir». Nous sommes, avec ce texte, loin d’une médiocrité sorbonnarde, après tout excusable, et plus près d’une mauvaise lecture du magazine Elle. A tout prendre, le texte nostalgique de Johann Cariou consacré à Hubert-Félix Thiéfaine, qui ne propose aucune maladroite grille de lecture, est infiniment plus convaincant et surtout, moins… prétentieux. Et que dire de l’admirable texte, à la colère et à la pitié rentrées (comme Barbey parlait d’un drame rentré), de Sarah Vajda consacré à
Caraco, dont la lecture ne m’a pas laissé d’autre souvenir si ce n’est l’impression désagréable de boire par petites lampées un jet doucereux et plaintif, s’est suicidé alors qu’il vomissait le monde et adorait le Siècle des Lumières, celui-là même qui a savamment sapé les colonnes sur lesquelles l’Occident s’appuyait depuis des siècles. Je ne comprends guère qu’un amoureux indéfectible de la déesse Raison se laisse aller à un aussi peu rationnel acte, à moins que… à moins que l’homme Caraco ne soit à ranger dans cette catégorie d’êtres si particulière, génialement décrite par Bernanos qui, en apparence fous de rigueur, n’en finissent pas de pleurer sur une transcendance qu’ils reniflent (au sens propre du verbe avec le maire du village de Fenouille) sans jamais la déterrer. Il paraît que certains cochons, lorsqu’ils n’arrivent pas à trouver la truffe qu’ils flairent pourtant de tous leurs pores, si je puis dire, sont subitement envahis par un inconcevable dégoût de vivre…
Finalement, il ne faut pas batailler bien longtemps pour découvrir le meilleur de Cancer ! qui, c’est un avantage, saute il est vrai immédiatement aux yeux. Autre constat : il me semble, non, cela devient une évidence, que ce meilleur se réduit de plus en plus (est de plus en plus réduit ? Mais par qui ?) à la portion congrue, et encore, je dois m’estimer chanceux puisque je n’ai pas eu, cette fois-ci, à perdre quelques précieuses minutes en lisant de sordides et consternantes bluettes sur Alizée même si, il est vrai, le scatophage Costes empuantit toujours ces pages de sa présence…
J’ai terminé ma malheureuse soirée en commençant Liquidation d’Imre Kertész. Il était temps… Kertész évoque comme nul autre l’évidence d’un mystère indicible (ou plutôt d’un secret selon la distinction célèbre de Gabriel Marcel) qui, au cœur secret du réel, façonne celui-ci, cœur secret et ténébreux (Auschwitz) dont l’écriture devra tenter de patiemment faire entendre les battements sourds, que plus personne, d’ailleurs, ne veut écouter ni même ne serait-ce qu’entendre.
Comme il est facile de constater la simplicité avec laquelle une grande écriture – au demeurant étonnamment simple et dépourvue par chance d’effets costiques – s’impose non seulement à nos esprits mais, comme par magie, efface la médiocrité et la vulgarité d'images dès lors condamnées à ricaner timidement dans un coin de notre esprit, sphériques comme de petites crottes creuses et pourtant malodorantes.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, revue cancer!, maurice g. dantec |  |
|  Imprimer
Imprimer




























































