« Durtal au Salon du Livre | Page d'accueil | Tsunami au royaume de Lilliput »
21/03/2006
Michel Crépu lecteur de George Steiner : tout va bien !

«Les livres scellent le sceau du bien.»
George Steiner, Le Silence des livres (Arléa, 2006).
«Les livres scellent la source.»
George Steiner, Les dissidents du livre, in Les Logocrates (L’Herne, 2003).
 Depuis combien d’années George Steiner n’a-t-il pas écrit un livre qui soit digne de ce nom ? Sans doute depuis Réelles présences qui parut en France en… 1991. Il est donc assez peu étonnant que le moindre de ses articles, la moindre de ses préfaces (par exemple celle, au demeurant excellente, pour un ouvrage d'Iris Murdoch, L'Attention romanesque, dont nous reparlerons sans doute) soient désormais publiés avec tambours battant et ronflements de grosse caisse même s’il ne s’agit, le plus souvent, que de textes qui présentent un maigre intérêt pour qui lit Steiner depuis des années, comme il en allait pour le récent Une certaine idée de l’Europe (Actes Sud, 2005) et je ne prends vraiment pas la peine de m’attarder sur les complaisants et ridicules entretiens que Steiner a eu la mauvaise idée d’accorder à Antoine Spire et Cécile Ladjali. Le court texte que nous évoquons ici, édité par Arléa et agrémenté d’une postface de Michel Crépu, d’abord publié en janvier 2005 dans la revue Esprit sous le titre La Haine du livre, est tout de même plus intéressant que les récentes productions de l’auteur. Résumé en quelques phrases, le propos de George Steiner est d’une belle simplicité et donne effectivement à penser. Par rapport, donc, à l’immense et mystérieux océan de l’oralité génialement illustrée par Socrate et le Christ (pour ne rien dire et pour cause, des traditions orales inconnues que les chercheurs soupçonnent être à l’origine des premiers textes de l’humanité), le continent de l’écrit arpenté depuis des siècles semble souffrir de bien des maux paralysants qui tous, loin s’en faut, ne constituent pourtant point un danger mortel comme nous le verrons. Certes, depuis l’âge d’or du livre initié par l’invention de Gutenberg, la lecture a profondément évolué et est, de nos jours, menacée par le monde moderne : les espaces de silence se réduisent, la mémoire, de moins en moins sollicitée par l’aiguillon du «par cœur», semble se transformer en pantin désarticulé depuis que le grand art mnémotechnique tombe en ruines, et que dire, en règle générale, de la faillite de l'enseignement délivré dans nos écoles ? Steiner évoque aussi deux des ennemis les plus acharnés du livre-roi, qu’il appelle le pastoralisme radical dont l’une des figures de proue est Thoreau et le nihilisme révolutionnaire, surtout russe, qui du livre et, plus largement, de la culture occidentale toute entière, ne fit pas grand cas on le sait. L’adage grotesque, remis au goût du jour par les imbéciles irresponsables qui ont saccagé la Sorbonne tout récemment, est connu : l’œuvre complète de Shakespeare ne vaut pas une paire de robustes bottes d’ouvrier. Un autre danger accablant le livre est évoqué par Steiner qui, dans son texte, ruse pourtant, comme à l’accoutumée, ce qui fait d'ailleurs l'intérêt des principaux ouvrages de l'auteur : en effet, Steiner se demande si la censure est réellement délétère pour l’écriture. À l’évidence dit-il, nombre des livres qui paraissent aujourd’hui, bien des écrits disponibles sur la Toile, mériteraient, tout bonnement, d’être censurés, tant leur violence et leur pornographie (c’est la même chose, dit-il) sont immédiatement visibles et menacent de nous engloutir. Pourtant, Steiner, sur les brisées de Leo Strauss, sait aussi que l’art se nourrit de contraintes et meurt de facilités. Certains des plus grands chefs-d’œuvre de l’art ont été pensés et exécutés alors que leur créateur, tout bonnement, risquait sa vie, à tout le moins de croupir tel Sade dans une geôle d’État, comme Marc-Édouard Nabe le rappelle ironiquement dans son Régal des Vermines, lui qui des prisons ne connaît pas même les parloirs.
Depuis combien d’années George Steiner n’a-t-il pas écrit un livre qui soit digne de ce nom ? Sans doute depuis Réelles présences qui parut en France en… 1991. Il est donc assez peu étonnant que le moindre de ses articles, la moindre de ses préfaces (par exemple celle, au demeurant excellente, pour un ouvrage d'Iris Murdoch, L'Attention romanesque, dont nous reparlerons sans doute) soient désormais publiés avec tambours battant et ronflements de grosse caisse même s’il ne s’agit, le plus souvent, que de textes qui présentent un maigre intérêt pour qui lit Steiner depuis des années, comme il en allait pour le récent Une certaine idée de l’Europe (Actes Sud, 2005) et je ne prends vraiment pas la peine de m’attarder sur les complaisants et ridicules entretiens que Steiner a eu la mauvaise idée d’accorder à Antoine Spire et Cécile Ladjali. Le court texte que nous évoquons ici, édité par Arléa et agrémenté d’une postface de Michel Crépu, d’abord publié en janvier 2005 dans la revue Esprit sous le titre La Haine du livre, est tout de même plus intéressant que les récentes productions de l’auteur. Résumé en quelques phrases, le propos de George Steiner est d’une belle simplicité et donne effectivement à penser. Par rapport, donc, à l’immense et mystérieux océan de l’oralité génialement illustrée par Socrate et le Christ (pour ne rien dire et pour cause, des traditions orales inconnues que les chercheurs soupçonnent être à l’origine des premiers textes de l’humanité), le continent de l’écrit arpenté depuis des siècles semble souffrir de bien des maux paralysants qui tous, loin s’en faut, ne constituent pourtant point un danger mortel comme nous le verrons. Certes, depuis l’âge d’or du livre initié par l’invention de Gutenberg, la lecture a profondément évolué et est, de nos jours, menacée par le monde moderne : les espaces de silence se réduisent, la mémoire, de moins en moins sollicitée par l’aiguillon du «par cœur», semble se transformer en pantin désarticulé depuis que le grand art mnémotechnique tombe en ruines, et que dire, en règle générale, de la faillite de l'enseignement délivré dans nos écoles ? Steiner évoque aussi deux des ennemis les plus acharnés du livre-roi, qu’il appelle le pastoralisme radical dont l’une des figures de proue est Thoreau et le nihilisme révolutionnaire, surtout russe, qui du livre et, plus largement, de la culture occidentale toute entière, ne fit pas grand cas on le sait. L’adage grotesque, remis au goût du jour par les imbéciles irresponsables qui ont saccagé la Sorbonne tout récemment, est connu : l’œuvre complète de Shakespeare ne vaut pas une paire de robustes bottes d’ouvrier. Un autre danger accablant le livre est évoqué par Steiner qui, dans son texte, ruse pourtant, comme à l’accoutumée, ce qui fait d'ailleurs l'intérêt des principaux ouvrages de l'auteur : en effet, Steiner se demande si la censure est réellement délétère pour l’écriture. À l’évidence dit-il, nombre des livres qui paraissent aujourd’hui, bien des écrits disponibles sur la Toile, mériteraient, tout bonnement, d’être censurés, tant leur violence et leur pornographie (c’est la même chose, dit-il) sont immédiatement visibles et menacent de nous engloutir. Pourtant, Steiner, sur les brisées de Leo Strauss, sait aussi que l’art se nourrit de contraintes et meurt de facilités. Certains des plus grands chefs-d’œuvre de l’art ont été pensés et exécutés alors que leur créateur, tout bonnement, risquait sa vie, à tout le moins de croupir tel Sade dans une geôle d’État, comme Marc-Édouard Nabe le rappelle ironiquement dans son Régal des Vermines, lui qui des prisons ne connaît pas même les parloirs. Rien de bien nouveau, on le constate donc, pour qui a lu et médité les essais les plus marquants de Steiner, puisque ces thématiques innervent chacun des textes de l’auteur : légèreté pourtant pérenne de l’oralité confrontée au marbre friable de l’écrit et à la fausse immortalité qu’il assure d'ailleurs de moins en moins, charmes proustiens de la lecture et maladies toutes modernes qui la rongent, voici deux des topoï les plus serinés par Steiner. De plus, et j’estime que l’éditeur devra me répondre franchement sur ce point : s’il est après tout bien normal de préciser que le texte édité par ses soins a paru dans Esprit, il est en revanche consternant de ne point rappeler qu’il n’est, en l’occurrence, qu’une version modifiée d’un texte (Les dissidents du livre) recueilli dans l’ouvrage publié par L’Herne en 2003 et depuis lors paru en édition de poche, intitulé Les Logocrates. De deux choses l’une : soit l’éditeur, Arléa, ne savait tout simplement pas que le texte qu’il allait mettre en vente avait été déjà publié pratiquement tel quel et alors, je me pose des questions sur son sérieux et ses compétences, soit il ne le savait que trop et la problématique, n’est-ce pas, rejoint une sphère morale pour le moins évidente. Dominique Autié le sait mieux que moi : dès qu'un éditeur baisse la garde, son livre, tout livre, se transforme en journal, comme une digue qui n'est pas entretenue par les soins des hommes suit sa pente et se liquéfie irrémédiablement. Ce n'est donc point une promotion mais une déchéance.
Ne noircissons pas trop le tableau car, tout de même, alors que le lecteur a constaté certaines incohérences (comme, par exemple, page 41, où Steiner, à moins qu’il ne s’agisse de son traducteur, passe du coq à l’âne : «L’usage de l’écran ne rend pas non plus de manière très évidente toute lecture traditionnelle obsolète. Il faudra du temps pour que son impact se fasse ressentir. Des études sont déjà parues pour rendre compte du fait que les enfants nourris de télévision et d’internet pouvaient éventuellement manifester des troubles de la volonté […]»), alors même qu'il s’apprête à fermer ce petit livre en se disant que Steiner n’a décidément plus grand chose à dire, lui qui, au passage, n’a été qu’un génial lecteur des autres et l'excellent vulgarisateur de leurs idées, quelques phrases donc, où il s’implique directement, toujours les plus intéressantes c’est un fait, intriguent et, littéralement, sauvent ce petit livre d'un ridicule à vau-l'eau éditorial. J’y ai en tout cas de nouveau retrouvé cette vieille fascination qui était mienne pour un homme ne craignant pas d’avouer ses propres sidérations, ses doutes et ses ridicules prudences. George Steiner n’est jamais aussi passionnant, je songe ainsi à Errata (publié en 1998 par Gallimard), que lorsqu’il emploie la première personne du singulier car cette utilisation, bien sûr, est sous sa plume le signe patent de l’aveu. En effet, la thématique véritable du Silence des livres est moins la confrontation entre l’oralité prodigieuse d’un Orphée capable de charmer la création comme nous le content les Géorgiques de Virgile, face donc à l’écrit qui paralyse les forces vives de l’esprit et, nous rappelle Platon, érige en parangon indestructible la statue de l’autorité (auctoritas, auctor, c’est tout un), que la certitude d’une présence réelle du Mal, de la barbarie, au sein même de l’art le plus accompli. Ce motif, encore une fois, est une des constantes de la réflexion steinerienne. Le penseur avoue ainsi que le grand compositeur, le professeur de renom, le célèbre philosophe, éprouvent bien rarement le besoin de compatir à la souffrance des hommes qu'ils ignorent, que bien trop souvent ils refusent de voir, d'aimer, d'éduquer, de protéger. Pourquoi, en effet se demande tel pâle surgeon de Montaigne enfermé dans sa bibliothèque, daigner redescendre de sa magnifique tour d’ivoire, où les livres sont rois, pour tomber dans le cloaque de la vie répugnante, imbécile, ignorante, au mieux, du monde de l'esprit ? Pourquoi encore entendre, sous l’emprise de la somptueuse musique de chambre, les hurlements des brûlés vifs ? Je ne cite point les dernières lignes du Silence des livres mais celles, pratiquement identiques, des Dissidents du livre (Les Logocrates, op. cit., p. 108) : «Moi qui suis enseignant et pour qui la littérature, la philosophie, la musique et les arts sont l’étoffe même de la vie, comment vais-je traduire cette nécessité en conscience morale concrète de la nécessité humaine, de l’injustice qui contribue si largement à rendre possible la haute culture ?». Telle est la question ultime, à laquelle George Steiner, il fallait s’en douter, se garde bien de répondre, même si je crois pouvoir lire, dans ce silence, une forme discrète de promotion de l’oralité, tout du moins d’un enseignement de maître à élève qui ne se laisserait plus paralyser par les fadaises derridiennes consistant à nier toute forme d’autorité et de transmission effectives.
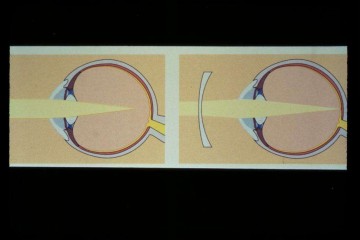
Si j’avais été professeur de français et que Michel Crépu eût été mon attentif élève, j’aurais écrit au stylo rouge, sur sa copie finalement bien peu épaisse : «Beau développement mais partiellement hors-sujet». Car enfin, comment se peut-il que le lecteur habituellement sérieux qu’est Michel Crépu ait jugé bon, dans son texte censé commenter celui de Steiner, n’évoquer qu’une seule (la plus visible, celle de la lecture...), des thématiques soulevées par l’auteur de Passions impunies (1997) ? On me dira qu'il faut faire court et que les commentaires propulsés à l'éthanol bloyen, ce n'est pas vraiment le genre de la maison, davantage adepte des énergies douces, quoique peu renouvelables... Certes mais le texte de Steiner étant lui-même bien court, la police des caractères ayant été grossie pour les besoins de l'impression, je ne pense pas que quelques pages supplémentaires sous la plume du patron de l'impeccable Revue des deux Mondes, auraient ajouté plus de quelques millimètres d'épaisseur à notre très épais volume ! Pour tout dire, il me semble que le commentaire de Michel Crépu, davantage qu’au Silence des livres, s’adresse plutôt à tel des textes recueillis dans Passions impunies. Certes Crépu, qui a évoqué Bossuet dans l’un de ses ouvrages, n’a bien évidemment pas tort de nuancer les critiquables raccourcis qu’emploie Steiner pour parvenir à ses fins argumentatives. Il a même parfaitement raison de filer sa propre métaphore, tout en transposant la problématique liée au choc entre l’oral et l’écrit à l’exemple, bien oublié de nos jours, de la querelle qui opposa l’Aigle de Meaux, partisan du recours systématique aux autorités scripturaires, à Madame Guyon flanquée de Fénelon, adeptes d’un transparent pur amour réputé pouvoir se passer de toute médiation. D’un côté, le filtre des écrits patiemment constitué par les générations de commentateur et, de l’autre, l’évidence lumineuse que ces mêmes écrits sont barrage plus que secours lorsqu’il s’agit de tenter de contempler Dieu sans miroir. Crépu enfin ne se trompe pas en affirmant que cette opposition sera celle que développeront les auteurs proches du classicisme contre les tenanciers du romantisme, oubliant toutefois d’évoquer les nombreuses nuances que Jean Paulhan apporta dans ses fameuses Fleurs de Tarbes à la célèbre querelle d’ailleurs moins spécifiquement littéraire qu’artistique, oubliant encore, in fine, d'évoquer le fait que toutes ces questions relatives à l'art de lire ont été évoquées et avec quelle puissance, par Auerbach, Spitzer et... Saint Augustin.
Pourtant, si le sens d’une lecture bien faite est de dévoiler, en dernier lieu, ce qui a été volontairement tu ou plutôt occulté par l’auteur, je suis plus que choqué que Michel Crépu se contente, dans un bel élan d’optimisme (avouons toutefois qu’il nous semble bien ridicule et si peu ajointé aux dangers que Crépu lui-même pointe), d’affirmer que, en dépit de la carence, dans le monde où nous vivons, de toute forme réelle d’autorité et de référence critique aux efforts des générations passées, tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux alors que, de l'aveu même de l'auteur, «L’auguste est mort, affirme Crépu qui ajoute qu’il n’y a plus personne pour recevoir, tenir la permanence et que, désormais, c’est une solitude inouïe [qui] commence.» Certes. Et puis, une fois dépassé le séduisant esthétisme du propos, une fois évacué l'apparent paradoxe du style de Crépu, mêlant académisme détendu et saillies de journalistes, impertinences ouatées et rigueur filandreuse, érudition volage et comique troupier (cette première phrase de son texte, ridicule entre toutes), que reste-t-il ? Rien voyons, puisque tout va bien ne vous l’a-t-on pas assez répété ? C’est donc la conclusion à laquelle se rend Michel Crépu, sans doute heureux de devoir d’ici peu rejoindre les catacombes pour s’adonner à son cher vice (qui, rassurons notre esthète-martyr improbable, ne va pas tarder à ne plus rester impuni) : la lecture. Pas un mot en tout cas sur cette alliance scandaleuse et pourtant irrécusable entre la plus haute culture et la plus maléfique barbarie, que Steiner s’acharne à sonder depuis son Château de Barbe-Bleue paru voici plus de trente ans. Pas un mot encore sur la non moins étonnante lucidité de Steiner, qui à mots couverts cependant nous laisse entendre que si sa situation personnelle, assurément confortable, devait être mise en cause ou durement inquiétée, il aurait, peut-être, bien du mal à adopter un comportement plus honorable et courageux que celui (lamentable, il faut le dire quels que soient les utiles nuances que nous apportent les fanatiques défenseurs du philosophe, comme Karl Löwith qui fut son élève, l’affirme sans ambages dans sa Vie en Allemagne avant et après 1933) dont fit preuve le rusé et taciturne Martin Heidegger durant la montée puis le triomphe du nazisme en Allemagne. Pas un mot sur l'extrême gravité de notre situation : si d'aventure l'art de la lecture devait réellement disparaître (n'en déplaise aux tentations monachiques peu crédibles exprimées par le jouisseur Crépu), c'est tout simplement l'Occident tel que nous l'avons connu qui cesserait d'exister : Crépu, pour s'en convaincre, serait sans doute bien avisé de lire l'essai de Brian Stock intitulé Bibliothèques intérieures.
Avant, donc, d’être un jour très prochain sévèrement puni, il faudrait tout de même que le vice de la lecture, que tant de belles âmes affirment être l’un des plus purs plaisirs de l’esprit, soit au moins correctement pratiqué, je veux dire exercé par des hommes que, pour punir de leur talent quasi-divinatoire, les bourreaux auront de légitimes envies d’emprisonner. Qui se soucierait, en effet, de jeter au cachot un journaliste ou un auteur au motif, certes peu avouable, de lecture superficielle, voire, de myopie ?
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, george steiner, michel crépu |  |
|  Imprimer
Imprimer


























































