« La Femme de Zante de Dionysos Solomos | Page d'accueil | Lointain écho de Bossuet, par Réginald Gaillard »
15/12/2009
Surréalisme et réalisme dans le nouveau triptyque d’Alexandre Mathis, par Francis Moury

Photographie (détail) de Juan Asensio.
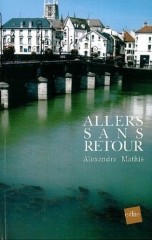 À propos de : Alexandre Mathis, Allers sans retour, roman-montage en deux volets : Le coup de folie de Roger Verdière et La mort mystérieuse d’Andrée Denis (éditions E-dite, novembre 2009).
À propos de : Alexandre Mathis, Allers sans retour, roman-montage en deux volets : Le coup de folie de Roger Verdière et La mort mystérieuse d’Andrée Denis (éditions E-dite, novembre 2009).Acheter cet ouvrage sur Amazon.
Présentation de l'éditeur
Allers sans retour est inspiré par deux faits divers. À Caudebec, près de Rouen, Roger Verdière, 18 ans, tue une sexagénaire pour la voler, afin de pouvoir aller au cinéma. Descendu à Paris, il passe le plus clair de son temps dans les salles obscures. Escapade de la durée d'un bal, dans les rues glacées de la butte Montmartre. Arrêté à la lisière de la jungle montmartroise, presque devant un de ces cinémas où il avait l'habitude d'aller, il est condamné à mort en 1939, à la veille de l'entrée en scène de l'armée allemande. Le lendemain du vendredi saint, à l'aube, Andrée Denis, une Parisienne de 17 ans, est retrouvée debout dans la Marne, tête émergeant de l'eau. Quelques heures avant, elle serait allée au cinéma, à Meaux, où elle ne connaissait personne. C'est ce que conclut une enquête rapide, à l'aide d'un billet de cinéma, au numéro irréaliste, optant, au bout de deux jours, pour un suicide dépourvu de tout mobile, et bien que personne ne vît la jeune fille au Majestic, et personne ne saura ce qu'elle était allée faire à Meaux. L'affaire n'aura pas de suite judiciaire. Une histoire survenue en 1936, à l'aube du Front populaire. Noyade qui pourrait rappeler celle de Mary Rogers, autre banal fait divers, qui avait inspiré à Edgar Poe Le Mystère de Marie Roget, jamais clairement éclairci. Différence de taille avec la mort de Marie Roget, personne n'a vu Andrée Denis, vivante, à Meaux. Deux allers sans retour... sur fond de cinéma.
«Vous qui me lisez, vous êtes encore parmi les vivants; mais moi qui écris, je serai depuis longtemps parti pour la région des ombres. Car, en vérité, d’étranges choses arriveront, bien des choses secrètes seront révélées, et bien des siècles passeront avant que ces notes soient vues par les hommes. Et quand il les auront vues, les uns ne croiront pas, les autres douteront, et bien peu d’entre eux trouveront matière à méditation dans les caractères que je grave sur ces tablettes avec un stylus de fer. L’année avait été une année de terreur, pleine de sentiments plus intenses que la terreur, pour lesquels il n’y a pas de nom sur la terre. Car beaucoup de prodiges avaient eu lieu, et de tous côtés, sur la terre et sur la mer, les ailes noires de la Peste s’étaient largement déployées.»
Edgar Allan Poe, Ombre [1833], in Nouvelles histoires extraordinaires (Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, trad. Charles Baudelaire, éd. établie et annotée par Y.-G. Le Dantec, 1951-1979), p. 477.
«Mais les ténèbres sont elles-même des toiles
Où vivent, jaillissant de mon œil par milliers,
Des êtres disparus aux regards familiers.»
Charles Baudelaire, Obsession [ca 1860], in Les Fleurs du mal, Spleen et idéal (éd. illustrée Classiques Garnier, établie par Antoine Adam, 1961), p. 82.
«Jean Péloueyre ouvrit le livre de Nietzsche à une autre page; il dévora l’aphorisme 260 de Par delà le bien et le mal, – qui a trait aux deux morales, celle des maîtres et celle des esclaves. Il regardait sa face que le soleil brûlait sans qu’elle en parût moins jaune, répétait les mots de Nietzsche, se pénétrait de leur sens, les entendait gronder en lui, comme un grand vent d’octobre. Un instant, il crut voir à ses pieds, pareille à un chêne déraciné, sa Foi. Sa Foi n’était-elle pas là, gisante, dans ce torride jour ? […] Il était de ces esclaves que Nietzsche dénonce; il en discernait en lui la mine basse; il portait sur sa face une condamnation inéluctable; tout son être était construit pour la défaite, comme son père, d’ailleurs, comme son père, dévot lui aussi mais mieux que Jean instruit dans la théologie, et naguère encore lecteur patient de saint Augustin et de saint Thomas d’Aquin.»
François Mauriac, Le Baiser aux lépreux et Génitrix (éd. Oxford University Press conforme au texte des éditions originales Bernard Grasset parues en 1922 et 1923, Clarendon French Series, edited with an introduction and notes by R. A. Escoffey, London, 1970), pp. 50-51.
«Pendant que les aides-bourreaux, dans l’aube grelottante de Baudelaire, calaient, à l’aide du niveau d’eau, la grêle machine de mort, un merle, excité par la lumière des lanternes, se mit à pousser un chant magnifique, surnaturel, exalté, beethovenien. Il apparaissait en noir sur le fond du ciel, encore violet, comme le corbeau dessiné par Manet pour le poème de Poe. Si Edgar Poe lui-même avait été là, cette telle nuit, avec ses rythmes sublimes dans la tête et ses trois verres de gin dans le nez, il eût conçu un nouveau poème, aussi beau que The Raven et Ulalume sur ce deuxième «fatidique oiseau».»
Léon Daudet, Paris vécu, Deuxième série : Rive gauche, Du quartier latin à la Santé (quatorzième édition, Gallimard, coll. N.R.F., 1930), p. 82.
«Kafka me cita une phrase de Hoffmannsthal : «L’odeur de la pierre humide dans un vestibule.» Et il se tut longtemps, n’ajouta rien, comme si cette modeste impression de la vie familière devait parler d’elle-même. Cela me fit une si profonde impression que je sais encore aujourd’hui la rue et la maison devant laquelle nous nous entretenions. Il est beaucoup de lecteurs qui croient trouver dans les œuvres de Kafka des affinités avec celles où sont représentés «les côtés nocturnes de la vie», celles de Poe, de Kubin, de Baudelaire. Il pourra leur apparaître surprenant que mon ami m’ait précisément ramené à la simplicité et au naturel, qu’il ait peu à peu arraché mon esprit à la confusion et à la corruption où il était plongé, et qu’il l’ait dégagé de cette puérile présomption dont était empreinte ma fausse désinvolture.»
Max Brod, Franz Kafka – Souvenirs et documents (traduction de l’allemand par Hélène Zylberberg, Gallimard, coll. N.R.F. - Leurs figures, 1945), p. 59.
Edgar Allan Poe, Ombre [1833], in Nouvelles histoires extraordinaires (Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, trad. Charles Baudelaire, éd. établie et annotée par Y.-G. Le Dantec, 1951-1979), p. 477.
«Mais les ténèbres sont elles-même des toiles
Où vivent, jaillissant de mon œil par milliers,
Des êtres disparus aux regards familiers.»
Charles Baudelaire, Obsession [ca 1860], in Les Fleurs du mal, Spleen et idéal (éd. illustrée Classiques Garnier, établie par Antoine Adam, 1961), p. 82.
«Jean Péloueyre ouvrit le livre de Nietzsche à une autre page; il dévora l’aphorisme 260 de Par delà le bien et le mal, – qui a trait aux deux morales, celle des maîtres et celle des esclaves. Il regardait sa face que le soleil brûlait sans qu’elle en parût moins jaune, répétait les mots de Nietzsche, se pénétrait de leur sens, les entendait gronder en lui, comme un grand vent d’octobre. Un instant, il crut voir à ses pieds, pareille à un chêne déraciné, sa Foi. Sa Foi n’était-elle pas là, gisante, dans ce torride jour ? […] Il était de ces esclaves que Nietzsche dénonce; il en discernait en lui la mine basse; il portait sur sa face une condamnation inéluctable; tout son être était construit pour la défaite, comme son père, d’ailleurs, comme son père, dévot lui aussi mais mieux que Jean instruit dans la théologie, et naguère encore lecteur patient de saint Augustin et de saint Thomas d’Aquin.»
François Mauriac, Le Baiser aux lépreux et Génitrix (éd. Oxford University Press conforme au texte des éditions originales Bernard Grasset parues en 1922 et 1923, Clarendon French Series, edited with an introduction and notes by R. A. Escoffey, London, 1970), pp. 50-51.
«Pendant que les aides-bourreaux, dans l’aube grelottante de Baudelaire, calaient, à l’aide du niveau d’eau, la grêle machine de mort, un merle, excité par la lumière des lanternes, se mit à pousser un chant magnifique, surnaturel, exalté, beethovenien. Il apparaissait en noir sur le fond du ciel, encore violet, comme le corbeau dessiné par Manet pour le poème de Poe. Si Edgar Poe lui-même avait été là, cette telle nuit, avec ses rythmes sublimes dans la tête et ses trois verres de gin dans le nez, il eût conçu un nouveau poème, aussi beau que The Raven et Ulalume sur ce deuxième «fatidique oiseau».»
Léon Daudet, Paris vécu, Deuxième série : Rive gauche, Du quartier latin à la Santé (quatorzième édition, Gallimard, coll. N.R.F., 1930), p. 82.
«Kafka me cita une phrase de Hoffmannsthal : «L’odeur de la pierre humide dans un vestibule.» Et il se tut longtemps, n’ajouta rien, comme si cette modeste impression de la vie familière devait parler d’elle-même. Cela me fit une si profonde impression que je sais encore aujourd’hui la rue et la maison devant laquelle nous nous entretenions. Il est beaucoup de lecteurs qui croient trouver dans les œuvres de Kafka des affinités avec celles où sont représentés «les côtés nocturnes de la vie», celles de Poe, de Kubin, de Baudelaire. Il pourra leur apparaître surprenant que mon ami m’ait précisément ramené à la simplicité et au naturel, qu’il ait peu à peu arraché mon esprit à la confusion et à la corruption où il était plongé, et qu’il l’ait dégagé de cette puérile présomption dont était empreinte ma fausse désinvolture.»
Max Brod, Franz Kafka – Souvenirs et documents (traduction de l’allemand par Hélène Zylberberg, Gallimard, coll. N.R.F. - Leurs figures, 1945), p. 59.
 Révélé par une trilogie romanesque parisienne alliant surnaturalisme et réalisme (Maryan Lamour dans le béton, Les Condors de Montfaucon, Chambre de bonnes – Le Succube du Temple) dont la singularité d’écriture lui méritait d’être comparé par les meilleurs critiques à Joyce et Céline, pour ne citer que deux de ses influences les plus évidentes, voici que paraissent, à un mois d’intervalle à peine, les deux premiers volumes d’une nouvelle trilogie, définie explicitement comme un second triptyque, tournant autour des pulsions autopunitives : Allers sans retour, inspiré par deux étranges affaires criminelles survenues en France en 1936 (la mort d’une jeune parisienne de 17 ans retrouvée, telle Ophélie chez Shakespeare, debout et à demi-nue dans la Marne : l’affaire sera classée, jamais élucidée) et 1939 (le jeune Verdière, 18 ans et vivant près de Rouen, assassine sa voisine rentière puis part à Montmartre où il passe les derniers jours avant son arrestation à visionner des films dans tous les cinémas de Clichy, Pigalle et Rochechouart), Edgar Poe dernières heures mornes relatant ce que furent peut-être les dernières heures du poète avant sa mort sur laquelle plane encore aujourd’hui un mystère. Le troisième volume enfin, pas encore paru mais dont le titre est déjà déterminé et annoncé dans les œuvres de Mathis à venir, sera consacré à l’histoire de Georges Rapin (un criminel qui fut guillotiné en 1960), sous le titre de M. Bill, R.N. 11.
Révélé par une trilogie romanesque parisienne alliant surnaturalisme et réalisme (Maryan Lamour dans le béton, Les Condors de Montfaucon, Chambre de bonnes – Le Succube du Temple) dont la singularité d’écriture lui méritait d’être comparé par les meilleurs critiques à Joyce et Céline, pour ne citer que deux de ses influences les plus évidentes, voici que paraissent, à un mois d’intervalle à peine, les deux premiers volumes d’une nouvelle trilogie, définie explicitement comme un second triptyque, tournant autour des pulsions autopunitives : Allers sans retour, inspiré par deux étranges affaires criminelles survenues en France en 1936 (la mort d’une jeune parisienne de 17 ans retrouvée, telle Ophélie chez Shakespeare, debout et à demi-nue dans la Marne : l’affaire sera classée, jamais élucidée) et 1939 (le jeune Verdière, 18 ans et vivant près de Rouen, assassine sa voisine rentière puis part à Montmartre où il passe les derniers jours avant son arrestation à visionner des films dans tous les cinémas de Clichy, Pigalle et Rochechouart), Edgar Poe dernières heures mornes relatant ce que furent peut-être les dernières heures du poète avant sa mort sur laquelle plane encore aujourd’hui un mystère. Le troisième volume enfin, pas encore paru mais dont le titre est déjà déterminé et annoncé dans les œuvres de Mathis à venir, sera consacré à l’histoire de Georges Rapin (un criminel qui fut guillotiné en 1960), sous le titre de M. Bill, R.N. 11.Bien qu'Edgar Poe dernières heures mornes et Allers sans retour aient tous deux été imprimés en septembre 2009, et bien que le premier ouvrage ait été déposé légalement en octobre 2009, alors que Allers sans retour l’a été en novembre 2009, on peut cependant considérer ce dernier livre comme le premier volume de ce triptyque, ne serait-ce que par l’ampleur romanesque et le nombre de pages : 555 pages alors qu'Edgar Poe dernières heures mornes n’en compte que 250 environs dont 30 pages de notes en polices de caractères très petites qui, imprimées en caractères de taille identique à ceux du premier volume, augmenteraient notablement, il est vrai, son volume paginé. Pourtant cet ordre n’est pas l’ordre chronologique de composition. Edgar Poe dernières heures mornes a été achevé le 17 octobre 2004 (1) alors qu'Allers sans retour a été rédigé en 2005 et 2006. À vrai dire, l’auteur lui-même se plaît, dans un courriel qu’il nous adresse, à brouiller les pistes que l’éditeur trace en quatrième de couverture : on peut placer l’histoire des dernières heures de Poe, celle des derniers jours de Roger Verdière, celle d’Andrée Denis, celle de M. Bill alias Georges Rapin sous le signe de Poe en raison de l’intérêt de ce dernier pour les criminels par sentiment préalable de culpabilité, pour le démon de la perversité autopunitive qui est fiévreusement analysé dans des contes tels que Le Chat noir ou Le Démon de la perversité. Mais ce n’est pour autant une «trilogie Poe». Elle n’a pas vraiment d’ordre non plus : on peut commencer indifféremment par un des trois livres (les deux parus ou le troisième à paraître), et poursuivre par les deux autres. Cela dit, si on veut suivre l’ordre historique réel des sujets, on peut commencer par Edgar Poe dernières heures mornes. Si on veut suivre l’ordre de l’éditeur, on peut commencer par Allers sans retour. On retombera, de toute manière, toujours sur son noyau central qui est aussi bien l’analyse par Freud des criminels par sentiment de culpabilité, dont un extrait est cité en exergue, parmi d’autres textes très brillants (écrits par des penseurs et des écrivains aussi divers que le psychologue Pierre Janet, le surréaliste André Breton, le philosophe Nietzsche) qui éclairent chacun d’une étrange lueur les enquêtes et les histoires – régulièrement commentées par l’auteur qui est actif durant chacun des deux récits, en notes ou dans le corps du texte, davantage dans la seconde partie que dans la première partie qui a un aspect fictif plus classique et d’une certaine manière plus intense aussi, doté de davantage de suspense) –, provenant de cette même pulsion incoercible, enchâssée dans un réalisme impressionnant.
Allers sans retour est placé sous le signe simultané du réalisme le plus méticuleux et du surréalisme le plus puissant. Son écriture est incomparablement plus aisée, simple, fluide que celle de la trilogie parisienne antérieure.
C’est aussi que durant toute la première partie consacrée au Coup de folie de Roger Verdière, on adopte son point de vue, celui d’un jeune homme de 18 ans qui est certes un criminel mais qui demeure un homme encore relativement innocent, fonctionnant par succession d’impressions, de perceptions qui ne forment jamais de courants de conscience excessivement emberlificotés. Nous voyons par ses yeux, nous pensons par son cerveau et de temps en temps, l’auteur commente telle pensée de Roger, tel fait observé par Roger. Mais le temps narratif des 300 premières pages de cette première partie est ici supérieurement traité en ce qu’il restitue tout l’univers mental, social, moral, esthétique, poétique de la France de 1938 en une période temporelle brève et précise qui va du 17 novembre 1938 au 31 décembre 1938. Le suspense est constant d’une page à l’autre, jusqu’à l’arrestation. Il rebondit ensuite car l’affaire Verdière est mise en perspective par Mathis, mise en relation aussi avec d’autres affaires, parallèles, connexes, voisines ou apparemment sans rapport mais participant pourtant du même univers, au même moment. Mathis recréé la solidarité ontologique du monde à travers la conscience marginale, fruste, de ce jeune homme. De janvier 1939 à août 1939, un nouveau suspense s’installe, levé in extremis. Il est nourri par la même technique, révélant des pans ahurissants d’inconscient individuel ou collectif : les faits divers rédigés par Francis Rico (Francis Carco ?) et recopiés par Mathis valent leur pesant d’or ! La lettre reçue par Céline après la parution de L’École des cadavres et l’article admirable intitulé Louis-Ferdinand Céline ou le Démon de la Pureté écrit par Marcel Sauvage, paru dans L’Intransigeant du 23 décembre 1938 aussi ! Le sommet de la première section d’Allers sans retour, ce ne sont pas les scènes d’action pure telle que la fuite de Roger lors d’une rafle près de la Place Clichy, décrite d’une manière pointilliste si fine qu’elle force l’admiration et l’identification, rafle qui s’achève par un rendez-vous manqué où il assiste à un meurtre. Ce sont au contraire les scènes contemplatives : celles des séances de projection des films, vus à travers le prisme de la sensibilité innocente, neutre, désirante pure, de Verdière qui reçoit chaque nouveau film comme un être réel, une découverte, une ouverture au monde en marge duquel il n’a pas encore absolument conscience de s’être mis. Évasion au double sens du terme : telle est l'odyssée de la conscience (2) de Verdière suivie presque heure par heure, mètre par mètre, par Mathis durant le temps qui précède son arrestation.
On n’oublie pas, ainsi, la projection de La Habanera (All., 1937) de Detlef Sierck (futur Douglas Sirk) – l’un des films préférés des Surréalistes ! – où il apprécie la description démentiellement littéraire de la neige – des larmes versées par les anges sur les hommes ! – faite par la sublime Zarah Leander à l’attention de son fils, ni celle de Les Dieux du Stade, qui produit sur Roger une impression viscérale. On n’oublie pas non plus celles, remises en situation, de Les Disparus de Saint-Agil ou de Police mondaine. Roger passe à un moment devant un cinéma dont la caissière semble être un fantôme et qui programme trois films fantastiques américains de James Whale : The Old Dark House (1932), L’Homme invisible (1933) et La Fiancée de Frankenstein (1935). Roger semble passer à côté du Styx symbolisant à la fois l’ancienne rivière des Grecs et le futur cinéma des années 1970 spécialisé dans le fantastique qui portera ce nom. Le Styx, le Colorado ou le Mexico, le Brady n’existent pas encore : leurs ancêtres sont déjà là et se nomment Gaité-Rochechouart, Delta, Studio 28, Clichy-Palace.
La seconde partie d’Allers sans retour consacrée à La mort mystérieuse d’Andrée Denis, est très étonnante par la volonté obsédante d’enquêter sur un fait au sujet duquel l’investigation se révèle in fine presque impossible alors qu’elle aurait dû avoir lieu : l’affaire avait été classée. Mathis se retrouve alors dans la situation de Dupin, le détective d’Edgar Poe, lorsqu’il enquête (deux ans après son éclaircissement du Double assassinat dans la rue Morgue) sur Le Mystère de Marie Roget, assez similaire à celui qui entoure la mort strictement véridique d’Andrée Denis, mystère qui constitue la première des Histoires grotesques et sérieuses. Accident, crime ou suicide ? On se souvient que Georges Bernanos faisait poser cette question à un journal en guise de conclusion à Un Crime en 1929. De fait, qui peut se targuer de jamais savoir la vérité ? Qui peut être certain de ne pas voir un jour sa vision du monde modifiée ? Le solide, concret, déterminé et rigide Léon Daudet emprisonné à la Santé (à côté de ceux qu’il nomme, et que tous nommaient, les «mains rouges») à l’âge de soixante ans, moralement décontenancé par l’assassinat irrésolu de son jeune fils Philippe, comprend brusquement que rien n’est simple : la manière dont il décrit la guillotine, ses préparatifs, sa mise en scène, à partir d’un souvenir identique, n’est plus tout à fait la même entre l’article qu’il donnait à L’Action française et qui est cité dans Allers sans retour, et le chapitre que Daudet lui consacre ensuite dans son mémorable Paris vécu.
Des pages 385 à 555, Mathis traque obstinément le moindre indice, refait les parcours possibles d’Andrée Denis, à partir d’une stricte analyse du réel de l’époque, et il arrive à nous faire éprouver une mauvaise conscience proche de celle du sentiment obsédant de culpabilité qui accable les héros criminels de Poe.
Si c’est un suicide, nos ancêtres de 1936 en furent obscurément responsables, comme c’est au fond le cas de chaque suicide. Comme disait, il me semble, l’écrivain Éric Orsenna, «À chaque fois qu’un de nos amis se suicide, nous nous posons la question : quel fut le cri que je n’ai pas su entendre ?».
Si c’est un meurtre, notre police est responsable de l’impunité du criminel, peut-être protégé à l’époque par sa situation, auquel cas ce sont les politiques qui en seraient responsables.
Si c’est un accident, de quelle obscure fatalité poursuivant la race humaine peut-il bien être la conséquence ?
Fatalité renvoyant à Poe – Poe dont Andrée lit, sans aucun doute possible, Double assassinat dans la rue Morgue tandis qu’elle se trouve dans un autobus ou dans le métro ! – et, par-delà Poe, à Shakespeare, et aux Tragiques grecs. Macbeth est cité en exergue dans une des pages de l’histoire de Verdière, et Hamlet l’est aussi dans une des pages de l’histoire de Andrée Denis.
Il reste enfin de La Mort mystérieuse d’Andrée Denis l’obsédante idée d’un portrait en creux, d’un absent insigne : le possible criminel peut-être coupable de la mort – ou responsable du suicide – d’une innocente. Absence-présence fantastique, en raison de la précision terrible qui imprègne le moindre indice concret, le moindre paysage contemporain ayant eu un lien avec l’affaire. Films, livres, publicités, rues, plans de métro, courrier administratif, articles de journaux (l’ahurissant, hallucinant article d’information écrit en forme de conte fantastique à la manière de Hanns Heinz Ewers ou de E. T. A. Hoffmann sur Sombre Dimanche, «la chanson qui tue» à Budapest en 1936, dont les prolongements nous amènent à bien des suicides hélas avérés et même à un souvenir bien réel de la chanteuse Damia, souvenir confié à Michel Marmin en 1968) : tout conspire à laisser le champ du possible ouvert, à ne pas refermer trop tôt le réel dans son infinie capacité de correspondances presque synesthésiques, parfois : les couleurs, les sons, se répondent en un écho obscur qui a pour conséquence une indélébile contamination du présent par le passé, par ce passé-ci qui nous est donné à tout jamais comme un fragment du nôtre, à présent que nous avons lu.
Présence de la mort et présence du mal qui imprègnent encore la conscience du narrateur-enquêteur, et qui déteint forcément sur le lecteur, sonné par ce voyage au bout de deux mystères à jamais inélucidables, chacun dans leur genre, mais bien au bout de la nuit dans les deux cas, de deux nuits très différentes mais de deux nuits liées par cette même qualité d’être… nocturnes. Un bourreau presque innocent et une victime probablement martyrisée, accolés par la littérature, tel un étrange symbole janusien, et qui ne cessent d’en appeler à un éveil progressif de la conscience, de la perception, du souvenir, par-delà l’oubli et le mur du sommeil.
Notes
(1) Je crois utile de citer ici un extrait d’un courriel reçu de Mathis le 22 octobre 2009, car il illustre assez cette volonté obstinée de faire correspondre l’écriture actuelle avec le passé, créant ainsi une connivence consciente, un pont entre les vivants et les morts dont la précision confine au fantastique :
«Le 17 octobre (tout le texte qui précède était fini) correspond exactement au 17 octobre 1849, jour où exactement E. Poe (mort dix jours avant) devait se marier avec Elmira, une amie d'enfance retrouvée. La partie posthume et l'épilogue ont été rédigés aussi fin 2004». Autre exemple frappant de pont entre un mort et un vivant : la rue de Nantes qui fut le domicile d’Andrée Denis et qui évoque à Régis Schleicher, correspondant de Mathis, le souvenir d’un appartement où il s’était «posé» un moment. La Poétique de l’espace est aussi, outre ce que Bachelard en a pensé parallèlement à sa Poétique de la rêverie, d’attendre que nos destins s’y croisent : mémoire que les carrefours conservent, et qu’ensuite conserve leur mémoire architecturale ou photographique, une fois qu’ils ont été détruits.
(2) L’expression «odyssée de la conscience» se trouve chez Schelling qui l’emploie à partir de 1815 dans ses leçons sur la mythologie. Cf. : Vladimir Jankélévitch, L’Odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling (Éditions Librairie Félix Alcan, coll. B.P.C., 1933).
Bibliographie sélective d’Alexandre Mathis
Œuvres parues
Allers sans retour, éd. E-dite, novembre 2009.
Edgar Poe dernières heures mornes, éd. E-dite, octobre 2009.
José Benazeraf, la caméra irréductible an 2002, [signé Herbert P. Mathese], éd. Clairac, 2007.
Chambres de bonnes – Le succube du Temple. Conte fiévreux, éd. E-dite, octobre 2005.
Les Condors de Montfaucon, éd. E-dite, novembre 2004.
Le Sang de l’autre, Préface à Le Goût du sang d’André Héléna, éd. E-dite, janvier 2004.
Minuit Place Pigalle, carrefour des illusions état des lieux aménagement du territoire suivi de Visite guidée dans Paname du parcours, à pinces et pressé, de quelques personnages d’André Héléna, in Polar n°23, éd. Rivages, mai 2000.
Maryan Lamour dans le béton, éd. I.d.é.e.s./Encrage, Les Belles Lettres, juin 1999.
Œuvres à paraître
M. Bill, R.N. 11.





























































 Imprimer
Imprimer