« 2666 de Roberto Bolaño, 4 : la nécrologie d’un inframonde, par Grégory Mion | Page d'accueil | La résurrection intégrale de MMF, Midi-Minuit Fantastique, par Francis Moury »
17/03/2014
D'après nature de W. G. Sebald
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 W. G. Sebald dans la Zone.
W. G. Sebald dans la Zone.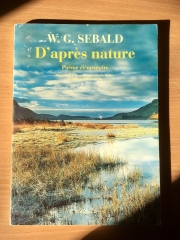 Acheter D'après nature sur Amazon.
Acheter D'après nature sur Amazon.Publié en 1988 en Allemagne et traduit par Sibylle Muller et Patrick Charbonneau pour le compte d'Actes Sud en 2007, D'après nature est composé de trois textes qui sont des poèmes en prose, adoptant la disposition et la forme de vers libres, qui sont consacrés à trois personnages historiques, Matthias Grünewald, Wilhelm Steller et enfin l'auteur lui-même, mort, bien trop tôt hélas, dans un banal accident de voiture. Dans le premier de ces textes, intitulé Comme la neige sur les Alpes, l'évocation par Sebald de la figure du grand peintre vivant dans une époque gorgée d'horreurs et de fanatismes religieux est indissociable du thème de la vision ou plutôt de l'absence de vision, qu'il s'agisse de l'aveuglement provoqué par une blancheur inouïe ou par des actes de cruauté ou, au contraire, d'un spectacle tellement inconnu que le plus grand des peintres ne pourrait le figurer que maladroitement et, comme tel, n'en donner qu'une piètre et fugace esquisse.
Ainsi, l'aveuglement est-il dans ce premier poème en prose synonyme de douleur, curieusement caractérisée comme étant celle qui «bien avant le temps, / [...] entre déjà dans les tableaux» (p. 10), mais aussi d'yeux méthodiquement crevés puisque : «Le 18 mais, jour où la nouvelle [de la bataille de Frankhausen] / lui parvint, Grünewald / ne sortit pas de chez lui. / Mais il entendit le bruit des yeux / qu'encore longtemps on continua de crever / entre le lac de Constance / et la forêt de Thuringe» (p. 30). Cet aveuglement est encore signifié par le «nerf optique [qui] / se déchire», provoquant une cécité comparable à celle qu'induit un événement inscrit en filigrane du texte, lorsque «dans l'atmosphère immobile / tout devient blanc, comme la neige / sur les Alpes» (p. 32), événement qui ne peut que nous rappeler celui qui eut lieu en 352, «lorsque, / au plus fort de l'été / il a neigé / sur le mont / Esquilin à Rome» (p. 27). N'explicitons point trop ces références, ce texte est parfois hermétique, comme d'ailleurs les deux autres, et sa qualité poétique se nourrit de ce caractère-là.
L'aveuglement est encore provoqué par le spectacle étrange et grandiose d'une éclipse, le peintre ayant été le témoin «du mystérieux dépérissement du monde / au cours duquel un crépuscule fantomatique / en plein milieu du jour se déversa comme un évanouissement, / et dans la voûte du ciel, / sur les bancs de brouillard et les parois / des nuages, sur un bleu froid / et lourd, un rouge ardent se leva et des couleurs / errèrent, éclatantes, qu'aucun œil jamais / n'avait perçues et que le peintre / désormais ne peut chasser de sa mémoire» (ibid.).
Curieuse parabole que celle de ce peintre finalement mystérieux, qui semble ne peindre que pour figurer sur ses toiles l'extinction de la vision qui ne peut elle-même signifier qu'une extinction d'un ordre supérieur, apocalyptique, qui menace le monde, consomption finale plusieurs fois évoquée au cours de ce beau texte (cf. pp. 25 et 29) et indiquée à l'occasion par exemple de la description de la déposition du Christ constituant la partie inférieure du fameux retable d'Issenheim, «où Grünewald, jetant un regard pathétique / sur l'avenir, a préfiguré / une planète totalement inconnue, couleur de craie, / derrière le fleuve bleu-noir» (ibid.).
Dans le deuxième texte, sans doute le moins intéressant des trois, Sebald évoque un certain Georg Wilhem Steller ayant participé aux expéditions de l'explorateur Bering, alors que l'appel du Grand Nord polaire et de sa solitude mortelle semblent contrebalancer le grouillement humain, par exemple perceptible dans la ville de Saint-Pétersbourg (cf. p. 39), où toute vie est irrémédiablement frappée de déréliction : «Mais tout, dit Théophon, / tout, mon fils, se mue en vieillesse, / la vie devient moindre, / tout diminue, / la prolifération / des espèces n'est qu'une illusion, et personne / ne sait où cela mène» (p. 41).
Dans le dernier texte du triptyque, intitulé La sombre nuit fait voile où Sebald évoque sa propre enfance, nous retrouvons les différentes thématiques qu'il développera dans le reste de ses ouvrages, au premier rang desquelles le souvenir, toujours lié au travail incessant du cerveau comme fasciné par la remontée jusqu'aux origines, le «commencement», «avec quelques traces si ténues soient-elles / d'auto-organisation, et parfois il en résulte / un ordre, beau par endroits / et apaisant, mais aussi plus cruel / que l'état précédent d'ignorance» (p. 67). La perte de l'innocence, en somme, se paie, et qui veut savoir d'où il vient, une tâche que Sebald a illustrée de livre en livre, doit accepter de se tenir devant la corne de taureau, par exemple en acceptant de courir de devenir fou (cf. p. 70).
Le souvenir de l'enfance de Sebald explique sa fascination pour la catastrophe, qu'il s'agisse de celle de «Nuremberg en flammes» dont la mère de l'auteur ne se souvient «plus aujourd'hui» (p. 69), ou bien de celle, plus modeste mais ô combien frappante, qui eut lieu le jour même de sa naissance, «le jour de l'Ascension / de l'an quarante et quatre», lorsque la tempête foudroie un des quatre porteurs du dais processionnel. Plus tard, le jeune Sebald nous confie qu'il passe des heures «à la fenêtre près des pots de fuchsias», «sans rien faire pendant des heures que regarder au-dehors», et que cette muette contemplation l'a «amené de bonne heure à [se] représenter / une catastrophe silencieuse qui / simplement se produit devant le spectateur» (pp. 71-2).
L'évocation de l'être phantasmatique qui symbolise aux yeux de l'auteur cette catastrophe, «un nain tatar / avec autour de la tête un bandeau rouge et une plume / blanche recourbée» (p. 72) demeure, bien que séminale elle aussi, un rébus dont l'énigme ne nous est pas expliquée, comme l'a été l'exploration de la ville de Manchester (cf. pp. 77 et sq.) ruinée par un Progrès scientifique pour lequel même ceux qui lui ont consacré leur vie, tel l'ingénieur D. de Zurich, perdent leur foi (cf. p. 81).
Ailleurs, Sebald évoque les vers de Haller et de Hölderlin qui sont «emplis / d'une étrange lumière, et pourtant / il y a déjà là errance et perdition, aussi loin / que porte le cœur», sans doute, précise l'auteur, parce qu'il est «en effet impossible / de mettre en harmonie / les voies de l'évolution des grands systèmes, [puisque] trop diffus est l'acte / de violence, [et qu'] une chose est toujours / le commencement d'une autre / et inversement» (p. 82), comme si l'homme moderne ne possédait plus depuis longtemps déjà la capacité de comprendre ce qu'il a mis en branle, et qui désormais lui échappe, alors que la voix des poètes pourtant point si anciens que cela comme Hölderlin, encore lumineuse et rougeoyante des braises à demi éteintes, est elle aussi condamnée, au mieux, à la nostalgie de ce qui a été irrévocablement perdu.
Perdu ? Récapitulé peut-être, comme nous l'indique le septième et dernier chant du texte, où se déploie une magnifique vision apocalyptique : «Les villes / phosphorescentes sur la rive, / les usines rougeoyantes de l'industrie / attendant sous les panaches de fumée, / telles des géants marins, que mugisse / la corne de brume, les lumières convulsives / des voies ferrées et des autoroutes, le murmure / des mollusques de reproduisant par millions, / les cloportes et les sangsues, la pourriture froide, / les gémissements dans les squelettes rocheux, / l'éclat du vif-argent, les nuages / filant entre les tours de Francfort, / le temps étiré et le temps accéléré, / tout cela traversait mes sens, / déjà si proche de la fin / que le moindre souffle faisait tressaillir / mon visage» (pp. 87-8).






























































 Imprimer
Imprimer