« Soumission de Michel Houellebecq, ou la shahada de Folantin | Page d'accueil | Paroles du Christ de Michel Henry »
15/01/2015
Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 La démonologie dans la Zone.
La démonologie dans la Zone.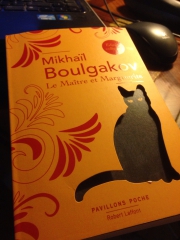 Je ne me bornerai, sur ce grand roman touffu qu'est Le Maître et Marguerite, inépuisable, même, comme tous les grands romans sont inépuisables, à quelques remarques. En aucun cas, de fait, ces quelques lignes ne constituent une critique à proprement parler. Je me suis servi de l'édition, comme toujours impeccable, publiée dans la collection Pavillons Poche chez Robert Laffont (1968, puis 2012), la traduction ayant été donnée par Claude Ligny et une intéressante préface par Sergueï Ermolinski, qui affirme que Boulgakov, jusqu'à ses tout derniers jours, s'inquiétait de ce roman achevé en 1940 et qui ne parut en URSS qu'en 1966, lequel exigeait qu'on lui en relise certaines pages (p. 47), peut-être celles, si belles et étranges, qui décrivent la confrontation entre le Procurateur de Judée, Ponce Pilate, et celui qu'il ne peut se résoudre que difficilement à faire exécuter, Yeshoua Ha-Nozri.
Je ne me bornerai, sur ce grand roman touffu qu'est Le Maître et Marguerite, inépuisable, même, comme tous les grands romans sont inépuisables, à quelques remarques. En aucun cas, de fait, ces quelques lignes ne constituent une critique à proprement parler. Je me suis servi de l'édition, comme toujours impeccable, publiée dans la collection Pavillons Poche chez Robert Laffont (1968, puis 2012), la traduction ayant été donnée par Claude Ligny et une intéressante préface par Sergueï Ermolinski, qui affirme que Boulgakov, jusqu'à ses tout derniers jours, s'inquiétait de ce roman achevé en 1940 et qui ne parut en URSS qu'en 1966, lequel exigeait qu'on lui en relise certaines pages (p. 47), peut-être celles, si belles et étranges, qui décrivent la confrontation entre le Procurateur de Judée, Ponce Pilate, et celui qu'il ne peut se résoudre que difficilement à faire exécuter, Yeshoua Ha-Nozri.La trame de l'histoire est célèbre, tout comme son début : tandis que deux imbéciles lettrés (dont un poète raté qui finira à l'asile) discutent de la certitude que le Christ n'a jamais existé, un rédacteur en chef ayant «commandé au poète, pour le prochain numéro de la revue, un grand poème antireligieux» (p. 58), un mystérieux personnage arrivé à Moscou, entame l'histoire qui sera celle racontée par l'écrivain qui se fait appeler le Maitre, et qui décrit donc les dernières heures du Christ, et les tourments intérieurs que celle-ci engendra dans l'esprit et le cœur de Pilate.
 «Figurez-vous que Jésus a réellement existé» (p. 72), affirme, bravachement, celui qui n'est autre que Woland, Satan, et Ponce Pilate le sait, lui plus que tout autre, parfaitement, comme il sait que «l'immortalité est venue» (p. 98, mais pas la sienne, sa fausse immortalité, son immortalité abjecte), pensée douloureuse qu'il ne parvient pas à chasser de son esprit, même s'il ne veut pas le reconnaître et ne trouvera la paix, après des siècles de tourment, que par l'intervention du Maître, qui lui pardonnera son prodigieux forfait (cf. p. 619), et le rendra libre, abolissant en quelque sorte cette fausse liberté acquise par le meurtre du Christ.
«Figurez-vous que Jésus a réellement existé» (p. 72), affirme, bravachement, celui qui n'est autre que Woland, Satan, et Ponce Pilate le sait, lui plus que tout autre, parfaitement, comme il sait que «l'immortalité est venue» (p. 98, mais pas la sienne, sa fausse immortalité, son immortalité abjecte), pensée douloureuse qu'il ne parvient pas à chasser de son esprit, même s'il ne veut pas le reconnaître et ne trouvera la paix, après des siècles de tourment, que par l'intervention du Maître, qui lui pardonnera son prodigieux forfait (cf. p. 619), et le rendra libre, abolissant en quelque sorte cette fausse liberté acquise par le meurtre du Christ.Les pages où Pilate, affligé d'une hémicrânie qui ne le laisse jamais en paix, interroge fébrilement le Christ qu'il est prêt à libérer (c'est le grand prêtre Joseph Caïphe qui exigera sa mort, avec deux autres condamnés, Hestas et Dismas, sur le Mont Chauve) sont magnifiques, et mériteraient à elles seules une longue étude détaillant leur richesse et leur beauté, mais les nombreuses différences existant entre l'histoire que Boulgakov invente et celle que nous rapportent les évangiles synoptiques, par exemple concernant ce qu'il nous est dit de Judas de Kérioth, l'homme qui, pour trente tétradrachmes, a aidé à faire arrêter Jésus.
Le style en est ample, les descriptions frappantes, et c'est une même mélancolie crépusculaire qui baigne les scènes de ce livre dans le livre, qui ne sont jamais totalement coupées du reste de l'histoire à la tonalité franchement picaresque et terriblement drôle et ironique, que nous raconte l'écrivain.
Cette autre histoire, imbriquée constamment avec celle de Pilate, se déroule à Moscou et n'est qu'une suite de numéros de prestidigitation, d'hypnose à grand échelle et de ventriloquie diabolique (cf. p. 624) dirait-on sans fin, les épisodes où Woland, «professeur de magie noire» (p. 168) et ses sbires ne paraissant jamais pouvoir s'arrêter de s'amuser avec tous les pitres et les fats (dont certains finiront à l'asile) de la société littéraire moscovite : en effet, «il suffit, comme on le sait, que la sorcellerie commence pour que plus rien ne l'arrête» (p. 162).
Rares sont les personnages qui comprennent qu'ils ont en fait rencontré Satan (cf. p. 252), réduit, comme son adversaire le Christ, à n'être qu'une fable, et c'est peut-être l'intérêt le plus profond du roman de Boulgakov que d'affirmer que des puissances spirituelles supérieures, bonnes ou mauvaises, et surtout mauvaises mais si terriblement drôles, existent jusqu'au cœur de la capitale de la glorieuse, matérialiste et athée Russie soviétique.
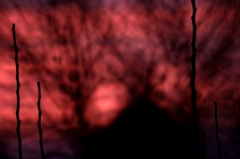 La démonologie que Boulgakov déploie n'est guère originale, le personnage de Faust, surtout l'opéra qu'en donna Gounod, y jouant un rôle référentiel primordial, la description de Woland (1) renvoyant aux caractéristiques habituelles de l'Esprit du Mal, les tours joués par la compagnie des diables ressortissant au domaine de l'illusion et de la prestidigitation, du mauvais rêve, de ce que les anciens appelaient les pompes du diable (cf. p. 464, où la foule du bal redevenant pourriture dès que ce dernier se termine), l'écrivain transformant même, là encore de façon classique si l'on se souvient du sabbat peint par Goethe, la belle Marguerite en sorcière conduite grâce à un onguent magique que lui donne Azazello à un immense bal donné par Woland (2), l'érotisme réel de ces pages savoureuses se bornant à quelques descriptions de la nudité de l'héroïne et de sa servante, Marguerite ayant de toute façon donné son cœur au Maître, puisque l'amour a surgi devant elle «comme surgit de terre l'assassin au coin d'une ruelle obscure» (p. 259).
La démonologie que Boulgakov déploie n'est guère originale, le personnage de Faust, surtout l'opéra qu'en donna Gounod, y jouant un rôle référentiel primordial, la description de Woland (1) renvoyant aux caractéristiques habituelles de l'Esprit du Mal, les tours joués par la compagnie des diables ressortissant au domaine de l'illusion et de la prestidigitation, du mauvais rêve, de ce que les anciens appelaient les pompes du diable (cf. p. 464, où la foule du bal redevenant pourriture dès que ce dernier se termine), l'écrivain transformant même, là encore de façon classique si l'on se souvient du sabbat peint par Goethe, la belle Marguerite en sorcière conduite grâce à un onguent magique que lui donne Azazello à un immense bal donné par Woland (2), l'érotisme réel de ces pages savoureuses se bornant à quelques descriptions de la nudité de l'héroïne et de sa servante, Marguerite ayant de toute façon donné son cœur au Maître, puisque l'amour a surgi devant elle «comme surgit de terre l'assassin au coin d'une ruelle obscure» (p. 259).Ce qui frappe avant tout, au-delà du romantisme noir évident de certaines images (cf. p. 586), est la liberté à laquelle aspirent les personnages principaux du roman, qui ne cessent de s'échapper de leurs prisons communes, le Maître, dans un passage retranché du roman, posant l'équivalence entre papiers d'identité et existence (cf. p. 485), et qui grâce à Woland peuvent chevaucher dans les airs et s'enivrer de la splendeur de la nuit, s'échapper de la clinique pour fous où ils sont enfermés, car cela n'a aucun sens de «mourir dans une salle d'hôpital, au milieu des gémissements et des râles des malades incurables» (p. 364), et qu'il vaut donc bien mieux «organiser un grand festin et ensuite prendre du poison, et passer dans l'autre monde au son des violons, entouré d'enivrantes beautés et de hardis compagnons» (pp. 364-5). Le personnage de Marguerite, sous le rapport de la liberté, est d'ailleurs bouleversant, superbe femme libre qui décide, quoi qu'il lui en coûte, d'aimer le Maître, qui lui est fidèle, et pas seulement de corps, alors que, devenue la Reine du bal satanique, elle eût pu choisir de bien plus prestigieux prétendants qu'un écrivain obscur mais génial ! C'est peut-être Marguerite qui est la plus belle création de Boulgakov, magnifique femme blonde (mais je puis me tromper... Oui, elle est brune) dans laquelle il a salué l'invincible courage des femmes et leur magnifique liberté, leur absence de peur, leur instinct aussi souple et à la fois résistant qu'une peau de bête, à mille lieues de tant d'exemples quotidiens de créatures plus ou moins lascives qui ne savent pas dire oui, qui ne savent pas dire non, et qui se prennent pour des princesses de haut rang quand elles laissent tomber un miroitant peut-être de leurs lèvres qu'elles supposent tentatrices, parole abjecte que quelque malheureux recevra comme un don du ciel, Marguerite qui est aussi à mille lieues de tant de petites Lolitas avides de reflets et dont les prénoms et jusqu'aux discours sont absolument interchangeables, jeunes femmes vieilles déjà faisandées et dont le plus banal regard trahit, moins que la connaissance de tous les vices qui ne sont jamais si nombreux qu'on le pense, l'évidence du cœur pourri, de l'âme traître, de la volonté tout juste apte à choisir le mâle qui saura contenter leurs reins mille fois ensemencés, de tant d'autres encore qui, après avoir hurlé leur amour à leur amant, n'ont eu de désir plus pressé que de s'égosiller, auprès d'un autre auquel elles s'attacheront de façon tout aussi indéfectible, l'espace de quelques jours de plaisirs convenus. Morne vie de femmes pas prises, d'hommes pas aimés, de paroles enfuies, oubliées, jamais dites ou bien dites et bafouées, ah, comme Marguerite a raison, avec l'aide du diable, de vouloir saccager le si paisible confort où nous planquons notre peur de la vie !
C'est d'ailleurs cette dimension qui atténue les diableries de Woland et de ses acolytes, puisque Satan sauve des flammes le manuscrit du livre du Maître, et qu'il ne s'agit pas là d'un mauvais tour, puisque l'exemplaire ne se dissipe pas en fumée une fois la plaisanterie jouée (cf. p. 497), comme si Satan acceptait tacitement de coopérer avec Dieu pour rappeler aux hommes leur existence commune, comme l'indique d'ailleurs l'épigraphe du roman emprunté au Faust de Goethe. Woland évoque auprès de Mathhieu Lévi qui d'ailleurs le traite de «vieux sophiste», une seule fois, cette collaboration nécessaire entre les lumières et les ténèbres : «Tu as prononcé tes paroles comme si tu refusais les ombres, ainsi que le mal. Aie donc la bonté de réfléchir à cette question : à quoi servirait ton bien, si le mal n'existait pas, et à quoi ressemblerait la terre, si on effaçait les ombres ? Les ombres ne sont-elles pas produites par les objets, et par les hommes ? Voici l'ombre de mon épée. Mais il y a aussi les ombres des arbres et des êtres vivants. Veux-tu donc dépouiller tout le Globe terrestre, balayer de sa surface tous les arbres et tout ce qui vit, à cause de cette lubie que tu as de vouloir te délecter de pure lumière ?» (p. 588).
Il est à ce titre très amusant de voir l'un des diables et serviteurs de Woland, Koroviev, prouver par l'absurde que Dostoïevski est un grand écrivain, pas de doute là-dessus nous affirme-t-il (cf. p. 578), comme si Satan était en fin de compte le meilleur juge de la grandeur d'un écrivain dans un pays cadenassé, ne croyant plus à la beauté, à l'art, à Dieu et au diable, et qui ne veut plus rien savoir, même, de la grandeur, dût-elle ne point excéder la taille du Petit père des peuples, Staline.
Notes
(1) «Deux yeux étaient fixés sur le visage de Marguerite. Au fond de l’œil droit brûlait une étincelle, et cet œil paraissait capable de fouiller une âme jusqu'à ses plus secrets replis. L’œil gauche était noir et vide, comme un trou étroit et charbonneux, comme le gouffre vertigineux d'un puits de ténèbres sans fond. Le visage de Woland était dissymétrique, le coin droit de sa bouche tiré vers le bas, et son haut front dégarni était creusé de rides profondes parallèles à ses sourcils pointus. La peau de son visage semblait tannée par un hâle éternel» (p. 432).
(2) Boulgakov semble se souvenir, pour l'attirail diabolique, du Roman de Léonard de Vinci de son compatriote Merejkovski et, plus largement, de nombreuses œuvres romantiques ou symbolistes, tout comme celles de Hoffmann, qu'il appréciait beaucoup, dont la vie misérable était bien connue en URSS et qu'il ne manquait pas de rapprocher de la sienne, condamné à devoir exécuter des travaux alimentaires et honni par la critique officielle.






























































 Imprimer
Imprimer