« La toile d’araignée de Joseph Roth, par Gregory Mion | Page d'accueil | Ken Loach : l’infatigable contempteur des politiques de mort, par Gregory Mion »
17/12/2019
Révolution 2 : Révolution et contre-révolution romaines, par Francis Moury

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Rappel
RappelRévolution 1 : Révolution et contre-révolution nationales-socialistes, ici.
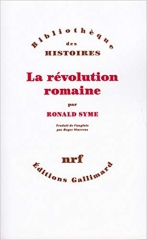 Note de lecture sur Ronald Syme, La Révolution romaine (1939-1951, traduction, 1967, par Roger Stuveras, nouvelle édition Gallimard, coll. NRF-Bibliothèque des histoires, novembre 2016, 670 pages environ). Acheter ce livre sur Amazon.
Note de lecture sur Ronald Syme, La Révolution romaine (1939-1951, traduction, 1967, par Roger Stuveras, nouvelle édition Gallimard, coll. NRF-Bibliothèque des histoires, novembre 2016, 670 pages environ). Acheter ce livre sur Amazon.«καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει»
Pour se justifier, ils changèrent la valeur habituelle des mots par rapport aux actes qu'ils qualifient.
Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, III, 82.
«Vetus ac jam pridem insita mortalibus potentiae cupido cum imperii magnitudine adolevit erupitque.».
L'antique soif de puissance, depuis longtemps innée au cœur des mortels, a grandi et fait explosion avec l'expansion de notre empire.
Tacite / Publius Cornélius Tacitus, Histoires, II, 38.
«C'est un ordre des Dieux qui jamais ne se rompt,
De nous vendre un peu cher les grands biens qu'ils nous font.».
Pierre Corneille, Cinna (1639-1643), II, 1, 559-560.
«Ce n'est pas la fortune qui domine le monde. On peut le demander aux Romains, qui eurent une suite continuelle de prospérités quand ils se gouvernèrent sur un certain plan et une suite non interrompue de revers lorsqu'ils se conduisirent sur un autre. Il y a des causes générales, soit morales, soit physiques qui agissent dans chaque monarchie, l'élèvent, la maintiennent, ou la précipitent; tous les accidents sont soumis à ces causes; et, si le hasard d'une bataille, c'est-à-dire une cause particulière, a ruiné un État, il y avait une cause générale qui faisait que cet État devait périr par une seule bataille : en un mot, l'allure principale entraîne avec elle tous les accidents particuliers.»
Charles-Louis de la Brède, baron de Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains (1734), §XVIII.
«À Rome, malgré toutes les pseudo-révolutions, la grande crise, profonde et radicale, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de la masse, fut toujours évitée».
Jacob Burckhardt, Considérations sur l'histoire du monde (1868 + cours et articles posthumes édités en 1905), version française de S. Stelling-Michaud, § IV (éditions PUF 1938, pp. 161-163).
«Restait le choix des moyens à employer. Ici encore les faits, ces créateurs tout puissants d'histoire, répondaient avec une clarté aveuglante. Au cours du dernier siècle de la République, patrie et régime se sont révélés choses inconciliables. En pareil cas, hésiter serait un crime. Une seule solution : le pouvoir personnel, devenu une nécessité pour le monde romain. Mais aussi – seconde leçon des réalités – impossibilité de la formule monarchique telle que César l'avait concue.et sur laquelle, pour le moment du moins, l'expérience venait de prononcer une sentence sans appel».
Léon Homo, Nouvelle histoire romaine, III L'Apogée, § 1 Auguste le fondateur (éditions Librairie Arthème Fayard, 1941 retirage 1958, p. 294).
Peut-on poser aux historiens grecs et romains antiques des questions qu'ils ne se sont pas posées ? Des questions concernant plus particulièrement la période-charnière allant des années 60 avant Jésus-Christ à 15 après Jésus-Christ ? Période-charnière car en 61 avant Jésus-Christ, Caius Julius Caesar, Cnaeus Pompeius Magnus et Marcus Licinius Crassus forment le premier triumvirat. En 14 après Jésus-Christ, l'empereur Auguste meurt et il est divinisé : l'empereur Tibère lui succède. Les contemporains ont commenté les conditions de cette chute de la République romaine et de la naissance de l'Empire romain. Nous savons, autant par ce qu'ils nous en ont raconté que par la manière dont ils nous l'ont raconté, qu'ils croyaient à la liberté mais ne croyaient pas au progrès, encore moins à la démocratie qui était pour eux le pire des régimes et l'antithèse même de l'idée de République. L'histoire de la civilisation était, à leurs yeux, soit l'histoire d'une décadence, soit celle de cycles de constructions puis de destructions vouées à se reproduire sans raison ou sous la seule raison d'un destin obscur, d'une nécessité de fer (1).
Octavius, futur Auguste (petit-fils de Julia, une des sœurs de César), lorsqu'il prit illégalement le pouvoir par les armes (une armée privée payée par sa fortune personnelle et celle de ses associés et partisans) pour venger décidément la mort de César (15 mars 44 avant Jésus-Christ), instaura sans réflexion théorique préalable, simplement à partir de la situation contemporaine révolutionnaire qu'il analysa correctement, l'ordre nouveau du Principat qui devait déboucher sur l'empire romain et sur la puissance mondiale inégalée de la dynastie julio-claudienne. Auguste devint donc auteur d'une révolution qui renversa définitivement la République romaine puis auteur d'une contre-révolution consciente dont Virgile, Horace, Tibulle, Properce, Ovide, Tite-Live furent les témoins voire les contributeurs à divers degrés; Ovide le fut jusqu'en 8 avant Jésus-Christ, date de son ordre exil reçu d'Auguste, exil qui fut maintenu par Tibère. Les effets sociologiques de cette contre-révolution furent une restauration morale, une extension du nationalisme (romain puis italien puis impérial : Syme montre que le changement d'échelle ne fut pas géographique mais politique), une renaissance religieuse, certes déjà amorcée, concernant cette dernière, au temps de la République dès l'époque de Cicéron (2). Elle fut appuyée par des groupes sociaux et des individus aux intérêts momentanément convergents mais ses effets durèrent bien au-delà d'eux : l'idéal politique antique hellénistique puis l'idéal médiéval occidental s'inspirent de l'empire augustéen; certains aspects de notre histoire moderne et contemporaine lui empruntent également certains traits.
C'est ce résultat inédit d'une contingence absolue et que rien ne laissait prévoir (Auguste, d'apparence fragile, vécut bien plus longtemps qu'on aurait pu s'y attendre alors qu'aucun de ses enfants ne devint empereur tandis que l'attitude des «nobiles» à son égard était imprévisible et demeura fluctuante : il y eut les ralliés, les neutres et les hostiles au sein d'une même famille ou parfois au sein d'une même vie individuelle) que peint Ronald Syme dans cet ouvrage monumental désormais classique paru en 1939, en édition revue et corrigée par l'auteur en 1951, puis en traduction française en 1967 et enfin dans cette nouvelle édition 2016. Il y a une certaine ironie historique dans ces dates : l'histoire adresse de ces clins d'oeil aux historiens. Une édition originale parue au début de la Seconde guerre mondiale, une traduction française parue au début des événements de 1968. Cette réédition 2016 (dont je donne ici la chronique – que le lecteur patient veuille bien me pardonner le délai écoulé entre la parution et la chronique - avec trois ans de retard, en cette fin d'été 2019) sera lue par une génération peut-être plus désabusée et moins naïve que ne le furent certaines générations du siècle passé.
Sir Ronald Syme (1903-1989) peut être considéré comme le Tacite anglais, en tout cas comme le plus grand historien anglais de l'antiquité romaine depuis Edward Gibbon (3). Tout comme Gibbon, Syme est pessimiste et il brosse, tout comme Tacite, l'inéluctable chute des nobles familles romaines, chute corollaire de celle de la République romaine remplacée par le Principat d'Auguste, principat lui-même progressivement transformé en règne impérial dynastique. C'est que ses modèles historiographiques le sont aussi : ils n'ont pas la naïveté démocratique de nos historiens français de la seconde moitié du vingtième siècle. Syme a pour maîtres grecs Thucydide et Dion Cassius, pour maîtres romains Salluste, Asinius Pollion, Suétone et Tacite. Les remarques de Syme sur leur style me semblent confirmer qu'il partage leur vision du monde, outre le fait qu'il les cite également pour critiquer, avec une précision et une sévérité inégalées, les autres sources grecques et romaines, à commencer par Velleius Paterculus (l'historien officiel de Tibère) mais aussi les sources littéraires augustéennes classiques telles que Virgile, Horace et Tite-Live. Il s'appuie pour cela non seulement sur une connaissance magistrale des lettres grecques et latines mais encore sur celle de la Prosopographia Imperii Romani (première édition à Berlin en 1897-1898) ainsi que sur celle des généalogies des familles nobles qui furent, depuis les Rois romains les plus anciens jusqu'à la République puis à l'Empire, le constant arrière-plan actif de l'histoire romaine antique.
Syme rejette la tradition historienne démocratique moderne qui considère la théorie politique cicéronienne comme la source théorique de l'action politique de César Auguste («Octavius» puis «Caesar Augustus» puis «Divus Julius Augustus») :
«Les savants, attentifs à scruter l'histoire des idées et des institutions, ont prétendu qu'environ quinze ans après sa mort revivait beaucoup plus que le souvenir et l'éloquence de Cicéron; toute sa conception de l'État romain triomphait après sa mort, en prenant forme et consistance dans la République nouvelle de César Auguste.
Ce serait une consolation si c'était vrai» (p. 303).
Les pages suivantes démontrent avec une sombre ironie, alternativement tendue et tragique, d'une sobriété ramassée héritée directement de Tacite, en quoi César Auguste n'adopta précisément pas la théorie cicéronienne du principat, en dépit d'une rencontre sémantique de surface. Syme traque les choses derrière les mots : il ne se paye jamais de mots. Le spinoziste Charles Appuhn pouvait encore s'y laisser prendre dans son édition-traduction du De Republica de Cicéron (4) en remarquant que ce dernier usait du terme princeps civitatis, repris par Auguste quelques années plus tard. Cicéron (bon connaisseur de l'histoire et des lettres grecques) se souvenait de Périclès mais il n'imaginait pas encore ce que serait la réalité du règne impérial d'Auguste qu'il crut bon de soutenir contre Antonius qui avait pourtant la légalité de son côté. Ce défaut de prévision devait abaisser son cou sous le couteau des assassins, quelques années plus tard (le 7 décembre 43 avant Jésus-Christ).
Vers 1960, la myopie française est toujours de mise. Claude Nicolet et Alain Michel connaissent certes, en 1961, l'existence du livre de Syme et ils savent que l'augmentation des connaissances en histoire politique, amène le professeur d'Oxford à une révision du rôle politique de Cicéron tout comme à une révision de sa position historique mais ils maintiennent pourtant in extremis la thèse traditionnelle française (dont ils fournissent une bibliographie détaillée de 1920 à 1960) de la préparation théorique du principat d'Auguste par les thèses politiques de Cicéron (5). Il faut dire que, à droite, au centre comme à gauche, l'université française demeurait fascinée par le déterminisme du dix-huitième siècle. Louis Althusser (6) et Raymond Aron (7) en créditaient presque simultanément Montesquieu, celui des Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains autant que celui de L'Esprit des lois mais la conception des lois de Montesquieu ne pouvait pourtant guère permettre de comprendre celle de Cicéron : pour celui-ci, les lois sont des commandements divins intangibles fondés sur la nature des choses; pour celui-là, elles sont des rapports observables entre des variables contingentes.
Toutes ces illusions françaises sont balayées d'un revers de main autant par Tacite que par Syme lecteur de Tacite qui s'avère capable de replacer l'œuvre de Tacite lui-même dans l'histoire politique et psychologique de l'empire postérieur à celui d'Auguste. La mort, la folie, la décadence ont accompagné ouvertement ou secrètement le Principat d'Auguste et ceux de ses successeurs julio-claudiens mais il n'y avait pas de fatalité structurelle ni de loi structurelle à l'œuvre dans cette histoire : la fortune, le destin, la contingence, ont joué leur rôle. Cette structure politico-juridique du Principat s'est maintenue pendant des siècles parce qu'elle apportait à la société romaine la paix et l'ordre (Pax et Princeps, voir Syme, §XXXIII) après des dizaines d'années de combats et de guerres civiles dévastatrices pour l'Occident, le Proche-Orient et l'Afrique mais dévastatrices d'abord pour Rome et pour l'Italie puisque des populations entières de villes importantes furent décimées dans des conditions de cruauté aujourd'hui inimaginables. Elle naquit et se maintint avec l'accord (parfois partiel... c'est toute la science historique de Syme de déterminer précisément ce degré de partialité à l'aide des sources) parfois suicidaire des familles nobles les plus puissantes du temps des anciens rois et de l'ancienne république (ceux auxquels était réservé par défaut le consulat), avec le concours moins suicidaire des chevaliers et des «hommes nouveaux». Les fonctions conservaient les mêmes noms : il y avait toujours des consuls, des tribuns, des préteurs, des fonctionnaires de rang varié mais les «hommes nouveaux» du régime montèrent avec lui puis disparurent sans laisser de postérité politique ni dynastique, surtout lorsqu'ils effleuraient les plus hautes couches de la société, celles dont la fréquentation était la plus dangereuse. À mesure qu'on se rapprochait physiquement et professionnellement des cercles du pouvoir, on risquait automatiquement davantage sa vie et ses biens : procès, accusations de trahison, jalousie, meurtres, exécutions, relégation décimèrent régulièrement les premiers cercles. Le pouvoir personnel dynastique des grandes familles romaines fut progressivement neutralisé par le pouvoir impérial : des individualités d'élite, il ne demeura bientôt plus qu'un souvenir fasciné.
Pourquoi le Principat naquit-il, pourquoi disparut-il ? Répondre à ces questions, c'est souvent en France choisir une philosophie de l'histoire voire même une attitude politique. Pas en Angleterre : la réponse de Gibbon à la seconde question est, par exemple, bien connue. Il pensait que le régime impérial romain disparut à cause du christianisme, facteur de rénovation politique. Cette réponse tranchée n'a rien d'évident : les empereurs devenus chrétiens, tout demeurait possible : saint Augustin n'était pas si catégorique concernant une incompatibilité structurelle entre politique romaine et religion. Les historiens romains antiques païens ne l'étaient pas non plus : Syme restitue leur ancien point de vue. Il s'attache d'abord aux historiens-témoins actifs et plaideurs pro-domo de la génération républicaine qui connut les guerres civiles : Salluste, Cicéron, César. Il se tourne ensuite vers les lettres latines du Principat d'Auguste (propagande de Tite-Live et Virgile) puis de Tibère (histoire de Vellieus Paterculus) et vers l'histoire antique postérieure. Les faits non rapportés, les noms oubliés, les compliments adressés ou non par un Horace parlent ainsi autant, grâce à Syme, que les faits rapportés et les noms cités par les autres. Ce qui amène Syme à reconstituer la réalité des rapports de force au prix d'un travail précis, restituant aussi archéologiquement l'histoire secrète (oubliée ou cachée par la propagande impériale) des familles et des alliances au moyen des inscriptions et des monuments. L'histoire antique, en tant que science visant la vérité, redevient bientôt grecque (Plutarque, Dion Cassius) – éloignés de Rome, ils peuvent s'exprimer plus librement - avant qu'elle ne redevienne plus tard romaine bien après le Principat d'Auguste, sous des empereurs plus libéraux : Suétone et Tacite sont alors libres d'écrire la vérité sur les guerres civiles républicaine et sur l'histoire de l'empire julio-claudien.
Parlant des époques dont ils ont choisi de parler, ces historiens romains (sans oublier les témoins actifs tels que Sénèque le philosophe stoïcien qui fut conseiller politique de Caligula puis de Néron mais rapporte à l'occasion des anecdotes du temps d'Auguste) parlent inévitablement d'eux. En examinant leurs textes Syme répond, par le biais de l'analyse littéraire et politique des œuvres de Salluste, de Cicéron, de César, de Virgile, de Tite-Live, d'Horace, de Sénèque, de Suétone et de Tacite, à la question philosophique initiale, celle du rapport de l'historien à l'histoire : poser des questions qu'elle ne s'est pas posée à une époque semble possible puisque, de facto, chaque époque procéda ainsi. Il y a une transcendance de chaque époque, une objectivité de chaque époque mais cette transcendance et cette objectivité font sens parce qu'elles nous font signe par-dessus, par-delà leurs propres limites temporelles. Ce qui leur permet de dialoguer, par l'intermédiaire de leurs historiens. On retrouve alors, tout naturellement, cette autre grande question que posait si précisément et si clairement Henri Gouhier : peut-on poser non seulement à une histoire mais encore à une philosophie (y compris à une philosophie de l'histoire) les questions qu'elle ne s'est pas posées ? (8)
Chaque époque comporte certes des écrivains qu'aucun régime n'explique et que l'historien ne peut circonscrire tant leur individualité est puissante : telles paraissent les puissantes personnalités de Salluste, de Lucrèce («[...] un solitaire dont la personnalité pose une énigme [...]», écrit Syme page 241), d'Asinius Pollion, de Tacite. Le cas de Tacite est celui d'un fonctionnaire impérial consciencieux qui demeure fasciné par la noblesse républicaine antique. L'histoire que Tacite écrit (notamment sa dernière œuvre, les Annales), veut établir et comprendre les causes de sa disparition : les pages que lui consacrent Syme comptent parmi les plus riches du livre. Syme insiste par ailleurs sur le fait que la fidélité familiale et les liens d'amitiés et de clientèle l'emportent régulièrement sur les liens administratifs ou militaires qu'ils contrebalancent voire subvertissent parfois. La politique d'Auguste fut non moins ambivalente à cet égard que celle de ses prédécesseurs et celle de ses successeurs. Au lecteur de Syme comme à celui de Tacite, Corneille apparaît donc, rétrospectivement, comme ayant bien restitué l'esprit politique et psychologique des Romains du Principat. Corneille en était conscient qui écrivait modestement mais nettement dans son Examen de Cinna (1660) : «[...] Rien n'y contredit l'histoire bien que beaucoup de choses y soient ajoutées [...]». Il n'est pas certain, au demeurant, selon Syme, que la conjuration de Cinna, telle qu'est rapportée par les historiens antiques, fût conforme à la vérité historique ni même qu'elle ait tout bonnement existé.
Sur le plan matériel, le livre se divise en deux parties : la première constituée par les abréviations des sources principales, suivies des cinq cents pages du corps principal du texte puis la seconde, une colossale annexe comportant cent pages de notes serrées. L'annexe comporte en outre une bibliographie d'études historiques (jusqu'en 1939), cinquante pages d'index, une liste des consuls romains de 80 avant Jésus Christ à 14 après Jésus Christ, des tableaux généalogiques des grandes familles romaines, depuis les origines royales archaïques à la fin de l'empire : les Metelli, les Catons, la famille d'Auguste et celle des Julio-Claudiens apparentés, les Aemilii Lepidi, les descendants de Pompeius Magnus, la famille de Séjan, celle de Varus. Il faut apprendre à manipuler l'index à vocation essentiellement prosopographique : on ne trouvera ainsi pas les références tacitiennes à «Tacite» mais à «Cornelius Tacitus» : la première entrée existe bien entendu et renvoie à la seconde. Il permet de distinguer (et de se remémorer, à mesure qu'on le consulte en cours de lecture) les faux-amis : ils sont nombreux et riches d'enseignement historique. Sa précision n'a d'égale que sa richesse. Les tableaux généalogiques permettent enfin de se faire une idée visuelle immédiate de l'ampleur de la puissance des familles romaines qui firent la politique de l'antiquité romaine durant une dizaine de siècles, de la fondation de Rome (753 avant Jésus-Christ) à la chute de l'empire (476 après Jésus-Christ).
Les citations grecques et latines sont systématiquement insérées sous la forme [texte + traduction] dans le corps principal comme dans les notes de l'ouvrage. Les références sont parfois anglicisées : par exemple, «Pline l'ancien, NH[Natural History]» alors que lecteur français s'attendrait à l'habituel «Pline l'ancien, HN [Histoire Naturelle]». Il suffit de rétablir mentalement l'abréviation à laquelle on est habitué : le cas se produit rarement et les abréviations sont, en général, immédiatement identifiables. La bibliographie concerne les études historiques mais pas les sources : les éditions des auteurs grecs et romains ne sont donc ni rassemblées ni référencées. Les textes antiques sont cités sans indication d'édition mais, bien sûr, avec leurs indications classiques de numéro de livres, de chapitres, de paragraphes.
Quelques coquilles sont disséminées dans le texte principal et dans les notes. Par exemple, page 181, on lit : «Le nouveau consul entra alors à Rome pour accomplir la (sic) sacrifice dû aux dieux immortels». Page 411, on lit : «Pas un mot ne fut prononcé au Sénat concernant l'exécution sommaire d'Agrippa Postumus. Il (sic) fut ordonné (sic) et accompli (sic) en secret par les soins du ministre Sallustius Crispus». Elles sont rares sur les 670 pages environ que compte l'ensemble, y compris dans la centaine de pages de notes de taille 5 ou 6 d'une solide richesse littéraire et archéologique qu'auraient certainement admirée les grands prédécesseurs de Syme que furent Gibbon et Mommsen.
Notes
1) Cf. Platon, Critias + Lucrèce, De Natura rerum, fin du livre V + Cicéron, Des lois, II, 16, 40. Quant au De Republica de Cicéron, il adapte parfois curieusement ses modèles platoniciens (Cicéron fut un grand lecteur de Platon) à l'ancienne République romaine de l'époque des Scipion Aemilien, fondée sur une oligarchie aristocratique à laquelle Marcus Tullius Cicéron n'appartenait pas.
2) Cf. Pierre Boyancé, Sur le Songe de Scipion (article paru in revue L'Antiquité classique, tome 11, Bruxelles 1942), note 1 de la page 6 et plus généralement la “thèse secondaire” de Pierre Boyancé, Études sur le Songe de Scipion, 1936. Boyancé fut le disciple de maîtres tels que Franz Cumont, Jérôme Carcopino, Émile Mâle et un ami de Pierre-Maxime Schuhl. Boyancé discuta en outre à l'Association Guillaume Budé, la question de savoir lequel, de Cicéron ou de Jules César, avait été celui qui prépara le plus directement l'avènement d'Auguste : il semble qu'il ait penché (au témoignage de Fernand Robert) pour Cicéron mais l'historien des religions et des idées qu'était Boyancé l'emporta probablement sur l'historien tout court... qu'il était aussi. Voir également, sur la question du génie romain dans l'histoire des religion, outre l'étude ancienne classique mais toujours consultable d'Albert Grenier, la synthèse plus récente de Jean Bayet, Histoire politique et psychologique de la religion romaine (éditions Payot, 1957).
3) Edward Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'empire romain (1776-1788).
4) Cicéron, De la république - Des lois, texte établi avec traduction, notices et notes par Charles Appuhn (Classiques Garnier 1954, tirage 1963), note 235 du livre V du De Republica, p. 404.
5) Claude Nicolet et Alain Michel, Cicéron par lui-même (éditions du Seuil, collection Écrivains de toujours, 1961), p.185. Cette vision persiste dans Claude Nicolet, Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine (éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque des histoires, 1976) dont Alain Michel signait, sans vraiment surprendre, un compte-rendu enthousiaste dans les Lettres d'humanité, in volume 35 de ce supplément au Bulletin de l'Association Guillaume Budé, n°4 de 1976. La figure politique de Cicéron fut l'objet de portraits (pro et contra) de la part d'historiens français aussi talentueux et divers que Gaston Boissier, Jérôme Carcopino, André Piganiol, Henri-Irénée Marrou. Syme maintient dresse un portrait complet, équilibré mais sans indulgence excessive car remis en situation avec une précision magistrale.
6) Louis Althusser, Montesquieu – La politique et l'histoire (éditions PUF, 1959).
7) Raymond Aron, Les Étapes de la pensée sociologique : Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber. (éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque des sciences humaines, 1967) + Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l'histoire – Essais sur les limites de la connaissance historique (éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque des sciences humaines, 1938, nouvelle édition 1986).
8) Henri Gouhier, La Philosophie et son histoire (éditions Vrin, 1944) + Henri Gouhier, L'Histoire et sa philosophie (éditions Vrin, 1952). À partir de Gouhier, la question rebondit chez Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l'invisible (éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque de philosophie, posthume 1964) où elle est brièvement examinée et commentée à deux reprises dans les si riches Notes de travail annexées au volume. Gouhier voulait clairement démarquer sa propre méthode de l'idéalisme d'Octave Hamelin (qui n'empêche nullement de lire les belles études d'histoire de la philosophie de Hamelin sur Aristote et Descartes) tandis que Merleau-Ponty visait, pour sa part, clairement à se démarquer du rationalisme structuraliste de son contemporain Martial Guéroult. La position du problème des rapports entre histoire et philosophie d'une part, entre histoire de la philosophie et philosophie de l'histoire d'autre part, remonte vraiment, en réalité, à G.W.F. Hegel, Leçons sur l'histoire de la philosophie (1805-1830). Leur introduction générale (qui traite aussi de l'histoire des religions et du rapport Orient-Occident) ne fut traduite en français par J. Gibelin qu'en 1954 (éditions Gallimard, NRF) et les leçons elles-mêmes ne le furent par Pierre Garniron qu'à partir de 1970 jusqu'à 1990 (éditions Vrin, collection BTP dirigée par Henri Gouhier).





























































 Imprimer
Imprimer