« Zéro K de Don DeLillo : les faux-monnayeurs de la vie éternelle, par Gregory Mion | Page d'accueil | La philocalie de Paul Morand, par Lounès Darbois »
18/04/2020
Du fantôme d'une langue pure. Sur L’hôpital, une nouvelle industrie. Le langage comme symptôme de Stéphane Velut, par Baptiste Rappin
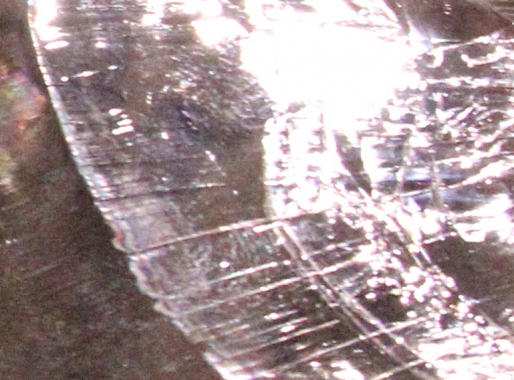
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Langages viciés.
Langages viciés.Voici quelques brèves considérations fortuites et désordonnées à propos de l’ouvrage L’hôpital, une nouvelle industrie. Le langage comme symptôme (1) de Stéphane Velut, de la pandémie du coronavirus et de l’impossibilité d’en tirer quelque leçon que ce soit.
Rien, à vrai dire, ne me prédestinait à pencher mon regard sur l’hôpital. Bien sûr, comme tout un chacun, j’ai à quelques reprises fréquenté les urgences, comme patient tout d’abord, mais bien plus souvent pour y amener l’un de mes enfants; et j’y ai en outre effectué quelques rares séjours, d’ailleurs d’autant plus courts à mesure que je prenais de l’âge, en raison de la sacrosainte DMS («Durée Moyenne de Séjour») que les gestionnaires, toujours riches d’indicateurs mais rarement aussi généreux quand il s’agit d’intelligence et de bon sens, ont imposée aux médecins et à leurs équipes, nous y reviendrons ci-dessous.
Il se trouve néanmoins que, par le hasard des circonstances ainsi que par la nécessité d’honorer mon service à l’université, je donne deux séminaires l’an, pour un total de quarante heures, dans un diplôme intitulé «Master en Management des Organisations Sanitaires et Sociales», dont la vocation est très précisément d’assurer la formation professionnelle des cadres des hôpitaux et des EHPAD («Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes» – industrie pour le moins juteuse) qui, une fois armés de leur brevet de «bons managers», s’en vont prêcher la bonne parole et les bonnes pratiques (attention, en réalité il vaut mieux parler de best practices) dans leurs organisations respectives. Et l’un de mes premiers étonnements, qui se manifesta dès les préliminaires, à savoir le rituel des présentations, tint à l’omniprésence criante du discours sur les «valeurs» (2) : valeur par-ci, valeur par-là, tout était, et l’est encore, prétexte à utiliser le terme, comme si son évocation suffisait à fédérer l’ensemble des professionnels présents dans la salle autour d’un curieux totem abstrait. Non pas «principe», «postulat» ou «norme» : «valeur». Formule incantatoire et autoréférentielle, qui joue le rôle d’une butée et met fin à la régression des causes à la manière du Premier moteur chez Aristote. Je compris alors, au fur et à mesure que je poursuivais mes séminaires, que la «valeur» est ce qu’il reste aux cadres de santé, sorte de nostalgie ou de résidu d’un passé désormais trouble sur lequel on peine à mettre un nom, quand tout ce pour quoi ils se sont engagés a disparu, jeté dans les oubliettes de l’histoire par la rationalisation organisationnelle imposée par le canon managérial. En d’autres termes, leur fragile équilibre psychique ne tient qu’à un mot, «valeur», dont la fonction est ainsi double : celle de masquer la crue réalité d’une application débile, infondée et incohérente, des principes du management scientifique à une sphère qui lui est, par essence, étrangère – laisser les questions ultimes de la vie et de la mort entre les mains d’un savoir désymbolisé et désymbolisant est tout simplement une folie anthropologique dont nous autres postmodernes paierons, tôt ou tard, le prix; maintenir l’engagement de personnels dont l’identité professionnelle a été sauvagement saccagée – leur souffrance, qui se révèle, parfois jusqu’aux larmes, dès l’amorce d’un dialogue sincère et fondé, n’a d’équivalent que la duperie dont ils sont les victimes.
Tout cela pour dire que j’étais quelque peu introduit à la question de l’hôpital, sans du tout prétendre en être familier et encore moins spécialiste voire, stade suprême de la reconnaissance médiatique, expert, quand survint la contagion planétaire, celle qui, partie d’une petite région de Chine, à peine onze millions d’habitants, gagna les continents européen et nord-américain. Aussi ne fus-je guère étonné d’entendre les médecins déclarer manquer de lits, de masques, de respirateurs, de personnel soignant : à l’ère du «zéro stock», rien ne reste immobile, rien ne demeure statique, tout circule, tout s’écoule, les virus, les patients, les lits, les masques, les respirateurs, le personnel soignant. Mais un ami profita de cette «crise», dont il faudrait plus précisément interroger le caractère critique, pour me faire parvenir un petit livre paru le 16 janvier 2020 aux Éditions Gallimard : L’hôpital, une nouvelle industrie, écrit par Stéphane Velut, neurochirurgien au Centre Hospitalier Régional de Tours.
Fait notable, Stéphane Velut n’est pas seulement neurochirurgien, mais il est également écrivain, auteur de deux romans, Cadence (2009) et Festival (2014), dont le premier fut récompensé du prix Sade. Certes, je dois avouer ne pas les avoir lus, et même n’en avoir jamais entendu parler; mais je suis convaincu que le travail d’écriture a rendu Stéphane Velut sensible à la question de la langue : c’est tout d’abord manifeste dans son dernier essai, dont le style, fluide et ciselé, emporte si insensiblement le lecteur à travers les pages qu’il parvient à la fin de ce petit livre sans s’en être aperçu; et c’est également observable au sous-titre ainsi qu’à l’objet de l’enquête : «la langue comme symptôme». Voilà qui me semble singulièrement notable : en associant le titre et le sous-titre de l’ouvrage, on pourrait d’emblée se risquer à une hypothèse peu commune et stimulante, à savoir que l’industrialisation de l’hôpital procède d’abord et avant tout d’une transformation de la langue, l’archéo-langue des professionnels (médecins, infirmiers, aides-soignants, etc.) cédant brutalement la place à une nov-langue managériale, mélange de jargon technique voire ésotérique (l’amélioration continue; le lean, les tableaux de bord et les indicateurs; la fameuse «DMS»; etc.) et d’incantation morale (les «valeurs» parmi lesquelles figurent, en bonne place, l’authenticité, l’implication du personnel, la culture d’organisation, l’humain, etc.).
Le neurochirurgien narre dès l’entame cette scène, si hilarante d’un point de vue intellectuel mais tellement dramatique quand on prend la mesure de sa portée ontologique, au cours de laquelle un jeune consultant, que l’on sent fraîchement sorti d’une école de commerce, pardon, d’une business school, donc fier et sûr de lui comme un maréchal d’empire, annonce le virage stratégique de l’hôpital : «Tout en restant dans une démarche d’excellence, il fallait désormais transformer l’hôpital de stock en hôpital de flux» (p. 6). Façon de dissimuler, derrière la technicité gestionnaire des termes qui annihile toute velléité de questionnement, que le nerf de la guerre, c’est l’argent, que l’argent, c’est bien connu, c’est du temps, donc qu’il devenait impératif de diminuer, de toutes les manières possibles («virage ambulatoire» : quelle expression savoureuse !), par tous les moyens imaginables (par exemple, la mise en place d’une forme inédite d’euthanasie sociale par la sélection des patients en fonction de leur pathologie), le temps de présence des patients à l’hôpital. Objectif : faire baisser la DMS, que diable !
Alors, évidemment, je ne vais pas multiplier les citations, j’arrête ici mon commentaire du bref ouvrage de Stéphane Velut que, contexte oblige, je recommande vivement au lecteur afin qu’il puisse imaginer non seulement les conditions dans lesquelles se trouve plongé l’hôpital, conditions habituelles mais rendues visibles par la pandémie, mais surtout pour qu’il prenne conscience qu’une institution, dans laquelle la question du sens de l’existence humaine est centrale, où il est quotidiennement question de la vie et de la mort, est en proie à un nihilisme technique dont l’atrophie de la langue s’avère un magnifique révélateur. Mais la réalité, c’est que nous sommes tous désormais exposés à la vague managériale : dans les entreprises bien sûr, car, contrairement à ce que l’on pourrait penser, là aussi, les métiers et les identités professionnelles se trouvent emportés par la lame de fond gestionnaire; à l’école et à l’université, dans lesquelles la démarche compétences se substitue à la transmission des savoirs et à la formation du jugement; dans les tribunaux où le nombre de dossiers traités par jour sert de boussole aux présidents au détriment même de l’idéal de la justice. Inutile de multiplier les exemples : partout, sans exception hélas, la nouvelle et clinquante langue du management, pure, positive, sans aspérité, éradique la langue de l’ancien monde, dans laquelle se mêlaient le parler de tous les jours et un vocabulaire technique lié à l’exercice du métier.
Après une phase de sidération, qui aura au passage permis l’instauration d’un État policier, dont le moment «Gilets jaunes» ne fut rétrospectivement que le prélude, la «crise sanitaire» suscite à présent, chez certains d’entre nous en tout cas, des espoirs d’un meilleur monde et d’une société plus juste : plus rien ne sera comme avant; il y aura «un avant et un après coronavirus»; même notre Président, pourtant zélé promoteur du nouveau monde, semble faire machine arrière, un comble pour un «marcheur» (car le «marcheur» ne saurait qu’aller de l’avant, c’est évident). Même l’argument de la «précédente crise», pas si lointaine que cela puisque remontant à la précédente décennie, ne suffit pas à convaincre nos forcenés optimistes : la Bourse a beau avoir connu des pics historiques après s’être effondrée en 2008, cette fois-ci, c’est pour de vrai ! «Après la crise» – comme si le cours normal du capitalisme et du management ne suivait justement pas au rythme infernal et saccadé de la révolution permanente et que l’on pouvait aussi aisément cerner un «avant» et un «après» la crise –, le défunt État renaîtra de ses cendres (par quel miracle ?, aimerait-on demander), ressortira le programme du Conseil National de la Résistance de ses cartons soigneusement rangés aux archives depuis 1983, et investira massivement afin de restaurer – attention, cela frise la réaction – la solidarité nationale.
Coquecigrues, mes chers amis ! Car, après la crise, tout reviendra comme avant, tant du côté de nos élites défaillantes, que du nôtre, vous savez, celui du petit consommateur postmoderne qui aspire à un retour de l’ordre – nommé «déconfinement» –, synonyme de travail, d’école et de vacances estivales, plutôt qu’au renversement de la société industrielle. Prenons date; je reconnaîtrai volontiers mes torts et mes erreurs d’analyse.
Je ne peux guère, dans le cadre de ce modeste billet d’humeur, faire étalage de l’ensemble des raisons qui me poussent à voir dans cette «crise», non pas une opportunité (et je confesse ici être passablement las de me voir rappeler à chaque occasion que le mot «crise», en chinois, désigne également l’opportunité : pitié, cessez, chers consultants, chers dirigeants, chers managers, ces insupportables jeux de langage qui ont pour seuls effets l’éclipse de la raison et la dissimulation du réel), mais le premier pas d’une rationalisation encore plus poussée de nos vies et de nos organisations – je n’évoque même pas l’ordre policier qui s’installe de façon durable dans notre pays et qui me semble, avec maintenant un peu de recul, l’autre face de la managérialisation d’un pays dont la tradition n’est pas libérale. Le raisonnement est transparent comme de l’eau de roche : si en France nous ne parvenons pas à faire face, dignement, à la pandémie, c’est parce que l’hôpital souffre de sa lourdeur bureaucratique, héritée de l’ancien monde, et que la clef réside, en toute logique, dans sa modernisation cette fois-ci intégrale. On confiera donc au management le soin de traiter cette demande d’efficacité, si bien que la «crise» aboutira, dans des délais relativement courts, à un accroissement de pratiques et de discours gestionnaires.
Il nous faudra ainsi d’abord renoncer collectivement à poser l’efficacité (ou la performance, ou l’excellence, ou encore l’adaptation, ses autres noms) comme Référence ultime de notre civilisation, c’est-à-dire cesser de rapporter toute activité à l’optimisation des moyens en rapport avec des objectifs, avant que tout changement de cap soit seulement envisageable – je ne dis même pas «possible». Laissez-moi vous dire, chers amis, que c’est plutôt mal engagé : en effet, chaque année, 20% des étudiants, dans le monde occidental, consacrent leurs études aux sciences de l’organisation, ce qui signifie, en d’autres termes, qu’un diplômé sur cinq s’en va conquérir les organisations – entreprises, hôpitaux, université, associations…– avec son carcan de matrices et ses batteries de tableau de bord. Sans compter sa méthodologie de cartographie des compétences, qui constitue, en dernière analyse, le cœur du réacteur. Afin de faire face, l’hôpital devra devenir un «hôpital apprenant», c’est même incontournable s’il souhaite rester l’«organisation citoyenne» qu’il est, et accélérer sa «transformation digitale». Eh oui, la «disruption» sera sa nouvelle culture. Pour cela, l’État investira massivement, quitte à emprunter sur des marchés financiers, faute de pouvoir le faire auprès de sa banque centrale : par conséquent, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, le souci des moyens, certainement légitime – à vrai dire, je n’en sais rien –, est secondaire par rapport à la question de l’organisation du travail, c’est-à-dire à la captation de la définition de l’activité par des parasites improductifs.
Dans le système méga-machinique au sein duquel nous survivons tant bien que mal, où les marges de manœuvre se réduisent chaque jour un peu plus, la langue m’apparaît comme un rempart prophylactique par trop sous-estimé. Si l’on admet, avec les penseurs que George Steiner appelle les «logocrates» (de Joseph de Maistre à Martin Heidegger et Pierre Boutang), que le monde vient à la présence dans et à travers la parole humaine, et qu’il existe donc en particulier un lien consubstantiel et charnel entre métier et langue, alors, à l’hôpital comme dans toutes les autres organisations, la première arme de défense contre l’immonde technique demeure la révolte contre ce «fantôme d’une langue pure» et la préservation d’une langue professionnelle singulière : elle seule est capable de faire naître et perdurer une communauté de pairs, elle seule permet de forger une identité professionnelle consistante, elle seule donne accès à un univers symbolique étranger à la logique arrasante de l’efficacité.
Notes
(1) Le titre choisi pour cet article fait référence à Maurice Merleau-Ponty, La prose du monde (Éditions Gallimard, coll. Tel, 1969), p. 10. L'ouvrage de Stéphane Velut a paru chez Gallimard, dans la collection Tracts.
(2) Voir à ce sujet, l’excellent ouvrage de Pierre Mari, En pays défait (Pierre Guillaume de Roux, 2019), p. 78 et suivantes.





























































 Imprimer
Imprimer