« Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit de Jacques Dewitte | Page d'accueil | Libra de Don DeLillo, par Gregory Mion »
05/10/2020
Métaphysique du rhume. Le management et la cybernétique au cœur de la démesure sophistique postmoderne (3), par Baptiste Rappin

 Baptiste Rappin dans la Zone.
Baptiste Rappin dans la Zone.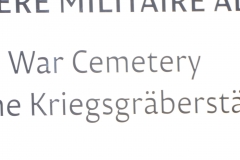 Métaphysique du rhume. Le management et la cybernétique au cœur de la démesure sophistique postmoderne (1).
Métaphysique du rhume. Le management et la cybernétique au cœur de la démesure sophistique postmoderne (1).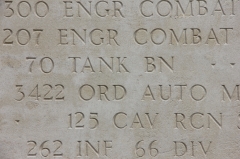 Métaphysique du rhume. Le management et la cybernétique au cœur de la démesure sophistique postmoderne (2).
Métaphysique du rhume. Le management et la cybernétique au cœur de la démesure sophistique postmoderne (2).Le management ou le retour de la sophistique
Il est toutefois un point largement resté inaperçu : dans les travaux portant sur la cybernétique, peu nombreux sont ceux qui, à notre connaissance, mentionnent, parmi sa descendance pléthorique, la filiation managériale. Cette loi du silence n’a d’égale que celle présente en sciences de gestion, pourtant discipline institutionnelle d’étude du management et des organisations, dans laquelle la cybernétique est au mieux évoquée dans une note de bas de page, mais le plus souvent superbement ignorée. Si le nom de cybernétique fut abandonné dès les années 1950, nous pouvons aussi donner une autre explication : le management se réduit souvent à la saisie intellectuelle de ses extrémités, du taylorisme qu’il est de bon ton de critiquer au nom de l’émancipation des travailleurs sans aucune prise en compte et discussion du projet utopique de fraternité qu’il porte, aux pratiques et courants les plus récents s’avançant sous les traits de la civilisation et du bonheur. Au milieu, le désert…
Cependant, la lecture des auteurs de l’après-guerre, qui sont les fondateurs du management contemporain, lève tous les voiles et élimine tout doute possible : Igor Ansoff et Robert Antony (1), pères respectifs du management stratégique et du contrôle de gestion, inscrivent explicitement leurs pas dans le sillage de la catégorie d’organisation telle que la cybernétique la thématisa : l’organisation, qui dès lors éclipsa les anciens concepts qu’étaient la bureaucratie, l’usine, la firme, l’entreprise… pour mieux les subsumer sous sa généricité, est une boucle de rétroaction qui fonctionne dans le déploiement d’actions soumises à des processus d’évaluation (contrôle de gestion, puis plus tard systèmes d’information et gestion des ressources humaines) en vue d’atteindre une finalité (définie par la stratégie qui prend en compte les ressources internes et le diagnostic de l’environnement dans toutes ses dimensions). Si le management comporte nécessairement une dimension politique, celle du gouvernement de subjectivités dans des contextes de changement permanent – car l’exception est devenue la règle selon le mot de Walter Benjamin –, l’on néglige généralement sa portée ontologique : la conversion métaphysique de l’action humaine en information à travers les tableaux de bord et les référentiels de compétences, les grilles de recrutement et d’évaluation, les logiciels et les progiciels de gestion, les chaînes de valeurs et les matrices stratégiques. Ce processus résulte d’un travail, souvent implicite voire inconscient, de modélisation de la réalité à laquelle le manager ou le consultant prélève la seule part fonctionnelle dont l’efficience se mesure au raccourcissement de la boucle rétroactive. Plus encore, dans une seconde phase, le modèle fonctionnel vient à se substituer à la réalité, opérant un coup d’état ontologique qui accomplit le triomphe du projet deleuzien d’enchaînement à la paroi de la caverne. Non seulement la carte n’est pas le territoire, mais la carte a supprimé le territoire : le philosophe griffu aurait contemplé, satisfait et repu, la prolifération rhizomique des simulacres dans les organisations qui ont désormais évacué toute question de sens pour se concentrer sur leur propre fonctionnement.
Il est pourtant un philosophe, que l’on pensait à tort déconnecté de l’actualité et des avancées scientifiques, et trop souvent comparé à Thalès chutant dans un puits devant les yeux moqueurs de sa servante thrace, qui saisit immédiatement l’essence même de la cybernétique. Heidegger écrit en effet en 1964 pour une conférence (qui sera prononcée par Jean Beaufret) de l’UNESCO à Paris : «Cette science [la cybernétique] correspond à la détermination de l’homme comme être dont l’essence est l’activité en milieu social. Elle est en effet la théorie qui a pour objet la prise en main de la planification possible et de l’organisation du travail humain» (2).
Le philosophe énonce la vérité du management : elle se nomme cybernétique et assigne l’homme à l’activité en milieu social, c’est-à-dire au travail. Cette même science qui se substitue à la philosophie, qui est à bout, est celle qui donne au management ses cadres conceptuels les plus propres : ce ne saurait être une surprise tant la notion de performance est consubstantielle à celle de vie pour toute organisation définie par la cybernétique.
L’inquiétant provient alors du caractère total que revêt le management à notre époque : quel pan de notre vie échappe à une organisation, soit que nous y évoluions soit que nous entrions en rapport avec elle (par exemple en tant que client ou consommateur) ? De la maternité à l’hôpital, ces théâtres chirurgicaux de notre finitude, de l’école à l’université, de l’entreprise à l’association, de Pôle Emploi à la CAF, des loisirs à la télévision, qui de nous peut prétendre rester extérieur au filet que le management a jeté sur nos vies ? Il s’agit tout d’abord d’un nouvel existential : en tant qu’être-jeté-dans-les-organisations, le management est devenu une dimension, certes inauthentique, de notre Dasein. C’est ensuite une catégorie historiale : le management fait époque, non pas au sens superficiel où il inaugure une nouvelle ère historique, mais dans la mesure où il se fait le site d’apparition de l’histoire, qu’aucun événement ne saurait aujourd’hui faire sens sans cette nouvelle détermination ontologique. Heidegger s’en confiait d’ailleurs, dans une lettre adressée à Hannah Arendt le 15 février 1950 : «[…], et il m’est apparu clairement que l’«organisation» relève du cœur inapparent, non certes pas technique, mais bien de ce à partir de quoi elle se déploie à l’aune de l’histoire de l’être» (3).
Pris dans les rets des organisations qui peuplent notre monde quotidien, mais aussi nos univers de science-fiction, nous sommes soumis au régime cybernétique que le management nous adresse en s’appuyant sur tous les savoirs-pouvoirs issus des sciences humaines et naturelles : l’être humain se doit de circuler et de faire circuler, il doit devenir aussi liquide que le monde fluide et réticulaire qui l’entoure. Car le management a parfaitement compris, dès ses origines tayloriennes, qu’il ne suffit pas de programmer et de faire tourner la boucle de rétroaction : l’ingénierie concerne également l’homme que les coachs et les accompagnateurs, pétris de bonnes intentions pour la plupart, se chargent d’adapter à cette nouvelle donne métaphysique. Toute aspérité, qu’elle prenne la forme de la transcendance ou de l’enracinement, se trouve alors suspecte de bloquer de limiter le flux permanent d’informations contrôlées qui assure la pérennité de l’organisation. Et l’on observe alors, face à cette entreprise cybernétique de déprogrammation-reprogrammation qu’est le management, les réactions désemparées de crispation identitaire.
Est-ce finalement une surprise que ce soit la cybernétique qui vienne commettre le matricide de la philosophie ? Non : en tant qu’elle se fonde sur l’efficacité de l’information modélisée, elle ne fait que retrouver l’inspiration des Sophistes qui enseignaient, contre rémunération, la technique des discours réussis. Entendons-nous bien : la question de l’efficacité n’est pas absente de la philosophie, la prudence aristotélicienne en témoigne hardiment. Elle ne revêt toutefois pas de sens en elle-même, et se place au service d’une cause finale désirable qui la légitime. Ce n’est pas le cas de la cybernétique et du management qui ne visent qu’à la préservation et à l’accroissement de l’organisation, en dehors de toute considération extérieure à ce plan strictement immanent.
Nous ne sommes certes pas les premiers à voir dans le management une nouvelle sophistique; Romain Laufer ne saurait, à ce titre, écrire plus juste : «Le marketing est la forme moderne (bureaucratique) de la sophistique» (4). L’auteur part d’un constat : l’émergence de la sophistique est liée à la crise d’un système de légitimité. Le raisonnement s’applique en effet tout d’abord à l’Antiquité puisque l’enseignement de Protagoras, Gorgias, Hippias, Prodicos et consorts fut florissant précisément à l’époque de guerre du Péloponnèse et de la remise en question de la démocratie par des prétentions oligarchiques (qui aboutirent au régime des Quatre Cents); mais il vaut également pour le système libéral dont la figure fondatrice, l’entrepreneur, se trouva malmené par la séparation de l’actionnaire et du manager, et dont le système souffrit de contestations radicales durant les années 1960 (5). Le marketing, comme nouvelle rhétorique, est à l’origine de la justification de cette institution qu’est l’organisation, et plus particulièrement la bureaucratie. Romain Laufer étendit par la suite son raisonnement à l’ensemble du management : «Désormais, gérer c’est légitimer, c’est-à-dire produire une argumentation susceptible de rendre le management de l’entreprise acceptable par toutes les parties prenantes» (6) écrit-il ainsi. Et, effectivement, un tableau de bord (contrôle de gestion), une grille d’évaluation (gestion des ressources humaines) ou une liste de normes (management de la qualité) ne valent que par la production d’un discours qui en donne le sens : un sens jamais fixé, toujours provisoire et perpétuellement (co-)construit voire négocié dans des interactions. Tel est justement le propre du sensemaking, concept que l’on doit au sociopsychologue des organisations Karl Weick, dont les conséquences ontologiques n’ont pas encore été pleinement envisagées.
Un détour par l’Ion, une œuvre de jeunesse de Platon, s’avère ici expédient : dans ce dialogue, le philosophe dresse une hiérarchie, que l’on retrouvera ultérieurement dans La République, des degrés de l’être en y superposant les types de discours : aux Modèles correspondent les dieux; aux copies, les poètes; et, enfin, aux idoles, les rhapsodes que Socrate définit comme les «interprètes des poètes», c’est-à-dire des «interprètes d’interprètes» (7). Voici bien ce que sont les managers qui s’évertuent, par le travail de la communication et les méthodes d’animation de groupes, à légitimer des modèles déjà issus d’une réduction de la réalité à l’information : des interprètes d’interprètes qui parlent d’informations d’information et de modèles de modèles, dans une régression à l’infini qui ne renvoient qu’au vertige nihiliste de l’abîme : les simulacres ne connaissent pas la sage formule aristotélicienne que Victor Hugo fit sienne : Ἀνάγκη στεναι (8).
Il semble bien que cette gigantomachie à propos de l’être par laquelle nous ouvrions nos propos, et en vertu de laquelle la philosophie en son essence même est un champ de bataille selon l’expression de Kant, connaisse un dénouement inattendu par la victoire de l’Illimité et de la Démesure assurée par le management cybernétique. Est-ce aussi sûr ? Laissons, en guise d’hommage à celui qui fut notre professeur à l’Université de Nice, le mot de la fin; Jean-François Mattéi, philosophe exemplaire du μέτρον, écrivaient en 2009 les lignes suivantes pour conclure son ouvrage Le sens de la démesure : «Ce vertige de la raison, égarée entre ses propres gouffres, est une crise de l’ordre parce que la raison ne parvient plus à sonder son propre fond. Et ce fond dionysiaque est un fond de désordre qui s’exprime de manière anarchique en échouant à réaliser la spiritualisation de la cruauté. Notre temps a cru éclipser la figure de Dionysos, mais le dieu souffrant n’est pas mort s’il reste continuellement déchiré. Le monde policé, celui qui qualifie de progrès «sa tendance à une précision fatale», a vu alors réapparaître les forces de l’hubris, trop longtemps refoulées, dans les convulsions de la politique, de la guerre et de l’économie. Mais cette violence d’une raison déraisonnable, asservie à l’orgueil humain, revendique confusément une limite au sein de son emportement, une étoile au cœur de son chaos ou un astre au fond de son désastre. C’est cela que Camus a nommé, après Nietzsche, la Pensée de Midi. Elle ne se satisfait pas d’un hommage obligé aux dieux de la Grèce, et elle n’oppose pas la mesure du bien à la démesure du mal comme si les deux principes étaient étrangers. Comme Hélène, la civilisation a un double visage, celui dont la beauté appelle le malheur et celui dont la violence rétablit l’ordre. Le conflit n’aura de cesse car, comme l’ont reconnu les penseurs et les poètes, le combat est bien le père de toutes choses. Dans ses dialogues, Platon n’avait rien exclu, la raison et le mythe, la sagesse et la folie, l’ivresse et la sobriété. Camus dans ses écrits, suivra la même leçon. «L’Exil d’Hélèn», au cours de sa méditation solaire, offre un calme contrepoint aux analyses plus sombres de L’Homme Révolté. Dans le second texte, le regard aigu de Camus comprend que "la vraie folie de démesure meurt ou crée sa propre mesure». Le premier texte, croisant les oxymores, voit la cause de l’abaissement de notre époque dans «l’excès de ses vertus autant que la grandeur de ses défauts». Quand la raison témoigne, par son déchirement même, des limites qui sont les siennes, qu’est-ce au fond que la mesure, sinon la conversion de la démesure ?» (9).
Notes
(1) Igor Ansoff, Corporate Strategy. An analytic approach to business policy for growth and expansion (New York, McGraw-Hill Inc., 1965); Robert Anthony, La fonction contrôle de gestion (Publi-Unions Éditions, 1993 : la première édition date de 1988 mais constitue en réalité une réécriture de l’ouvrage de 1965 : Planning and Control Systems : A Framework for Analysis, Boston : Division of Research, Harvard Business School).
(2) Martin Heidegger, La fin de la philosophie et la tâche de la pensée, dans : Questions III et IV (traduit de l’allemand par André Préau, Éditions Gallimard, coll. Tel, 1990), p. 285.
(3) Arendt H. et Heidegger M. (2001), Lettres et autres documents, 1925-1975 (traduit de l’allemand par Pascal David, Éditions Gallimard, coll. Nrf, l’auteur souligne), p. 83.
(4) Romain Laufer, Le marketing entre l’activité marchande et le marché dans Armand Hatchuel, Olivier Favereau, Franck Aggeri (dir.), L’activité marchande sans le marché ? (Presses des Mines, coll. Économie et Gestion, 2009), pp. 181-209.
(5) Romain Laufer, Système de légitimité, marketing et sophistique dans Barbara Cassin (dir.), Le plaisir de parler (Les Éditions de Minuit, coll. Arguments, 1986), p. 223.
(6) Romain Laufer, Les institutions du management : légitimité, organisation et nouvelle rhétorique dans Albert David, Armand Hatchuel et Romain Laufer (dir.), Les nouvelles fondations des sciences de gestion (Vuibert, «FNEGE», 2008, seconde édition), p. 81.
(7) Platon, Ion, 535a, dans Platon, Premiers dialogues, op. cit., p. 417.
(8) On ne saurait donner exemple plus frappant d’une performance sophistique réussie que le succès commercial et médiatique de l’économiste Thomas Piketty qui, dans Le capital au XXIe siècle (Éditions du Seuil, coll. Les livres du nouveau monde, 2013), avance ses thèses sur fond de commentaires de la World Top Incomes Database : commenter une base de données, qui elle-même constitue une modélisation du réel, c’est produire, en tant qu’«interprète d’interprète», un simulacre qui se prétend science.
(9) Jean-François Mattéi, Le sens de la démesure. Hubris et Dikè, Cabris (Éditions Sulliver, coll. Archéologie de la modernité, 2009), pp. 180-1.
Lien permanent | Tags : philosophie, management, technique, baptiste rappin |  |
|  Imprimer
Imprimer





























































