« La modernité alogale : à propos de Jan Marejko, par Jacques Dewitte | Page d'accueil | Céline et l’ontologie du cahin-caha, par Augustin Talbourdel »
17/10/2020
Le Temps gagné de Raphaël Enthoven : la « littérature » d’un Putanat tentaculaire et de l’onction cathodique, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Richard Davenport (The Guardian).
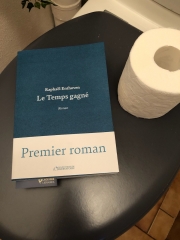 Rappel.
Rappel.Le Temps gagné de Raphaël Enthoven, ce roman que l'on expédie d'un derrière (point tout à fait) distrait.
«[…] les émissions dites littéraires les plus connues servent – et de manière de plus en plus servile – les valeurs établies, le conformisme et l’académisme, ou les valeurs du marché.»
Pierre Bourdieu, Sur la télévision.
«Bientôt tu auras tout oublié, bientôt tous t’auront oublié !»
Marc-Aurèle, Pensées.
 Le méprisable et minuscule coprolithe de Raphaël Enthoven, pompeusement auréolé d’un titre proustien – Le Temps gagné (1) – et subsidiairement immatriculé par le fantôme d’Alfred de Musset (puisque la quatrième de couverture, probablement rédigée par un sot ou une sotte des Éditions de l’Observatoire – qui en comptabilise assurément beaucoup étant donné les couillons et les couillonnes qu’elle honore souvent d’une réclame ampoulée – nous promet que nous allons découvrir la «confession d’un enfant du XXe siècle»), cette sordide et lamentable cagade, donc, pourrait à elle seule justifier tous les diagnostics de Léon Bloy à propos des saletés de la bourgeoisie et plus concrètement à propos de la manière dont le Bourgeois, cet archétype émérite de la sous-humanité, jamais rassasié de sa bêtise et de celle de ses pairs, «aime tout […] et avale tout» (2), avec une préférence évidente mais dissimulée pour la merde et ses inénarrables déclinaisons. En effet, dans ce Temps gagné qui se veut un roman, un cantique du «courage», une conquête de la «liberté», voire un précis de «violence» existentielle digne du parcours dramatique de Robert Frost et qui n’est tout au plus que la rédaction essoufflée d’un asthmatique du style, d’un Édouard Louis de goguenots germanopratins et d’un ancien khâgneux n’ayant point fait le deuil de ses références canoniques, il n’est question que de merde, c’est-à-dire, en toute rigueur, d’une merde supposément romancée qui eût dû s’abstenir d’être si laborieusement chiée et qui, par spectaculaire synecdoque et par irrésistible embourgeoisement de son émetteur depuis environ dix ans, a d’une part envahi la France entière, à tout le moins la France putanisée de la rentrée littéraire (journalistes, attachées de presse et lecteurs fins amateurs de pets, ces bibliomanes autoproclamés qui accélèrent le démâtage des valeurs), et, d’autre part, son auteur et les personnages à peine déguisés de son caca nerveux rancunier, soi-disant littéraire, où il règle itérativement ses comptes avec ceux qui l’auraient si inconvenablement traité.
Le méprisable et minuscule coprolithe de Raphaël Enthoven, pompeusement auréolé d’un titre proustien – Le Temps gagné (1) – et subsidiairement immatriculé par le fantôme d’Alfred de Musset (puisque la quatrième de couverture, probablement rédigée par un sot ou une sotte des Éditions de l’Observatoire – qui en comptabilise assurément beaucoup étant donné les couillons et les couillonnes qu’elle honore souvent d’une réclame ampoulée – nous promet que nous allons découvrir la «confession d’un enfant du XXe siècle»), cette sordide et lamentable cagade, donc, pourrait à elle seule justifier tous les diagnostics de Léon Bloy à propos des saletés de la bourgeoisie et plus concrètement à propos de la manière dont le Bourgeois, cet archétype émérite de la sous-humanité, jamais rassasié de sa bêtise et de celle de ses pairs, «aime tout […] et avale tout» (2), avec une préférence évidente mais dissimulée pour la merde et ses inénarrables déclinaisons. En effet, dans ce Temps gagné qui se veut un roman, un cantique du «courage», une conquête de la «liberté», voire un précis de «violence» existentielle digne du parcours dramatique de Robert Frost et qui n’est tout au plus que la rédaction essoufflée d’un asthmatique du style, d’un Édouard Louis de goguenots germanopratins et d’un ancien khâgneux n’ayant point fait le deuil de ses références canoniques, il n’est question que de merde, c’est-à-dire, en toute rigueur, d’une merde supposément romancée qui eût dû s’abstenir d’être si laborieusement chiée et qui, par spectaculaire synecdoque et par irrésistible embourgeoisement de son émetteur depuis environ dix ans, a d’une part envahi la France entière, à tout le moins la France putanisée de la rentrée littéraire (journalistes, attachées de presse et lecteurs fins amateurs de pets, ces bibliomanes autoproclamés qui accélèrent le démâtage des valeurs), et, d’autre part, son auteur et les personnages à peine déguisés de son caca nerveux rancunier, soi-disant littéraire, où il règle itérativement ses comptes avec ceux qui l’auraient si inconvenablement traité. L’ensemble compose une agitation fécale assez préoccupante dans la mesure où ce répugnant gémissement incarne une certaine réalité de l’offre et de la demande, une certaine façon, aussi, d’alimenter les ambitions des chieurs d’encre et d’assouvir un public scatophage, un sinistre lectorat grandissant à vue d’œil au cœur d’un pays qui se glorifie pourtant d’être la lanterne mondiale des lettres. Mais soyons magnanimes et osons une hypothèse à décharge : sans doute est-ce à cause d’une constipation psychique de longue durée que Raphaël Enthoven donne l’impression d’avoir impudiquement prouté ou sous-prousté son livre, se soulageant à bon droit de cet entassement parasite, n’esquivant pas néanmoins le stéréotype du «vieux prout» (p. 324) à large portée, ce ballonnement détendu qu’on aurait préféré inaudible et inodore, ce long-range gas qui se répand à chaque publication susceptible d’exciter les narines démocrates d’un Augustin Trapenard, ceci après avoir profité d’un laxatif miraculeux offert par les Éditions de l’Observatoire, une maison qui semble s’être spécialisée dans l’épanchement du tout-à-l’égout de tel ou tel nanti qui n’en pouvait décidément plus de ses puants démons intérieurs. Hélas, à notre époque, ce qui jadis n’aurait pu franchir les limites des lieux d’aisances se trouve désormais surexposé comme le dernier périple de Sylvain Tesson, ce Dumont d’Urville bon marché pour eunuque parisien ou pour sous-préfète qui confond l’ascension de la roche de Solutré avec le couloir Whymper de l’Aiguille Verte, et, ce faisant, les mauvaises odeurs essaiment goulûment et exigent qu’on les ventile vigoureusement.
On a donc ici un méchant petit navet troublé de ressentiment, une détestable rédaction de nain ulcéré par d’autres nains, un amas de coups fourrés qui empeste la psychologie de l’émasculé qui se venge de guingois, sans panache et sans aucune inspiration pamphlétaire, sans un reliquat de testicule, vérifiant par là même une constatation peu gratifiante pour son ridicule producteur : Raphaël Enthoven nous avait déjà prouvé sa relative nullité en concepts, or, cette fois, il nous prouve sa nullité absolue en prose. Il est en outre curieux que ce justicier de sa propre cause perdue, se prévalant volontiers du registre de la vérité (cf. p. 416), se soit rangé sous les auspices du roman alors qu’il eût été plus adéquat d’en appeler à la tradition consacrée du récit. Mais ce serait méconnaître le caractère du Bourgeois que de s’étonner trop longtemps de ce choix d’Enthoven. Si ce pitre sommital a officiellement choisi le roman, c’est, d’une part, en vue d’obtenir les distinctions sacramentelles qui accompagnent le statut de romancier dans l’univers du crétinisme atavique de Saint-Germain-des-Prés (ou des Pets), puis, d’autre part, en raison de son incapacité à totalement s’assumer en tant que redresseur de torts et surtout en tant que version anémiée de La Bruyère ou de La Rochefoucauld, les hallebardes verbales de ce myrmidon sous-pigiste dans mille gazettes faisandées n’étant que des cotons-tiges qui ramassent un peu de cire dans les oreilles à peine sifflantes d’une société de lilliputiens (et de lilli-putes), une société dont l’esbroufeur Enthoven, malgré qu’il en ait, n’est jamais sorti et ne sortira jamais. On se moque ainsi de savoir que ce branleur chevronné (selon ses dires) s’attaque à l’un ou l’autre de ses ennemis intimes en démoulant chaque fois son cake devant une porte de l’Enfer, mais, en revanche, on se moque beaucoup moins que ce malappris feigne de se déprécier littérairement afin de mieux dénigrer – ou emmerder – ses bourreaux présumés sous le couvert de la licence romanesque.
Il faut du reste se méfier du Bourgeois lorsqu’il revendique le courage et le difficile apprentissage de la liberté. Et puis d’abord de quelle espèce de courage Raphaël Enthoven serait-il le nom ? Du courage de déféquer en public et de regarder grossir la verge d’un analphabète journalisme scatophile ? Du courage d’évoquer sa défécation et de pressentir l’imbibition vaginale de quelques croupières chargées d’écrire un avis dithyrambique au sujet de cette insipide imitation d’actionnisme viennois ? Du courage de brocarder son père, d’accabler sa mère (3), d’assaisonner son beau-père Isi Beller en le taxant de «gros lard», de «connard», de «gros con» et même «[d’enculé] de sa race» ? Du courage d’affirmer son hédonisme d’une effarante banalité ? Du courage de moucharder divers détails putassiers concernant les habitudes de Justine Lévy à la selle (cf. p. 372) ? Du courage de dédaigner l’écriture de Bernard-Henri Lévy tout en ne valant pas soi-même un atome infra-stylistique d’une crotte indigente de Mohammed Aïssaoui (cf. p. 295) ? Du courage d’avoir affronté une journée de canicule en Espagne en ayant toujours connu l’air conditionné réel ou métaphorique (cf. pp. 139-144) ?
Et qu’en est-il de la liberté qui succède à toute cette pétulance d’Achille d’opérette ? S’agit-il de l’illustrer en disant merde à des individus dont la position sociale, indubitablement, aura fortement contribué à ce que le rejeton Raphaël Enthoven puisse un instant nous enquiquiner de ses pleurnicheries gamines au lieu de séjourner pour l’éternité dans son lieu naturel – l’écurie des hongres ? S’agit-il par ailleurs de s’imaginer dans la peau d’un pur épicentre de possibilités qui peut à loisir réduire à néant les assauts du déterminisme ? S’estime-t-il de la sorte immunisé contre l’essentielle chétivité de ses semblables quand ceux-là s’aventurent à se prendre pour des Balzac ou des Maupassant, ceux-là, en définitive, qui ne passent pour des écrivains que par accident grâce à la presse la plus illettrée du système solaire ? Que Raphaël Enthoven n’oublie pas que la théorie sartrienne de la liberté, qu’il aime commodément valoriser (cf. p. 362), souffre d’un affreux tropisme bourgeois qui frôle l’indécence quand on l’éprouve in media res, à plus forte raison quand il croit pertinent de l’appliquer en rappelant que si son père avait voulu être normalien, il aurait pu, et que, de surcroît, pour ce père académiquement humilié, sangloter de regret dans la cour de la prestigieuse École de la Rue d’Ulm relèverait d’une faute de goût parce que «faire au monde le procès de son impuissance est un terrible aveu d’impuissance» (p. 362). Que Raphaël Enthoven, par conséquent, n’oublie jamais que si son père a effectivement raté ses études et qu’il en a fomenté des monuments d’amertume, lui, de son côté, a prodigieusement raté son roman tout simplement parce qu’il n’est pas un romancier, ni même une toute petite promesse de romancier, car il était par essence conditionné pour persévérer dans un état général d’inanité de toutes les facultés qui président au génie littéraire. Il n’est au mieux qu’un Bourgeois qui devait un jour ou l’autre torchonner un livre de fiction parce que cela devait participer de sa distinction mondaine, à rebours de toute vocation ou de toute conviction d’écriture. Qu’il le veuille ou non, si Raphaël Enthoven est parvenu à publier un si mauvais livre, tout puant d’orgueil et de mauvaise humeur, c’est qu’il appartient à cette même coterie qui peut publier des étrons à la chaîne sans être accusée de trouble à l’ordre public. Il n’existe en ce sens nulle différence de nature entre Enthoven fils, Enthoven père, Enthoven mère, Bernard-Henri Lévy ou sa fille Justine – ce sont tous des homoncules du milieu de la culture, des nabots qui ont la haine de tout ce qui les dépasse et qui s’organisent en association de malfaiteurs pour profaner le moindre vestige de majesté spirituelle. Entre eux, finalement, il n’existe qu’une différence de degré en cela que Raphaël Enthoven a réussi l’exploit de faire imprimer un livre encore plus épouvantable que les livres de ses opposants désignés.
Les conditions de possibilité de cette gredinerie répondent en fait à un mécanisme social qui permet à la classe bourgeoise de confisquer la majorité des accès à la culture tout en semant l’inquiétude et l’impossibilité de s’affirmer scolairement ou artistiquement dans les autres classes réputées inférieures. En aucune manière un manuscrit tel que celui du Temps gagné n’aurait pu jouir de l’assentiment d’un quelconque éditeur s’il n’avait été le fruit d’un matamore introduit comme Raphaël Enthoven. Cette manifestation du népotisme est particulièrement saillante dans un pays tel que la France et elle engendre une marée noire de la littérature qui vient empoisonner les animaux créatifs piégés par cette pollution croissante. Les tempéraments intrinsèquement créateurs sont méthodiquement éliminés par une industrie culturelle incompétente qui produit en masse et qui se reproduit abondamment dans l’intention de manufacturer du profit. On aboutit dès lors à un modèle de littérature standardisé par le Putanat de l’argent et des renommées artificielles, aggravé en outre par la complicité d’un journalisme scélérat qui distribue les récompenses et qui, à la télévision, orchestre les cérémonies de l’onction cathodique. Que Raphaël Enthoven s’autorise à railler les pouvoirs de la télévision en dit long sur le niveau de certitude et de fausse lucidité de ce vaste bluffeur (cf. pp. 302 et 391). Il est tellement intégré aux rouages de la Machine médiatique qu’il s’accorde en apparence le luxe de lui chier dessus à dessein de se placer en surplomb, vêtu des qualités de l’homme avisé, alors même qu’il dépend uniquement de cette arithmétique de l’image où tout est mis en scène et repose sur le scénario de quelques managers professionnels du racolage. L’objectif, pour lui, consiste à se fabriquer une notoriété de rebelle, de personnalité courageuse, de philosophe et d’écrivain qui n’est pas dupe du système en vigueur, en dépit du fait que ces titres lui sont exclusivement alloués par le mensonge d’un Putanat immense et tentaculaire. Or il n’y a pas une ombre de courage chez Enthoven, pas un seul centimètre de hardiesse, car il a fallu qu’il soit suffisamment installé dans le champ médiatique pour nous inonder maintenant de ses torrentielles hémorroïdes, ce qu’il n’aurait pas osé quand il était en train de pénétrer dans la carrière de l’imposture, tirant des ficelles qu’on lui a gracieusement tendues. Ce n’est ainsi que la récurrence médiatique d’Enthoven qui le légitime, ce n’est qu’un phénomène d’accoutumance qui le conforte dans son rang d’usurpateur, et ce n’est globalement que par un genre de saut journalistique (à défaut d’un véritable saut qualitatif) que cet amateur de gonflette intellectuelle colonise désormais le paysage de la culture. Au reste, sa présence cathodique maximale ne renvoie nullement à un effet maximal d’exhaussement des esprits, puisque, loin de rendre service au peuple, Raphaël Enthoven l’abaisse et le prépare à consommer dans la durée les éléments liquides de ses interminables coliques. Dans le fond, il n’y a pas plus poltron que ce fat, et telle une Cécile Coulon qui parle de prendre des risques là où toute la presse la plus conne de l’Histoire lui construit une autoroute de précautionneux charlatanisme, Raphaël Enthoven se prélasse dans les fantasmes du courage tout en étant harnaché d’une tonne de cordes et de mousquetons sur la microscopique façade des Éditions de l’Observatoire, ce muret de snobisme où gigotent par exemple Marylin Maeso et Dorian Astor, opportunistes avocats de notre Alain Robert du dimanche.
Il s’ensuit que Raphaël Enthoven a vraiment du culot lorsqu’il prétend échapper à toute espèce d’élitisme, usant et abusant, dans cette optique, de références populaires franchement intempestives et prévaricatrices (cf. pp. 231-9). Son toupet n’est pas moins ample lorsqu’il prétend aussi agir indépendamment des structures de quelque show-business répertorié au bulletin officiel d’un Putanat sélectif, ne serait-ce déjà que parce qu’il nous soumet ici, avec ce malodorant Temps gagné, une réelle société secrète de l’eucharistie anale où le pasteur qu’il incarne opère une impressionnante transsubstantiation de l’Esprit en matière fécale. Le ministre du culte Enthoven, promu par une autorité nécessairement occulte, ne s’adresse in fine qu’aux plus fervents initiés de la chose fécale – et accessoirement de la chose branlomaniaque. Ce n’est clairement pas le tout-venant de la populace qui est invité à tâter de ce messianisme suprême du transit intestinal, de cet éminent magistère de l’entre-olfaction canine du trou du cul, de cette métaphysique de caniches se reniflant minutieusement et assidûment le fondement. Pour être fondamentalement admis aux rituels fienteux du souverain pontife Enthoven, il est indispensable de posséder un haut degré de perversion et une aptitude à renverser la Croix, accessible seulement à une secte de dévots comblés de béatitude, à la frange d’une élite inversée qui met tout cul par-dessus tête et qui aménage le règne d’un Antéchrist des humanités. On comprend aisément que pour s’immiscer au sein de ces commémorations spécifiques, il faille être à tout le moins un zélateur du plus énorme mange-merde que la France ait jusqu’à présent porté. L’aristocratie de la branlette et du dépôt de pêche est à ce prix. Quel dommage, cependant, que Raphaël Enthoven n’ait pas pris l’initiative de se faire analyser par son beau-père Isi Beller – il se fût peut-être délivré du stade anal et de cette navrante sémantique du caca boudin matérialisée en vengeance infantile de cour de récréation !
Car tout est vulgairement, désespérément, cruellement infantile dans cette apocalyptique nullité du bon élève qui veut jouer au dur ou au génie et qui se retrouve systématiquement relégué à l’étage d’une poussive et embarrassante tentative de créativité, loin, si loin des titans littéraires sur lesquels il ne peut que disserter (parfois lourdement) en croyant qu’il appartient aux mêmes orbites d’enthousiasme. L’enseignement de la philosophie, pour Raphaël Enthoven, constitue déjà un mandat complexe et plutôt que de faire le malin à la télévision, en alternance entre trois formules creuses et deux assauts cacophoniques de Petit Brabançon, il ferait mieux de revenir à la source même de son métier et d’aller fortifier les âmes des lycéens. Il faut le redire inlassablement : Raphaël Enthoven, symboliquement parlant, n’a même pas les épaules assez larges pour endosser un pull de Tatiana de Rosnay ou un blazer tigré d’Alain Mabanckou, qui n’est pourtant qu’un James Baldwin pour hospice californien, ainsi, de là à se figurer qu’il puisse rivaliser avec un Proust, un Musset, un Camus ou n’importe quel autre mastodonte de notre divin panthéon des lettres, ce n’est bien sûr qu’une affaire d’analphabétisme, d’auto-persuasion pathologique ou de crapulerie éditoriale. Si Raphaël Enthoven est susceptible de donner le change avec un écrivain ou ce qui passe pour écrire, il ne peut le faire qu’avec les têtards susnommés, en l’occurrence les guignols qu’il a pris pour cible, les préposés à la faillite imaginative d’une grenouille qui s’est minablement projetée dans la robuste nature d’un bœuf Wagyu. De l’aveu même d’Enthoven, si son père Jean-Paul a besoin de dégobiller «cent sottises» pour atteindre «un aphorisme» (p. 328), on en conclura que le descendant, à n’en pas douter, a besoin de chier cent hectolitres de diarrhée pour aboutir à une platitude semi-aphoristique. On aurait pu ponctionner dans chaque page du Temps gagné une quantité de pièces à conviction pour étayer notre juste sévérité, mais on se bornera à une trinité de fadaises, dans l’ordre chronologique de leur apparition : «La violence dont on s’abstient ressemble à une faveur qu’on vous adresse» (p. 98), «Changer de vie ou changer d’avis, c’est changer de déception» (p. 107), et, enfin, «Dans la vie, on décide [et] c’est après qu’on délibère» (p. 115). Quoique ces libellés aient vocation à séduire la néo-khâgneuse provinciale qui se verrait bien stagiaire chez France Culture l’été prochain ou le journaliste à tête vide qui ne jure que par le dernier tweet d’Eugénie Bastié, ils ne sont, objectivement, que des éléments de langage qui suintent l’indigestion de lectures faiblement assimilées. En effet, il est certain que Raphaël Enthoven n’a guère lu, ou mal lu, pour nous infliger tant de ratages lexicologiques, tant de médiocres adjonctions de prédicats, tant de phrases boursouflées, tant de propension à simuler le fantastique despote éclairé, tant d’efforts à mimer le cheval de compétition qui se cabre et qui assomme de son agile sabot tous ses adversaires, alors qu’il ne se révèle que sous l’aspect d’un morveux portatif dépourvu de puissance, impatient de nuire avec les expédients d’un jean-foutre, accumulant ses pathétiques forfaits en prenant immédiatement la fuite, tel ce brigand de merdeux qui sonne à une maison et décampe fissa dans sa planque pour se délecter de sa frivole couillonnade.
Toutefois ne nous leurrons pas complètement devant l’exhibition de cette farouche sottise. La méconnaissance d’Enthoven pour ce qui concerne la littérature est dorénavant un fait avéré, certes, mais sa connaissance de la sociologie est réelle parce qu’il exécute à la perfection le cahier des charges des «prophètes de la transgression», le mémento de tous les dissidents certifiés par le climat médiatique, sachant saisir l’occasion d’un scandale archi-scénarisé afin de provoquer des «coups d’État spécifiques dans le champ intellectuel» ou ce qui en tient lieu (4). Peu importe les vexations et les inimitiés engendrées par ce livre-bouse, peu importe les dures sanctions qu’il recevra de notre main providentiellement fouettarde, elles ne sont quasiment que des coups d’épée dans l’eau en comparaison de la banquise réticulaire qui garantit à Raphaël Enthoven de subsister encore longtemps sous les projecteurs malgré le flagrant délit de son abjection. L’époque étant elle-même abjecte, ce que Raphaël Enthoven égarera en accointances raisonnables, il le multipliera en accointances aberrantes. Nonobstant l’écart qu’il faudrait établir entre les prosélytes honoraires de cette franc-maçonnerie fécaloïde et les gobe-mouches prêts à se laisser cornaquer jusqu’à la lisière de cette Sainte Loge des Fécalomes, la stratégie commerciale des Éditions de l’Observatoire avait adroitement misé sur l’onde de choc qui succèderait aux pseudo-révélations estivales, lorsque les bonnes feuilles, dit-on habituellement, devaient commencer à fuiter et à exciter les bas instincts dominants de notre siècle démoniaque où prospèrent les tarentules de la mécréance. C’est la raison pour laquelle ce bronze coulé était certain de se vendre, de se répandre, de générer des capitaux, et l’on peut même soupçonner que les réactions des victimes directes de ce Temps gagné ne sont éventuellement que des comédies impeccablement jouées. Plus gravement et plus cyniquement : on peut même poser l’hypothèse que Raphaël Enthoven a négligemment évacué le cigare qu’il avait au bord des lèvres dans le but de vérifier le haut niveau de servilité de son milieu et, par extension, la bassesse d’une nation qui lui assure là de conséquentes étrennes.
Il va de soi que de telles certitudes tolèrent tous les cumuls de médiocrité. Le Bourgeois sait qu’il a remporté la bataille idéologique parce que le prolétariat ne souhaite plus le contester mais lui ressembler. Dans son for intérieur, le lecteur trivial d’Enthoven aspire à modeler sa vie sur celle de ce narrateur enculeur de mouches (mais pas uniquement !), ce narrateur dévolu au rôle d’une bitte d’amarrage où vient allégoriquement s’enrouler le vol ravissant des mouches à merde. Quiconque détient une sensibilité et une intelligence vives ne peut donc adhérer aux cabrioles de ce matador pour arène de Playmobil, car, d’une part, on se contrefiche des fessées et des gifles endurées par ce turbulent sosie de Yann Moix, et, d’autre part, on ne parvient pas à croire à ce qui est ici raconté à grand-peine, faute d’un élan olympien qui accréditerait l’existence positive d’un chef-d’œuvre. Raphaël Enthoven a été souffleté durant son enfance de sale gosse ? Raphaël Enthoven n’a pas été l’enfant-roi qui aurait dû préfigurer le trône d’un philosophe-roi platonicien, malheureusement déchu en trône vernaculaire ? Raphaël Enthoven a contracté un mariage précipité en subissant le succubat d’une jouvencelle bien dotée ? Cela n’a aucune sorte d’importance. Le roman est si nul et non avenu que son contenu pourrait être l’histoire de n’importe qui et surtout de n’importe quoi. Il est interchangeable avec la biographie du premier nigaud qui aurait vécu un chouïa de cette simili-brutalité et qui se piquerait de proclamer sa voix au chapitre des lettres françaises. Car il ne faut pas être davantage qu’une truelle du Sixième Arrondissent parisien pour écrire si pauvrement la situation de son enfance corrigée plutôt que battue (Enthoven l’avoue d’emblée – cf. p. 24), tout comme il ne faut pas être autre chose qu’un paria du talent pour caractériser le rire d’une mère en «rire de canard» (p. 13), soulignant par là une imagination indiscutablement carencée, lestée d’un bestiaire conforme aux sentiers battus de Babar ou de Maya l’Abeille. Cette détresse du style, associée à une prétention infinie, traduit la veulerie de l’héritier qui s’est contenté du minimum. Malgré la cuillère d’argent de la culture savante qui a pris possession de la bouche d’Enthoven dès sa naissance, celui-ci n’en a fait que de la tambouille, de la merde, en somme, d’où son espèce de passe-droit qui lui concède la permission d’être léger en philosophie, inexistant en littérature, mais zénithal dans la vulgarité et dans l’escroquerie de la culture populaire passée au crible de l’habileté scolaire. Lorsqu’il écrit que Rocky Balboa était «[son] optimisme, [son] horizon, [son] utopie concrète, [son] Europe» (p. 48), outre l’effronterie bourgeoise de ce référent qui ne conviendrait pas à un enfant véritablement persécuté, il y a là, inexorablement, l’envie de faire peuple, ajointée à la volonté de se démarquer dans le relâchement et dans le débraillé mental parce que l’ombre planante des filières d’excellence, toujours, constituera l’amnistie du Bourgeois qui jamais n’admettra ses sinécures et ses impostures. Oserait-on discréditer Enthoven sur le seul angle de ses pulsions philistines qu’on nous rétorquerait, en guise d’argument définitif, que lui, tout de même, a franchi l’Himalaya des établissements d’enseignement les plus prestigieux et qu’il a donc toute latitude pour s’empiffrer de ses déjections en les mélangeant à quelques pincées de pédanterie. Or ce qu’il serait bon de dire, c’est que Raphaël Enthoven, en sus de se ridiculiser à chaque virgule de son feuilleton d’arrivisme, ridiculise les écoles qu’il a fréquentées. Une loi devrait être votée pour désavouer les monstres de duplicité, les calculateurs et les fils à papa, lorsque ceux-ci trahissent la noblesse de l’éducation qu’ils ont reçue et se vautrent dans un obscène relativisme culturel, trompant ainsi le peuple en l’incitant à croire que Rocky Balboa, au fond, concurrence la finesse des textes fondateurs qui ont propulsé le Bourgeois dans les meilleures institutions de la République. Ce qui apparaît ici en filigrane, c’est évidemment la ruse, le moyen, l’innommable manœuvre d’un embargo de la culture savante : le Bourgeois, en intercédant fièrement pour la culture populaire, se réserve les plus beaux morceaux de la culture savante et laisse penser qu’il est lui-même un oracle de la grande culture. Le point d’aboutissement de tout cela, c’est le danger du détournement de la grande culture, à savoir une crise de la culture telle que la dénonçait Hannah Arendt, ce moment où les choses les plus profondes ne pourront peut-être plus résister à leurs interprétations superficielles à des fins de divertissement, ce moment, finalement, où la distance est comblée entre un Marcel Proust et un Raphaël Enthoven, entre une Simone de Beauvoir et une Alice Coffin, entre un Jacques Laurent et un Romaric Sangars, entre une Emily Dickinson et une Cécile Coulon.
Par conséquent Raphaël Enthoven continue allègrement de se moquer du monde lorsqu’il invoque le paradigme de l’enfant malheureux qui a eu la vie sauve en découvrant les livres (cf. pp. 58-9). En tant que Bourgeois irréprochable dans son essence, ne l’oublions pas, Raphaël Enthoven est pusillanime. Il n’aurait pas pu avoir le cran de talocher crûment son beau-père et encore moins celui de se suicider pour en terminer avec cette insupportable vie, ce bagne pour minets où l’enfant outragé peut nourrir la créature de son malaise en voyageant aux États-Unis, au Maroc, en Italie, à moins qu’il ne lui faille changer de domicile parisien de temps en temps, non sans être allé en Haute-Savoie où il a pu expérimenter la beauté de son reflet, se trouver «objectivement beau» (p. 88), avec le lac d’Annecy pour fond de teint panoramique. Sans doute est-il nécessaire de rappeler à Raphaël Enthoven que l’enfant qui serait authentiquement brutalisé n’aurait aucune chance d’avoir un visage d’angelot vexé, pas plus qu’il n’aurait l’opportunité d’accéder au moindre livre et à la moindre invitation au voyage aux quatre coins de la planète. Pour l’enfant qui endure vraiment la cruauté des adultes, l’horizon se limite à un cagibi de calamités et la violence est si résolue qu’elle empêche même la liberté intérieure. On s’aperçoit ainsi que Raphaël Enthoven, en plus d’avoir commis un livre dégoûtant, en plus de nous ennuyer de sa condition apocryphe d’offensé, commet par surcroît des offenses indéniables en insultant obliquement toutes les formes possibles de l’enfance infortunée. En d’autres termes, on a là un Bourgeois qui se scarifie avec les touches de son ordinateur pour essayer de se donner une consistance d’écrivain, une épaisseur biographique ou un je-ne-sais-quoi de canaille, afin, piteusement, de compenser les signes éclatants de sa bêtise congénitale. Et toute cette souffrance de quincaillerie, du reste, se trahit par l’un des plus remarquables penchants bourgeois : l’exacerbation de l’école, la dramatisation exorbitante du parcours scolaire, car pour le Bourgeois, entendons-nous bien, la menace ne saurait venir de nulle part sinon du devoir sur table qui prend des allures d’Oradour-sur-Glane, du professeur auquel on attribue des coefficients de divinité pour se donner le sentiment d’avoir vaincu un panthéon, ou encore de la troisième partie de dissertation, un jour d’agrégation, où il sera dit, a posteriori et dans une ambiance de salon, qu’on aura là survécu à Gettysburg avec notre stylo bille. Tout est donc méconnaissance du malheur chez le Bourgeois parce que toute sa vie s’apparente à une théâtralisation des plus insignifiants soubresauts d’une existence (cf. pp. 202-3). En cela, pour le Bourgeois, il est recommandé d’exagérer ou d’encanailler les étapes de sa vie en vue de dissimuler le scandale de sa tranquillité, ou, plutôt, en vue de camoufler le fait que le Bourgeois est tranquille parce que sa position sociale n’est envisageable qu’à la proportion de l’intranquillité qui prolifère ailleurs (et dont le Bourgeois est l’ignoble artisan). En fin de compte, eu égard au maléfice du Bourgeois, il n’est pas surprenant que tout soit à peu près anémique ou dégénéré dans ce roman, y compris cette séquence de défloration caviardée par une plume de bidet (cf. pp. 280-1). À tout le moins, on se dégage de ces bouffonneries scatologiques avec deux convictions : d’abord que Raphaël Enthoven n’est même pas capable de torcher correctement le cul de son roman puisqu’il l’afflige d’un épilogue d’une confondante mièvrerie (cf. pp. 522-3), ensuite qu’il serait bien capable, en revanche, d’enterrer son père au cimetière des chiens si cela pouvait lui garantir une ristourne de la part des fossoyeurs (5).
Notes
(1) Éditions de l’Observatoire (2020).
(2) Léon Bloy, Exégèse des lieux communs (Tous les goûts sont dans la nature).
(3) Laquelle sera relativement rédimée.
(4) Pierre Bourdieu, Sur la télévision (Raisons d’agir Éditions, 2008).
(5) Cf. Léon Bloy, Le sang du pauvre.






























































 Imprimer
Imprimer