« Céline et l’ontologie du cahin-caha, par Augustin Talbourdel | Page d'accueil | Trois entretiens sur la guerre, la morale et la religion, suivis du Court traité sur l'Antéchrist de Vladimir Soloviev »
23/10/2020
L’avenir d’une illusion de Sigmund Freud, par Gregory Mion
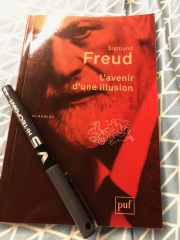 «La religion est la scission de l’homme d’avec lui-même.»
«La religion est la scission de l’homme d’avec lui-même.»Ludwig Feuerbach, L’Essence du christianisme.
L’équilibre instable du monde culturel
Dans les premières pages de L’avenir d’une illusion (1), par le biais d’un propos généraliste, Freud attire notre attention sur les réussites problématiques de la culture. Si la culture est incontestablement ce qui a permis à l’homme de s’élever au-dessus du règne animal, si elle est encore un moyen d’exploiter la nature tout en la dominant par toutes sortes de techniques, elle est aussi, en contrepartie, le lieu de «la contrainte» et du «renoncement pulsionnel». En cela précisément, la culture favorise la vie en commun, elle encourage les hommes à la paix et à la promotion de la raison, cependant elle demeure fragile parce qu’elle ne peut pas totalement changer la nature archaïque et incompressible de l’être humain. En effet, la culture semble avoir mieux réussi à modifier la nature en périphérie des hommes plutôt qu’elle ne paraît avoir réussi à transformer la nature à l’intérieur des hommes. En d’autres termes, nous avons appris à nous frayer un chemin au milieu de la jungle en utilisant une machette ou un bulldozer, nous avons su tirer parti des montagnes et des mers, mais nous n’avons aucune garantie sur ce qu’il faudrait enseigner pour irrévocablement limiter quelques-uns de nos instincts démesurés ou notre pulsion de mort. La culture, au prix d’efforts constants, parvient plus ou moins à modérer les tempéraments humains excessifs, mais, périodiquement, des guerres éclatent et anéantissent en peu de temps des décennies ou des siècles de progrès spirituel (2). On en arrive donc à ce paradoxe : la culture rend service aux hommes tout en ayant la charge de se méfier d’eux – la tension entre l’intérêt universel de la culture et les désirs particuliers des hommes est de ce point de vue hautement palpable.
La culture est d’autant plus vulnérable que les pulsions et les passions de la masse humaine sont fortes. La multitude accepte rarement de faire un travail sur elle-même ou de se laisser convaincre par des arguments. Par conséquent la continuité de la culture (c’est-à-dire le prolongement d’une civilisation pacifique) dépend selon toute vraisemblance d’une minorité qui doit sans arrêt agir sous la menace d’une majorité qui peut sortir de ses gonds à n’importe quel moment. Au fond, ce que montre Freud, c’est que l’histoire de l’humanité n’a jamais accouché d’un peuple absolument irréprochable, et, a fortiori, d’une culture infaillible. Les dispositifs culturels les plus raffinés ne sont pas parvenus à canaliser les désirs les plus destructeurs. Pour preuve, l’Allemagne n’a pas évité le nazisme malgré le triomphe immémorial de sa littérature et de sa philosophie. Et les États-Unis, malgré le glorieux passé du président Abraham Lincoln et les fulgurances d’un Martin Luther King, n’ont toujours pas vaincu le spectre de la ségrégation raciale. Pire, le président Lincoln et le pasteur King ont tous les deux été assassinés. Il existe ainsi, à en croire Freud, une part irréductible des hommes, un pôle de violence et d’imperfection qui brise quasiment tout espoir de voir émerger avec régularité des «meneurs» exemplaires, dévoués, incorruptibles et flegmatiques, capables de transmettre aux masses l’envie d’emprunter le chemin définitif de la vertu. D’ailleurs, aussitôt qu’on s’imagine de tels hommes exceptionnels, ne tombons-nous pas dans le piège du fantasme ? Peut-on vraiment agir sur les passions invincibles des hommes ? Les plus vertueux d’entre nous ne sont pas à l’abri du vice et comme l’a très bien formulé Montesquieu jadis, la vertu elle-même «a besoin de limites» (3).
La soif de destruction des hommes semble donc inusable et Freud, au lieu d’espérer l’impossible abolition d’une inhumanité chaque fois à l’affût, prête à éclater aussi soudainement qu’un orage, se contente déjà de dire que si un jour nous accédons à une inversion des proportions de violence, à savoir que la majorité agressive puisse être devenue la minorité, cela sera déjà amplement satisfaisant. Mais, pour l’heure, ce que le monde humain doit affronter, ce avec quoi nous devons cohabiter, c’est le fait que chaque individu est potentiellement un ennemi de la civilisation constituée. Selon Freud, il y a trois volontés pulsionnelles à combattre si l’on souhaite préserver la société de l’anarchie des instincts : le cannibalisme, l’inceste et le meurtre. En ce qui concerne l’anthropophagie, Freud estime qu’il s’agit d’un phénomène endigué. Toutefois il n’en va pas de même pour l’inceste et pour le meurtre, car l’interdit culturel du premier suscite le désir de transgression, et le second, en dépit de son illégalité unanimement reconnue, se trouve quelquefois manifesté à travers la réalité judiciaire de la peine de mort. On ne peut certes nier que l’essor des techniques et des sciences a positivement façonné l’âme humaine et l’a stimulée pour agir moralement, on ne peut nier non plus l’importance du Surmoi (4) dans le processus d’absorption des contraintes, mais tous ces acquis sont précaires et ne subsistent qu’à la faveur d’entraves extérieures tangibles (l’incarnation de la justice, la possibilité concrète de la punition, la multiplication des méthodes de dissuasion, etc.). De plus, les hommes arrivent à convertir leurs désirs incestueux et leurs désirs homicides en actions tolérables ou supportables, en autant de forfaits de substitution qui les soulagent apparemment de cette pression pulsionnelle primitive. À titre d’illustration, Freud cite «le mensonge», «la tromperie» et «la calomnie», la manière dont les sociétés, mutatis mutandis, s’arrangent pour que cela reste impuni ou assimilé, comme s’il fallait que la violence brutale des pulsions soit transfigurée en une sorte de violence symbolique ou civilisée susceptible d’être moins choquante.
Ces considérations générales sur la culture s’achèvent par l’aveu du caractère inopérant des civilisations qui ont oppressé les masses tout en les faisant travailler assidûment au maintien du régime culturel. Les différents idéaux culturels de par le monde sont de surcroît sujets à caution du fait même qu’ils ont parfois engendré des divergences regrettables entre les nations. Si cela a pu fomenter des unions sacrées entre les oppresseurs et les opprimés au sein d’une même nation, on ne saurait néanmoins s’en accommoder. Ce que l’on cherche à obtenir, c’est un expédient ou un moyen durable de compenser l’irrépressible afflux des pulsions, comme l’art, par exemple, qui a le mérite de sublimer une énorme quantité d’interdits ou d’exalter un certain nombre d’idéaux structurants pour une société. Les «représentations religieuses» possèdent à cet égard une fonction culminante. Mais sont-elles exemptes de tout reproche malgré la sagesse originaire qui les constitue en apparence ?
L’origine des représentations religieuses
Dans l’esprit de Freud, il est hors de doute que la culture met un point d’honneur à nous protéger de la nature et nous détourne d’un contexte de violence qui serait peut-être permanent si nous n’avions pas le bénéfice de plusieurs siècles d’éducation. Là où Hobbes revendiquait la nécessité d’un État fort pour assurer la sécurité de chacun et brider les passions naturelles des hommes, là où l’auteur du célèbre Léviathan préconisait de se dessaisir de nos droits sur toutes choses pour les remettre dans les mains d’un pouvoir souverain au moyen d’un contrat social préposé à la stabilisation de la paix, Freud, lui, préfère une politique culturelle d’envergure afin de contenir l’agressivité intrinsèque des hommes. Or bien que Freud déplore la nature belliqueuse des hommes, bien qu’il affirme que «l’homme n’est pas un être doux» (5), il ne croit pas que cette agressivité soit absolue dans la mesure où elle se relativise déjà dès l’instant où une catastrophe naturelle survient. La solidarité prend le dessus dès lors qu’il s’agit de s’unir en vue d’affronter l’hostilité de la nature, c’est-à-dire lorsque nous coopérons pour lutter contre tout ce qui est dissocié du monde humanisé et qui peut nous foudroyer à tout moment. Ce à quoi l’on assiste dans ce cas de figure relève ni plus ni moins d’une tentative humaine de maîtriser ce que l’on appelle volontiers le «destin» ou la fatalité.
Les hommes et les cultures s’associent couramment pour résister à l’indétermination de la nature. Ces rassemblements ponctuels, en se répétant au gré des épreuves du destin, ont peu à peu remplacé une perception physique du monde par une perception métaphysique. Autrement dit les hommes ont de moins en moins accueilli la nature telle qu’elle est parce qu’ils ont eu de plus en plus tendance à postuler ce qu’elle pourrait être à partir d’une «volonté maligne» – ou à partir de toute espèce d’entité qui se situerait dans un au-delà, dans un invisible, dans un genre d’avant-poste inaccessible où se jouerait la partition des événements naturels. En se représentant l’intention d’une entité malveillante et rusée aussitôt qu’une catastrophe les frappe de plein fouet, les hommes, outre qu’ils nous démontrent ici leur superstition, justifient qu’ils ont également besoin de comprendre ce qui demeurerait indéchiffrable sans le concours de leur imagination consolatrice et prolifique. Ce besoin éperdu de sens répond à un envahissant besoin d’ordre, à un appétit de rationalisation qui s’acharne à braver le désordre inhérent à la nature, perçue en tant que force immense et imprévisible, en tant que chaos irrésistible. Parce que les hommes ne veulent pas intégrer le vertige du hasard, le non-sens de la mort violente et l’indifférence totale de la nature, ils préfèrent encore imaginer un diable ou un monstre aux commandes de la nature. En cela, bien avant Freud et sa confondante lucidité, Lucrèce, dans son impressionnant De rerum natura, avait probablement raison de mentionner la difficulté qu’ont les hommes à admettre le complet hasard du monde naturel et leur propension à présupposer des dieux derrière le vaste théâtre de l’univers vivant.
À la racine de cette attitude, Freud identifie la vulnérabilité infantile, la situation de «désaide» (6), en l’occurrence le besoin de protection, et, consécutivement, le rapport nécessaire et ambigu au père (comme figure tutélaire à la fois redoutable et protectrice). À rebours de l’animal qui va voler assez rapidement de ses propres ailes, l’enfant, lui, n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins et sa condition périlleuse dure longtemps. L’enfant va donc puiser un antidote à sa frayeur en se rapprochant du père, en se serrant contre cette sommité d’amour et de force. C’est là que se développe un échantillon de divinité car l’enfant, s’il devient croyant une fois qu’il atteint l’âge adulte, invoquera un dieu protecteur avec lequel il se sentira protégé et rassuré. Les conflits originels relatifs au père biologique, la dimension équivoque d’un lien aussi bien agressif (la haine du concurrent) que sentimental (l’amour du modèle) au début de la vie, seront résolus par «une solution admise par tous», c’est-à-dire une divinité qui s’imposera comme un idéal à vénérer. Un dieu – quel qu’il soit – comblera non seulement notre besoin d’amour précoce mais aussi notre désarroi grandissant à l’idée qu’il faille mourir.
La détresse de l’enfant s’étend ainsi jusqu’à sa vie d’adulte. Ce que le père naturel effectuait aux premiers âges de la vie, un Père surnaturel, immortel et plus fort encore l’effectue pendant le temps des angoisses qui se rattachent au quotidien de l’homme achevé (parmi lesquelles on recense la finitude, la brutalité de la vie, le sentiment d’impureté de la culture, etc.). S’intéressant plus spécifiquement à la divinité de la «culture blanche chrétienne», Freud évoque un Dieu dont le royaume remplit trois fonctions. Tout d’abord il s’agit de conjurer «les effrois de la nature», de transformer la peur de certaines présences naturelles en euphorie, en admiration à la vue des merveilles de la création divine. À la suite de quoi s’engage une réconciliation «avec les cruautés du destin», avec la mort souvent inexplicable ou inacceptable, sous les auspices de la Providence qui stipule que n’importe quelle forme de Mal sera pondérée par un Bien éminemment plus grand. Enfin, d’une manière davantage fréquente compte tenu des visions de moins en moins idolâtres de la nature, la divinité des chrétiens est surtout assignée à un rôle moral dans le but d’apporter une réponse à l’immoralité constitutive de la civilisation. On attend essentiellement de Dieu qu’il procède à une «[compensation des] manques et [des] dommages liés à la culture», d’où les «trésors de représentations» réconfortantes déployés au sein des discours et des pratiques religieuses. Il est fondamental d’esquisser en ce monde les contours d’une terre promise où les uns et les autres, les humiliés et les offensés, les martyrs et les innocents, pourront conquérir des réparations spectaculaires pour tous les préjudices endurés ici-bas. Se construit alors le thème de l’espérance religieuse par le truchement de laquelle s’érige une «fin plus élevée» de l’existence. Quiconque adopte l’espérance d’un saint peut faire face aux vexations et aux embûches de toutes les catégories. Et hors de toute caricature, le principe de l’espérance, ou, pour mieux dire, la vie religieuse à proprement parler, aspire au «perfectionnement de l’être humain» en le soulageant de l’énigme la plus insoutenable (mais qui le demeure pour ceux qui ne vivent pas dans la foi) : la mort. Étant donné que l’existence terrestre n’est qu’un passage qui nous offre l’opportunité d’aiguiser notre âme de façon à entrer sereinement dans l’existence divine, nous sommes exhortés à nuancer les imperfections de la culture en raison des perfections indiscutables qui nous sont prédites. La justice de Dieu rachètera les défaillances de la justice des hommes et elle punira les criminels. Au reste, de tous les dieux qui ont précédé la chrétienté, on peut suggérer, avec Freud, qu’ils se sont bien coalisés et qu’ils ont fini par engendrer «l’Être divin unique», la synthèse des idoles d’autrefois, la cristallisation des êtres supérieurs de naguère en une version définitive et cardinale.
Quoique l’analyse de Freud soit la plupart du temps partiale voire scandaleusement désenchantée aux yeux des lecteurs dévots, elle n’en est pas moins pertinente pour saisir le potentiel hallucinatoire de la religion, pour évaluer le mécanisme de formation de la croyance religieuse comme enracinée dans la fragilité de enfance et se déplaçant progressivement, l’âge mature se consolidant, vers un besoin universel et profondément humain, vers une recherche de la tranquillité assortie d’une fuite de tous les motifs d’inquiétude. C’est pourquoi l’on ne peut contester à la religion son pouvoir de ciment social, sa capacité d’agglomération et le crédit de ses différents syncrétismes. Mais Freud aime à chahuter la naïveté des hommes et les conclusions trop complaisantes auxquelles ils adhèrent quelquefois (7), en quoi il ne peut approuver la solution religieuse comme renforcement fiable de l’âme humaine. En effet, maintenant que Freud a mis le doigt sur le «complexe paternel» pour remonter à la source de la foi, il est inadmissible qu’il s’arrête en si bon chemin. D’après lui, la croyance religieuse perdure parce qu’elle s’établit sur un terrain libidinal et pulsionnel, elle pousse sur une terre radicalement irrationnelle, et, en cela, elle se manifeste comme une illusion pérenne qui soustrait les hommes à une véritable conquête d’eux-mêmes, qui les détourne d’une véritable appropriation de leur psychisme. Pour que les hommes entrent en possession d’eux-mêmes plutôt que d’être possédés par des chimères, il est indispensable qu’ils aient recours à d’authentiques démarches scientifiques et la réflexion de la psychanalyse en est une, fût-elle indirecte tout au long de L’avenir d’une illusion.
La force de persuasion des dogmes
Les représentations religieuses ont franchi la barrière du temps et Freud part du principe qu’elles sont désormais le fruit d’un héritage davantage que le résultat d’une méditation individuelle ou d’une commotion spirituelle vécue dans la solitude. Elles se sont méthodiquement accordées pour former un «système religieux» qui contient même la révélation de Dieu. Cela confirme que la religion dérive de la culture et que le mystique d’antan a été graduellement remplacé par le fidèle quelconque. La religion n’apparaît donc plus vraiment en nous-mêmes – elle s’immisce en nous par l’intermédiaire d’une éducation religieuse qui flatte notre âme d’enfant, qui nous ravitaille en paroles rassurantes et en images apaisantes. L’enfant qui gît en nous est mis en sécurité par une personnification particulière des forces de la nature. Ce mouvement d’apprentissage – ou de catéchisation initiale – nous enseigne que «Dieu est le père exalté», la survivance éternelle de notre premier père protecteur. Et quoique l’aspect concurrentiel du père soit annihilé dans la présence d’un dieu que l’on aime inconditionnellement, il subsiste malgré tout une ambivalence, une ambiguïté, en ce sens que Dieu implique simultanément la fascination et la crainte parce qu’on aime tout autant sa bienveillance qu’on redoute sa puissance.
Plus concrètement, la religion se fixe dans des dogmes et l’on se familiarise d’abord avec la dogmatique de l’école qui édicte «ce qui est pour nous le plus important». La scolarité fonctionne à l’instar d’une salle d’attente de la religion parce que l’enfant, assis sur sa chaise et s’imprégnant de la leçon du maître, apprend à croire sur parole. Les connaissances qu’on lui inculque sont le «résultat abrégé d’un assez long procès de pensée», la simplification efficace d’un savoir complexe passé au crible des exigences d’un enseignement de masse. Cette pédagogie amputée d’un réel esprit critique facilite la découverte des dogmes religieux. Ces derniers reposent sur des sources invérifiables et sur des récits que la science a dûment disqualifiés. L’irrationalité de la religion est traditionnellement défiée par la rationalité de la science, et, au siècle des Lumières dont Freud se fait le continuateur, l’essor du monde savant a malmené le propos classiquement religieux. Mais Freud remarque néanmoins que le niveau du savoir scientifique, fût-il très avancé au moment où il écrit, ne constitue pas un alibi suffisant pour se lancer dans un dénigrement total des dogmes. La persistance des angoisses humaines fait qu’il est toujours mal vu de réfuter ou d’interroger la cohérence les dogmes, lesquels doivent être pris comme des vérités fondamentales et rigoureusement irrécusables. De sorte que les dogmes, s’ils sont légitimement la materia prima qui fournit un éclairage aux plus grandes questions que peut se poser un homme (comme : d’où venons-nous ? où allons-nous ?), sont aussi les choses les moins fondées de l’humanité puisque leurs contenus séjournent dans les régions les moins accessibles à la science. De surcroît, Freud ne manque pas de blâmer la sévérité des dogmes aussitôt qu’on leur cherche querelle, mais sans doute qu’il eût été mieux inspiré de distinguer en amont entre deux catégories hétérogènes de la croyance : d’une part la croyance de type ordinaire et d’autre part la foi comme croyance spécifique, la première étant l’adhésion banale à une proposition injustifiable par la raison (telle que «le père Noël existe»), la seconde étant la certitude absolue en l’existence de Dieu, conciliable avec un exercice appliqué de la raison comme a pu le montrer par exemple le philosophe arabe Averroès dans son Discours décisif.
Il n’empêche que Freud ne s’attarde pas sur la possibilité de la nuance. Pour lui, invariablement, les doctrines religieuses ne s’adressent pas à la raison humaine. Il ne peut pas se rallier à la foi qui proclame qu’à Dieu rien n’est impossible, et que, ce faisant, nous pouvons en venir à croire à des propositions qui seraient jugées absurdes par une intelligence down-to-earth. Il ne remet pas pour autant en cause l’existence de la vie mystique, il ne désavoue pas certaines révélations prodigieuses de la vérité divine, mais il se demande ce qu’il faut faire de tous ceux qui n’ont pas vécu cette étonnante expérience intérieure. C’est là une éventuelle hiérarchie dans la foi : il y aurait ceux qui mériteraient toute notre respect, les pèlerins de l’absolu et les fabuleux mendiants du désert, puis il y aurait tous les autres, les illuminés par défaut, les croyants par atavisme culturel, ceux que devraient se ranger derrière les solutions raisonnables afin de s’extirper de l’illusion réconfortante.
Pour enfoncer le clou, Freud soutient que nous nous comportons vis-à-vis de la religion comme nous le faisons vis-à-vis des fictions. La religion insinue par conséquent un genre de suspension consentie de l’incrédulité. Les dogmes possèdent une incomparable force de persuasion, c’est pourquoi, en fin de compte, nous croyons à ce qu’ils racontent au même titre que nous croyons au personnage d’un roman tout en sachant qu’il s’agit d’une entité réellement inconsistante ou inexistante. Le paradoxe de la fiction nous apprend qu’il n’est pas du tout incongru de pleurer sur le destin de papier d’Anna Karérine (8), et, par analogie, il n’est pas du tout incongru que l’être humain puisse agir comme si le discours religieux détenait une consistance effective. La fiction sous-entend un mentir-vrai qui correspond à la religion, et, au grand dam de Freud, peut-être faudrait-il estimer que le mensonge de la fiction, parfois, délivre une vérité profonde que la rationalité scientifique ne pourra jamais approcher. Par contraste, Freud entend seulement défendre son plaidoyer pour la raison (et la psychanalyse), refusant le moindre secours des fictions pour nous orienter positivement dans la vie. Il y a chez Freud la condamnation d’une logique floue présumée (la religion) au profit d’une logique nettement articulée (la science). La loi de la science doit ainsi éliminer la Loi supérieure de Dieu et construire une vérité qui redonne toute sa dignité et toute sa place à la raison.
L’illusion religieuse et ses effets
Si les dogmes véhiculés par les religions sont aussi persuasifs, c’est qu’ils prennent appui sur les pouvoirs de l’illusion, sur la manière dont elle colonise notre psychisme. Pour clarifier sa thèse, Freud distingue l’illusion de l’erreur et de l’idée délirante. Au sujet de l’erreur, elle relève d’un défaut d’appréciation, d’un manque de jugement, comme lorsque nous nous trompons dans un calcul ou comme lorsqu’une théorie se trouve objectivement corrigée par une nouvelle théorie. L’erreur met donc en avant une défaillance passagère de nos facultés rationnelles sans affecter la réalité en quoi que ce soit, tandis que l’illusion révèle le surgissement et l’ancrage d’un désir imaginaire que l’on croit assouvi ou sur le point de l’être (ce qui altère diversement notre perception du réel). Il s’ensuit que l’illusion religieuse se définit à l’égal d’un «[accomplissement] des souhaits les plus anciens, les plus forts et les plus pressants de l’humanité», parmi lesquels on compte le besoin d’une justice transcendante qui amende la justice imparfaite des hommes, la supplique d’une continuité de la vie après la mort et, ultimement, le recours à des réponses métaphoriques censées démêler ce que la science ne peut pas éclaircir. La persévérance de ces illusions s’explique par le fait qu’elles sont toujours impulsées par le péril de l’enfance et par toutes les peurs qui nous poursuivent inconsciemment à la suite de cette période vulnérable. Tant et si bien que nous croyons en Dieu moins parce qu’on nous impose cette croyance que parce que nous voulons y croire de toutes nos forces – nous voulons être hallucinés par sa présence, nous la désirons viscéralement afin d’échapper à une effrayante solitude existentielle, nous consentons intimement à sa puissance d’apaisement. Dans cette perspective, les doctrines religieuses et la façon dont elles organisent une partie de l’espace public, en sus de la façon dont elles instruisent la vie privée des croyants, ne sont pas de purs éléments de délire (ce sont les manifestations d’une vérité psychique au fond de laquelle affluent les «souhaits les plus anciens» de l’humanité). Partant de là, les cultes, les textes sacrés et les arts religieux, pour ne citer qu’eux, semblent étirer la réalité jusqu’au monde céleste mais ils ne sont pas des contradictions délirantes du monde réel commun. Néanmoins Freud croit pertinent de souligner que certaines croyances religieuses se rapprochent du délire tant elles contrarient le sens objectif de la réalité.
En tant qu’elle se situe à la base de nos plus intimes espérances, l’illusion est indémontrable et irréfutable – elle suit l’homme comme son ombre intérieure et elle résiste à toute explication trop rigide. Il n’y a guère que la matérialisation de l’illusion sous forme de doctrine religieuse qui est passible d’une explication, mais, pour l’illusion proprement dite, sa source est si profondément incrustée dans le psychisme humain qu’elle échappe à toute schématisation. En outre, l’illusion religieuse exacerbe nos désirs les plus ancestraux, de sorte que plus on s’abandonne à la religion, plus on risque de désirer l’impossible (la pardon pour nos offenses, les retrouvailles avec nos disparus, la déchéance de nos ennemis, etc.). C’est la raison pour laquelle l’illusion religieuse détient une longévité colossale : elle promet le bonheur et de temps en temps elle accomplit chimériquement des miracles.
Il va de soi que la vérité révélée de la religion surpasse en qualité de vie la vérité construite et démontrée de la science. À quoi bon connaître scientifiquement le monde si cette connaissance ne me garantit pas le bonheur et ne fait de moi qu’un triste singe savant ? La froideur scientifique ne réchauffe pas les âmes et elle n’entretient pas les souhaits millénaires des hommes. Il paraît de ce fait évident que les hommes aspirent au bonheur avant d’aspirer à la connaissance. Et si cette dernière se dresse devant les instruments qui nous rendent heureux, alors elle sera combattue directement ou indirectement. Au fond la science et la religion n’ont jamais cessé d’être rivales (frontalement ou obliquement) : l’une prétend que l’autre est une illusion qui prive les hommes de se réaliser dans toutes leurs forces, et la religion, accusée de prestidigitation mentale, rétorque à la science qu’elle procure à l’humanité un «idéal moral» qui stabilise la vie sur Terre. À la décharge de la religion, du reste, la critique scientifique oublie souvent que les textes religieux ne prétendent pas être lus littéralement – mais allégoriquement ou paraboliquement. De plus, à force de clouer la religion au pilori, la science (ou une certaine manière de faire de la science) omet de décrier quelques-unes de ses pratiques moralement douteuses (comme celles de tous les docteurs Frankenstein en herbe ou confirmés).
Il est intéressant par ailleurs de supposer que l’illusion religieuse n’est peut-être qu’une facette de toutes les illusions qui gouvernent le monde. Par honnêteté intellectuelle, Freud admet que l’illusion religieuse s’étend possiblement à d’autres domaines de la culture, tant et si bien que les sociétés industrialisées ne sont potentiellement que des dispositifs complexes qui exaucent nos vœux les plus chers. Puisque les hommes veulent être rassurés, puisqu’ils veulent être heureux en cette vie comme dans celle qui soi-disant suivra, il n’est pas incongru de spéculer qu’à côté de la religion traditionnelle se tient par exemple une religion de la technique, promettant l’immortalité bionique à plus ou moins brève échéance (9). Cela tendrait à prouver que les hommes se forgent des divinités un peu partout, qui divinisant les techniciens, qui divinisant les artistes, qui divinisant l’argent, et ainsi de suite selon toutes les idoles qui revendiquent la mort de Dieu tout en existant en fonction d’une modalité similaire de l’illusion. Par conséquent les «prescriptions de la culture», quelles qu’elles soient, ne seraient que des espèces d’injonctions résultant des commandements du psychisme et de leur interprétation religieuse, favorisant l’administration de la société dans une multiplicité de secteurs. Il est alors envisageable de penser la politique à l’instar d’un reflet du religieux : les lois sociales et juridiques se veulent en quelque sorte équivalentes à la Loi divine, d’où l’importance que le peuple y croie au même titre qu’il est susceptible de croire en Dieu. À vrai dire, tant que le peuple croit que la loi est juste en dépit de toutes les imperfections de la culture, le pouvoir politique évite une guerre civile probable. Le pieux mensonge (ou l’extension de l’illusion religieuse), en politique, subvient activement aux besoins primitifs de l’humanité (à commencer par le besoin de vivre en sécurité).
Pourtant, malgré les avantages particuliers de l’illusion religieuse, malgré le fait que beaucoup d’hommes ne pourraient pas continuer à vivre sans le soutien des doctrines religieuses, Freud nous assène que la science est un meilleur atout que le souverain bien offert par la religion. Il ne craint pas que la psychanalyse, à travers ses prises de position pour le moins radicales, soit taxée d’hérésie ou qu’on la perçoive comme une impitoyable machine à désillusionner les masses. Convoquant l’évidence ou ce qui doit passer pour tel, Freud affirme que si la religion avait été d’un quelconque secours, nous n’aurions pas voulu changer le monde. Des siècles de religion n’auront pas suffi par exemple à résoudre le problème récurrent d’une société humaine où le vice triomphe et où la vertu échoue. En plus de ce scandale moral, la religion a péniblement vécu certaines poussées de l’Histoire qui ont parfois notablement réformé la culture, tout comme elle a amèrement reçu certaines découvertes scientifiques. Si l’on ajoute à cela une tendance croissante à l’hédonisme ou au culte du plaisir, on comprend que la religion soit désormais réduite à une sorte de fantaisie accessoire et importune. Et Freud insiste encore sur le caractère extrêmement stérile de la religion en écrivant que même du temps où elle était puissante, elle était finalement impuissante à réprimer l’immoralité, sans doute à cause de quelques accommodements avec Dieu ou à cause de quelques abus de la casuistique. Mais Freud, de nouveau et un peu intempestivement après cette série de remontrances, concède à la religion une compétence de dissuasion ou de police des mœurs. Il se demande ce qu’il adviendrait de la société si les «incultes» et les «opprimés» apprenaient que Dieu n’existe pas ou qu’on a de moins en moins la foi depuis que la science a décisivement progressé. Ce détour argumentatif nous rappelle la fameuse réflexion de Dostoïevski lorsque l’écrivain russe, dans Les Frères Karamazov, conjecturait que l’éventuelle inexistence de Dieu constituerait la porte ouverte à toutes les dérives humaines. L’absence avérée d’une instance morale telle que Dieu serait sûrement préjudiciable en vue de contenir les pulsions de ceux qui jusqu’ici se sont tenus assez tranquilles. En d’autres termes, la religion ne doit peut-être pas disparaître entièrement de l’horizon des consciences si l’on veut perpétuer les coordonnées d’une civilisation fraternelle.
Vers un monde savant laïcisé
Quand il est religieusement fondé, l’interdit culturel du meurtre est orné d’une remarquable épaisseur solennelle et il tient en respect de nombreuses velléités de violence. Toutefois l’usage régulier de «l’auréole du sacré» suscite des interférences dommageables entre les affaires du ciel et les affaires terrestres. Dans la mesure où Freud se mobilise pour que les «prescriptions culturelles» soient uniquement motivées par la raison, il souscrit formellement au modèle d’une société laïque. Hors de la sphère du sacré, par hypothèse, les procédures de répression s’assouplissent et exercent un empire moins oppressant sur les individus. Le verdict d’une justice à hauteur d’homme est en ce sens plus facilement audible et intelligible que le verdict d’une justice qui nous prédit quelquefois des châtiments éternels. Autrement dit la justice concrète et relative des hommes, nonobstant ses défauts, a l’air moins intimidante que la justice absolue de la religion. Et outre la justice, ce sont évidemment tous les domaines de la société qui doivent être reconquis par la raison, pour autant du moins que telle ou telle ramification de la culture soit influencée par l’hallucination religieuse.
Ce que Freud a en tête, c’est une civilisation ultra-scientifique, diffusant une perception de la réalité véridique et dépassionnée, affranchie des fables et des ensorcellements religieux. Il estime que c’est la condition sine qua non de la liberté, et, par ce truchement catégorique, il fait semble-t-il un peu trop vite abstraction des exagérations virtuelles de la science. On l’a déjà dit mais il faut le répéter : la fin déclarée de la religion ne nous protège pas de l’apparition de nouveaux aspects de la divinité, d’autant que, à tout prendre, l’adoration d’une figure céleste (Dieu) paraît moins dangereuse que l’idolâtrie d’une figure terrestre (le scientifique auquel on accorderait toute confiance). À cet égard le savant auquel on prête des pouvoirs illimités s’expose à des licences plus néfastes que celles du religieux auquel on aurait alloué les mêmes faveurs. La planète pourrait être anéantie par les conséquences négatives de l’illusion religieuse, nous ne le contestons pas, mais il est vraisemblable que la probabilité d’un fanatisme scientifique ou d’un excès de science provisoire nous mènerait encore plus vite à la catastrophe. Qu’aurait pensé Freud des deux bombes atomiques de 1945 s’il avait pu les voir ? Que dirait-il actuellement des intentions exhibées du transhumanisme, voire du zèle prescripteur de l’Organisation Mondiale de la Santé en temps de pandémie ? Rien n’indique a priori que la crédibilité que l’on attribue à la science ne participe pas des mêmes processus mentaux que ceux qui se produisent dans l’illusion religieuse.
Cette question de l’illusion généralisée à tous les degrés des facultés humaines, Freud n’a pas manqué de se la poser. Il est même le premier à reconnaître la large incidence des «souhaits pulsionnels» dans la culture et la manière dont cela compromet le travail de l’intelligence. Est-il donc vraiment possible de se passer de la religion ? Faut-il considérer que ceux qui croient en un dieu sont ceux qui ne sont pas capables de renoncer à la silhouette protectrice d’un père ? Bien que ces interrogations soient légitimes, Freud subodore que la religion aggrave l’écart entre les pulsions et l’intelligence, celles-là prenant toujours plus le dessus sur celle-ci, d’où sa volonté de tenter le pari d’une «éducation irréligieuse» à dessein de diminuer l’ascendant des multitudes cognitivement affaiblies. Ce serait aussi l’occasion de vérifier si les hommes ne sont que des centres pulsionnels dotés d’une intelligence médiocre. En effet, en cas d’échec de la science à corriger l’esprit des hommes dans ce qui les convertit à l’illusion, on pourrait baisser le rideau et certifier que le genre humain est irrécupérable.
Quoi qu’il en soit, cette éducation scientifique – ou ce désapprentissage de la religion – devra être graduel car il serait téméraire de priver subitement le peuple de «l’opium» (10) qui l’a illusoirement délivré de la misère sociale (Marx) et de ses peurs d’enfant (Freud). Dans la droite lignée de Marx, le chef de file de la psychanalyse veut désintoxiquer l’humanité du refuge imaginaire de la religion pour que l’individu «forge sa réalité en homme détrompé et revenu à la raison, afin qu’il gravite autour de lui-même, c’est-à-dire autour de son véritable soleil» (11). Ce que Freud espère, en écho de Marx, c’est que les hommes s’émancipent d’un état de tutelle suffocant et qu’ils s’éloignent de tous les dispositifs d’infantilisation mis en œuvre par la religion. Le désengagement d’un au-delà fantasmagorique devrait provoquer la plénitude d’un engagement ici-bas en instituant un contexte politique débarrassé des idoles et des impératifs moraux irréalistes. L’abandon croissant du repère affectif de la religion devrait par conséquent rapatrier les hommes au sein d’une existence davantage intellectuelle. En d’autres termes, on cherche à remplacer l’union affective de la religion par l’union raisonnée des consciences guéries du stupéfiant religieux. Loin des alanguissements ou des lyrismes de la religion, loin des engrenages de la superstition ou des sophismes de quelques fous de Dieu, Freud a pour but l’établissement d’une société sobre, séculière et scientifique. Il est d’ailleurs étrange qu’il s’exprime en ordonnant un ralliement au «Dieu λόγος», en l’occurrence, littéralement, le Dieu-Raison (mais aussi le Dieu-Langage qui renvoie à la parole éminente du psychanalyste qui doit nous aider à vivre sans le père). La référence à une divinité de la raison doit être comprise comme la seule divinité tolérable à l’intérieur d’un monde qui court à sa perte à cause de sa haine répétitive de l’intelligence. La nomination de la raison (ou du langage psychanalytique) au rang de toute-puissance sera la garantie d’une civilisation autonome, libérée des tromperies, des théologiens ardents et des arrières-mondes consolateurs. Aussi, parce que la science se perfectionne continuellement et qu’elle renforce le champ de ses vérités, elle est beaucoup plus opportune pour édifier une société durablement lucide. Cette authentique apologie de la science (et par extension de la psychanalyse), au terminus de L’avenir d’une illusion, annonce qu’elle est la seule à pouvoir dévoiler le monde, la seule à pouvoir restituer aux hommes la réalité que la religion lui avait jusqu’ici confisquée. En tant que telle, la science n’est pas un deus ex machina qui vient de nulle part, elle est plutôt l’unique mode de donation fiable de la réalité, l’unique moyen de nous enrichir intérieurement et de nous préparer à agir efficacement dans le monde, dût-on agir en solitaire après avoir perdu ou tué le père. Au fond, ce que dit Freud, c’est que la science va peu à peu remettre l’homme dans le cours de l’Histoire en lui redonnant les moyens d’une action substantielle – les moyens de courber la matière même des choses après avoir été courbé par l’antimatière de l’illusion religieuse.
Notes
(1) Sigmund Freud, L’avenir d’une illusion (PUF), traduction par Anne Balseinte, Jean-Gilbert Delarbre et Daniel Hartmann. L’essai est publié en 1927.
(2) Ce thème de la violence latente qui devient subitement patente et détruit les apports séculaires de la culture jalonne tout le versant anthropologique de l’œuvre freudienne, dont, évidemment, Le Malaise dans la culture qui paraît trois ans après L’avenir d’une illusion. Du reste, parmi les textes que Freud a consacrés à cette propension cyclique des hommes à détruire la civilisation, comme s’il s’agissait d’accomplir une espèce de libération hygiénique et vitale des pulsions trop longtemps refoulées, on peut citer les remarquables Propos d’actualité sur la guerre et sur la mort, écrits en 1915, en pleine Grande Guerre. On a presque l’impression que pour continuer à vivre, les hommes, de temps en temps, ont besoin de répandre la barbarie et la mort.
(3) Montesquieu, De l’esprit des lois (livre XI).
(4) Le Surmoi, chez Freud, désigne l’intériorisation des exigences et des interdits parentaux. Le terme est introduit en 1923 dans Le Moi et le Ça. Le Surmoi correspond plus particulièrement à une partie de l’appareil psychique qui sert à la fois de modèle et de censeur pour le Moi (entendu, lui, comme partie de la personnalité qui assure les fonctions conscientes et la protège des événements angoissants). Ainsi le Surmoi incarne un genre de tribunal intérieur qui est le reflet de la loi comme bien moral. Par conséquent le Surmoi joue un rôle critique éminent et nous empêche de prendre conscience de nos désirs les plus transgressifs. Il faut donc retenir que la critique du Surmoi s’applique sur notre réalité intérieure de manière inconsciente tandis que le Moi, à l’inverse, émet une critique de la réalité extérieure.
(5) Freud, Le Malaise dans la culture.
(6) Le mot allemand Hilflosigkeit est sans équivalent en français malgré son usage courant pour les germanophones. Il signifie «être en manque d’aide» ou «être en situation de détresse».
(7) C’est ce qu’il fait magistralement dans son Introduction à la psychanalyse, au moment où il résume les trois fameuses blessures narcissiques de l’humanité : la découverte de Copernic, la théorie de Darwin et enfin l’hypothèse de l’inconscient révélée par la psychanalyse, autant d’avancées à portée scientifique qui ont tour à tour désarçonné les conceptions en vigueur et qui ont rappelé aux hommes que rien n’est jamais acquis, que rien ne permet d’alimenter durablement quelque prétention à la connaissance exhaustive de soi et du monde.
(8) Cf. Colin Radford, Le destin d’Anna Karénine (Esthétique contemporaine, Vrin, 2005).
(9) Le roman Zéro K de Don DeLillo raconte admirablement cette dérive blasphématoire.
(10) Cf. Karl Marx, Critique de la philosophie du droit de Hegel.
(11) Marx, ibid.
Lien permanent | Tags : philosophie, sigmund freud, l'avenir d'une illusion, gregory mion, religion, science |  |
|  Imprimer
Imprimer





























































