« Le Spectre de Frankenstein d’Erle C. Kenton, par Francis Moury | Page d'accueil | Les Épées de Roger Nimier »
17/10/2021
L’Amérique en guerre (25) : Outremonde de Don DeLillo, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Willy Spiller.
 L'Amérique en guerre.
L'Amérique en guerre.«Peut-être que la Métropolis de l’avenir ne pourra vraiment s’édifier que sur le terrain vague créé par le souffle d’un conflit atomique.»
Bernard Charbonneau, Le Jardin de Babylone.
«Un joueur de baseball, c’était un homme, et pourtant, dès lors qu’il faisait partie d’une équipe, il était transformé en un animal, un mutant ou un esprit vivant au ciel auprès de Dieu.»
Paul Auster, Tombouctou.
Aperçu général d’une acropole romanesque
 Probablement l’œuvre la plus emblématique du répertoire de Don DeLillo, la plus dense et la plus difficile aussi, Outremonde (1) explore les tendances du psychisme américain pendant la Guerre Froide. En près de mille pages où alternent des moments narratifs classiques, des flux vertigineux d’omniscience, des dialogues crus et des conversations très sophistiquées, se constitue un réseau de personnages avec lesquels nous remontons le temps jusqu’aux années 1950, traversant quatre décennies de tensions nationales et de provocations internationales où plane en permanence la menace de l’arme atomique. En effet, après un prologue mémorable qui décrit un jour fameux de l’année 1951, le roman débute en 1992, en léger aval de la Guerre Froide qui fut ni plus ni moins que «l’urgence de la guerre sans la guerre» (p. 440), puis le drame s’aventure à contre-courant dans le fleuve de l’Histoire, cherchant des causes aux conséquences initialement rapportées, sollicitant un cadre pour ce tableau factuel baroque, procédant à une généalogie individuelle et collective de la conscience – et de l’inconscient – d’une nation déterminée à éliminer de son sol toutes les formes de l’idéologie soviétique et tous les signes d’un étrange marasme. En cela, une autre idéologie apparaît, celle de l’Amérique paranoïaque et arrogante, conquérante également, celle d’un peuple surexposé à de nombreuses pathologies sociales et parfois condamné à trouver des terrains d’épanouissement au sous-sol, aux carrefours de l’underground, en-deçà de la surface contaminée par la peur et par les discours officiels qui entretiennent un état d’exception obstiné vis-à-vis de l’ennemi communiste.
Probablement l’œuvre la plus emblématique du répertoire de Don DeLillo, la plus dense et la plus difficile aussi, Outremonde (1) explore les tendances du psychisme américain pendant la Guerre Froide. En près de mille pages où alternent des moments narratifs classiques, des flux vertigineux d’omniscience, des dialogues crus et des conversations très sophistiquées, se constitue un réseau de personnages avec lesquels nous remontons le temps jusqu’aux années 1950, traversant quatre décennies de tensions nationales et de provocations internationales où plane en permanence la menace de l’arme atomique. En effet, après un prologue mémorable qui décrit un jour fameux de l’année 1951, le roman débute en 1992, en léger aval de la Guerre Froide qui fut ni plus ni moins que «l’urgence de la guerre sans la guerre» (p. 440), puis le drame s’aventure à contre-courant dans le fleuve de l’Histoire, cherchant des causes aux conséquences initialement rapportées, sollicitant un cadre pour ce tableau factuel baroque, procédant à une généalogie individuelle et collective de la conscience – et de l’inconscient – d’une nation déterminée à éliminer de son sol toutes les formes de l’idéologie soviétique et tous les signes d’un étrange marasme. En cela, une autre idéologie apparaît, celle de l’Amérique paranoïaque et arrogante, conquérante également, celle d’un peuple surexposé à de nombreuses pathologies sociales et parfois condamné à trouver des terrains d’épanouissement au sous-sol, aux carrefours de l’underground, en-deçà de la surface contaminée par la peur et par les discours officiels qui entretiennent un état d’exception obstiné vis-à-vis de l’ennemi communiste.Une fois ces précisions liminaires énoncées, on distingue alors assez rapidement la polysémie de l’outre-monde visé par DeLillo : il s’agit conjointement du monde soviétique considéré en tant que crypte planétaire, des rares zones d’émancipation où l’on peut exercer un libre arbitre rédempteur, des «montagnes creusées dans le Nouveau-Mexique» et des «montagnes évidées dans le Colorado» (p. 499) à l’intérieur desquelles s’activent les savants fous du nucléaire, mais encore des coulisses du pouvoir américain où s’élaborent les éléments de langage arbitraires anti-communistes et les prolongements de la psychose. L’ensemble s’édifie comme une sorte de Vie mode d’emploi de Georges Perec où l’immeuble de l’existence américaine serait proposé en coupe frontale au lecteur, nous révélant certains secrets, certaines indiscrétions, certaines conspirations vraisemblables, avec cet ultime dessein, bien sûr, de nous dévoiler le dessous des cartes de la Guerre Froide. À ce titre, on peut d’ailleurs évoquer l’application jubilatoire de la «Dietrologia», un terme italien qui «signifie la science de ce qui est derrière quelque chose», l’étude minutieuse «de ce qui est derrière un événement» (p. 302). D’origine italienne, passionné de surcroît par les forces invisibles et constitutives de l’humanité, Don DeLillo, à n’en pas douter, rend ici hommage à ses racines identitaires et esthétiques, sondant les États-Unis pour mieux comprendre sa place au sein de ce pays fascinant et pour encore repousser les limites de ses pratiques romanesques. Davantage que dans le déroutant Libra ou le si prévoyant Bruit de fond, DeLillo, avec ce livre infiniment prospecteur, touche aux confins de l’Amérique et aux tréfonds d’une Terre catastrophée par le face-à-face de deux paradigmes abusifs qui se disputent une dérisoire postérité (2).
Symboliquement, du reste, tout semble partir ou graviter autour de la «Jornada del Muerto», ce lieu solitaire du Nouveau-Mexique, cet endroit le plus reclus et le plus contradictoire de la Tierra de Encanto, «site du premier essai atomique jamais réalisé» (p. 576). Dès lors qu’une explosion nucléaire se fit entendre aux abords de ces domaines abandonnés de Dieu et de ses créatures, dès lors qu’on ajouta à la désolation naturelle une désolation technique, un excès de rationalité, l’univers prit une funeste tournure et inaugura cette époque désenchantée où l’homme désormais se trouvait en capacité de s’autodétruire complètement. Si Jean-Paul Sartre repéra dans la bombe atomique le paradoxe d’une liberté supérieure, soutenant avec aplomb qu’il fallait maintenant chaque jour choisir de vivre ou de mourir (3), caractérisant de la sorte l’accablante responsabilité qui pesait sur les épaules du monde humain, il convient peut-être cette fois-ci de minimiser la philosophie et de supposer qu’un tel instrument de combat – ou instrument de dissuasion – ratifie plutôt le commencement d’une danse macabre, d’un crépuscule irrémissible, voire d’une définitive obsolescence de l’homme pour reprendre les mots judicieusement alarmistes de Günther Anders. Ce contraste qui sépare l’homme libéré par la technique de l’homme prisonnier de la technique nous rappelle, au besoin, l’ambivalence du progrès qui est à la fois une bénédiction et une malédiction. Or c’est la malédiction qui monopolise le débat, et, donc, c’est du côté de la servitude intentionnelle ou somnambule que Don DeLillo braque souvent son regard, comme si la bombe et ses dérivatifs polarisaient à peu près tout. En raison de cela, fatalement, il regarde un peu moins du côté de la liberté, qu’il approche par intermittence, moyennant ici ou là des plongées nécessaires au cœur des quartiers atypiques et des cerveaux indociles. Les soumis, les crédules, les grosses têtes vénales et les façonneurs d’aliénation se comptent par millions et les prophètes de l’autonomie, eux, sont de facto voués à circuler parmi les secteurs où quasiment nulle âme ne se rend ou ne soupçonne qu’il puisse y avoir de la vie sainte en réserve.
L’Amérique mystifiée et momifiée
 Au seuil de ce roman admirable à maints égards, monstrueux pourrait-on dire aussi, une hypothèse relativement commune fait irruption mais son maniement littéraire unique la cristallise sur-le-champ : si l’une des ramifications de l’Histoire des États-Unis possède une acoustique, si elle produit un son à nul autre pareil, si ce timbre civilisationnel relève d’un langage particulier, celui-ci concerne indiscutablement «l’ardeur à grande échelle» (p. 11), en l’occurrence la clameur des foules qui se soulèvent au cours des événements sportifs, de même que la montée en puissance de cette foule qui s’achemine au stade, telle une somme d’individualités traduisant par son agglutinement progressif un saisissant préavis de révolution (cf. pp. 11-2). Don DeLillo, au fil d’un long prologue ahurissant (cf. pp. 11-65), ne manque pas de souligner la ligature spéciale qui unit la chose sportive à la chose historique, deux molécules qui finissent par devenir cosa mentale en Amérique, l’une et l’autre se fondant, se répondant, se déployant en un système de représentations où convergent indifféremment les dieux du stade et les ténors de la politique. S’affirme ainsi une dimension ludique assez envahissante : l’Américain ordinaire est celui qui observe continuellement les coups d’un jeu immense. Il est témoin des exploits sportifs comme il est témoin des arbitrages de son gouvernement ou de ses autorités locales. Plus le coup est spectaculaire, plus il est décisif au sein d’une matrice de règles occultement évolutives, plus l’approbation populaire sera au rendez-vous, peu soucieuse d’interroger la valeur quelquefois négative de ce qui a été applaudi avec ferveur. Il est important de gagner ou de mimer tous les comportements de la victoire, mais, en filigrane, il est tout aussi important d’y parvenir avec panache, avec héroïsme, avec finalement un sens accompli de la dramaturgie. La victoire écrasante a ses mérites mais la victoire laborieuse ou inattendue est dotée d’une envergure très avantageuse. À ce jeu-là, sportivement, l’issue des joutes n’est pas vraiment problématique et n’engage par la suite que le zèle des journalistes et des foules stupéfiées, toutefois, politiquement parlant, ces traditions dorénavant consolidées ont naguère servi des opportunistes tels que Huey Long ou bien Ignatius Donnelly (4).
Au seuil de ce roman admirable à maints égards, monstrueux pourrait-on dire aussi, une hypothèse relativement commune fait irruption mais son maniement littéraire unique la cristallise sur-le-champ : si l’une des ramifications de l’Histoire des États-Unis possède une acoustique, si elle produit un son à nul autre pareil, si ce timbre civilisationnel relève d’un langage particulier, celui-ci concerne indiscutablement «l’ardeur à grande échelle» (p. 11), en l’occurrence la clameur des foules qui se soulèvent au cours des événements sportifs, de même que la montée en puissance de cette foule qui s’achemine au stade, telle une somme d’individualités traduisant par son agglutinement progressif un saisissant préavis de révolution (cf. pp. 11-2). Don DeLillo, au fil d’un long prologue ahurissant (cf. pp. 11-65), ne manque pas de souligner la ligature spéciale qui unit la chose sportive à la chose historique, deux molécules qui finissent par devenir cosa mentale en Amérique, l’une et l’autre se fondant, se répondant, se déployant en un système de représentations où convergent indifféremment les dieux du stade et les ténors de la politique. S’affirme ainsi une dimension ludique assez envahissante : l’Américain ordinaire est celui qui observe continuellement les coups d’un jeu immense. Il est témoin des exploits sportifs comme il est témoin des arbitrages de son gouvernement ou de ses autorités locales. Plus le coup est spectaculaire, plus il est décisif au sein d’une matrice de règles occultement évolutives, plus l’approbation populaire sera au rendez-vous, peu soucieuse d’interroger la valeur quelquefois négative de ce qui a été applaudi avec ferveur. Il est important de gagner ou de mimer tous les comportements de la victoire, mais, en filigrane, il est tout aussi important d’y parvenir avec panache, avec héroïsme, avec finalement un sens accompli de la dramaturgie. La victoire écrasante a ses mérites mais la victoire laborieuse ou inattendue est dotée d’une envergure très avantageuse. À ce jeu-là, sportivement, l’issue des joutes n’est pas vraiment problématique et n’engage par la suite que le zèle des journalistes et des foules stupéfiées, toutefois, politiquement parlant, ces traditions dorénavant consolidées ont naguère servi des opportunistes tels que Huey Long ou bien Ignatius Donnelly (4). Ce graduel mélange des genres a impliqué une logique maladive du divertissement exhaustif et cette idée qu’un événement – de quelque nature soit-il – a le devoir d’être par essence retentissant (sinon il est relégué dans la catégorie du sous-événement ou du non-événement). Pourtant la chronologie inversée de la Guerre Froide, chronologie que Don DeLillo travaille après son copieux préambule, insiste justement moins sur les devants de la scène que sur les coulisses de ce conflit interminable, comme si, subtilement, l’archétype du bruyant gouvernement des foules par l’action directe devait se compléter d’un nouvel arsenal d’actions indirectes. À l’amorce des années 1950, il semble donc que le glas ait sonné pour les stratégies ultra-démonstratives qui révèlent presque tout d’elles-mêmes, lestées de sommités fanfaronnes n’ayant qu’un double fond limité. De ce fait, en recourant dans ce prologue aux émotions tonitruantes d’un match de baseball d’anthologie (les New York Giants contre les Brooklyn Dodgers durant l’indélébile 3 octobre 1951), mais encore en décrivant aussi bien le troupeau que les bergers réunis au fabuleux stade unificateur, l’objectif présumé de l’auteur consiste habilement à dissocier la grandissante passivité de la masse américaine de l’activité férocement exponentielle de la minorité dirigeante, la première étant animée par la volonté de croire davantage que par la volonté de savoir, et la seconde étant préoccupée à scénariser l’inessentiel, à s’en mêler, à le mettre en spectacle, tout en conservant l’essentiel dans les forteresses inexpugnables et introuvables de l’oligarchie. Pendant que la multitude se distrait, assouvie par une succession de narrations tumultueuses, l’élite garde la main sur les événements réellement cruciaux (et ceux-là sont invariablement silencieux, discrets, joués dans les interstices des échanges géopolitiques, dans les sinueuses dialectiques de la diplomatie, dans les sections patriciennes d’une arène de baseball, cela va de soi, ou encore dans les abysses de la Terre, dans ces souterrains labyrinthiques où se fabriquent des obus qui pourraient anéantir le monde entier).
Par conséquent, il résulte des inédites duplicités de la Guerre Froide un raidissement du mensonge, de la manipulation et du divertissement juxtaposés : les personnalités apparentées à des populistes ou à des amuseurs professionnels, les athlètes également, ne sont plus que des fantoches plébiscités dont le rôle immédiat ou intermédiaire se résume grosso modo à duper les masses, à les conditionner en revendiquant leur instruction (5), tandis que, du temps révolu de Long ou de Donnelly, il pouvait subsister un lien entre un rassemblement public turbulent et la participation à un véritable destin national, à un authentique accroissement de la vitalité, ne fût-ce même que de très loin d’un point de vue métaphysique. Autrement dit, la Guerre Froide installe un astucieux dispositif de détournement de l’attention tout en feignant d’entraîner l’Amérique dans la Voie préférentielle, dans ce que l’on promeut comme étant la liberté absolue, alors même que se renforce une existence conforme à la machine capitaliste, une manière de vivre unidimensionnelle, les pieds dans les fers, triste constat qui sera nettement établi dans l’épilogue (cf. pp. 843-890). D’une façon tout à fait sinistre, nous sommes passés de l’ère des pieux mensonges aux allures hystériques, signature d’une certaine Amérique d’antan non dépourvue d’élans fédérateurs constructifs, à l’ère des mensonges païens aux allures de sérieux plaidoyers pour la vérité, associés à des événements surmédiatisés qui accaparent l’esprit critique. Cette Amérique-là, celle qui s’institue au moment de la Guerre Froide et qui s’affermit encore au lendemain de quarante ans de luttes symboliques, cette Amérique de la féérie inlassable et de l’industrie omnipotente de la frivolité, en concubinage avec des ambitions axiologiques démesurées, cette Amérique, assurément, mériterait qu’on lui administre d’emblée l’extrême-onction tant elle s’effondre sous ses intenables contradictions. On ne peut pas vouloir assumer la suprême direction de la planète tout en valorisant les innombrables constituants du tableau périodique de la régression vitale. La Guerre Froide – et tout ce qui lui a succédé – confirme par-delà son évidente et glaciale sémantique les preuves d’une inquiétante rigor mortis des esprits et des corps. Il n’est en fin de compte nullement surprenant que le Capital se nourrisse avidement au baquet de la Guerre Froide puisque l’économie occidentale aime d’autant plus la guerre que celle-ci n’en a pas l’air. Cela favorise la perpétuation et le durcissement d’un statu quo prodigieusement criminel et outrageusement légalisé, entouré de l’incessant refrain du panem et circenses.
Il n’en fallait pas tant pour attirer dans les travées privées de ce stadium new-yorkais un émérite serpent tel que J. Edgar Hoover et une vedette du gabarit de Sinatra. Qu’une équipe ou une autre remporte la mise n’a aucune sorte d’importance pour ces flambantes étoiles d’un ciel enténébré. Sur la ligne imaginaire qui incarne le chain of command de la patrie et qui conduit jusqu’aux secrets d’État, Sinatra et Hoover ne sont qu’à quelques encablures du noyau dur, à proximité de ces laboratoires prométhéens où s’écrit l’Histoire et où se perfectionnent les armes de destruction massive. Eux sont dans la confidence et les autres, tous les membres du public, toute la plèbe absorbée par l’évolution du score, vivent et meurent selon le résultat du match, à tel point d’ailleurs qu’une défaite est susceptible de ruiner d’abondants espaces urbains comme si une bombe avait été lâchée sur les maisons (cf. p. 15). Aux uns (rarissimes) la délectation de surplomber, de profiter du délire bachique des foules prisonnières du spectacle, le bonheur d’être certains d’avoir un abri antiatomique au cas où une bombe serait concrètement larguée sur l’Amérique, aux autres (ordinaires) l’ignorance diluée dans le culte récréatif, le banal hédonisme du sport, le sincère bouleversement d’apercevoir les personnes éminentes au sein d’une «tribune très sélecte» (p. 17). Avec sa «gueule de bouledogue» et son «corps épais» supportant une «tête de Bouddha» (p. 18), Hoover magnétise la multitude et se console de sa taille minuscule. Du reste, en brocardant le directeur du FBI et d’autres gros bonnets réels, Don DeLillo entrelace adroitement la réalité et la fiction, radicalisant une opération littéraire assez prisée de James Ellroy (6). Cela tend à montrer sans la moindre ambiguïté que la vulgarité, la décadence et la responsabilité proviennent toujours des élites et que le peuple n’est qu’un pâle reflet des causes premières d’une Amérique aux abois.
En outre, la description épique de ce derby qui oppose les Giants et les Dodgers sur fond de négociations politico-sensationnelles prend un aspect remarquablement dramatique à l’instant où l’agent spécial Rafferty déloge Hoover de son strapontin et l’avertit que l’Union soviétique, le fier monolithe rouge, sur son propre territoire, a «procédé à un essai atomique sur un site secret» (p. 25). Le spectre du communisme non seulement se fait plus envoûtant mais atteint aussi un degré de matérialisation qui méduse les États-Unis d’en haut comme les États-Unis d’en bas. Des rumeurs et des informations caricaturées ne cessent de se diffuser depuis les prémices de cette Cold War ainsi baptisée par George Orwell, tant et si bien qu’on explique les places libres du stade par une espèce de crainte prolétarienne vis-à-vis du lugubre péril nucléaire, mastodonte épée de Damoclès psychique suspendue au-dessus d’un pays triplement possédé par la toute-puissance de la presse, par un état d’urgence assidûment régénéré et par la volonté d’être halluciné. Le monstre paranoïaque s’empâte et devient une graisse nationale qui redoute le pire et ressasse sans relâche les vieilles rengaines du danger bolcheviste. Cela s’éternise dans un contexte de «déclin moral qui règne partout» (p. 30) et permet de penser, au détour d’une éventuelle conjecture fracassante, que les États-Unis valent moins que l’URSS. Mais d’une manière moins conjecturale et beaucoup plus patente, il est clair, a posteriori, que les USA ont manufacturé une narrativité de l’effroi au sujet du maléfice socialiste afin de structurer la nation autour d’une peur collective rentable.
Quoi qu’il en soit, nolens volens, on sent peser sur cette partie de l’Occident un couvercle baudelairien, une voûte céleste fatale, une calamiteuse vocation allégoriquement illustrée par une reproduction du Triomphe de la mort de Pieter Bruegel l’Ancien dans le magazine Life, publication hebdomadaire au titre si aberrant quand on songe aux implications herméneutiques de ce chef-d’œuvre de la Renaissance flamande (cf. pp. 44-5 et 53-5). C’est un mouvement de foule consécutif à une euphorie sportive qui a fait planer la double-page déchirée du tableau de Bruegel jusqu’aux mains révulsées de Hoover. Parmi les divers objets que le public balance sur la pelouse du stade, il y a des papiers, des fragments de journaux, des morceaux de magazines, des objets non identifiés, puis, comme un fait exprès, Le Triomphe de la mort reproduit avec pompe atterrit dans l’orbite de Hoover et ce dernier s’en indigne tout autant qu’il s’en trouve éberlué. En effet, sur le segment tribord de cette terrible peinture, se dessine «une sorte de trou de l’enfer», un orifice censément ergonomique, une bouche fonctionnelle «qui pourrait être un tunnel de métro ou un couloir de bureaux» (p. 44), écho anticipé d’une Amérique grégaire, massifiée, une nation forcenée dont le peuple s’entasse sous le couperet de la Faucheuse après avoir tutoyé les sommets de la pulsion de mort. C’est le pays dans son intégralité qui se voit aspiré par un trou noir, par une puante douve du Slough of Despond de John Bunyan, aimanté par une sombre destinée irréversible et contre laquelle ne résiste aucun secours providentiel. La gouvernance des États-Unis gît métaphoriquement sur l’œuvre de Bruegel et se rattache à une monarchie absolue des suprématies malfaisantes. Il ne s’agit pas d’une terre de la composition, de la fertilisation – il s’agit d’un nuisible royaume de la croix inversée, royaume tout entier assujetti aux agents maudits de la décomposition, de la putréfaction. À quelque niveau que ce soit de l’Amérique, «les morts sont venus prendre les vivants» (p. 53), les pécheurs, les canailles, les scélérats, les concupiscents et les damnés, tous autant qu’ils sont, déferlent en essaims vengeurs pour proclamer que «la Mort est partout», que la «Conflagration» arrive prestement, que «la Terreur universelle» (p. 54) est imminente, symptomatique d’un monde où la bombe à fission existe insolemment et occupe par-dessus le marché une position centrale dans les pourparlers internationaux (cf. p. 55).
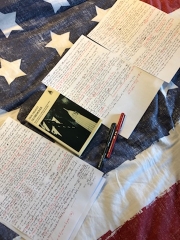 Or à cette déflagration prochaine correspond la déflagration présente de la victoire inespérée des Giants, les deux fracas se réfléchissant sur l’œil vitrifié d’un Shéol atlantique, victoire obtenue par le biais d’un home run de Bobby Thomson au détriment d’un lancer de Ralph Branca. On discute du point d’impact de la balle à l’instar du lieu «où le général Lee s’est rendu à Grant» (p. 64) ou encore, cela se pourrait, à l’instar de cet endroit où les Russes viennent de tester leur matériel nucléaire. D’égal à égal avec la politique, avec la valse historique, le sport est en mesure de courber l’espace-temps le plus manifeste et de s’emparer des consciences pour une durée indéterminée. Le sport tel qu’en lui-même l’Amérique l’éprouve insinue quelque chose comme une sécurité intérieure (cf. pp. 64 et 185). Il est résolument «une note de bas de page à la fin de la guerre» organique (p. 105) et surtout il est un expédient qui noie le poisson, qui dissimule des guerres particulièrement abstraites, inorganiques, tout en provoquant des dissensions à une échelle insoupçonnable de l’économie, suscitant de déplorables crispations commerciales et culturelles. Par conséquent nous comprenons que la balle propulsée par Thomson puisse être dotée d’une aura aussi éblouissante qu’un bibelot qui eût appartenu aux annales du pouvoir politique. En définitive, le projectile de Thomson est d’autant plus primordial qu’il figure le réifiant levier d’Outremonde, passant d’un coin à l’autre du pays en fonction de la flamme spéculative de certains fanatiques, acquérant progressivement l’attractivité d’une bombe à neutrons, devenant l’irréprochable insigne d’un empire sur autrui. Et l’on se dispute la balle pendant qu’à d’autres strates plus enfouies des imbrications humaines, infailliblement, l’on se bagarre pour de plus considérables prestiges. En tant que telle, cette balle de baseball sublimée par Bobby Thomson est l’expression d’un vigoureux tropisme de la convoitise et d’un instinct furieux qui pousse les hommes à mythologiser le réel. Elle est une source de gravitation quasi universelle à l’image du violon de Jaume Cabré dans Confiteor, tangible fusil de Tchekhov surchargé, revenant de façon lancinante tout au long du roman, notamment durant les épisodes touchant aux pathétiques pérégrinations de Manx Martin.
Or à cette déflagration prochaine correspond la déflagration présente de la victoire inespérée des Giants, les deux fracas se réfléchissant sur l’œil vitrifié d’un Shéol atlantique, victoire obtenue par le biais d’un home run de Bobby Thomson au détriment d’un lancer de Ralph Branca. On discute du point d’impact de la balle à l’instar du lieu «où le général Lee s’est rendu à Grant» (p. 64) ou encore, cela se pourrait, à l’instar de cet endroit où les Russes viennent de tester leur matériel nucléaire. D’égal à égal avec la politique, avec la valse historique, le sport est en mesure de courber l’espace-temps le plus manifeste et de s’emparer des consciences pour une durée indéterminée. Le sport tel qu’en lui-même l’Amérique l’éprouve insinue quelque chose comme une sécurité intérieure (cf. pp. 64 et 185). Il est résolument «une note de bas de page à la fin de la guerre» organique (p. 105) et surtout il est un expédient qui noie le poisson, qui dissimule des guerres particulièrement abstraites, inorganiques, tout en provoquant des dissensions à une échelle insoupçonnable de l’économie, suscitant de déplorables crispations commerciales et culturelles. Par conséquent nous comprenons que la balle propulsée par Thomson puisse être dotée d’une aura aussi éblouissante qu’un bibelot qui eût appartenu aux annales du pouvoir politique. En définitive, le projectile de Thomson est d’autant plus primordial qu’il figure le réifiant levier d’Outremonde, passant d’un coin à l’autre du pays en fonction de la flamme spéculative de certains fanatiques, acquérant progressivement l’attractivité d’une bombe à neutrons, devenant l’irréprochable insigne d’un empire sur autrui. Et l’on se dispute la balle pendant qu’à d’autres strates plus enfouies des imbrications humaines, infailliblement, l’on se bagarre pour de plus considérables prestiges. En tant que telle, cette balle de baseball sublimée par Bobby Thomson est l’expression d’un vigoureux tropisme de la convoitise et d’un instinct furieux qui pousse les hommes à mythologiser le réel. Elle est une source de gravitation quasi universelle à l’image du violon de Jaume Cabré dans Confiteor, tangible fusil de Tchekhov surchargé, revenant de façon lancinante tout au long du roman, notamment durant les épisodes touchant aux pathétiques pérégrinations de Manx Martin. Résident du quartier de Harlem dans le septentrion lésé de Manhattan, le dénommé Manx Martin a mis le grappin sur le trophée de son jeune fils Cotter, un butin dangereusement conquis en cette journée du 3 octobre 1951 à l’occasion du match inoubliable et d’une auto-prescription d’école buissonnière. À force de ruse et d’obstination, Cotter a pu intercepter la balle du home run et la ramener chez lui, au nez et à la barbe d’un poursuivant hargneux. Sans le savoir, il a été la petite main socialement opprimée par laquelle un chapitre de la mythologie sportive s’est écrit, parallèlement au chapitre des tensions idéologiques qui se sont accrues ce même jour. Par ailleurs, la constante miscibilité du phénomène sportif et du phénomène politique découvre son apogée à travers la réflexion intempestive d’un collectionneur de baseball – Marvin Lundy – qui s’est rendu compte que le noyau radioactif d’une bombe atomique est «exactement de la même taille qu’une balle de baseball» (p. 187). C’est aussi Marvin Lundy, soit dit en passant, qui stipule que les sièges inoccupés lors de la rencontre entre les Giants et les Dodgers sont le signe irréfutable d’une irruption de la temporalité historique dans la temporalité festive. Qu’elle soit raisonnée ou impulsive, la peur de l’attaque nucléaire est un horizon palpable pour les Américains des années 1950 et de toutes les années postérieures qui ont dûment justifié la terminologie d’une Guerre Froide (cf. p. 264). Au demeurant, cette intrication étrange de la trajectoire d’une balle de baseball avec la trajectoire de l’arme atomique certifie le genre de valeur démultipliée de l’objet sphérique projeté par Thompson, et, parce que Manx Martin n’est qu’un épiphénomène trivial au milieu de cette phénoménalité magique, parce qu’il n’est qu’un misérable nègre incapable de s’apercevoir des enjeux à long terme, broyé de surcroît par «l’éternel sujet de la dèche» (p. 161), il était inévitable qu’il subtilisât le trésor de son rejeton afin de le vendre aussitôt au plus offrant, au plus malin des clients, stupide colporteur de la médiocrité fétichiste parmi l’atmosphère d’une Big Apple enfiévrée par les prouesses des Giants. Puis, au hasard de sa déambulation boutiquière, il croise la route d’un prêcheur de rue, évangéliste d’asphalte qui palabre à propos de la résistance des insectes aux radiations, de la persévérance dans l’être des blattes, de la science qui soutient que «les insectes seront encore là quand les bombes atomiques abattront les immeubles et détruiront les gens et tueront les oiseaux et les animaux et châtreront les chiens et les chats» (p. 382). L’orateur appesantit son apocalyptique homélie en désignant le privilège des Blancs de New York, car, pour eux, des refuges nuclear-proof sont prévus, au détriment des Noirs qu’on remettra volontiers aux nuées ardentes du rayonnement létal (cf. p. 383). Or malgré ces déclarations hyperboliques teintées de vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire ou à écouter, Manx Martin, imperturbable Ulysse d’opérette, vaque à ses projets mercantiles en ces premières heures du 4 octobre 1951, enveloppé de la nuit qui exacerbe sa transe cupide, une montre arrêtée depuis six semaines fixée à son trémulant poignet de disetteux.
Finalement, au bout de sa chevauchée nocturne, il vendra la balle à un honnête pater familias et à son fils, pour la somme de trente dollars et des broutilles (cf. p. 706). La modicité de l’échange, réverbérée par l’avalanche d’intrigues du roman, nous frappe par le truisme de sa violence de classe. À la fois heureux et déboussolé par cette transaction, Manx Martin s’improvise philosophe et précise à son acheteur que le baseball est «plus énorme que certaines guerres» (p. 707). Cette parole improvisée contient toute la thèse de Don DeLillo sur la faculté médiatique d’intoxiquer la population modeste par un faisceau d’événements sportifs – ou bien pour susciter une analogie avec les événements politiques ou polémologiques, ou bien pour mobiliser l’attention des plus influençables sur les minima de l’Histoire. Cependant les temps ont changé en période de Guerre Froide et l’alternative précédente se dessine plus clairement, se neutralisant en quelque sorte : si une relation de transitivité semble se maintenir en surface entre l’ordre ludique et l’ordre politique, le premier, à présent, n’est plus qu’un suppôt du second, une opportunité de saturer de légendes l’espace visible en vue de conserver sous scellés l’espace caché des principes régulateurs de l’existence américaine. Non pas que des Huey Long ou des Ignatius Donnelly soient subitement devenus impossibles, mais, s’ils devaient apparaître à l’époque de la Guerre Froide et même après ce conflit de semi-passivités réciproques, ils n’auraient plus la même fonction qu’auparavant. Là où ils pouvaient être autrefois des exhibitionnistes de l’âme américaine, c’est-à-dire des protagonistes de l’Amérique hardline issue de ses plus profondes racines, ils ne seront plus, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, que de négligeables coquilles vides animées par l’immatériel mandarinat du Capital et par les cyniques fomentateurs de crédos. En un mot, avec la Guerre Froide, les dirigeants des États-Unis ne sont plus tellement ceux qui apparaissent mais ceux qui n’apparaissent pas ou qui ne le font que très parcimonieusement, tel l’inénarrable J. Edgar Hoover, peut-être davantage président de son pays que ne le fut un Franklin D. Roosevelt.
Ossuaires pour des squelettes artificiels : l’Amérique remise en question (du millésime 1992 en trompe-l’œil au mitan des années 1980)
La fin de la Guerre Froide a laissé sur la planète de déconcertants cimetières. Il y a bien sûr les bâtiments désaffectés ou à demi réhabilités de l’univers soviétique, ces mausolées titanesques à la (fausse) gloire des prolétariats successifs, vastes cités de science-fiction qu’on dirait désormais hantées par des fantômes antédiluviens ou agrégées à une conurbation de Tchernobyl. Il y a aussi ces déserts d’Amérique où reposent des cadavres d’avions qui furent au service de l’armée, quelque part dans le nulle part de l’Arizona, des carcasses rangées scrupuleusement, selon la rigueur d’un cadastre de nécropole, formant les macabres coordonnées d’un aircraft boneyard. Ces aéronefs sont immatriculés en tant que B-52, «bombardiers de longue portée» (p. 77), jadis omniprésents pour opérer le survol des «frontières soviétiques» (p. 83), flottant plus haut que n’importe quel avion de ligne, assimilables à de microscopiques traces de lumière dans les firmaments orientaux. Autour de ces macchabées métalliques tournent et retournent des artistes peintres à mi-chemin de l’art brut et du land art, ravis d’être là sous le patronage de Klara Sax (Sachs hors pseudonyme), rassasiés de cette matière facile d’emploi puisque ces avions se décapent aisément. Une seule couche de peinture était naguère suffisante pour recouvrir ces monstres d’artillerie car les méticuleux motifs d’agrément ne valent que pour les avions de tourisme (cf. p. 76). L’occasion était donc trop belle pour Klara Sax, à la recherche d’un zénith esthétique, à la conquête d’une création qui pourrait dignement refermer sa carrière grâce à la combinaison d’une œuvre géante et de la charge émotionnelle relative à ces appareils qui se délestaient par le passé de colis nucléaires, «[pliant] les cieux à leurs méthodes» (p. 510).

La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.




























































 Imprimer
Imprimer