« Fusées, Mon cœur mis à nu, La Belgique déshabillée de Charles Baudelaire | Page d'accueil | L’Amérique en guerre (32) : Johnny s’en va-t-en guerre de Dalton Trumbo, par Gregory Mion »
30/01/2023
Le Pays des sapins pointus de Sarah Orne Jewett : une terre de théophanie, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Alexander Turner (The Guardian).
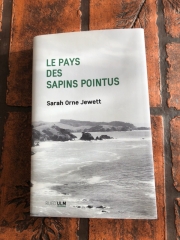 «Les choses créées ont pour essence d’être des intermédiaires. Elles sont des intermédiaires les unes vers les autres, et cela n’a pas de fin. Elles sont des intermédiaires vers Dieu. Les éprouver comme telles.»
«Les choses créées ont pour essence d’être des intermédiaires. Elles sont des intermédiaires les unes vers les autres, et cela n’a pas de fin. Elles sont des intermédiaires vers Dieu. Les éprouver comme telles.»Simone Weil, La Pesanteur et la Grâce.
«Et la maison la plus belle, celle en laquelle apparaît l’amour de l’ouvrier, n’est pas celle qui est plus grande ou plus haute que d’autres. La belle maison est celle qui reflète fidèlement la structure et la beauté cachées des choses.»
Alexandre Grothendieck, Récoltes et semailles.
Comme Cristina Campo qui fut pendant un peu plus d’un demi-siècle (1923-1977) la pythie fragile d’une Italie malade (du fascisme) et convalescente, la discrète Sarah Orne Jewett souffrait d’un cœur défaillant qui l’emporta dans sa soixantième année en 1909, dans son Maine natal, dans ce nord-est des États-Unis où deux vitesses antinomiques s’affirmaient en ce temps-là : l’une ascendante, l’autre descendante – la première en métropole, la seconde hors des villes, deux rythmes associés respectivement à la préparation de l’Amérique en tant que puissance planétaire expansive (d’une part) et à la survivance de l’Amérique en tant que puissance de concentration spirituelle (d’autre part). Autant dire d’emblée que Sarah Orne Jewett ne fut jamais solidaire de la folie américaine expansionniste qui se traduisait en immeubles, en machines et en délires cupides. Elle demeura presque toute sa vie sur les charmantes berges du Maine et parmi les vertes forêts du Pine Tree State, et lorsqu’elle n’y était pas, lorsqu’elle pouvait se rendre par exemple jusqu’à Boston pour mesurer l’état de son intelligence avec les meilleurs cerveaux de sa nation, elle ne perdait pas de vue l’éclatante vérité de son home turf, et, pour tout avouer, elle n’oubliait pas que les plus beaux enseignements se trouvent dans la nature, dans la mélodie noctambule de l’engoulevent ou sur l’écorce d’un arbre séculaire, dans le mystère flamboyant d’une fleur ou à l’écoute du timbre si singulier de la marée montante, quelque part parmi les infinis de la Création que nous ne saurions rencontrer à l’étage d’une bibliothèque ou sur les bancs de l’école, dût-on fréquenter les vénérables bâtiments de Harvard. Dès lors cette femme sensible et cardiaque se tint éloignée de cette espèce de fascisme du progrès, de cette mégalomanie qui commençait à durement sévir en Amérique (1), et plus son pays se ruait dans les enfers de la vie matérielle, plus elle consolidait ses attaches à la vie de l’esprit, telle Cristina Campo qui ne cessa d’accroître sa richesse intérieure afin de ne pas mourir des pathologies modernes – mais qui mourut quand même trop tôt, à l’image de son officieuse et ancestrale cousine d’Amérique, trahie par un cœur vulnérable qui était moins la preuve d’un banal problème d’anatomie que la preuve d’une âme exceptionnellement noble dont la subtile configuration intangible n’avait pu que causer un défaut mortel au moment de s’incarner dans un corps condamné à supporter un monde tangible et ignoble (celui de l’Italie mussolinienne). Nous faisons ainsi du décès de Sarah Orne Jewett non pas une fatalité physique, mais nous en faisons plutôt une exaspération métaphysique, une féminité incompossible avec une rustrerie exponentielle, quelque chose comme la suprême fatigue d’un monde qui accélérait en direction des plus massacrantes lignes d’arrivée, la grande lassitude d’une femme qui a dû souffrir de sentir son prieuré du Maine menacé par le bruit des cités aberrantes, non sans avoir enduré au cours de sa jeunesse adolescente la blessure innommable de la guerre civile. Pour l’un et l’autre de ces rares cœurs féminins, pour Cristina Campo et pour Sarah Orne Jewett, les palpitations ou les tachycardies furent certainement répétitives devant les danses macabres de l’Histoire et leurs textes, leurs écrits providentiels, des premiers jusqu’aux derniers, racontent les tremblements de leurs âmes particulières, les événements de leurs psychismes uniques, les manières dont elles ont transfiguré la laideur croissante de la civilisation occidentale par le biais d’un perpétuel recrutement de la Beauté (dans les livres pour Cristina Campo et dans les incunables de la nature pour Sarah Orne Jewett – dans le divin finalement).
Quasiment inconnue en France, l’œuvre de Sarah Orne Jewett a été remise au goût du jour par les Éditions de la Rue d’Ulm qui viennent de proposer une réédition du Pays des sapins pointus (2), un petit roman dont les accents régionalistes révèlent moins les couleurs locales du Maine que la profonde carnation de l’universel. On se tromperait en effet si l’on réduisait la contribution littéraire de cette sobre romancière à une simple chronique de la ruralité telle qu’elle s’éprouve dans une modique partie de la Nouvelle-Angleterre, comme plusieurs se sont dupés, jadis, en brocardant la Provence de Jean Giono, incapables de discerner dans les rues et les alentours de Manosque les signes d’une réelle présence cosmique venue de l’Antiquité grecque. De sorte que l’on serait tenté de formuler pour Sarah Orne Jewett ce que le turbulent Henry Miller a formulé pour Walt Whitman dans son Tropique du Cancer : «Chez Whitman, le drame américain tout entier prend vie, son passé et son futur, sa naissance et sa mort. Whitman a exprimé tout ce qui a quelque valeur en Amérique, et il n’y a rien d’autre à en dire.» (3) Il n’est pas immérité de considérer Sarah Orne Jewett à l’instar d’un auteur qui a compris non seulement la trame essentielle de sa patrie, mais aussi, a fortiori, la source de ce motif ontologique, l’énergie primitive qui a mis les pionniers en action de grâce et qui désormais doit être remémorée – voire célébrée – tant elle a été détournée sous les aspects d’une énergie prédatrice. Par conséquent toute la fiction de Sarah Orne Jewett relève peut-être d’une célébration des États-Unis comme étant l’apologie d’un espace magique, comme la défense et l’illustration d’un temple naturel amenant les hommes à se surpasser pour le bien commun, par contraste avec un pays désarçonné ou en voie de l’être définitivement, un pays en train de tourner le dos à ce qui l’a édifié en propre, envoûté par les «trois monstres» occidentaux qui effrayaient Simone Weil de jour comme de nuit : l’argent qui corrompt, le machinisme qui aliène et l’algèbre qui axiomatise les relations humaines (4). De cette façon le Maine de Sarah Orne Jewett apparaît sous les traits d’un antidote aux vaines conquêtes des Babylone avoisinantes et lointaines, possible remède au narcissisme capitalistique évoluant d’Est en Ouest, de l’Atlantique au Pacifique, ressouvenir nécessaire de ce que sont les perspectives sacrées à l’heure où l’horizon n’est plus vraiment une promesse de lumière mais une sombre arabesque d’ambitions profanes. Sans doute est-ce l’un des arguments informels qui a pu encourager Willa Cather à louer le travail de Sarah Orne Jewett, à l’éditer, à le préfacer, le mettant incontestablement au niveau des maîtres avérés de la littérature américaine fondatrice (5).
On s’apercevra de la pertinence de ces éloges en ouvrant Le Pays des sapins pointus et en passant un été en compagnie d’une narratrice écrivain qui revient à Dunnet Landing pour se ressourcer, pour approfondir les dimensions de ce sanctuaire de la sérénité, pour se reposer aussi dans cette «petite ville côtière» (p. 15) fictive du Maine. On croirait pratiquement qu’il s’agit d’un retour à Ithaque, d’un bonheur d’Ulysse qui n’a pas tant fait un beau voyage mais dont le voyage, précisément, va s’initier aux abords de Dunnet Landing et se prolonger ici en des splendeurs qui ne peuvent advenir que par l’intercession de ce fascinant territoire. On aura du reste anticipé que la fascination inhérente à ces lieux provient majoritairement du charisme des sapins pointus, des remparts culminants qu’ils forment, dressés contre les cieux et s’agrégeant comme une «grande armée» (p. 48) d’immarcescibles sentinelles qui protège les autochtones de son halo végétal autant qu’elle dissuade les éventuels intrus qui voudraient perturber l’équilibre de la concorde régnante. Chromatiquement, le vert domine la palette des épithètes traversant le roman, le vert doté à la fois de souplesse et de compacité, car le soleil passe entre les branches des sapins pour illuminer la localité, pour éclater en de rassurantes nuances d’émeraude, et parfois le soleil ne passe pas, la densité le retenant, le vert se muant alors en ombres impénétrables qui préservent le secret de ce rivage millénaire. On irait même jusqu’à dire que le ciel de cette Nouvelle-Angleterre ultra-septentrionale est tout à fait constitué de verdure, tout constellé de chlorophylle étoilée, que les sapins de Dunnet Landing et des environs sont un ciel à part entière, un firmament phyto-sidéral qui donne à voir une version nouvelle des demeures de Dieu. Et au milieu de cette communauté maçonnée sur ces rives océaniques «[inchangées]» et à plus forte raison immuables (p. 15), aussi invétérées que les sapins, au milieu de ce microcosme imprégné du macrocosme divinement conçu, au milieu donc de cet enchantement d’exception habite une certaine Mrs. Almira Todd, logeuse estivale de la narratrice, passionnée par les plantes médicinales mais laissant au médecin de la ville le soin d’administrer les maladies avec un professionnalisme de rigueur, se reconnaissant volontiers comme une «herboriste éclairée» (p. 19) dont le savoir quasi chamanique ne souhaite pourtant nullement s’interposer parmi les savoirs cartésiens de la contrée. Elle est à Dunnet Landing une figure locale inspirante, une dame approchant des soixante-dix ans et dépositaire d’une existence sereine, routinière, réglée selon les saisons et l’étourdissante charité de la nature, heureuse de séjourner au cœur de ses trésors végétaux où les simples les plus délicats côtoient les rameaux les plus spectaculaires. C’est pourquoi la narratrice, dès l’instant où elle prend une chambre d’hôte chez Mrs. Todd, se retrouve tout de suite enivrée par la multiplicité de ces senteurs végétales qui «faisaient remonter obscurément à la mémoire quelque chose d’un passé oublié» (p. 17), probablement un parfum des archétypes, une odeur abyssale où l’on pressent l’intrigante combinaison des mains de Dieu à l’œuvre. Il va de soi que l’amitié ne tardera point à se forger entre ces deux femmes, l’une devinant les dons de l’autre, littéralement les dons du ciel, puis l’autre s’entichant subrepticement de sa locataire (cf. p. 86), et la narratrice, pour commenter ceci, telle une évidence qui doit cependant être énoncée avec laconisme, posera sur le papier que Mrs. Todd est digne d’une aimable ambassadrice, capable de «s’entendre avec les forces premières de la nature» (p. 114), avec l’assortiment des empires telluriques et célestes déployés sur ce littoral du Maine éternel.
Les activités semi-druidiques de Mrs. Todd sont autant des prescriptions pour ses proches et les gens de la région qu’ils sont les éléments d’une étonnante pharmacopée pour le lecteur. D’ailleurs plus Mrs. Todd prend de la place dans la narration, plus la nature proclame sa loi non écrite, sa présence omni-englobante, avec une prévalence du royaume végétal sur le royaume des eaux (et divers surgissements harmonieux du royaume animal à côté de cette gigantomachie structurante pour le Maine luxuriant de Sarah Orne Jewett). Deux plantes remarquables se détachent de ces verdoyantes réticulations : d’abord les saxifrages (cf. p. 16), poussant ou plutôt brisant calmement les segments rocheux du jardin de Mrs. Todd, symboles d’une patiente fragilité qui peut renverser des montagnes, plantes rupicoles qui correspondent aussi bien à l’herboriste de Dunnet Landing distribuant la douceur parmi la dureté de certaines souffrances qu’à Sarah Orne Jewett elle-même, véritable efflorescence humaine possédant la faculté de se frayer un passage sur la lourde pierre du cœur occidental – ensuite la tanaisie (cf. p. 24), prospérant autour d’un modeste édifice ayant fonction d’école, plante auréolée de vertus miraculeuses puisque sa racine linguistique, en sus de sa racine concrète, résonne avec l’athanasia des anciens Grecs (6), avec une espérance d’immortalité qui n’est autre que le chemin dédié à ceux qui désirent se fondre et se confondre au souverainisme de la nature après avoir été aveuglés par les suprématies néfastes du monde civilisé. Cette ambiance où affleure l’immaculée pérennité des plantes produit en outre un sentiment de nostalgie, une douloureuse aspiration à être le témoin d’une Atlantide ressuscitée, d’un mode d’existence où ce qui a lieu de salutaire à Dunnet Landing pourrait arriver n’importe où. Et les vieillards de la municipalité font l’expérience de la nostalgie parce qu’ils sont conscients que même ici, même au centre des plus résistants archaïsmes de Dunnet Landing, il y a des choses qui se perdent, des traditions qui périclitent, comme par exemple «la mort des grands voiliers» (p. 35), la raréfaction de ces navigateurs qui personnifiaient l’esprit de l’aventure et qui donnaient à la Nouvelle-Angleterre une mirifique aura d’infinité – l’envie de regarder in the distance. C’est le vieux et nébuleux capitaine Littlepage qui s’en émeut, un capitaine poète dont le nom devient ainsi un aptonyme, un vétéran des mers légendaires qui a lu et relu Le Paradis perdu de John Milton et qui pourrait figurer dans un roman de Joseph Conrad comme tant d’autres protagonistes de la société imaginée par Sarah Orne Jewett.
Le caractère fabuleux représenté par la géographie à la fois physique et mentale de ce Maine arcadien s’accentue encore lors d’une visite à l’Île verte, chez Mrs. Blackett, la mère octogénaire de Mrs. Todd. En promenade insulaire avec William Todd, le frère d’Almira, la narratrice découvre un panorama superbe «au-dessus du cercle des sapins pointus» (p. 67), sur le belvédère prêté par une colline, et là, en surplomb de la canopée boréale qui intitule son récit, elle se remplit «d’un sentiment d’espace» et d’une impression d’extension «dans le temps» (p. 67). L’agrandissement des repères spatio-temporels sur cette infime surface insulaire est corrélatif – tout autant qu’il est le correctif – d’un rétrécissement des impasses modernes qui défigurent l’humanité, tel un effet relativiste bienvenu, tel un phénomène de modération des absolutismes de la modernité galopante. Sur l’Île verte, un genre d’Utopie élaborée par Thomas More serait susceptible d’apparaître, mais c’est une vision qui doit être tempérée car la microsociété formée par William et sa mère ne suffit pas à fonder un optimisme politique d’envergure. On s’en tiendra par conséquent aux sensations libératrices de l’endroit, aux présages d’un paisible entrebâillement des portes de la perception, à cette prodigieuse poignée de secondes où nous ressentons l’Istigkeit de Maître Eckhart (7), c’est-à-dire cette vivification de la conscience, cette amplification de notre âme qui nous permet de recevoir le miracle du il y a – l’authentique certitude qu’il n’y a que du il y a et que cela subvient aux besoins de toutes les béatitudes possibles. Et là au moins, à défaut d’être en mesure de se lancer dans la fable d’un idéal politique, on peut tout de même se réjouir en pariant que l’Île verte sera le dernier bastion du monde quand tout se sera effondré, quand l’idéologie du progrès aura tout dévasté et que l’Ange de l’Histoire envisagé par Walter Benjamin viendra se protéger sous les sapins de ce havre de paix ou sur ses tertres invincibles. L’Ange, du reste, pourrait aussi se nourrir des propriétés du pouliot, une autre plante paradigmatique du Pays des sapins pointus, une plante dont la valeur est exacerbée sur l’Île verte et dont le rôle excède le statut médicinal étant donné que cette plante matérialise une convergence décisive entre Mrs. Todd et la narratrice (cf. pp. 71-2). Le lieu précis de la cueillette du pouliot est presque un lieu de culte pour Mrs. Todd : elle a vécu sur cette fraction de terre des émotions intenses (notamment avec Nathan, son mari décédé), et tandis qu’elle se confie à la narratrice en s’enivrant des «senteurs florales venues de la nuit des temps» (p. 72), sa parole contribue à solenniser ce panthéon de verdure autant qu’elle est solennisée par une force venue d’en haut, comme si, à l’intérieur de cet anonyme périmètre de lande surnaturelle, on pouvait sentir non pas un Appel, non pas une Ascension, mais une Descente, en l’occurrence la migration de Dieu vers la matière, l’acte d’une théophanie dont l’Île verte serait la continuelle et heureuse destination – ou le site élu qui serait comme la translittération de la pensée de Dieu pour ceux qui sauraient en avoir l’intuition. Ce moment de cueillette est donc fondamental parce que non seulement il unit Mrs. Todd et la narratrice sur un plan supérieur, mais il initie également l’estivante à un soulèvement décisif de son âme parce que «le ciel descendant sur terre soulève la terre au ciel» (8), la transfigurant pour toujours avec les furtifs sacrements de Dunnet Landing et de ses périphéries.
Cette mystique du Maine est prolongée par le personnage de Mrs. Susan Fosdick qui vient apporter à la chronique de ce pays de cocagne sa marque déposée. Encore une fois, tel que nous l’évoquions tantôt, Mrs. Fosdick ne dépareille aucunement avec la galerie de tempéraments conradiens qui jalonnent cette fausse histoire locale et cette vraie odyssée universelle. Il s’agit d’une amie de Mrs. Todd qui s’annonce à l’instar d’une «marée» (p. 82), d’un irrésistible mouvement aquatique, sommité féminine composant la guilde des «vieilles femmes du rivage» (p. 82) et dont la vie fut largement occupée par la mer, par les voyages, par la psychologie des corsaires qui aiguise la lame de «la curiosité et [de] la sagesse» (p. 82). En femme prolifique et vigoureuse, Mrs. Fosdick a engendré une «vaste progéniture» (p. 83) essentiellement décimée par les malheurs incompressibles du travail maritime. À l’image du valeureux Gilliatt de Victor Hugo, les enfants de Mrs. Fosdick ont tous connu leur pieuvre lovecraftienne et pour la plupart d’entre eux elle fut fatale, mais au-delà de cette fatalité, au-delà de ces destins brisés, un folklore s’entretient, la mythologie d’un récent passé perdure afin de sauver les générations d’aujourd’hui d’un présent moins tonifiant. Cela commence déjà par l’hagiographie de «ces personnages un peu baroques», par la canonisation populaire de «ces baroudeurs qui erraient dans le pays» (p. 90) et qui ne cessaient d’écrire la longue saga des îles environnantes et de répondre à l’exhortation du grand large – the Wild Call of the Open Sea. Puis au souvenir de ces aventuriers de l’océan s’ajoute le souvenir des chevaliers de l’infatigable réclusion, la commémoration de «ceux qui s’enfermaient chez eux» (p. 90), impressionnants successeurs des anachorètes d’autrefois. C’est alors l’occasion pour Mrs. Fosdick d’exhumer des annales de Dunnet Landing le prestige ascétique de Joanna Todd, «cousine [du] défunt mari de Mrs. Todd» (p. 90), morte vingt-deux ans auparavant dans l’isolement consenti de son ermitage (cf. pp. 87-108). Elle vivait sur l’Île dite au tas de coquillages, autre nom pittoresque pour désigner l’une des entités de l’archipel, un bout de terre flottant parmi les contes et les légendes et aussi parmi quelques spectres amérindiens. On voyait en Joanna «quelque chose de médiéval» à travers la radicalité de son choix, elle qui, à la suite d’un «tourment d’amour» (p. 96), s’en alla vivre solitairement pour ne plus avoir à endurer l’opprobre qui frappe les femmes abandonnées – ou l’ostracisme qui s’abat sur les femmes contemplatives. On reconnut très vite qu’elle avait l’air «tellement au-dessus du commun» (p. 104), que sa propension à l’ascèse, d’une certaine manière, devait précéder sa décision de vaincre son chagrin par le truchement de l’exil. En elle miroitaient les sommets spirituels des pères du désert et son parcours scrupuleusement détaillé par Mrs. Fosdick laisse transparaître l’empreinte séraphique de plusieurs apophtegmes. L’aura de Joanna Todd n’était pas usurpée, son attraction était réelle et son érémitisme n’avait pas la moindre hypocrisie, à tel point d’ailleurs qu’on lui transférait de plein gré des provisions et sûrement des messages, des lettres aussi bien désespérées que préoccupées par un sujet philosophique, écrites par quelque soul in torment ne pouvant se confesser auprès des mentalités exclusivement sociables. Sa disparition provoqua du reste un pèlerinage spontané, les humbles foules de Dunnet Landing affluèrent en déférentes processions, parfois la curiosité l’emportant sur la révérence, mais tout un chacun finit par s’incliner loyalement devant la dépouille de cette indéniable sainte (cf. p. 107). Et en relatant ces événements de naguère, Mrs. Fosdick suscite un attendrissement supplétif chez la narratrice, une raison de plus de se sentir adoptée, assimilée à ce dernier coin de paradis, à cet ultime canton de la tranquillité où la solitude peut se hisser au niveau d’une plénitude parce que l’itinéraire de Joanna Todd fut l’un de ces passionnants «sentiers que l’on trace et retrace pour se rendre aux sanctuaires de la solitude» exonérée de toute mélancolie noire (p. 112).
Et bientôt l’été touche à sa fin à Dunnet Landing et le séjour de la narratrice également. Un jour du mois d’août est réservé à un «grand rassemblement de famille» (p. 134) à la ferme des Bowden, ce qui constitue pour la narratrice l’opportunité de pratiquer l’intérieur des terres, d’aller voir le Maine selon des conformations différemment terraquées, là où les flots du fantastique océan se mêlent à des sources plus insondables encore que les plus ténébreux abîmes de la mer, là où, potentiellement, les racines des sapins pointus prennent contact avec leurs occultes ferments nutritifs. Ainsi les paysages de ce Maine primitif font de durables cristallisations sur l’œil de la narratrice, laquelle, de station en station, avise «toute une cascade de champs bien dégagés» (p. 128) se déroulant placidement vers «la vaste étendue marine d’une baie» (p. 128), et cette platitude topographique, «un peu plus au nord», se gonfle subitement de «montagnes pâles et bleues» justifiant «l’ampleur» (p. 128) de cette vue, le désir, aussi, d’élargir notre focale, de rompre avec une optique analytique, une optique fragmentaire, pour expérimenter la synthèse latente – le continuum cosmique pour le dire sans détour – que nous procure la beauté patente de ce tableau vivant. Il émane de cette vision du Maine une allégorie de l’Union au sens plein du terme, un plaidoyer naturellement exprimé en faveur de toutes les sortes de syncrétismes, et humainement parlant, ce discours pacifique de la nature se distribue ou se relance dans le personnage de Santin Bowden, érudit des guerres et des stratégies, mécontent de ne pas avoir pu se battre durant la guerre de Sécession à cause de sa présumée fragilité physique (et assurément à cause de sa suprématie métaphysique incompatible avec la brutalité des philistins des deux bords). Figure de proue de l’Amérique originelle, extraction de l’essence même des États-Unis d’Amérique, le pétulant Santin Bowden, organisateur de cette récréation familiale qui ressemble tant à des noces transcendantalistes, réunit non seulement les membres d’une même famille mais aussi les membres de l’Amérique se considérant comme une transition, comme une dynamique de corrélation, somme toute les prophètes bucoliques d’une région encore immunisée contre les forces de la désunion et soucieuse de réfuter la plaie suppurante de la guerre civile, cette guerre qui n’en finit pas de se poursuivre par d’autres moyens et qui se trouve mentionnée subrepticement tout au long du Pays des sapins pointus (9).
En écho à la philanthropie de Santin Bowden, la narratrice, l’été s’achevant, fait la connaissance d’un autre «cœur affectueux» (p. 162), à savoir Elijah Tilley, briscard de la marine, veuf et toujours ému des réminiscences concernant sa femme (cf. pp. 152-168). Les aveux ou les épanchements d’Elijah vont au plus simple et soulignent la verticalité de cet homme, aussi droit, aussi fiable que les sapins qui veillent sur Dunnet Landing. On en jugera par ce qu’il raconte sur l’une des habitudes de sa femme : «Vous voyez le petit fauteuil à bascule là-bas ? C’était le sien. Eh bien, moi, quand je suis assis comme ça et que je le vois, je me dis que c’est quand même bizarre qu’elle ait disparu et que ce fauteuil, lui, soit toujours là, au même endroit, comme si de rien n’était.» (p. 161). L’information n’est pas donnée, mais nous concevons sans peine qu’Elijah et son épouse ont dû se rendre à l’île ou s’était retirée Joanna Todd, tant pour l’assister avec pudeur du temps de sa claustration que pour la saluer après sa mort. L’île de Joanna, pour peu qu’on la raccorde au degré de compassion d’Elijah Tilley, n’est en rien dissociable du fauteuil à bascule où aimait à se reposer la femme de ce tendre navigateur. Quoi qu’il puisse arriver à Dunnet Landing, la majorité de ses habitants, à commencer par Elijah Tilley, ne sauraient admettre que les morts ont accouché d’un vide incommensurable. Sur le modèle de la nature, la société de Dunnet Landing semble avoir horreur du vide, et, ce faisant, elle crée de la plénitude dès qu’une forme de la vacuité se manifeste et elle parvient à contrarier – par un naturel tropisme d’addition – toutes les espèces de la soustraction malgré l’humilité de ses actions et de ses conceptions. Il y a par conséquent une participation collective et assidue aux saintes et abondantes énergies qui sillonnent cet échantillon du Maine. La narratrice le ressent nettement pour elle-même : ces deux ou trois mois de la haute saison l’ont métamorphosée (cf. p. 170). Et d’ailleurs à quel type de métamorphose faut-il se rallier pour comprendre la nouvelle ordonnance ontologique de la narratrice ? Se perçoit-elle avec autant d’acuité que Mrs. Todd la perçoit ? A-t-elle vraiment une idée des profondes raisons qui acculent Mrs. Todd à un comportement sévère voire ulcéré au moment des adieux ? Notre hypothèse est que la narratrice n’est pas tout à fait prête à s’avouer le revirement qui s’est effectué en elle, à s’avouer le lent glissement interne qui l’a orientée vers une affection ambiguë pour Mrs. Todd, et cette dernière, plus aguerrie de ce que l’atmosphère locale est capable de commettre, plus lucide également sur son rapport au veuvage et à son identité féminine bousculée, s’attendait peut-être à ce que sa locataire diffère son départ et clarifie en sa compagnie ce qui était en train de devenir une amitié pieusement troublée (cf. pp. 170-2). Au lieu de cela, il n’advient de cette romance hardiment spéculée que sa syntaxe atmosphérique, sa phrase océane, lorsque la narratrice embarque sur un «petit vapeur côtier» (p. 172) et qu’elle profite d’une mer «pleine de vie», une mer gorgée de «la liberté des vents» (pp. 172-3), une émancipation par le souffle d’un divin pneuma qu’on aurait aimé voir éclore d’une façon plus explicite. À croire donc que le vide laissé par la narratrice sera difficile à combler pour Mrs. Todd (10).
Notes
(1) Sur cette tendance négative de la mentalité américaine à l’aube du XXe siècle, on peut lire La Jungle d’Upton Sinclair, un roman paru en 1906 et résumant les mauvais plis d’une nation de moins en moins riche de Dieu.
(2) Sarah Orne Jewett, Le Pays des sapins pointus (Rue d’Ulm, 2022, traduction de Cécile Roudeau). L’ouvrage est complété d’autres textes de l’auteur qui étendent le secteur dramatique découvert à la lecture du Pays des sapins pointus. Signalons enfin un bel appareil de notes et une postface imposante, travaux conjugués de Cécile Roudeau. NB : l’agrégation externe d’anglais, pour une partie du programme d’oral de la session 2023, propose en outre de travailler sur The Country of the Pointed firs et les textes afférents à cet univers littéraire.
(3) Henry Miller, Tropique du Cancer.
(4) Cf. Simone Weil, La Pesanteur et la Grâce.
(5) L’édition de Willa Cather date de 1925. Quant à l’édition originale du Pays des sapins pointus, elle date de 1896.
(6) On consultera du reste la note de la traductrice à ce sujet (cf. p. 304).
(7) Dans Les portes de la perception d’Aldous Huxley (titre qui provient d’une expression de William Blake), on rencontre la notion d’Istigkeit au cours des pages les plus mystiques de l’extravagant Britannique.
(8) Simone Weil, op. cit.
(9) Cf. à ce propos la vingt-cinquième note de la traductrice en page 306.
(10) Nous ne faisons pas référence aux autres histoires de Dunnet Landing. Nous ne faisons que travailler à partir des données immédiates et médiates du Pays des sapins pointus.




























































 Imprimer
Imprimer