Rechercher : alain soral
Villa Vortex de Maurice G. Dantec

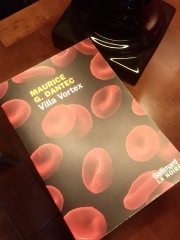 Il y aurait ici des pages à écrire sur la crétinerie des pseudo-critiques professionnels qui, sur Villa Vortex, le roman du polémique Dantec, n'ont rien su dire ou si peu que cela en devient pathétiquement drôle, par exemple sous la truelle d'une certaine Sabrina Champenois pour Libération. Passons. Qu'il est donc facile de critiquer la longueur (réelle) de ce roman pléthorique, gargantuesque et qui, c'est vrai, s'embourbe quelque peu dans sa dernière partie, sorte de polar mystico-futuriste qui joue avec la technique de l'enchâssement chère à Ian Watson et bien connue des lecteurs de Philip. K. Dick. À ce titre, on ne peut que souligner que Dantec est un lecteur averti, non seulement et selon toute apparence d'Ubik (voir la thématique du personnage mort qui contamine pourtant l'espace des vivants), mais aussi du Maître du Haut Château. Et de combien d'autres puisque Dantec, à la différence de ceux qui le vouent aux gémonies sans même l'avoir lu ou, ce qui est pire, mal lu, est un immense lecteur. Reste que, hormis L'Affaire Zannini de Marc-Édouard Nabe, je ne vois guère de livre récent comparable à Villa Vortex ni même de romanciers français qui, par leurs intentions et les moyens dont ils disposent, puissent aisément se comparer à ces deux... Si, il y a tout de même Houellebecq... En fait, au-delà des définitions simplistes (enquête policière et futuriste pour l'un, vrai-faux journal métaphysico-burlesque pour l'autre), Villa Vortex tout comme le livre de Nabe peuvent et doivent se lire, avant tout, comme une quête du vrai langage, dépassant par leur ambition Babel 17 de Samuel Delany ou même L'Enchâssement de Watson, le premier imaginant une forme de langage devenu arme absolue, le second une langue poétique qui, désormais, (re-)deviendrait, par sa capacité à nous faire pénétrer dans l'Autre réalité, la sorcellerie évocatoire dont parlait Baudelaire...
Il y aurait ici des pages à écrire sur la crétinerie des pseudo-critiques professionnels qui, sur Villa Vortex, le roman du polémique Dantec, n'ont rien su dire ou si peu que cela en devient pathétiquement drôle, par exemple sous la truelle d'une certaine Sabrina Champenois pour Libération. Passons. Qu'il est donc facile de critiquer la longueur (réelle) de ce roman pléthorique, gargantuesque et qui, c'est vrai, s'embourbe quelque peu dans sa dernière partie, sorte de polar mystico-futuriste qui joue avec la technique de l'enchâssement chère à Ian Watson et bien connue des lecteurs de Philip. K. Dick. À ce titre, on ne peut que souligner que Dantec est un lecteur averti, non seulement et selon toute apparence d'Ubik (voir la thématique du personnage mort qui contamine pourtant l'espace des vivants), mais aussi du Maître du Haut Château. Et de combien d'autres puisque Dantec, à la différence de ceux qui le vouent aux gémonies sans même l'avoir lu ou, ce qui est pire, mal lu, est un immense lecteur. Reste que, hormis L'Affaire Zannini de Marc-Édouard Nabe, je ne vois guère de livre récent comparable à Villa Vortex ni même de romanciers français qui, par leurs intentions et les moyens dont ils disposent, puissent aisément se comparer à ces deux... Si, il y a tout de même Houellebecq... En fait, au-delà des définitions simplistes (enquête policière et futuriste pour l'un, vrai-faux journal métaphysico-burlesque pour l'autre), Villa Vortex tout comme le livre de Nabe peuvent et doivent se lire, avant tout, comme une quête du vrai langage, dépassant par leur ambition Babel 17 de Samuel Delany ou même L'Enchâssement de Watson, le premier imaginant une forme de langage devenu arme absolue, le second une langue poétique qui, désormais, (re-)deviendrait, par sa capacité à nous faire pénétrer dans l'Autre réalité, la sorcellerie évocatoire dont parlait Baudelaire...Il paraît aussi évident d'affirmer que cette dimension (cachée, voire ésotérique...) de Villa Vortex est passée presque totalement inaperçue des critiques, je l'ai dit, qui certes n'ont jamais songé à rappeler les références pourtant évidentes de Dantec (et de Nabe) : Barbey, Bloy, Hello, qui tous, à divers degrés, s'affligèrent de la pauvreté du véhicule littéraire dont ils se servaient, tout en le conduisant vers des terres jusqu'alors inexplorées ... Oui, décidément, le cadavre de la littérature française, qui il y a peu bougeait encore selon certains optimistes, paraît à présent parfaitement mort... Reste que seuls Nabe et Dantec, même si Villa Vortex est critiquable sur bien des points (puisque par exemple la seconde partie de ce roman n'est qu'assez difficilement conciliable avec la première, remarquable), paraissent encore capables de lui insuffler quelque vie... Qui d'autre ? Florian Zeller ? La triade acéphalique Millet/Angot/Nothomb ? Oui, je sais ! : Nabe ou même Richard Millet, qui s'imagine être le dernier écrivain de langue française, alors qu'il y a Sarah Vajda, Jean Védrines, Guy Dupré, combien d'autres encore... Je corrige d'ailleurs ce que je viens d'écrire un peu trop rapidement, en retirant Nabe de cette liste fort réduite, l'hystérique nain pseudo-bloyen s'étant depuis quelques mois durablement embourbé dans les sables irakiens avec son affligeant Printemps de feu... et je ne parle pas de sa revue à tirage limité (qu'en est-il de son lectorat réel ?), La Vérité, aussi aguicheuse qu'une putain centenaire.
«Les hommes craignent la vérité parce qu’une seule étincelle de vérité formulée et vécue en fait éclore d’autres […].»
Wilhelm Reich, Le Meurtre du Christ (Éditions Champ libre, 1971).
Villa Vortex de Maurice G. Dantec, qui est le premier tome d’une trilogie intitulée Liber Mundi, a sans doute fait parler les critiques. Parler et non pas écrire. Dantec n’a d’ailleurs guère dû s’étonner des quelques réactions provoquées par son livre, lui qui remarquait fort justement, dans son Théâtre des opérations, que «quand l’horizon de la littérature se restreint aux moi des auteurs, c’est qu’elle se trouve déjà allongée dans le caveau de famille». Nul doute sur ce point : la littérature française contemporaine n’est plus même un cadavre qui mime la vie, se souvient qu’il a vécu, bouge encore et, parfois, parle, d’une parole échangeable, soumise au plus offrant, monnayable comme l’est une marchandise, c’est-à-dire une catin. Bref, nous ne cessons d’entendre les râles d’alcôve d’une «parole putanisée», selon la trouvaille de Michel Waldberg qui n’évoque cependant pas la prochaine étape, à vrai dire déjà réalisée, celle d’une parole cette fois totalement aseptisée, clonée, donc pornographique dans sa répétition mécanique ou angotique, parole neuve, novlangue que plus aucun lien ne rattache désormais à la vie. La littérature française n’est donc plus une charogne mais un fantôme, mieux un simulacre qui s’est totalement abstrait du réel, qui, tel l’idiot, s’est coupé de lui, sans même la ressource de convoquer, comme le roman de Faulkner, le bruit et la fureur. Je ne surprendrai que les mauvais lecteurs ou les critiques qui ne font rien d’autre que s’entregloser en affirmant dès lors que l’intention la moins commentée du livre de Dantec est d’avoir justement voulu sauver l’écriture du naufrage. Aussi peu modestement qu’il convient à tout réel écrivain, le but poursuivi par l’auteur est ainsi péremptoirement posé : «faire (sur)vivre la littérature». La déshumanisation incriminée du langage est une des conséquences de la réification totale de l’homme et du monde selon Dantec : «Il ne fallait plus s’étonner si le langage lui-même devenait ciment, dès lors que les artistes choisissaient d’œuvrer avec les bétonneurs […] (VV, 103). Il s’agira dès lors, pour le flic Kernal, principal personnage de Villa Vortex, comme pour le romancier lui-même, de se lancer à la poursuite du langage édénique qui, selon Walter Benjamin, jouissait d’un réel pouvoir d’évocation, était capable d’appeler les choses et les êtres à leur existence, en les nommant. Avant que le langage des hommes ne soit rendu impuissant par la lèpre de ce que Benjamin appelle la «surdénommination», la parole était, vraiment, la «sorcellerie évocatoire» du poète. Mais, dans Villa Vortex qui évoque la phase terminale du cancer qui ronge la France et l’Europe, donc leur langage creux, les mots sont bien évidemment totalement séparés des choses, incapables qu’ils sont d’évoquer la moindre réelle présence. Totalement séparés ? Pour le mystérieux tueur en série poursuivi par Kernal, les mots et les choses ne font qu’un, il n’y a aucune coupure entre le désir et l’action, aucune séparation entre la matière même du mot et la chose, c’est-à-dire le corps torturé. Ainsi, les cadavres mutilés des jeunes filles que découvre Kernal, par un monstrueux procédé informatique inventé par le tueur, sont-ils capables de s’animer et, même, de parler ou plutôt de hurler, postmortem, l’enfer de leur supplice. La parole réelle, celle des pauvres torturées, on le voit, vient d’une région dans laquelle il faudra pour Kernal ne pas craindre de s’aventurer. D’emblée encore, l’acte premier par excellence, le Fiat divin, est ici retourné et parodié par les hurlements des victimes qui, en somme, appellent à la vie, mais à une vie elle-même ridicule et grotesque, leur propre cadavre.
Dès lors, le vortex évoqué par Dantec est moins celui qui d’ici peu aura avalé la Ville moderne que le maelström tapi au sein même de son livre. L’auteur de Villa Vortex, comme le narrateur du conte de Poe, ne peut-il donc s’adresser à ses lecteurs qu’au moyen d’une ridicule bouteille jetée à la mer à laquelle il aura confié ses dernières paroles avant de sombrer dans le gouffre hurlant ? Fort bien car, c’est une chance inespérée, dans le danger croît aussi ce qui sauve puisque ce maelström est tout simplement la Parole, originelle, séminale, aujourd’hui rongée par la lèpre des «discours publicitaires et des ritournelles citoyennes» (VV, 64) mais qui, selon nombre d’auteurs (comme Léon Bloy, fort apprécié par Dantec, ou Ernest Hello, que cite Mard-Édouard Nabe dans Alain Zannini) regroupés par George Steiner sous l’appellation de «logocrates», renferme encore, faiblement, une lueur, rougeoyante dans le foyer de l’étymon, qu’il s’agira donc de ranimer pour espérer en faire un feu. Pour ces logocrates comme pour Dantec, le langage est donc «le miroir de l’Être», selon l’expression de Georges Bernanos. Se servir des mots pour ne strictement rien dire, c’est donc atteindre l’Être et le prostituer. Inversement, et là se trouve bien l’immense difficulté, peut-être même l’échec final du romancier, plonger dans la Parole n’est certainement pas une affaire vite expédiée de cicérone étourdi. Dans Monsieur Ouine, autre roman crépusculaire chantant la nuit du monde, autre œuvre à l’écriture lacunaire, tronquée, elliptique et énigmatique, autre roman policier dévoyé (mais avec un crime non élucidé et sans meurtrier) qui est une plongée dans le chaos et le Mal à nulle autre pareille, unique je crois dans la littérature occidentale, c’est le néant dans lequel va tomber le personnage éponyme, ancien professeur de langues, qui constitue paradoxalement le foyer de l’écriture, la matrice originelle depuis laquelle la parole bernanosienne s’est élancée, pour trouer de ses innombrables efforts l’obscurité des mots qui ne veulent plus rien dire, qui, pipés et moqués, ne servent plus qu’à grasseyer la ritournelle aigre de l’Arrière. Dès lors, l’écrivain, selon l’image mille fois jaunie mais néanmoins parfaitement juste, doit réellement ne pas craindre de pénétrer dans le royaume duquel Orphée puis Dante, pour nous délivrer leurs chants, sont revenus.
Cette plongée est un éveil. Celui auquel nous convie Dantec risque bien, à tout le moins, de nous surprendre, de nous prendre au dépourvu comme si nous étions conviés à ouvrir nos yeux sur l’espace noir de l’horreur, sur ce que nous ne faisions que soupçonner et qui à présent nous est indiqué sans détour : la vraie vie est la mort et, tout autant, la parole partout diffusée, la parole littéraire (donc, de nos jours, entièrement médiatisée) et intellectuelle de nos élites n’est rien d’autre qu’un simulacre, la mort et la putréfaction se donnant l’apparence de la vie.
Je suis vivant et vous êtes mort
Qu’est-ce que Maurice G. Dantec a voulu nous dire avec Villa Vortex ? En grand lecteur de l’œuvre de Philip K. Dick, il n’est guère difficile de comprendre que Dantec a désiré analyser et illustrer avec son roman cette consternante banalité : nous sommes morts et c’est moi qui suis vivant. Moi, Kernal, le personnage principal du livre ? Non, puisque ce flic est mort avant même que d’avoir commencé sa narration. Marc Naudiet alors, le mystérieux tueur en série que Kernal ne parviendra jamais à capturer ? Non car le meurtrier est décédé d’un cancer des os alors que le policier ne cessera d’amasser des preuves de sa culpabilité, dans une opiniâtreté un peu folle qui le rapproche du policier du roman de Dürennmatt intitulé La Promesse. Les cadavres des pauvres suppliciées, qui sont encore capables de parler par un montage informatique astucieux du tueur ? Non, à l’évidence. Qui donc alors ? Moi, Maurice G. Dantec, l’auteur de ce livre intitulé Villa Vortex ? Non car Dantec ne cherche rien tant, frénétiquement, que sa propre disparition, transpercé par la corne de taureau de l’écriture qui exige que l’on prenne tous les risques, comme l’illustre également ce roman de la transformation ou plutôt résurrection qu’est Alain Zannini. Moi enfin, le livre, qui ne suis pourtant rien de plus qu’un livre clos, achevé, un livre fractal donc, une bribe, imparfaite et limitée dans ses béances mêmes et ses écritures alternées, que Dantec oppose à la cohérence insurpassable de la Bible (TdO, p. 524), du Livre, de l’Infini ? Oui, c’est bien moi, Villa Vortex, livre borné et pourtant, sans être de sable comme celui de Borges, infini, qui suis vivant. C’est là le second paradoxe du roman de Dantec, auteur qui, après tout, n’est qu’un prête-nom parmi tant d’autres, auteur qui, comme Paul Gadenne dans son énigmatique Invitation chez les Stirl, pourrait bien prétendre qu’il n’est absolument rien de vivant, si, justement, ce prénom, cette initiale et ce nom, Maurice G. Dantec, ne rappelaient aux lecteurs l’existence d’un auteur que les imbéciles déclarent sulfureux alors qu’il n’est rien de moins qu’absent, bouche d’ombre de la fin de partie chère à Beckett qui, comme le personnage du tueur en série, ne peut s’empêcher de disparaître, de digérer sa propre œuvre afin de renaître à une exigence plus haute, à une vérité que la littérature ne fait qu’entrevoir. Car l’écriture de Dantec est une théurgie, qui rien de moins que métaphoriquement exige la mort de l’auteur, son effacement. Les mots qui suivent valent donc pleinement pour le romancier : «à mesure que Kernal est attiré vers le bas […] son esprit est aspiré par le haut, vers les limites de la connaissance pure».
Un rapprochement peut ici être esquissé entre le flic Kernal, qui jamais n’hésite à nous affirmer sa volonté de rejoindre la nuit, et le démoniaque F. Vidal Olmos, personnage du second roman d’Ernesto Sábato, Héros et Tombes, qui traque sans relâche la mystérieuse Secte des aveugles, enfouie dans les profondeurs souterraines où se perdra d’ailleurs Olmos, non sans avoir, peut-être, touché à la Vérité maléfique que cache ce monde inverti. Entrevoir cette Vérité ultime, pour Olmos comme pour Kernal, ce sera mourir, selon les principes mêmes de toute initiation. Il y a plus car, pour l’auteur, parler depuis le royaume de la mort c’est placer son œuvre tout entière sous un éclairage inhabituel : le soleil noir d’Auschwitz. À ces mots, j’entends rire les imbéciles. Ainsi et contre le commandement (mille et mille fois ressassé) édicté par Adorno, Dantec n’hésite pas à plonger son regard dans ce que nous pourrions appeler, après Armand Robin, un véritable «camp de concentration verbal» et, avec le romancier de Babylon Blues, un «trou noir>». Écoutons l’auteur affirmer qu’il «ne s’agit même pas, en effet, de vouloir à tout prix décrire l’expérience concentrationnaire nazie, mais de savoir l’inscrire dans notre processus de création, de savoir indiquer dans nos livres que nous sommes bien ceux d’Après […]» (TdO, 345). Nos lecteurs consciencieux auront remarqué que, par cette problématique, par celle qui, de livre en livre, lui fait mêler réflexions sur la politique et sur la révolution biologique en cours, à dire vrai déjà intimement présente dans nos vies, l’auteur de Villa Vortex offre une saisissante illustration de certaines des thèses de Giorgio Agamben qui, à la suite des travaux de Michel Foucault, affirme que l’expérience concentrationnaire est devenue le véritable nomos de la politique moderne ou plutôt de la biopolitique puisque le corps humain, désormais, est tout entier livré à la technique, devenu champ d’expérimentation et de réification infinies pour la science. À ce titre, la description que Dantec nous donne de la ville moderne ressemble à s’y méprendre à celle du camp de concentration : «le biotope paradoxalement sans vie de cette zone industrielle est désormais le tabernacle du sacrifice, le lieu sacré recelant en son centre un être sans identité anéanti par la décomposition terminale de l’homme anonyme des mégapoles» (VV, 37). Je n’éviterai pas de redoubler la banalité du discours sur la Shoah en répétant que cette expérience concentrationnaire est proprement intransmissible, incommunicable mais que Villa Vortex, sans en parler directement, est pourtant un livre né d’Auschwitz. Nous pourrions dès lors affirmer que l’expérience concentrationnaire est devenue, au moins depuis Paul Celan, le véritable nomos de toute vraie littérature, qui doit s’écrire, plus que jamais, devant le bourreau, fût-il parfaitement invisible comme dans l’une des paraboles d’Imre Kertész, Le Chercheur de traces. Sur cette route âpre et tortueuse, où les crachats des crétin ne manquent et ne manqueront pas de fuser, Dantec n’est pas seul : à sa façon aussi, rien de moins qu’intuitive et zébrée de noires illuminations, George Steiner répète à chacun de ses livres qu’Auschwitz est le creuset bestial où la langue elle aussi, comme un immense corps vivant martyrisé, a plongé avec des millions de victimes réduites en cendres, sans doute parce que, dans un parallèle qui n’a pas manqué d’offusquer les petites âmes, le Verbe a sombré dans le gouffre du Golgotha.
Imre Kertész une fois de plus, dans Un Autre, établira à son tour une scandaleuse proximité entre l’horreur absolue de la Crucifixion et celle de la Shoah. Villa Vortex, en voulant libérer la langue de sa mécanique et confondante banalité – cette même banalité du Mal analysée par Hannah Arendt qui scandalisa – désire sans doute éviter, moins inconsciemment qu’il n’y paraît, que le langage puisse être réduit, une nouvelle fois, à l’immense mensonge que façonna expertement la propagande nazie et, de nos jours mais de façon parfaitement homéopathique, nos médias.
Liber mundi
Avec Villa Vortex, Dantec entreprend la quête véritable de tout écrivain réel, quête qui était celle du narrateur du conte de Borges, quête qui est celle, fébrile et mallarméenne au possible, du Livre : «Une autre superstition de ces âges est arrivée jusqu'à nous : celle de l'Homme du Livre. Sur quelque étagère de quelque
16/07/2006 | Lien permanent
Entretien avec Matthieu Giroux à propos de Charles Péguy, un enfant contre le monde moderne

 Juan Asensio
Juan AsensioMatthieu, il me semble que votre petit livre sur Péguy, dans sa concentration même et par son refus avoué de toute forme de surpoids universitaire, pourrait être à bien des égards qualifié, selon le titre d’un ouvrage de Rémi Soulié tout aussi efficace que le vôtre, de «Péguy de combat». Qu’ajouter en effet qui n’ait d’ores et déjà été écrit sur Péguy comme sur tant d’autres grands écrivains dont les textes auront été décortiqués sans relâche par une armée diligente de professionnels du commentaire rédigé en marge, et qui s’entregloseront de colloques en colloques ? Ainsi, votre Péguy peut être commodément rangé dans une poche et tout aussitôt dégainé contre tel ou tel de ses piètres lecteurs désireux de manière plus ou moins avouée de faire de l'écrivain ce qu’il n’est pas, ou ce qu’il n’est pas seulement : un socialiste, un dreyfusiste, un chrétien, «parfois un patriote» écrivez-vous (p. 9) et même, c’est à la mode dans certain petit raout se voulant incorrect, un droitiste convaincu. Au rebours de ces lectures non seulement biaisées mais qui font les malines, votre postulat est aussi simple que crâne : il n’y a qu’un seul Péguy qui les subsume tous, et ce Péguy peut être compris comme un enfant.
Matthieu Giroux
Je n'ai malheureusement pas eu la chance de lire le Péguy de Rémi Soulié. Par conséquent, je ne sais trop si le mien peut être rapproché du sien. Mon livre est modeste, concis, certes, mais il a une prétention : dire quelque chose sur Péguy qui n'ait pas été formulé ailleurs. J'ai lu beaucoup de littérature sur Péguy et je n'ai croisé aucun livre qui place la figure de l'enfant au centre de sa réflexion. Peut-être que les universitaires, que je semble apprécier plus que vous, n'ont pas encore tout dit ? Ou peut-être que la densité herméneutique de Péguy est inépuisable ? Je vous trouve sévère vis-à-vis des universitaires même si je comprends les dérives que vous pointez. Le livre de Camille Riquier, Philosophie de Péguy ou les mémoires d'un imbécile, sorti l'an dernier, est admirable par la façon dont il redonne sa cohérence philosophique à l'œuvre de Péguy. De même, celui d'Alexandre de Vitry, Conspiration d'un solitaire : l'individualisme civique de Charles Péguy, en propose une lecture très originale. J'ai justement tendance à penser que les universitaires ont une approche plus dépassionnée que certains péguystes médiatiques : Alain Finkielkraut (Le mécontemporain demeure un très bon livre) ou Edwy Plenel notamment. Pour en revenir à mon livre, j'estime que, si l'importance de la figure de l'enfant dans l'œuvre de Péguy n'a été ignorée par personne, il ne faut pas la limiter au Péguy catholique d'après 1908 et à ses trois mystères (Mystère de la charité de Jeanne d'Arc, Mystère du porche de la deuxième vertu et Mystère des saints innocents). Selon moi, l'enfance et le sentiment de sa perte tourmente Péguy dès le départ et traverse l'intégralité de son œuvre, de Pierre, commencement d'une vie bourgeoise (1899, posthume) à Notre Jeunesse (1910) en passant par Zangwill (1904 où il s'en prend au «vieux» Renan) ou aux Situations (1906). Pour Péguy, être un enfant, être jeune, n'est pas une caractéristique physique mais morale. À ses yeux, les enfants sont exemplairement mystiques puisqu'ils refusent de s'habituer à la laideur du monde moderne.
Juan Asensio
C’est donc dire que Georges Bernanos, pour lequel la figure de l’enfant est elle aussi si importante, vitale même, mais aussi Pierre Boutang qui a beaucoup réfléchi à la question de la filiation et de la piété, notamment en débattant avec George Steiner sur l’Antigone de Sophocle, ont bien lu Charles Péguy. Vous montrez que la figure de l’enfant n’a de sens qu’en lien avec celle du commencement qui, systématiquement, est dévorée par la fin. Autrement dit, c’est la politique qui dévore la mystique dont elle est pourtant issue, puisqu’il n’y a pas de «commencement qui ne soit pas mystique» (p. 53), comme c’est le vieillard, le «vieux Renan» ou Monsieur Ouine, qui dévore l’enfant. Vous allez plus loin en affirmant, je vous cite (cf. pp. 45-6) que, «à la manière dont le monde moderne fait croire qu’il est un héritier des anciens mondes, les politiques font croire qu’ils sont les héritiers des mystiques» et que, du coup, «les fins héritent des commencements». Or, il n’y a pas «héritage mais corruption et destruction» puisque «le monde moderne n’est héritier d’aucun monde». L’entreprise de Charles Péguy est courageusement solitaire et elle m’a même paru, à bien des égards, constituer une forme de pari de verticalité au sein d’un monde devenu résolument plat. Pouvons-nous alors considérer l’œuvre de Charles Péguy comme une tentative de retrouver l’aura enfuie de cet ancien monde duquel le nôtre, cassé comme le prétendait Gabriel Marcel, s’est coupé ? De façon encore plus audacieuse voire franchement folle, Péguy n’a-t-il pas tenté, avant d’être si vite fauché par une balle reçue en plein front, d’instaurer le ferment d’une renaissance intellectuelle et spirituelle de la France ou, pour le dire d’une autre façon, de créer un véritable commencement ?
Matthieu Giroux
Pour Péguy, il y a des choses qui sont irrémédiablement perdues. Les anciens mondes sont perdus. En revanche, ce qui peut être retrouvé, c'est leur caractère organique. L'expression du monde moderne que nous connaissons est celle d'un monde mécanique, desséché, habitué... Pour Péguy, c'est dans la nature du monde moderne que de substituer au désordre vivant des anciens mondes un ordre mort. Cet ordre mort est la conséquence de la domination de la puissance de l'argent qui soumet les autres puissances. Dans les anciens mondes, il existait des puissances qui mêlaient le temporel et le spirituel. Péguy prend l'exemple de la chevalerie («puissance de gantelet») qui était une puissance matérielle au service de la puissance spirituelle (le roi, le pape). Quand Péguy dit que l'argent est «seul devant Dieu», «seul face à l'esprit», il décrit la dichotomie tragique des puissances qui caractérise le monde moderne : le temporel et le spirituel ne sont plus mêlés, ils sont devenus ennemis. Ce qu'on laisse à l'argent est perdu pour l'esprit. Ce qu'on laisse à la politique est perdu pour la mystique. Péguy espère tout de même un retournement : «Ce n'est pas pour toujours», écrit-il. Il faut que certains individus (les héros, les génies et les saints) se fassent les garants des mystiques, qu'ils gardent en eux les conditions de possibilité d'un recommencement vivant où l'esprit et la grâce «mouilleront» à nouveau le monde. Mais pour que cela advienne, il faut que l’événement soit encore possible. Et le monde moderne contient en lui-même une terrible menace : qu'un jour, rien ne puisse plus advenir, qu'il n'y ait plus de naissances et plus d'enfants. Évidemment, Péguy fait tout pour que ce «recommencement» ait lieu. Mais après l'échec de la fondation du socialisme, Péguy est dans une entreprise individuelle et mystique plutôt que collective et politique. Je ne sais trop si Péguy possède un véritable «projet» mais disons qu'il entretient un espoir.
Juan Asensio
Je me demande à ce titre de quelle façon Charles Péguy eût pu saluer la naissance de l’État d'Israël, lui qui, selon vous, considérait Bernard-Lazare comme un enfant, un «enfant du peuple premier, enfant du peuple juif des commencements» et, partant, «garant d'une forme de mystique primitive» (p. 60). Pouvons-nous faire du Pierre Boutang de La Guerre de six jours par exemple, sur cette seule question, l'héritier direct de Charles Péguy, du moins d'un Charles Péguy qui n'a pas pu, par définition, exprimer toute sa pensée politique sur Israël ?
Matthieu Giroux
Je crois qu'il est difficile de répondre à cette question. On sait que le grand maître de Péguy, Bernard-Lazare, a connu Theodor Herzl et qu'il a encouragé le projet sioniste à ses débuts. Mais Bernard-Lazare, comme Péguy, était un libertaire, une personnalité solitaire. On sait aussi le sort que la communauté juive française a réservé à Bernard-Lazare. Je pense que Péguy aurait été sensible à la fondation de l’État d'Israël sous sa forme socialiste et «communautarienne» tout en gardant en tête que l'errance est constitutive de la grandeur du judaïsme. Le Christ n'était-il pas un prophète errant ? Quand Péguy célèbre Bernard-Lazare dans Notre jeunesse, il célèbre un Juif français, courageux, solitaire et abandonné par les siens (comme le Christ). Quand Péguy célèbre la mystique juive, il veut montrer qu'elle est partie prenante de la mystique chrétienne et de la mystique républicaine. C'est en catholique français que Péguy se pose la question du judaïsme. En revanche, difficile d’imaginer Péguy saluant la forme actuelle de l’État d'Israël qui n'a plus rien à voir avec le projet sioniste des commencements. Peut-être aurait-il dit que les politiques actuels trahissent la mystique pour tenter de faire une fin ! Qui sait ? Une chose est sûre : les projections de ce type sont toujours risquées.
Juan Asensio
Si l'état d'enfance, écrivez-vous, «peut être pensé comme une imitation du Royaume de Dieu et comme une voie d'accès privilégiée à la sainteté» (p. 64), sommes-nous dès lors fondés à assimiler l'état de vieillesse non seulement à une forme de pétrification purement réduite à la politique au sens le moins noble, donc le moins mystique, de ce terme, mais aussi comme une espèce d'avarice devenue folle (avarice de la vie, de l'énergie, de la joie mais aussi... thésaurisation !) au sens qu'Ernest Hello donnait à ce terme ? Nous voici abordant la grande thématique de l'Argent devenu roi de notre monde plus encore que de celui de Charles Péguy. Comment imaginer un recommencement, donc, si nous vous suivons, le triomphe de l'esprit d'enfance aux «vertus chevaleresques» (p. 84), dans un monde tout entier occupé par des passions d'hommes murs et même de vieillards, l'accumulation de l'argent pour lui-même, l'accumulation du capital n'ayant d'autre fin qu'elle-même ?
Matthieu Giroux
Encore une fois, la jeunesse, comme la vieillesse, n'est pas une caractéristique physique mais morale. Le «jeune» Renan était vieux. Le «vieux» Bernard-Lazare était jeune. Pour Péguy, la règle, c'est qu'en vieillissant physiquement, on vieillit aussi moralement. Et le monde moderne, qui est un monde «vieux», encourage ce vieillissement généralisé en masquant les mystiques pour favoriser le triomphe de l'argent qui est, comme vous dites, une «passion de vieillard». L'argent, pour Péguy, est frère de l'idéologie du progrès qui est une «théorie de caisse d'épargne, de fécule et de réserve». Le seul moyen pour enrayer la domination toujours plus grande de l'argent est de redonner la première place à l'esprit, celle qui lui revient de droit. Mais, dans le monde moderne, l'esprit n'en finit plus de compter ses ennemis : les matérialistes, les positivistes, les sociologues, les politiques, les capitalistes, les athées. En revanche, les amis de l'esprit se comptent sur les doigts d'une main. Il y a bien quelques mystiques comme Péguy, comme Bernard-Lazare, comme ceux qui contribuent aux Cahiers de la Quinzaine. Mais, avec Péguy, la liste des mystiques diminue en même temps que le nombre de ses amis : Jean Jaurès, Daniel Halévy, Romain Rolland, Alfred Dreyfus... Péguy se brouille sans cesse et s'isole. Les conditions d'un retour à la mystique, d'une victoire de l'esprit sont de plus en plus difficiles à réunir. Seul un événement d'envergure pourrait faire basculer les choses; l'Affaire Dreyfus aurait dû jouer ce rôle, mais elle fut détournée en affaire «dreyfusisme», la mystique qui était la sienne fut dévorée par la politique. De même, la fondation du socialisme aurait pu mettre un terme à cette domination de l'argent, mais, encore une fois, ce fut un échec.
Juan Asensio
Péguy allant en fin de compte de constat d'échec en constat d'échec... Jean-Noël Dumont, qui fut mon excellent professeur de philosophie à classe de terminale, d’hypokhâgne et de khâgne à Lyon, a pu parler, à propos de Péguy sur lequel il a écrit un petit livre, d'«axe de détresse». Pouvons-nous parler de l'espoir ou de l'espérance plutôt d'un désespéré à propos de Péguy ? Venons-en par ce biais à une question implicite sur votre petite étude revigorante : si vous estimez que Péguy est un écrivain qui ne nous ment pas (voir votre Avant-propos), cela veut dire que certains sont menteurs ou même qu'ils font mentir Péguy, ce qui est probablement pire à vos yeux ! Du coup, et vous l'écrivez sans ambages, il «est tentant de vouloir faire sien Péguy, de tirer Péguy vers soi» (p. 9). Qui, aujourd'hui, tire ou du moins tente de tirer un peu trop grossièrement Charles Péguy vers soi puisque, a contrario, vous avez plus haut nommé quelques commentateurs honnêtes ? Pour ne pas vous donner l'impression de chercher à vous piéger, et puisque, après tout, sur les brisées de Joseph de Maistre, Péguy affirme qu'il faut faire «des questions de personne, parce qu’il n’y a que des questions de personne», je vous dirais que j'ai quelque difficulté à comprendre le Péguy d'Antoine Compagnon, fort à la mode droitiste ces dernières années, en dépit même de la prudence de ce mandarin universitaire. Voici ce qu'il écrit à propos de Péguy : «Seuls les antimodernes littéraires, les écrivains, exemplairement Péguy, prouvent qu’il est possible de se mettre en congé du progressisme sans devenir ipso facto de «nouveaux réactionnaires» – prouvent que les vrais modernes sont les modernes à leur corps défendant» (1). C'est beaucoup de circonvolutions pour faire de Péguy un antimoderne mais surtout pas, grands dieux non !, un réactionnaire, l'horrible réalité !
Matthieu Giroux
Péguy accorde un primat à l'espérance sur les autres vertus théologales (foi et charité). En cela, il est un catholique hétérodoxe. Pour lui, il est plus difficile d'espérer que d'avoir la foi ou d'être charitable. L'espérance est une croyance et un amour qui regardent vers demain. Peut-être que cette préférence peut s'expliquer par cette insatisfaction perpétuelle, cette déception toujours renouvelée que lui inflige le présent. Péguy n'est pas un désespéré, il entérine la perte et les échecs mais il croit toujours que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, que quelque chose viendra à commencer ou recommencer. Quand j'écris que certains tirent Péguy vers eux. Je pense plutôt à Alain Finkielkraut qui tire Péguy vers Barrès, à Edwy Plenel qui tire Péguy vers la «gauche» (et non vers le socialisme) ou encore à Yann Moix qui insiste sans cesse sur le philosémitisme de Péguy. Je préfère, dans leur approche de Péguy, les personnes que j'ai évoquées plus haut. Je pense aussi à ceux qui citent des phrases de Péguy sans l'avoir lu. Ainsi «Il faut dire ce que l'on voit et, ce qui est plus difficile, il faut voir ce que l'on voit » ou encore «Parce qu'ils n'aiment personne ils croient qu'ils aiment Dieu » devenaient des slogans sur les réseaux sociaux après le 13 novembre pour dénoncer la «barbarie» islamiste. Grotesque. Contrairement à vous, je reconnais un mérite à la thèse de Compagnon sur les antimodernes, ces «modernes contrariés», ceux qui sont «à l'avant-garde de l'arrière-garde» ou «à l'arrière-garde de l'avant-garde». Pour Compagnon, les antimodernes sont emportés par le mouvement de la modernité mais ils cultivent une défiance vis-à-vis de l'idéologie du progrès. Péguy, même s'il se considère comme un classique, est parfaitement moderne d'un point de vue littéraire. Mais il est antimoderne dans la mesure où il critique les dérives de la sociologie qui domine son époque. Il me paraît risqué de dire de Péguy qu'il est «réactionnaire» puisque les réactionnaires sont ceux qu'il a combattus toute sa vie, à savoir les nationalistes de l'Action française. Il existe un passage dans la biographie de Maurras écrite par Boutang où ce dernier compare L'avenir de l'intelligence, grand texte de Maurras, avec les Situations de Péguy : «Le ton est plus "réactionnaire" que celui de L’avenir de l’Intelligence et l’on voit bien que Marx eût dénoncé comme "féodal" le socialisme de Péguy.» C'est vrai que l'ethos de Péguy rappelle les hommes de l'ancienne France. Sa passion pour Jeanne d'Arc, pour la chevalerie ou pour les cathédrales sont des marqueurs. Mais, pour Péguy – et c'est un point important –, la Révolution française a été faite par les hommes de l'ancienne France. La Révolution est un fruit de l'arbre Moyen Âge. J'ajouterai que lorsqu'on dit «réactionnaire», il faut dire par rapport à quoi. Péguy salue, comme le fera Bernanos, la Révolution française. La modernité que dénonce Péguy ne commence pas en 1789 mais en 1881, date où, selon lui, le parti intellectuel a assis sa domination sur la République.
Juan Asensio
Connaissez-vous ce que Georges Hyvernaud a écrit sur Charles Péguy ? Je me permets de citer un passage éloquent de l'article que j'ai consacré à La peau et les os (2) : «Il faudrait encore dénicher l’imposture de certaines écritures, et cela lorsque c’est d’autant plus nécessaire que celui qui parle et écrit est considéré comme un maître. Les actuels thuriféraires de Charles Péguy, nains juchés sur les épaules d’un géant qui, selon Georges Hyvernaud, n’est point si grand que cela, feraient bien de lire les pages que l’écrivain consacre à l’auteur de Notre jeunesse, intitulées ironiquement Leur cher Péguy. Hyvernaud reproche à Péguy d’être un auteur, aussi doué qu’on le voudra, qui ne s’en paie pas moins de mots, qui joue au pauvre alors qu’il ne l’est pas vraiment, pour preuve «ces calembours trop appuyés. Ces façons de mal parler exprès, ces vulgarités d’expression qui sont l’innocente débauche des agrégés de grammaire» (p. 131). Péguy, comme pas un, s’entend «à brouiller les choses et les mots, à imposer aux mots de tout le monde un sens qu’ils n’ava
30/11/2018 | Lien permanent
Asensio au Kosovo ou la baleine dans le ruisseau

 Quelle n'a pas été ma surprise lorsque la traductrice albanaise de mon ouvrage sur Judas, Anila Xhekaliu, m'a dit que j'allais être invité par mon éditeur albanais Buzuku dirigé par le très fantasque Abdullah Zeneli, à la Foire internationale du livre de Pristina !
Quelle n'a pas été ma surprise lorsque la traductrice albanaise de mon ouvrage sur Judas, Anila Xhekaliu, m'a dit que j'allais être invité par mon éditeur albanais Buzuku dirigé par le très fantasque Abdullah Zeneli, à la Foire internationale du livre de Pristina !Il faut dire que ma Chanson d'amour de Judas Iscariote, parue au Cerf en 2010 et traduite en 2017 sous le titre mélodieux de Kënga e dashurisë e Judë Iskariotit, a reçu un excellent accueil critique dans cette région, par exemple sous la plume d'un Behar Gjoka (qui fit paraître dans sa revue la traduction albanaise de tel de mes articles intitulé Trois piétés en époques troubles) ou d'un Anton Nikë Berisha, dans un article intitulé Misteri i tradhtisë ose hijesimi i dashurisë publié sur ce site puis recueilli dans un recueil d'articles de ce même auteur sous le titre Paanësiae fjalës poetike.
 C'est le 16 mai (alors que je dois me rendre au Kosovo le 4 juin) qu'une conseillère de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France au Kosovo que par courtoisie je ne nommerai pas, m'écrit pour m'indiquer que mon éditeur et ses services allaient prendre en charge mon séjour (transport international, national et hébergement). Elle manifeste par ailleurs le désir que je la mette en relation avec mon éditeur, afin de lui acheter une vingtaine d'exemplaires de mon Judas pour l'offrir à certains de ses partenaires francophones. Je lui réponds que je suis absolument ravi de me rendre au Kosovo mais, n'en croyant pas mes yeux, je lui demande si je dois bien comprendre ce qu'elle m'a écrit. Le lendemain, soit le 17, elle me précise que c'est mon éditeur qui paiera mon billet d'avion, mais je n'en reste pas moins très heureux.
C'est le 16 mai (alors que je dois me rendre au Kosovo le 4 juin) qu'une conseillère de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France au Kosovo que par courtoisie je ne nommerai pas, m'écrit pour m'indiquer que mon éditeur et ses services allaient prendre en charge mon séjour (transport international, national et hébergement). Elle manifeste par ailleurs le désir que je la mette en relation avec mon éditeur, afin de lui acheter une vingtaine d'exemplaires de mon Judas pour l'offrir à certains de ses partenaires francophones. Je lui réponds que je suis absolument ravi de me rendre au Kosovo mais, n'en croyant pas mes yeux, je lui demande si je dois bien comprendre ce qu'elle m'a écrit. Le lendemain, soit le 17, elle me précise que c'est mon éditeur qui paiera mon billet d'avion, mais je n'en reste pas moins très heureux. C'est encore le 16 mai que cette même personne m'envoie un nouveau courriel où elle m'écrit qu'elle pense comprendre (que de circonvolutions diplomatiques !) que je suis intéressé par le fait de me rendre, une fois à Pristina, en Albanie (Tirana) et en Macédoine du nord (Skopje), et, pour compléter ce tableau somme toute idyllique, m'indique qu'elle est toute prête à organiser une rencontre avec le public à l'Alliance française de Pristina, m'assurant que l'un de ses collaborateurs, chargé de mission culturelle, était à ma disposition pour préparer au mieux mon séjour.
C'est encore le 16 mai que cette même personne m'envoie un nouveau courriel où elle m'écrit qu'elle pense comprendre (que de circonvolutions diplomatiques !) que je suis intéressé par le fait de me rendre, une fois à Pristina, en Albanie (Tirana) et en Macédoine du nord (Skopje), et, pour compléter ce tableau somme toute idyllique, m'indique qu'elle est toute prête à organiser une rencontre avec le public à l'Alliance française de Pristina, m'assurant que l'un de ses collaborateurs, chargé de mission culturelle, était à ma disposition pour préparer au mieux mon séjour.Jusqu'à ma venue à Pristina, je n'échange plus avec ce membre de l'Ambassade que quelques courriels sans grande importance, qui me permettent par exemple de savoir que cette dernière a acheté... trois ou quatre petits exemplaires de mon ouvrage sur Judas, et non, donc, une vingtaine, mais cela n'a à mes yeux aucune importance, puisque je suis heureux de me rendre dans un pays que je ne connais pas, et pour une aussi merveilleuse raison que celle que m'apporte la traduction d'un de mes ouvrages ! Pour faire bonne figure, je mets en relation l'Ambassade et mon dernier éditeur, Ovadia, afin que je puisse, sur place, disposer de quelques exemplaires de mon dernier ouvrage, Le temps des livres est passé. Je ne sais si ces exemplaires sont parvenus à bonne destination mais, comme pour mon livre sur Judas, je n'en ai vu pas l'ombre d'une feuille au Kosovo. Ils y finiront sans doute à une poubelle (de recyclage ?) ou, par un curieux hasard dont les dieux littéraires sont souvent friands, sous les yeux d'un lecteur, jeune ou vieux, connaissant le français.
 J'arrive le 4 juin à Pristina, très tard le soir en raison d'un fort bel orage au-dessus de l'aéroport Charles de Gaule qui m'a fait songer, toutes proportions gardées bien sûr, aux dernières images du très beau film intitulé Take Shelter. Dès le lendemain, je dois prononcer quelques mots à l'ouverture officielle de la Foire du livre, où je serre la main de deux personnes de l'Ambassade de France, mais non pas celle de la personne qui a été, pour l'heure, mon interlocutrice. C'est après que j'ai chaleureusement remercié les autorités en place, ainsi, cela va de soi, que les services de l'Ambassade de France au Kosovo, que l'on m'apprend, fort diplomatiquement bien sûr, que de fâcheuses considérations de planning et autres contrariétés absolument regrettables semblent avoir considérablement compromis, et même très franchement annulé, toute forme de coopération entre la voix officielle de la France au Kosovo et l'auteur que vous savez, dépité mais n'en laissant comme il se doit, protocole oblige, rien paraître. Apparemment, ce sont les mêmes contrariétés calendaires qui me font comprendre que je ne pourrai même pas disposer de mes quatre ridicules exemplaires de mon livre en français. Comme il est parfaitement établi que rien ni personne ne sauraient décidément gâcher mon plaisir d'être loin de la France, je me contente de remercier l'homme affable bien que protocolairement distant qui vient de m'apprendre l'existence de ces impondérables absolument normaux en Albanie, cette dernière remarque étant je le suppose destinée à atténuer ma déception.
J'arrive le 4 juin à Pristina, très tard le soir en raison d'un fort bel orage au-dessus de l'aéroport Charles de Gaule qui m'a fait songer, toutes proportions gardées bien sûr, aux dernières images du très beau film intitulé Take Shelter. Dès le lendemain, je dois prononcer quelques mots à l'ouverture officielle de la Foire du livre, où je serre la main de deux personnes de l'Ambassade de France, mais non pas celle de la personne qui a été, pour l'heure, mon interlocutrice. C'est après que j'ai chaleureusement remercié les autorités en place, ainsi, cela va de soi, que les services de l'Ambassade de France au Kosovo, que l'on m'apprend, fort diplomatiquement bien sûr, que de fâcheuses considérations de planning et autres contrariétés absolument regrettables semblent avoir considérablement compromis, et même très franchement annulé, toute forme de coopération entre la voix officielle de la France au Kosovo et l'auteur que vous savez, dépité mais n'en laissant comme il se doit, protocole oblige, rien paraître. Apparemment, ce sont les mêmes contrariétés calendaires qui me font comprendre que je ne pourrai même pas disposer de mes quatre ridicules exemplaires de mon livre en français. Comme il est parfaitement établi que rien ni personne ne sauraient décidément gâcher mon plaisir d'être loin de la France, je me contente de remercier l'homme affable bien que protocolairement distant qui vient de m'apprendre l'existence de ces impondérables absolument normaux en Albanie, cette dernière remarque étant je le suppose destinée à atténuer ma déception. C'était donc alors, même si je l'ignorais à ce moment-là, la première et la toute dernière fois que je voyais un des représentants de l'Ambassade de France au Kosovo, celle-là même qui sut, lors de la venue de Mathias Enard à Pristina, et cela en dehors de tout événement littéraire particulier, lui dérouler le tapis rouge que ses balzaciens pieds se sont fait un plaisir de fouler, qui plus est en tenant compte de ces fameuses particularités que sont au Kosovo ce que la saleté, les embouteillages, l'insécurité, les camps de migrants et les centres pour toxicomanes sont à la glorieuse capitale de la France, Paris je crois, non seulement une double nature que plus personne ne prend vraiment la peine de considérer avec attention et encore moins n'ose critiquer mais un glorieux attribut de son rang et de son rayonnement planétaire. Ainsi est-ce cette même ambassade aux moyens très variables suivant la personne censée en bénéficier qui rend compte d'une rencontre entre les lycéens de Pristina, Kamenica, de Klina et d’Obiliq et l'auteur internationalement connu dont ils ne connaissaient toutefois même pas le nom deux minutes avant qu'il ne prenne la parole, pour raconter les habituelles fadaises qu'il égrène toutes les fois qu'il parle. Comme Alain Damasio, Mathias Enard parle comme il écrit; non, je me montre injuste car Alain Damasio écrit encore plus mal qu'il ne parle. Cet événement considérable, durant lequel la jeunesse du Kosovo a eu l'honneur de découvrir le plus grand écrivain français depuis Balzac (ou Balzak, comme je l'ai vu orthographier sur une traduction en albanais) a eu lieu le 17 octobre 2018. Nous apprenons aussi que le maire de Pristina, Shpend Ahmeti, n'a pas trouvé exagéré de remettre à notre fierté littéraire nationale les clés de sa ville et, parce qu'il serait tout bonnement indécent de ne point célébrer à sa juste valeur le nouveau BalzaK de la littérature française, Mathias Enard est convié, cette fois-ci le 16 octobre, à l'Alliance française de Pristina pour, là encore, éblouir un public rare quoique concentré par sa maîtrise du verbe.
C'était donc alors, même si je l'ignorais à ce moment-là, la première et la toute dernière fois que je voyais un des représentants de l'Ambassade de France au Kosovo, celle-là même qui sut, lors de la venue de Mathias Enard à Pristina, et cela en dehors de tout événement littéraire particulier, lui dérouler le tapis rouge que ses balzaciens pieds se sont fait un plaisir de fouler, qui plus est en tenant compte de ces fameuses particularités que sont au Kosovo ce que la saleté, les embouteillages, l'insécurité, les camps de migrants et les centres pour toxicomanes sont à la glorieuse capitale de la France, Paris je crois, non seulement une double nature que plus personne ne prend vraiment la peine de considérer avec attention et encore moins n'ose critiquer mais un glorieux attribut de son rang et de son rayonnement planétaire. Ainsi est-ce cette même ambassade aux moyens très variables suivant la personne censée en bénéficier qui rend compte d'une rencontre entre les lycéens de Pristina, Kamenica, de Klina et d’Obiliq et l'auteur internationalement connu dont ils ne connaissaient toutefois même pas le nom deux minutes avant qu'il ne prenne la parole, pour raconter les habituelles fadaises qu'il égrène toutes les fois qu'il parle. Comme Alain Damasio, Mathias Enard parle comme il écrit; non, je me montre injuste car Alain Damasio écrit encore plus mal qu'il ne parle. Cet événement considérable, durant lequel la jeunesse du Kosovo a eu l'honneur de découvrir le plus grand écrivain français depuis Balzac (ou Balzak, comme je l'ai vu orthographier sur une traduction en albanais) a eu lieu le 17 octobre 2018. Nous apprenons aussi que le maire de Pristina, Shpend Ahmeti, n'a pas trouvé exagéré de remettre à notre fierté littéraire nationale les clés de sa ville et, parce qu'il serait tout bonnement indécent de ne point célébrer à sa juste valeur le nouveau BalzaK de la littérature française, Mathias Enard est convié, cette fois-ci le 16 octobre, à l'Alliance française de Pristina pour, là encore, éblouir un public rare quoique concentré par sa maîtrise du verbe. Les mauvaises langues habituelles estimeront que je ne suis, une fois de plus, qu'un envieux, un jaloux, un aigri mais, outre le fait que je n'ai jamais rien demandé à l'Ambassade de France, qui de son propre chef a pris la liberté de me contacter et de me faire miroiter un alléchant programme de rencontres et d'activités au Kosovo et dans plusieurs de ses régions limitrophes, il était évident que je ne pouvais inscrire ma venue dans ce pays sur les traces boueuses de Mathias Enard qui n'a jamais été à mes yeux, et ceci avant même qu'il n'acquière une réputation universelle, qu'un romancier amphigourique, comme en témoignent mes différentes critiques indiquées dans cette note ironique, où je moquais cet écrivain parfaitement consensuel et, pour cette raison, encensé par une presse indigente n'ayant pas honte de le comparer à Balzac ! Je le dis et le redis et ne m'embarrasserai, pas plus que par le passé, d'une prudence toute diplomatique qui n'a que faire en matière de critique littéraire : le talent, à peu près nul, de Mathias Enard, a été récompensé comme il se doit par le prix littéraire le plus déconsidéré au monde, le Goncourt bien sûr, parce que cet écrivant sans autre talent que celui de se vendre a fait absolument tout ce qu'il fallait pour être honoré de la sorte.
Les mauvaises langues habituelles estimeront que je ne suis, une fois de plus, qu'un envieux, un jaloux, un aigri mais, outre le fait que je n'ai jamais rien demandé à l'Ambassade de France, qui de son propre chef a pris la liberté de me contacter et de me faire miroiter un alléchant programme de rencontres et d'activités au Kosovo et dans plusieurs de ses régions limitrophes, il était évident que je ne pouvais inscrire ma venue dans ce pays sur les traces boueuses de Mathias Enard qui n'a jamais été à mes yeux, et ceci avant même qu'il n'acquière une réputation universelle, qu'un romancier amphigourique, comme en témoignent mes différentes critiques indiquées dans cette note ironique, où je moquais cet écrivain parfaitement consensuel et, pour cette raison, encensé par une presse indigente n'ayant pas honte de le comparer à Balzac ! Je le dis et le redis et ne m'embarrasserai, pas plus que par le passé, d'une prudence toute diplomatique qui n'a que faire en matière de critique littéraire : le talent, à peu près nul, de Mathias Enard, a été récompensé comme il se doit par le prix littéraire le plus déconsidéré au monde, le Goncourt bien sûr, parce que cet écrivant sans autre talent que celui de se vendre a fait absolument tout ce qu'il fallait pour être honoré de la sorte. Je me suis montré, à Tirana, d'une aménité, d'une cordialité, bref : d'une diplomatie absolument exemplaire, afin de ne mettre personne dans l'embarras, mais il est clair que, de retour à Paris, je ne me suis absolument pas gêné pour écrire aux intéressés ce que je pensais de leur défection. Qui vais-je surprendre en affirmant que je n'ai reçu aucune réponse de la part de l'intéressée, plus haut évoquée, ni même de ses zélés collègues ? Cette note, que je n'ai point voulue trop acide, renseignera suffisamment je crois sur les procédés qui, dans le délicat domaine de la collaboration artistico-intellectuelle entre deux pays, sont monnaie courante : le voyage de l'un, le plus connu, le bon vendeur, celui qui a reçu le Goncourt et fait parler de lui dans les médias mais qui écrit comme on fait, et comme on fait une matière peu esthétique, en se cachant dans un lieu d'aisance, est considérablement facilité (je reste dans l'euphémisme) par les services français présents dans le pays où il est invité, alors que l'autre, le sans-grade, le sans-presse autre que confidentielle, l'exécrateur public des prix dits littéraires du putanat médiatico-germanopratin, le contempteur inlassable de la merde qui ose se dire littérature, celui-là est ni plus ni moins que lâché en rase campagne kosovare.
Je me suis montré, à Tirana, d'une aménité, d'une cordialité, bref : d'une diplomatie absolument exemplaire, afin de ne mettre personne dans l'embarras, mais il est clair que, de retour à Paris, je ne me suis absolument pas gêné pour écrire aux intéressés ce que je pensais de leur défection. Qui vais-je surprendre en affirmant que je n'ai reçu aucune réponse de la part de l'intéressée, plus haut évoquée, ni même de ses zélés collègues ? Cette note, que je n'ai point voulue trop acide, renseignera suffisamment je crois sur les procédés qui, dans le délicat domaine de la collaboration artistico-intellectuelle entre deux pays, sont monnaie courante : le voyage de l'un, le plus connu, le bon vendeur, celui qui a reçu le Goncourt et fait parler de lui dans les médias mais qui écrit comme on fait, et comme on fait une matière peu esthétique, en se cachant dans un lieu d'aisance, est considérablement facilité (je reste dans l'euphémisme) par les services français présents dans le pays où il est invité, alors que l'autre, le sans-grade, le sans-presse autre que confidentielle, l'exécrateur public des prix dits littéraires du putanat médiatico-germanopratin, le contempteur inlassable de la merde qui ose se dire littérature, celui-là est ni plus ni moins que lâché en rase campagne kosovare.  J'y retournerai d'ailleurs bien volontiers, sachant, mais cette fois-ci par avance et en pleine connaissance de cause, qu'il me faudra me passer des diligences, absentes à mon égard, de l'Ambassade de France au Kosovo et, ma foi, je ne m'y rendrai, là-bas ou à Tirana en Albanie, qu'avec plus de plaisir encore ! Je me montrerais mauvais joueur si je m'avisais de sous-estimer le rôle conséquent joué par le personnel de cette ambassade qui a tout de même trouvé le temps, au milieu de sujets dont la portée géopolitique est infiniment plus stratégiques on s'en doute pour la France que la venue d'un critique littéraire en terre étrangère, de saluer ma venue à Pristina sur son compte Facebook officiel.
J'y retournerai d'ailleurs bien volontiers, sachant, mais cette fois-ci par avance et en pleine connaissance de cause, qu'il me faudra me passer des diligences, absentes à mon égard, de l'Ambassade de France au Kosovo et, ma foi, je ne m'y rendrai, là-bas ou à Tirana en Albanie, qu'avec plus de plaisir encore ! Je me montrerais mauvais joueur si je m'avisais de sous-estimer le rôle conséquent joué par le personnel de cette ambassade qui a tout de même trouvé le temps, au milieu de sujets dont la portée géopolitique est infiniment plus stratégiques on s'en doute pour la France que la venue d'un critique littéraire en terre étrangère, de saluer ma venue à Pristina sur son compte Facebook officiel. Je m'amuse de constater que c'est quand même un ambassadeur, ou plutôt un ancien ambassadeur, et de haut vol qui plus est, Besnik Mustafaj, par ailleurs, comme notre nouveau Balzac germanopratin, auteur publié chez Actes Sud, qui a fait, pour moi, un parfait inconnu, le travail que l'Ambassade de France a été bien incapable, elle, alors qu'elle était en toute possession de ses moyens on le devine plus conséquents que ceux de particuliers, de faire, à savoir : me permettre de découvrir cette région à l'histoire extraordinairement complexe, boire et dîner, discuter, jusqu'à des heures impossibles de la division entre Serbes et Albanais, de son ancienne vie dans les hautes sphères de la diplomatie, de la littérature bien sûr, sa grande, son unique passion, littérature pas seulement albanaise puisque Besnik, outre le fait de parler un français impeccable qui m'a été fort utile lorsque j'ai publiquement pris la parole, est un fin lettré. Je le remercie bien chaleureusement de n'avoir pas ménagé ses efforts, avec le concours plus qu'utile et appréciable de l'Ambassadeur d'Albanie à Pristina, et aussi de m'avoir dressé, alors que nous roulions vers Mitrovica, un panorama subtil et érudit des forces en présence et de la situation géopolitique de la région. Je remercie aussi l'étonnant Abdullah Zeneli, mon éditeur et, pour l'heure puisque l'Ambassade de France s'est subitement désistée, unique mécène albanais, Zeneli, l'homme qui projette, en excellent joueur d'échecs qu'il est, des coups cachés dans d'autres coups, et je remercie enfin ma traductrice, Anila Xhekaliu, belle âme s'il en est qui n'aura pas ménagé ses efforts, sans elle aussi m'avoir jamais rencontré, pour me servir de cicérone à Pristina alors qu'elle vit à Tirana et me faire rencontrer quelques lecteurs enthousiastes et érudits de mon Judas !
Je m'amuse de constater que c'est quand même un ambassadeur, ou plutôt un ancien ambassadeur, et de haut vol qui plus est, Besnik Mustafaj, par ailleurs, comme notre nouveau Balzac germanopratin, auteur publié chez Actes Sud, qui a fait, pour moi, un parfait inconnu, le travail que l'Ambassade de France a été bien incapable, elle, alors qu'elle était en toute possession de ses moyens on le devine plus conséquents que ceux de particuliers, de faire, à savoir : me permettre de découvrir cette région à l'histoire extraordinairement complexe, boire et dîner, discuter, jusqu'à des heures impossibles de la division entre Serbes et Albanais, de son ancienne vie dans les hautes sphères de la diplomatie, de la littérature bien sûr, sa grande, son unique passion, littérature pas seulement albanaise puisque Besnik, outre le fait de parler un français impeccable qui m'a été fort utile lorsque j'ai publiquement pris la parole, est un fin lettré. Je le remercie bien chaleureusement de n'avoir pas ménagé ses efforts, avec le concours plus qu'utile et appréciable de l'Ambassadeur d'Albanie à Pristina, et aussi de m'avoir dressé, alors que nous roulions vers Mitrovica, un panorama subtil et érudit des forces en présence et de la situation géopolitique de la région. Je remercie aussi l'étonnant Abdullah Zeneli, mon éditeur et, pour l'heure puisque l'Ambassade de France s'est subitement désistée, unique mécène albanais, Zeneli, l'homme qui projette, en excellent joueur d'échecs qu'il est, des coups cachés dans d'autres coups, et je remercie enfin ma traductrice, Anila Xhekaliu, belle âme s'il en est qui n'aura pas ménagé ses efforts, sans elle aussi m'avoir jamais rencontré, pour me servir de cicérone à Pristina alors qu'elle vit à Tirana et me faire rencontrer quelques lecteurs enthousiastes et érudits de mon Judas !Je me suis dit que la meilleure façon de remercier mon éditeur consistait, après tout, à lui emprunter, en guise de titre, l'image qu'il a utilisée pour évoquer ma venue : avec Asensio au Kosovo, nous avons fait nager une baleine dans un ruisseau !
Légende des illustrations.
Dans l'ordre ou le désordre, les différentes photographies montrent mon éditeur (infiniment plus drôle et avenant qu'il n'en a l'air !), Abdullah Zeneli, au Salon du Livre de Paris, le discours d'ouverture de la Foire internationale du livre de Pristina ou encore le public, essentiellement féminin et qui fut ému jusqu'aux larmes par la lecture de quelques témoignages d'atrocités, assistant à une conférence à la Bibliothèque nationale du Kosovo afin de présenter la traduction albanaise du livre de Sevdije Ahmeti, Journal d'une femme du Kosovo. Cet événement poignant a été relayé ici. Un autre média albanais a évoqué ce moment. Signalons encore que je figure, avec ma traductrice, Anila Xhekaliu et Besnik Mustafaj, sur le pont de Mitrovica séparant les populations serbes et albanaises et, enfin quelques heures avant mon départ pour Paris, lors d'une assez courte conférence à propos de mon Judas, avec Besnik Mustafaj me servant d'interprète de très haut vol. La photographie servant d'illustration principale montre la sculpture (Heroinat Memorial), assez réussie, d'un visage de femme composé de ceux de 20 000 autres, violées durant la Guerre du Kosovo.
23/06/2019 | Lien permanent
La France et les États-Unis à l’épreuve du Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler (Essai d’analyse morphologique du XXIe

Nous proposons ci-après un essai sur la philosophie de l’histoire d’Oswald Spengler, ainsi que sur sa méthodologie dans le décryptage de l’actualité sociopolitique et géopolitique. L’essai étant assez long, nous en publions seulement le premier quart. Le lecteur intéressé découvrira l’essai entier dans le document PDF ci-joint.
 Le Déclin de l'Occident (Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle) (1) est l’œuvre principale et capitale de la philosophie de l’histoire depuis un siècle. Publié en deux parties, la première en 1918, la seconde en 1922, rapidement traduit dans toutes les langues, à l’exception notable du français (2), cet esen deuxsai d’Oswald Spengler (1880-1936), qui s’inscrivait plus ou moins malgré lui dans le mouvement intellectuel de la Révolution conservatrice allemande (1918-1932), a fasciné et déterminé parmi les plus grands esprits; et seul le triomphe du gauchisme culturel a pu ces dernières décennies jeter sur lui l’ombre idéologique funeste de son mancenillier cérébral.
Le Déclin de l'Occident (Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle) (1) est l’œuvre principale et capitale de la philosophie de l’histoire depuis un siècle. Publié en deux parties, la première en 1918, la seconde en 1922, rapidement traduit dans toutes les langues, à l’exception notable du français (2), cet esen deuxsai d’Oswald Spengler (1880-1936), qui s’inscrivait plus ou moins malgré lui dans le mouvement intellectuel de la Révolution conservatrice allemande (1918-1932), a fasciné et déterminé parmi les plus grands esprits; et seul le triomphe du gauchisme culturel a pu ces dernières décennies jeter sur lui l’ombre idéologique funeste de son mancenillier cérébral.Ses nombreux disciples se découvrent dans les domaines les plus divers. Après lecture du Déclin de l’Occident, leur œuvre en semble marquée au fer rouge. Citons Ernst Jünger, André Malraux, Pierre Drieu la Rochelle, Howard Phillips Lovecraft, Issac Asimov, Claude Lévi-Strauss, Arnold Toynbee, Julien Gracq, Cioran, Ernst Nolte, Samuel Huntington, Alain de Benoist, Philippe Muray. En France, l’essai méconnu de Drieu la Rochelle (3) intitulé Notes pour comprendre le siècle (1941) nous paraît l’écrit français le plus spenglérien jamais paru. Certaines pages de Tristes Tropiques (1955) semblent calquées sur Le Déclin de l’Occident. Samuel Huntington doit à Spengler tous ses concepts historiques, dont celui de choc des civilisations, et le livre éponyme (1996) lui est un véritable hommage, bien qu’Huntington ne soit qu’un sous-Spengler assez timide – à l’instar de Toynbee, et que dire de Nolte ! La Nouvelle Droite, et en particulier Alain de Benoist, dès les années 1970, s’est explicitement réclamée d’Oswald Spengler, et n’a jamais failli à son admiration depuis, jusque dans les numéros les plus récents de la revue Éléments. Les deux plus fameux essais de Philippe Muray : Le XIXe siècle à travers les âges (1984) et Après l’Histoire (1999-2000), sont imbibés de la pensée spenglérienne. Et comment comprendre des œuvres romanesques aussi fascinantes qu’Héliopolis (1949) d’Ernst Jünger, Aux Montagnes de la Démence (1931) de Lovecraft, le Cycle de Fondation (1942-1993) d’Isaac Asimov, et les essais sur l’Art et l’Histoire de Gracq, Cioran et Malraux, publiés entre 1950 et 1980, sans s’être au préalable imprégné de Spengler ?
La méthode analytique que propose Le Déclin de l’Occident est proprement inouïe. Pourtant, Oswald Spengler ne prétendait pas à l’originalité absolue. Il déclare dès les premières pages de son essai, précisément dans l’Introduction, qu’il ne fait que poursuivre, étendre et approfondir une méthode d’analyse historique initiée instinctivement, presque inconsciemment, par Goethe dans ses écrits poétiques et dramatiques, en particulier dans les deux Faust (1808 & 1832), puis théorisée et affinée par Friedrich Nietzsche dans Par-delà Bien et Mal (1886) et Généalogie de la morale (1887). Fausse modestie ? Hommage sincère d’un thuriféraire ?
L’influence nietzschéenne est une évidence. Plus profondément, l’œuvre de Spengler s’inscrit dans le vaste mouvement germanique contre les Lumières, d’abord entaillées par le Romantisme de la Sturm und Drang, ensuite balafrées par Hegel et Kierkegaard, enfin dépassées et immolées par Nietzsche et Freud, et dont la Révolution conservatrice allemande de l’Entre-deux-guerres se voulut le premier avatar métapolitique. Voici un siècle que la Philosophie des Lumières est une sénescence surannée, une putréfaction intellectuelle, que les Lumières se sont éteintes dans les âmes européennes dont elles ne devraient plus servir que de fumier aux intelligences. Voici pourtant un siècle que les idéaux sociopolitiques et géopolitiques occidentaux en restent tributaires (le gauchisme culturel dans un capitalisme néolibéral); ceci explique le dédain universitaire envers l’œuvre de Spengler.
Toujours est-il que cet essai dense d’un millier de pages imprimées en petits caractères est, plus qu’une révolution intellectuelle, une véritable révélation humaine. C’est en réalité l’essai historique le plus roboratif jamais rédigé. Ses lignes traumatisent à jamais notre vision de l’Histoire… et de l’actualité.
La recension détaillée d’un tel ouvrage mériterait une étude approfondie qui étendrait cet article jusqu’à user la patience du lecteur. Elle a, de fait, plusieurs fois été rédigée. Nous nous contenterons de renvoyer le lecteur curieux au numéro 59-60 (mars 2011) de la revue Nouvelle École ainsi qu’aux nombreux articles publiés sur la Toile, qui en proposent d’excellents résumés pédagogiques.
Notre volonté ici est plutôt de montrer au néophyte la vigueur et l’actualité brûlante de cette œuvre, de susciter en lui le désir impérieux de la dévorer, en l’appliquant directement à la situation sociopolitique et géopolitique contemporaine. Quant aux initiés, nous leur offrons le bonheur d’exercer leur intelligence en confirmant ou infirmant notre analyse.
Dans cet objectif, nous nous contenterons d’offrir, avant de la mettre en pratique, un bref résumé de la méthode analytique spenglérienne, ainsi que des nuances que nous y apportons (I).
La mise en œuvre consistera à comparer la civilisation occidentale (européenne et nord-américaine) à celle de l’Antiquité gréco-romaine (Grèce, Étrurie, Rome), afin de déterminer le stade historique actuel de la France et des États-Unis, et prédire par là même l’avenir de la France à travers ses seuls scénarios possibles (II).
I – LA MÉTHODE ANALYTIQUE SPENGLÉRIENNE DE L’HOMOLOGIE HISTORIQUE
a) Les phases morphologiques des civilisations
L’analyse d’Oswald Spengler se fonde sur l’observation que chaque culture constitue une Vision du Monde (Weltanschauung ou Psyché) originale, unique et exclusive, circonscrite par des totems et des tabous, exprimée par des symboles précis, partagée par une population donnée, dans un lieu défini, et que cette vision se développe toujours, à travers les siècles, selon un schème spécifique.
Cette Vision du Monde, ou Psyché culturelle, va déterminer en son aire les rapports sociaux, économiques, politiques, artistiques, philosophiques, théologiques, amicaux, amoureux qu’elle a frappés de son sceau psychique. Autrement dit, notre esprit se construit autour de l’héritage spirituel, intellectuel, impressif et génétique de nos ancêtres, que nous transmettent notre famille, notre classe sociale, notre éducation premières, dont nous sommes imprégnés, imbibés même, dans l’enfance et l’adolescence, qui s’impose ainsi, instinctivement et inconsciemment, à l’individu adulte, formant son psychisme; et dont personne, sauf de rares intelligences, ne saurait s’abstraire.
L’objectif des individus les plus éminents (clercs et aristocrates, devenus intellectuels et politiciens) sera alors de poursuivre la logique de cette vision en l’approfondissant et en la confrontant au Réel. Cette confrontation engendre un mouvement dialectique (donc tragique) entre le Réel (Nature, Cosmos, Cultures étrangères) et la Psyché culturelle.
Ces considérations mènent Oswald Spengler à préciser qu’une civilisation n’est pas tant une unité ethnique, linguistique, géographique ou religieuse qu’une communauté de destin.
Deux individus issus de cultures différentes peuvent donc user de la même langue et des mêmes concepts abstraits (Justice, Liberté, Égalité, Fraternité, Dieu, Laïcité, Patrie, etc.) sans que les définitions desdits concepts se rejoignent, puisqu’elles ne recouvrent pas la même perception du Réel. Ces deux individus occasionnent ainsi, à leur insu, un dialogue de sourds susceptible d’engendrer les pires méprises et, sous l’accusation d’hypocrisie, des haines inexpiables – ceci précisé qu’une langue, à moins d’être un sabir, est toujours formatée à l’aune d’une culture donnée. Les psychismes culturels s’avèrent, en conséquence, radicalement hermétiques entre eux, à l’exception d’individus d’une intelligence et d’une érudition exceptionnelles.
Spengler compare dès lors les stades historiques d’une culture donnée, par nature tragiques et dialectiques, à un développement organique, ce qui explique le choix des métaphores morphologiques fauniques et floristiques pour désigner lesdits stades (4) :
-L’enfance et l’adolescence ou phase printanière : la Psyché culturelle se caractérise alors par une mystique onirique ancrée dans un paysage rural maternel et s’exprime en symboles poétiques.
-L’âge adulte ou phase estivale : la Psyché se caractérise par une âme encore pleine du souvenir de l’enfance, et s’exprime à travers des symboles rationalisés.
-L’âge mûr ou phase automnale : la Psyché se caractérise par un rationalisme et une irréligion prégnants en raison du déracinement citadin, entraînant un oubli de l’esprit de jouvence originel, mais les esprits, plus préoccupés du Monde que du Ciel, de la Nature que du Cosmos, sont encore plein de vigueur, et s’expriment par concepts et abstractions.
-La vieillesse ou phase hivernale : la Psyché se caractérise par une frilosité devant la cruauté de la Nature et devant d’autres jeunesses, ne s’exprime plus que dans un Droit mesquin et des ambitions sociopolitiques matérialistes;
-Pétrification cadavérique : la Psyché devient incapable de création nouvelle, et soit se contente de l’imitation itérative des créations anciennes (période post-historique), soit plonge dans l’amnésie culturelle (prélude à une acculturation).
Dans la culture française, par exemple, la jouvence printanière correspond à la seconde moitié du millénaire médiéval (1095-1494) (5), la jeunesse estivale à la Renaissance et au Baroque (1494-1653) (6), l’âge mûr automnal à Versailles et aux Lumières (1653-1815) (7), la sénescence hivernale à la Révolution industrielle et à la décolonisation (1815-1969) (8), la décomposition cadavérique s’instaurant à compter des années 1970.
Toutes les cultures commencent par une époque mystique des cathédrales et des croisades sise au sein de paysages agrestes, se composent exclusivement de paysans, d’aristocrates et de clercs, répartis en trois ordres, ordres divisés en classes sociales hermétiques et très racées (par endogamie génétique); toutes s’achèvent dans des mégapoles petites-bourgeoises coupées de la campagne originelle où se brassent toutes les ethnies et toutes les classes sociales jusqu’à ne plus se distinguer dans un informe métissage; entre les deux époques, de huit à treize siècles peuvent s’écouler, ce que, par facilité théorique, Spengler va ramener à une période millénaire, soit un décompte morphologique sur dix siècle – de même qu’un être humain, de nos jours, a, dans les pays industrialisés, une espérance de vie moyenne de quatre-vingts ans, alors que certains individus s’éteindront de mort naturelle à soixante ans et d’autres centenaires. Il s’en induit que les phases historiques modelées par la morphologie ne durent pas toutes le même nombre de décennies ou de siècles. Par exemple, si la jeunesse estivale est censée durer en moyenne deux siècles dans chaque civilisation millénaire, cela signifie qu’elle dure au minimum un peu plus d’un siècle et au maximum trois siècles soit entre cent vingt années et trois cents années, en raison de contingences imprévisibles : guerres civiles, invasions, épidémies, génocides, isolat culturel, acculturation forcée, épuisement des esprits en raison d’épreuves tragiques, génie exceptionnel avortant par son œuvre (politique ou artistique) la postérité potentielle; mais dans tous les cas, cette phase historique aura lieu à tel stade morphologique.
Quelle nécessité de s’achever pour une culture ? C’est l’objection principale formulée contre Spengler par ses contempteurs. Cette nécessité semble pourtant évidente. Un artiste, parvenu à la perfection de son art, s’étiole ou se tait. Chaque écrivain cherche à rédiger une œuvre, symbiose de la perfection stylistique et de la profondeur philosophique, de celle-ci incarnée par celle-là, œuvre à la recherche de laquelle il épuise son existence entière, sans toujours y parvenir. Les écrivains et poètes dont l’âme atteint ce sommet deviennent soudain silencieux, ou bien passent le reste de leur vie se plagier. Dans ce dernier cas, ils accoucheront peut-être de beaux livres; cependant, même mieux maîtrisés sur le plan stylistique, ils n’obtiendront jamais la fraîcheur solaire de l’œuvre à son zénith. Ainsi de Jean Racine, qui à la onzième tragédie, Phèdre (1677), après treize années de tragédies successives, atteignit sa perfection, et se tut. Il ne reprit la plume qu’à la demande expresse et insistante de la reine morganatique, et ses deux tragédies suivantes, Esther (1689) et Athalie (1691), si elles se révèlent encore meilleures par le style, la maîtrise du sujet et la profondeur, ne possèdent plus cette fièvre qui fascine dans les vers des années 1660-70 : elles sont d’une superbe cristallisée. Racine s’est simplement plagié.
Il en va de même des cultures : chacune cherche à porter à la perfection une Psyché culturelle qu’elle veut imposer à la Nature, à la société, à Dieu, aux concepts, à l’étranger; tous ses arts : politique, militaire, esthétique, y tendent fébrilement. Lorsqu’elle y est parvenu, elle s’étiole, puis se plagie (pétrification) ou se tait (acculturation). Et les générations successives ne font que reprendre le travail des générations précédentes où celles-ci l’ont abandonné, travail dont hérite leur psychisme culturel. L’Art français a trouvé une sorte de perfection à la fin du XIXe siècle et dans le premier tiers du XXe; il n’a plus rien à dire depuis, et les quelques génies littéraires qui subsistent, malgré leur fièvre personnelle, ne parviennent pas à sortir du roman proustien ou célinien. On observe le même mouvement dans la mode : alors qu’un profane observe à l’œil nu les dissemblances flagrantes entre les modes des décennies successives 1920 et 1930, ou bien 1970 et 1980, les décennies 2000, 2010, 2020 ne se distinguent plus que par des nuances, et il serait aisé de faire passer la plupart des vêtements de l’an 2000 pour une mode vestimentaire 2020, alors qu’il était ridicule de porter un habit 1920 en 1930, ou 1975 en 1985. Sur le plan politique, l’Ancien Droit à travers le régime monarchique incarnait l’âme française; son anéantissement par la Révolution de 1789, qui crut à la mode rationaliste pouvoir tout engendrer ex nihilo, faillit sonner le glas d’une culture qui chercha ensuite fébrilement à retrouver une forme organique à travers des soubresauts révolutionnaires et putschistes réguliers de 1789 à 1958; la Constitution gaullienne (1958-1962) lui a accordé cette grâce; et depuis, les réformateurs constitutionnels appelant à une VIe République ne proposent sous ce nom qu’une resucée de la IVe (1946-1958). Quant à l’art militaire, il a trouvé son héros avec Napoléon (1799-1815), et il a fallu une succession de catastrophes jusqu’à Diên Biên Phu (1954) pour que les militaires français abandonnent leur fascination morbide pour l’empereur déchu.
C’est en ce sens que les cultures sont un psychisme communautaire développé selon une logique morphologiques par une élite imbibée de ce psychisme.
Dès lors, Oswald Spengler effectue une distinction désuète entre culture et civilisation : la «culture» désignerait la période de vitalité d’une culture, la «civilisation» celle de sa putréfaction. Nous lui préférerons, dans l’étude ci-après, la distinction plus moderne entre préhistoire et histoire : la culture désignera ainsi tout peuple présentant une Vision du Monde originale; mais la civilisation intronisera son entrée dans l’Histoire, laquelle entrée naît d’un rapport dialectique violent entre les individus, les idées, les ordres et les classes sociales d’une culture donnée. En d’autres termes, la préhistoire se caractérise par une pensée clanique, tribale et hiérarchisée autour d’un chef de clan (élu ou héritier), dans une structure souvent limitée à quelques centaines ou milliers voire dizaines de milliers d’individus : ainsi des Aborigènes d’Australie, des Amérindiens d’Amazonie ou d’Amérique du Nord, des peuples nomades d’Afrique, des Germains païens ou ariens des Grandes Invasions, des Musulmans de Ciscaucasie (Daghestan, Ossétie, Tchétchénie, Circassie), des Mongols hunniques. Ces peuples anhistoriques connaissent certes des luttes de pouvoir entre individus, mais non idéologiques, non dialectiques : il ne s’agit pas pour eux de transformer morphologiquement leur culture, mais de diriger un groupe donné. Les luttes médiévales entre Guelfes et Gibelins pour savoir qui du pape ou de l’empereur doit détenir et incarner le pouvoir spirituel, de même que les contre-révolutions opposées à des révolutions en vue d’instaurer des ordres politiques s’excluant, leur restent inconcevables. Dans la phase préhistorique (dénuée de toute expérience historique) ou post-historique (civilisation pétrifiée) d’une culture, termes que nous confondrons désormais sous celui d’anhistorique, la tribu fonctionne sur un mode de croyances, de totems et de tabous inviolables et indubitables, dont la mise en œuvre est effectuée par le chef sur lequel pèse toute responsabilité, tandis que la moindre incartade, la moindre originalité est sévèrement châtiée. Or, les grands concepts politiques et philosophiques, les grands symboles théologiques et artistiques naissent, à l’inverse, et en toute logique, de la dialectique historique, de la déchirure qu’instaure celle-ci dans les âmes et les corps (sociaux). Sans Histoire, point de grande littérature, point de recherche artistique, nul questionnement philosophique ou social, aucune co
11/01/2021 | Lien permanent
Le Temps gagné de Raphaël Enthoven : la « littérature » d’un Putanat tentaculaire et de l’onction cathodique, par Gregor

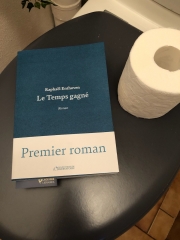 Rappel.
Rappel.Le Temps gagné de Raphaël Enthoven, ce roman que l'on expédie d'un derrière (point tout à fait) distrait.
«[…] les émissions dites littéraires les plus connues servent – et de manière de plus en plus servile – les valeurs établies, le conformisme et l’académisme, ou les valeurs du marché.»
Pierre Bourdieu, Sur la télévision.
«Bientôt tu auras tout oublié, bientôt tous t’auront oublié !»
Marc-Aurèle, Pensées.
 Le méprisable et minuscule coprolithe de Raphaël Enthoven, pompeusement auréolé d’un titre proustien – Le Temps gagné (1) – et subsidiairement immatriculé par le fantôme d’Alfred de Musset (puisque la quatrième de couverture, probablement rédigée par un sot ou une sotte des Éditions de l’Observatoire – qui en comptabilise assurément beaucoup étant donné les couillons et les couillonnes qu’elle honore souvent d’une réclame ampoulée – nous promet que nous allons découvrir la «confession d’un enfant du XXe siècle»), cette sordide et lamentable cagade, donc, pourrait à elle seule justifier tous les diagnostics de Léon Bloy à propos des saletés de la bourgeoisie et plus concrètement à propos de la manière dont le Bourgeois, cet archétype émérite de la sous-humanité, jamais rassasié de sa bêtise et de celle de ses pairs, «aime tout […] et avale tout» (2), avec une préférence évidente mais dissimulée pour la merde et ses inénarrables déclinaisons. En effet, dans ce Temps gagné qui se veut un roman, un cantique du «courage», une conquête de la «liberté», voire un précis de «violence» existentielle digne du parcours dramatique de Robert Frost et qui n’est tout au plus que la rédaction essoufflée d’un asthmatique du style, d’un Édouard Louis de goguenots germanopratins et d’un ancien khâgneux n’ayant point fait le deuil de ses références canoniques, il n’est question que de merde, c’est-à-dire, en toute rigueur, d’une merde supposément romancée qui eût dû s’abstenir d’être si laborieusement chiée et qui, par spectaculaire synecdoque et par irrésistible embourgeoisement de son émetteur depuis environ dix ans, a d’une part envahi la France entière, à tout le moins la France putanisée de la rentrée littéraire (journalistes, attachées de presse et lecteurs fins amateurs de pets, ces bibliomanes autoproclamés qui accélèrent le démâtage des valeurs), et, d’autre part, son auteur et les personnages à peine déguisés de son caca nerveux rancunier, soi-disant littéraire, où il règle itérativement ses comptes avec ceux qui l’auraient si inconvenablement traité.
Le méprisable et minuscule coprolithe de Raphaël Enthoven, pompeusement auréolé d’un titre proustien – Le Temps gagné (1) – et subsidiairement immatriculé par le fantôme d’Alfred de Musset (puisque la quatrième de couverture, probablement rédigée par un sot ou une sotte des Éditions de l’Observatoire – qui en comptabilise assurément beaucoup étant donné les couillons et les couillonnes qu’elle honore souvent d’une réclame ampoulée – nous promet que nous allons découvrir la «confession d’un enfant du XXe siècle»), cette sordide et lamentable cagade, donc, pourrait à elle seule justifier tous les diagnostics de Léon Bloy à propos des saletés de la bourgeoisie et plus concrètement à propos de la manière dont le Bourgeois, cet archétype émérite de la sous-humanité, jamais rassasié de sa bêtise et de celle de ses pairs, «aime tout […] et avale tout» (2), avec une préférence évidente mais dissimulée pour la merde et ses inénarrables déclinaisons. En effet, dans ce Temps gagné qui se veut un roman, un cantique du «courage», une conquête de la «liberté», voire un précis de «violence» existentielle digne du parcours dramatique de Robert Frost et qui n’est tout au plus que la rédaction essoufflée d’un asthmatique du style, d’un Édouard Louis de goguenots germanopratins et d’un ancien khâgneux n’ayant point fait le deuil de ses références canoniques, il n’est question que de merde, c’est-à-dire, en toute rigueur, d’une merde supposément romancée qui eût dû s’abstenir d’être si laborieusement chiée et qui, par spectaculaire synecdoque et par irrésistible embourgeoisement de son émetteur depuis environ dix ans, a d’une part envahi la France entière, à tout le moins la France putanisée de la rentrée littéraire (journalistes, attachées de presse et lecteurs fins amateurs de pets, ces bibliomanes autoproclamés qui accélèrent le démâtage des valeurs), et, d’autre part, son auteur et les personnages à peine déguisés de son caca nerveux rancunier, soi-disant littéraire, où il règle itérativement ses comptes avec ceux qui l’auraient si inconvenablement traité. L’ensemble compose une agitation fécale assez préoccupante dans la mesure où ce répugnant gémissement incarne une certaine réalité de l’offre et de la demande, une certaine façon, aussi, d’alimenter les ambitions des chieurs d’encre et d’assouvir un public scatophage, un sinistre lectorat grandissant à vue d’œil au cœur d’un pays qui se glorifie pourtant d’être la lanterne mondiale des lettres. Mais soyons magnanimes et osons une hypothèse à décharge : sans doute est-ce à cause d’une constipation psychique de longue durée que Raphaël Enthoven donne l’impression d’avoir impudiquement prouté ou sous-prousté son livre, se soulageant à bon droit de cet entassement parasite, n’esquivant pas néanmoins le stéréotype du «vieux prout» (p. 324) à large portée, ce ballonnement détendu qu’on aurait préféré inaudible et inodore, ce long-range gas qui se répand à chaque publication susceptible d’exciter les narines démocrates d’un Augustin Trapenard, ceci après avoir profité d’un laxatif miraculeux offert par les Éditions de l’Observatoire, une maison qui semble s’être spécialisée dans l’épanchement du tout-à-l’égout de tel ou tel nanti qui n’en pouvait décidément plus de ses puants démons intérieurs. Hélas, à notre époque, ce qui jadis n’aurait pu franchir les limites des lieux d’aisances se trouve désormais surexposé comme le dernier périple de Sylvain Tesson, ce Dumont d’Urville bon marché pour eunuque parisien ou pour sous-préfète qui confond l’ascension de la roche de Solutré avec le couloir Whymper de l’Aiguille Verte, et, ce faisant, les mauvaises odeurs essaiment goulûment et exigent qu’on les ventile vigoureusement.
On a donc ici un méchant petit navet troublé de ressentiment, une détestable rédaction de nain ulcéré par d’autres nains, un amas de coups fourrés qui empeste la psychologie de l’émasculé qui se venge de guingois, sans panache et sans aucune inspiration pamphlétaire, sans un reliquat de testicule, vérifiant par là même une constatation peu gratifiante pour son ridicule producteur : Raphaël Enthoven nous avait déjà prouvé sa relative nullité en concepts, or, cette fois, il nous prouve sa nullité absolue en prose. Il est en outre curieux que ce justicier de sa propre cause perdue, se prévalant volontiers du registre de la vérité (cf. p. 416), se soit rangé sous les auspices du roman alors qu’il eût été plus adéquat d’en appeler à la tradition consacrée du récit. Mais ce serait méconnaître le caractère du Bourgeois que de s’étonner trop longtemps de ce choix d’Enthoven. Si ce pitre sommital a officiellement choisi le roman, c’est, d’une part, en vue d’obtenir les distinctions sacramentelles qui accompagnent le statut de romancier dans l’univers du crétinisme atavique de Saint-Germain-des-Prés (ou des Pets), puis, d’autre part, en raison de son incapacité à totalement s’assumer en tant que redresseur de torts et surtout en tant que version anémiée de La Bruyère ou de La Rochefoucauld, les hallebardes verbales de ce myrmidon sous-pigiste dans mille gazettes faisandées n’étant que des cotons-tiges qui ramassent un peu de cire dans les oreilles à peine sifflantes d’une société de lilliputiens (et de lilli-putes), une société dont l’esbroufeur Enthoven, malgré qu’il en ait, n’est jamais sorti et ne sortira jamais. On se moque ainsi de savoir que ce branleur chevronné (selon ses dires) s’attaque à l’un ou l’autre de ses ennemis intimes en démoulant chaque fois son cake devant une porte de l’Enfer, mais, en revanche, on se moque beaucoup moins que ce malappris feigne de se déprécier littérairement afin de mieux dénigrer – ou emmerder – ses bourreaux présumés sous le couvert de la licence romanesque.
Il faut du reste se méfier du Bourgeois lorsqu’il revendique le courage et le difficile apprentissage de la liberté. Et puis d’abord de quelle espèce de courage Raphaël Enthoven serait-il le nom ? Du courage de déféquer en public et de regarder grossir la verge d’un analphabète journalisme scatophile ? Du courage d’évoquer sa défécation et de pressentir l’imbibition vaginale de quelques croupières chargées d’écrire un avis dithyrambique au sujet de cette insipide imitation d’actionnisme viennois ? Du courage de brocarder son père, d’accabler sa mère (3), d’assaisonner son beau-père Isi Beller en le taxant de «gros lard», de «connard», de «gros con» et même «[d’enculé] de sa race» ? Du courage d’affirmer son hédonisme d’une effarante banalité ? Du courage de moucharder divers détails putassiers concernant les habitudes de Justine Lévy à la selle (cf. p. 372) ? Du courage de dédaigner l’écriture de Bernard-Henri Lévy tout en ne valant pas soi-même un atome infra-stylistique d’une crotte indigente de Mohammed Aïssaoui (cf. p. 295) ? Du courage d’avoir affronté une journée de canicule en Espagne en ayant toujours connu l’air conditionné réel ou métaphorique (cf. pp. 139-144) ?
Et qu’en est-il de la liberté qui succède à toute cette pétulance d’Achille d’opérette ? S’agit-il de l’illustrer en disant merde à des individus dont la position sociale, indubitablement, aura fortement contribué à ce que le rejeton Raphaël Enthoven puisse un instant nous enquiquiner de ses pleurnicheries gamines au lieu de séjourner pour l’éternité dans son lieu naturel – l’écurie des hongres ? S’agit-il par ailleurs de s’imaginer dans la peau d’un pur épicentre de possibilités qui peut à loisir réduire à néant les assauts du déterminisme ? S’estime-t-il de la sorte immunisé contre l’essentielle chétivité de ses semblables quand ceux-là s’aventurent à se prendre pour des Balzac ou des Maupassant, ceux-là, en définitive, qui ne passent pour des écrivains que par accident grâce à la presse la plus illettrée du système solaire ? Que Raphaël Enthoven n’oublie pas que la théorie sartrienne de la liberté, qu’il aime commodément valoriser (cf. p. 362), souffre d’un affreux tropisme bourgeois qui frôle l’indécence quand on l’éprouve in media res, à plus forte raison quand il croit pertinent de l’appliquer en rappelant que si son père avait voulu être normalien, il aurait pu, et que, de surcroît, pour ce père académiquement humilié, sangloter de regret dans la cour de la prestigieuse École de la Rue d’Ulm relèverait d’une faute de goût parce que «faire au monde le procès de son impuissance est un terrible aveu d’impuissance» (p. 362). Que Raphaël Enthoven, par conséquent, n’oublie jamais que si son père a effectivement raté ses études et qu’il en a fomenté des monuments d’amertume, lui, de son côté, a prodigieusement raté son roman tout simplement parce qu’il n’est pas un romancier, ni même une toute petite promesse de romancier, car il était par essence conditionné pour persévérer dans un état général d’inanité de toutes les facultés qui président au génie littéraire. Il n’est au mieux qu’un Bourgeois qui devait un jour ou l’autre torchonner un livre de fiction parce que cela devait participer de sa distinction mondaine, à rebours de toute vocation ou de toute conviction d’écriture. Qu’il le veuille ou non, si Raphaël Enthoven est parvenu à publier un si mauvais livre, tout puant d’orgueil et de mauvaise humeur, c’est qu’il appartient à cette même coterie qui peut publier des étrons à la chaîne sans être accusée de trouble à l’ordre public. Il n’existe en ce sens nulle différence de nature entre Enthoven fils, Enthoven père, Enthoven mère, Bernard-Henri Lévy ou sa fille Justine – ce sont tous des homoncules du milieu de la culture, des nabots qui ont la haine de tout ce qui les dépasse et qui s’organisent en association de malfaiteurs pour profaner le moindre vestige de majesté spirituelle. Entre eux, finalement, il n’existe qu’une différence de degré en cela que Raphaël Enthoven a réussi l’exploit de faire imprimer un livre encore plus épouvantable que les livres de ses opposants désignés.
Les conditions de possibilité de cette gredinerie répondent en fait à un mécanisme social qui permet à la classe bourgeoise de confisquer la majorité des accès à la culture tout en semant l’inquiétude et l’impossibilité de s’affirmer scolairement ou artistiquement dans les autres classes réputées inférieures. En aucune manière un manuscrit tel que celui du Temps gagné n’aurait pu jouir de l’assentiment d’un quelconque éditeur s’il n’avait été le fruit d’un matamore introduit comme Raphaël Enthoven. Cette manifestation du népotisme est particulièrement saillante dans un pays tel que la France et elle engendre une marée noire de la littérature qui vient empoisonner les animaux créatifs piégés par cette pollution croissante. Les tempéraments intrinsèquement créateurs sont méthodiquement éliminés par une industrie culturelle incompétente qui produit en masse et qui se reproduit abondamment dans l’intention de manufacturer du profit. On aboutit dès lors à un modèle de littérature standardisé par le Putanat de l’argent et des renommées artificielles, aggravé en outre par la complicité d’un journalisme scélérat qui distribue les récompenses et qui, à la télévision, orchestre les cérémonies de l’onction cathodique. Que Raphaël Enthoven s’autorise à railler les pouvoirs de la télévision en dit long sur le niveau de certitude et de fausse lucidité de ce vaste bluffeur (cf. pp. 302 et 391). Il est tellement intégré aux rouages de la Machine médiatique qu’il s’accorde en apparence le luxe de lui chier dessus à dessein de se placer en surplomb, vêtu des qualités de l’homme avisé, alors même qu’il dépend uniquement de cette arithmétique de l’image où tout est mis en scène et repose sur le scénario de quelques managers professionnels du racolage. L’objectif, pour lui, consiste à se fabriquer une notoriété de rebelle, de personnalité courageuse, de philosophe et d’écrivain qui n’est pas dupe du système en vigueur, en dépit du fait que ces titres lui sont exclusivement alloués par le mensonge d’un Putanat immense et tentaculaire. Or il n’y a pas une ombre de courage chez Enthoven, pas un seul centimètre de hardiesse, car il a fallu qu’il soit suffisamment installé dans le champ médiatique pour nous inonder maintenant de ses torrentielles hémorroïdes, ce qu’il n’aurait pas osé quand il était en train de pénétrer dans la carrière de l’imposture, tirant des ficelles qu’on lui a gracieusement tendues. Ce n’est ainsi que la récurrence médiatique d’Enthoven qui le légitime, ce n’est qu’un phénomène d’accoutumance qui le conforte dans son rang d’usurpateur, et ce n’est globalement que par un genre de saut journalistique (à défaut d’un véritable saut qualitatif) que cet amateur de gonflette intellectuelle colonise désormais le paysage de la culture. Au reste, sa présence cathodique maximale ne renvoie nullement à un effet maximal d’exhaussement des esprits, puisque, loin de rendre service au peuple, Raphaël Enthoven l’abaisse et le prépare à consommer dans la durée les éléments liquides de ses interminables coliques. Dans le fond, il n’y a pas plus poltron que ce fat, et telle une Cécile Coulon qui parle de prendre des risques là où toute la presse la plus conne de l’Histoire lui construit une autoroute de précautionneux charlatanisme, Raphaël Enthoven se prélasse dans les fantasmes du courage tout en étant harnaché d’une tonne de cordes et de mousquetons sur la microscopique façade des Éditions de l’Observatoire, ce muret de snobisme où gigotent par exemple Marylin Maeso et Dorian Astor, opportunistes avocats de notre Alain Robert du dimanche.
Il s’ensuit que Raphaël Enthoven a vraiment du culot lorsqu’il prétend échapper à toute espèce d’élitisme, usant et abusant, dans cette optique, de références populaires franchement intempestives et prévaricatrices (cf. pp. 231-9). Son toupet n’est pas moins ample lorsqu’il prétend aussi agir indépendamment des structures de quelque show-business répertorié au bulletin officiel d’un Putanat sélectif, ne serait-ce déjà que parce qu’il nous soumet ici, avec ce malodorant Temps gagné, une réelle société secrète de l’eucharistie anale où le pasteur qu’il incarne opère une impressionnante transsubstantiation de l’Esprit en matière fécale. Le ministre du culte Enthoven, promu par une autorité nécessairement occulte, ne s’adresse in fine qu’aux plus fervents initiés de la chose fécale – et accessoirement de la chose branlomaniaque. Ce n’est clairement pas le tout-venant de la populace qui est invité à tâter de ce messianisme suprême du transit intestinal, de cet éminent magistère de l’entre-olfaction canine du trou du cul, de cette métaphysique de caniches se reniflant minutieusement et assidûment le fondement. Pour être fondamentalement admis aux rituels fienteux du souverain pontife Enthoven, il est indispensable de posséder un haut degré de perversion et une aptitude à renverser la Croix, accessible seulement à une secte de dévots comblés de béatitude, à la frange d’une élite inversée qui met tout cul par-dessus tête et qui aménage le règne d’un Antéchrist des humanités. On comprend aisément que pour s’immiscer au sein de ces commémorations spécifiques, il faille être à tout le moins un zélateur du plus énorme mange-merde que la France ait jusqu’à présent porté. L’aristocratie de la branlette et du dépôt de pêche est à ce prix. Quel dommage, cependant, que Raphaël Enthoven n’ait pas pris l’initiative de se faire analyser par son beau-père Isi Beller – il se fût peut-être délivré du stade anal et de cette navrante sémantique du caca boudin matérialisée en vengeance infantile de cour de récréation !
Car tout est vulgairement, désespérément, cruellement infantile dans cette apocalyptique nullité du bon élève qui veut jouer au dur ou au génie et qui se retrouve systématiquement relégué à l’étage d’une poussive et embarrassante tentative de créativité, loin, si loin des titans littéraires sur lesquels il ne peut que disserter (parfois lourdement) en croyant qu’il appartient aux mêmes orbites d’enthousiasme. L’enseignement de la philosophie, pour Raphaël Enthoven, constitue déjà un mandat complexe et plutôt que de faire le malin à la télévision, en alternance entre trois formules creuses et deux assauts cacophoniques de Petit Brabançon, il ferait mieux de revenir à la source même de son métier et d’aller fortifier les âmes des lycéens. Il faut le redire inlassablement : Raphaël Enthoven, symboliquement parlant, n’a même pas les épaules assez larges pour endosser un pull de Tatiana de Rosnay ou un blazer tigré d’Alain Mabanckou, qui n’est pourtant qu’un James Baldwin pour hospice californien, ainsi, de là à se figurer qu’il puisse rivaliser avec un Proust, un Musset, un Camus ou n’importe quel autre mastodonte de notre divin panthéon des lettres, ce n’est bien sûr qu’une affaire d’analphabétisme, d’auto-persuasion pathologique ou de crapulerie éditoriale. Si Raphaël Enthoven est susceptible de donner le change avec un écrivain ou ce qui passe pour écrire, il ne peut le faire qu’avec les têtards susnommés, en l’occurrence les guignols qu’il a pris pour cible, les préposés à la faillite imaginative d’une grenouille qui s’est minablement projetée dans la robuste nature d’un bœuf Wagyu. De l’aveu même d’Enthoven, si son père Jean-Paul a besoin de dégobiller «cent sottises» pour atteindre «un aphorisme» (p. 328), on en conclura que le descendant, à n’en pas douter, a besoin de chier cent hectolitres de diarrhée pour aboutir à une platitude semi-aphoristique. On aurait pu ponctionner dans chaque page du Temps gagné une quantité de pièces à conviction pour étayer notre juste sévérité, mais on se borne
17/10/2020 | Lien permanent
Georges Molinié, prince des cacographes

 Je croyais avoir lu, en matière d'inepties verbales, de torcheculatives envolées post-grammaticales, de barbarismes mongolo-oulipiens, de zeugmatiques attelages de verbes à sémantisme vide, d'hypallageux truismes soupliniens, de métaphores synesthéphages d'une laideur diacritique, d'infatuesques et tudeux rudoiements de notre langue à bout de souffle et de coups, de sémiostylistiques épanchements de sinovie, je croyais donc avoir lu, en cette matière hélas aussi profonde que les océans de la planète Solaris (matière et planète autour desquelles, comme dans le roman de Lem, une véritable clique de spécialistes qui les étudient sans relâche orbitent), beaucoup de belles et bonnes choses, d'insignes réussites, par exemple sous les plumes badigeonnées de sottise diafoireuse de MM. Jacques Derrida, le singe savant que les douanes nord-américaines n'ont malheureusement pas mis en stricte quarantaine, Jean Bessière l'énigmatologue contrarié ou encore François Rastier le chercheur légèrement subventionné mais je dois reconnaître que jamais, jamais je n'ai eu la chance de lire un des somptueux ouvrages de Georges Molinié, ancien directeur de l'UFR de Langue française à l'Université de Paris-Sorbonne, éminent stylisticlinologue, émérite patricien de la sémantolophagie, roi des fonds où broutent quelques milliers d'étudiants et, très probablement, leurs professeurs, admirateurs discrets et sujets immodérés du prince des cacographes.Si l'on me demandait par quel miracle, aussi, j'ai pu contourner l'obstacle pourtant de belle taille que mes professeurs de classes préparatoires m'avait tendu avec malice, justement la lecture des ouvrages dudit Georges Molinié, spécialiste universellement connu de la catachrèse anapestifuge, je ne saurais quoi répondre. La chance sans doute, rien de plus, cet aveu m'en coûte puisqu'il ne suppose point, de ma part, quelque précoce capacité de résistance à la stupidité institutionnalisée. Il est vrai que, parvenant non sans mal à éviter, grâce à mon portulan personnel, l'amer que constituait la lecture du cuistre moliniesque, je ne pus toutefois qu'encalminer piteusement mon frêle esquif sur l'îlot clippertonien colonisé par plusieurs milliers de manchots que ma carte, dûment tenue à jour, répertoriait sous le nom de Genette-Soulevent. Je tombai donc de Molynide en Derryda pour sûr, Genette n'étant qu'une sous-épigraphe presque anodine d'un texte autrement complexe, bien que fou. De plus, absolument accaparé par la modeste tâche consistant à tenter de décortiquer, pour les soumettre à une saine analyse, les pelotes de déjection où je lis la destinée brumeuse de mes nains favoris tels que Todorov ou Kéchichian, je n'ai pu me résoudre à lire Molinié dont l'écriture infra-verbale, si je puis dire, m'a été mise sous les yeux (ou plutôt, ici, sous le nez) par René Pommier, agrégé des Lettres classiques, ancien élève de l'ENS, docteur d'État et professeur ayant enseigné vingt-deux années à Paris IV. D'habitude, les théories ronflantes de titres universitaires me font sourire mais, ma foi, je constate avec plaisir que l'empilement des diplômes n'est pas toujours le signe d'une profonde stupidité, d'une intelligence dévoyée seulement désireuse, sans doute pour se prouver qu'elle est de belle taille plutôt que de réel poids, d'aligner sagement les épreuves écrites comme autant de moutons qu'il s'agira d'enjamber les uns après les autres.Mes chers lecteurs, quelques spécimens dangereux du sabir moliniesque vous attendent derrière cette cage en titane. Le bon docteur Moreau n'y est pour rien je crois, mais il est bien vrai que ses descendants sont beaucoup plus discrets que lui, puisqu'ils vivent désormais au milieu de nous tous et non plus à l'abri des regards, fou expérimentant sur quelque île perdue.Je vous prie de ne point jeter à ces monstres hélas sexués des friandises, de peur que nos étranges créatures phocomèles (mais pourvues pourtant d'une gueule vorace et d'organes génitaux conséquents) ne se reproduisent inconsidérément.Nous les verrions alors peut-être se retourner contre leur créateur, le placide docteur Molinein, et poursuivre ce dernier sans relâche jusqu'au pôle Nord, où le froid extrême régnant dans cette région, espérons-le tout du moins, immobiliserait durant des siècles l'ardeur créative des uns et la docte stupidité de l'autre.
Je croyais avoir lu, en matière d'inepties verbales, de torcheculatives envolées post-grammaticales, de barbarismes mongolo-oulipiens, de zeugmatiques attelages de verbes à sémantisme vide, d'hypallageux truismes soupliniens, de métaphores synesthéphages d'une laideur diacritique, d'infatuesques et tudeux rudoiements de notre langue à bout de souffle et de coups, de sémiostylistiques épanchements de sinovie, je croyais donc avoir lu, en cette matière hélas aussi profonde que les océans de la planète Solaris (matière et planète autour desquelles, comme dans le roman de Lem, une véritable clique de spécialistes qui les étudient sans relâche orbitent), beaucoup de belles et bonnes choses, d'insignes réussites, par exemple sous les plumes badigeonnées de sottise diafoireuse de MM. Jacques Derrida, le singe savant que les douanes nord-américaines n'ont malheureusement pas mis en stricte quarantaine, Jean Bessière l'énigmatologue contrarié ou encore François Rastier le chercheur légèrement subventionné mais je dois reconnaître que jamais, jamais je n'ai eu la chance de lire un des somptueux ouvrages de Georges Molinié, ancien directeur de l'UFR de Langue française à l'Université de Paris-Sorbonne, éminent stylisticlinologue, émérite patricien de la sémantolophagie, roi des fonds où broutent quelques milliers d'étudiants et, très probablement, leurs professeurs, admirateurs discrets et sujets immodérés du prince des cacographes.Si l'on me demandait par quel miracle, aussi, j'ai pu contourner l'obstacle pourtant de belle taille que mes professeurs de classes préparatoires m'avait tendu avec malice, justement la lecture des ouvrages dudit Georges Molinié, spécialiste universellement connu de la catachrèse anapestifuge, je ne saurais quoi répondre. La chance sans doute, rien de plus, cet aveu m'en coûte puisqu'il ne suppose point, de ma part, quelque précoce capacité de résistance à la stupidité institutionnalisée. Il est vrai que, parvenant non sans mal à éviter, grâce à mon portulan personnel, l'amer que constituait la lecture du cuistre moliniesque, je ne pus toutefois qu'encalminer piteusement mon frêle esquif sur l'îlot clippertonien colonisé par plusieurs milliers de manchots que ma carte, dûment tenue à jour, répertoriait sous le nom de Genette-Soulevent. Je tombai donc de Molynide en Derryda pour sûr, Genette n'étant qu'une sous-épigraphe presque anodine d'un texte autrement complexe, bien que fou. De plus, absolument accaparé par la modeste tâche consistant à tenter de décortiquer, pour les soumettre à une saine analyse, les pelotes de déjection où je lis la destinée brumeuse de mes nains favoris tels que Todorov ou Kéchichian, je n'ai pu me résoudre à lire Molinié dont l'écriture infra-verbale, si je puis dire, m'a été mise sous les yeux (ou plutôt, ici, sous le nez) par René Pommier, agrégé des Lettres classiques, ancien élève de l'ENS, docteur d'État et professeur ayant enseigné vingt-deux années à Paris IV. D'habitude, les théories ronflantes de titres universitaires me font sourire mais, ma foi, je constate avec plaisir que l'empilement des diplômes n'est pas toujours le signe d'une profonde stupidité, d'une intelligence dévoyée seulement désireuse, sans doute pour se prouver qu'elle est de belle taille plutôt que de réel poids, d'aligner sagement les épreuves écrites comme autant de moutons qu'il s'agira d'enjamber les uns après les autres.Mes chers lecteurs, quelques spécimens dangereux du sabir moliniesque vous attendent derrière cette cage en titane. Le bon docteur Moreau n'y est pour rien je crois, mais il est bien vrai que ses descendants sont beaucoup plus discrets que lui, puisqu'ils vivent désormais au milieu de nous tous et non plus à l'abri des regards, fou expérimentant sur quelque île perdue.Je vous prie de ne point jeter à ces monstres hélas sexués des friandises, de peur que nos étranges créatures phocomèles (mais pourvues pourtant d'une gueule vorace et d'organes génitaux conséquents) ne se reproduisent inconsidérément.Nous les verrions alors peut-être se retourner contre leur créateur, le placide docteur Molinein, et poursuivre ce dernier sans relâche jusqu'au pôle Nord, où le froid extrême régnant dans cette région, espérons-le tout du moins, immobiliserait durant des siècles l'ardeur créative des uns et la docte stupidité de l'autre. Spécimen 1«Le narrateur dit au lecteur que la princesse de Clèves dit à son mari, M. de Clèves, que la reine Dauphine lui a dit (à elle la princesse) que le vidame de Chartres lui a dit (à elle la reine) que M. de Nemours lui a dit (à lui le vidame) qu'un ami lui a dit (à lui le duc) qu'une dame a dit à son mari (son histoire)», Georges Molinié et Alain Viala, Approches de la réception. Sémiostylistique et sociopoétique de la réception (PUF, 1993), pp. 79-81.
Spécimen 1«Le narrateur dit au lecteur que la princesse de Clèves dit à son mari, M. de Clèves, que la reine Dauphine lui a dit (à elle la princesse) que le vidame de Chartres lui a dit (à elle la reine) que M. de Nemours lui a dit (à lui le vidame) qu'un ami lui a dit (à lui le duc) qu'une dame a dit à son mari (son histoire)», Georges Molinié et Alain Viala, Approches de la réception. Sémiostylistique et sociopoétique de la réception (PUF, 1993), pp. 79-81. Spécimen 2«le stylème est appréhendé comme un caractérisème de littérarité, c'est-à-dire comme une détermination langagière fondamentalement non informative (même fictionnellement) dans le fonctionnement textuel», La Stylistique (PUF, coll. Que sais-je ?, 1989), p. 105.
Spécimen 2«le stylème est appréhendé comme un caractérisème de littérarité, c'est-à-dire comme une détermination langagière fondamentalement non informative (même fictionnellement) dans le fonctionnement textuel», La Stylistique (PUF, coll. Que sais-je ?, 1989), p. 105. Spécimen 3«On peut donc se livrer à un deuxième ratissage de la page, en quête de marques langagières se constituant peu à peu, par accumulation-augmentation-imbrication, à l'intérieur et au cours du tissu textuel concret en question», La Stylistique (PUF, coll. Premier Cycle, 1993), pp. 191-2.
Spécimen 3«On peut donc se livrer à un deuxième ratissage de la page, en quête de marques langagières se constituant peu à peu, par accumulation-augmentation-imbrication, à l'intérieur et au cours du tissu textuel concret en question», La Stylistique (PUF, coll. Premier Cycle, 1993), pp. 191-2. Spécimen 4«il convient d'associer à la considération, méthodologique, que la façon dont une discipline construit ses objets décide de l'interprétation qu'elle en tirera, la considération, épistémologique, qu'il y a distance, différence, entre l'objet et le concept, entre les formes empiriques et les constructions épistémiques», Approches de la réception (op. cit.), p. 2.
Spécimen 4«il convient d'associer à la considération, méthodologique, que la façon dont une discipline construit ses objets décide de l'interprétation qu'elle en tirera, la considération, épistémologique, qu'il y a distance, différence, entre l'objet et le concept, entre les formes empiriques et les constructions épistémiques», Approches de la réception (op. cit.), p. 2. Spécimen 5«car, justement, c'est plus il avance que le texte devient plus nettement lyrique», La Stylistique (op. cit.), p. 177.
Spécimen 5«car, justement, c'est plus il avance que le texte devient plus nettement lyrique», La Stylistique (op. cit.), p. 177. Spécimen 6 ou prince des monstres«L'environnement interdit une analyse selon la saisie 1 (S1), qui impliquerait ici un simple niveau I, difficile à concilier avec l'extrême focalisation introspective du narré : en revanche, cette saisie 1 (S1) serait parfaitement interprétative, avec un actant émetteur de type JE (récit à la première personne) : ce qui n'est matériellement pas le cas. Mais il ne faudra pas oublier ce sentiment (ou ce fantôme de sentiment) du lecteur. La saisie 2 (S2) est, paradoxalement, plus évidemment exclue encore : elle impliquerait une distanciation analytique très forte des héroïnes, bien difficile à admettre en l'occurrence, sans artifice de lecture assez violent. Et le modèle de la saisie 3 (S3) ? Elle permet [...] toutes les intégrations-fusions imaginables, ce qui est effectivement exigé dans cette phrase. Mais justement, l'intégration-fusion semble ici excessive : trop lisse, trop belle, et, finalement, comme se donnant presque elle-même en objet de discours. À l'intérieur de cette fusion, s'instaure comme une distanciation qui souligne à tout le moins, la manipulation d'une instance émettrice par l'autre instance (celle du niveau inférieur) : la saisie 3 (S3) ne suffit plus. Il faut pouvoir rendre compte de la fusion actantielle du type de la saisie 3 (S3), de l'impression que le narrateur (actant émetteur de niveau I, quelle que soit la stratification interne du I) est d'une certaine façon partie prenante de l'histoire racontée, et aussi de l'extériorité stylisée qui marque ce narré; ce dernier trait peut se gloser en disant que l'objet du récit est alors qu'une histoire est racontée. C'est tout ce mixte qu'il s'agit d'expliciter», Approches de la réception (op. cit.), pp. 82-3.À titre purement informatif, rappelons que le texte ayant généré ce commentaire est le suivant : «Elles aimaient bien tremper leur lèvre supérieure dans la coupe légère, et sentir le pétillement des bulles qui piquait à l'intérieur de leur bouche et leurs narines», Le Clézio, La Grande vie.Sources des illustrations :Spécimen 1 : Aldrovandi, Ulysse (et Ambrosino, Bartholomeo), Monstrorum historia cum paralipomenis historiae omnium animalium Bartholomaeus Ambrosinus (Bologne, N. Tebaldin, 1642, cote BIUM 881).Spécimen 2 : Boaistuau, Pierre, Histoires prodigieuses (Paris, 1566, cote BIUM 42.194).Spécimen 3 : Liceti, Fortunio, De monstrorum caussis, natura et differentiis libri duo (Padoue, P. Frambotti, 1634, cote BIUM 6.964).Spécimen 4 : Rüff (ou Rueff), Jacob, De conceptu et generatione hominis, de matrice et ejus partibus, nec non de conditione infantis in utero... (Francfort sur le Main, 1587, cote BIUM 71.560).Spécimen 5 : Schenck, Johann Georg, Monstrorum Historia memorabilis, monstrosa humanorum partuum miracula, stupendis conformationum formulis ab utero materno errata, vivis exemplis, observationibus et picturis referens (Francofurti, 1609, ex officina typographico Matthiae Beckeri, impensis viduae Theodori de Bry, et duorum eius filiorum, cote BIUM 72.438).Spécimen 6 : Paré, Ambroise, Vingt cinquième livre traitant des monstres et prodiges, Œuvres (Paris, G. Buon, 1585, cote BIUM 1.709).
Spécimen 6 ou prince des monstres«L'environnement interdit une analyse selon la saisie 1 (S1), qui impliquerait ici un simple niveau I, difficile à concilier avec l'extrême focalisation introspective du narré : en revanche, cette saisie 1 (S1) serait parfaitement interprétative, avec un actant émetteur de type JE (récit à la première personne) : ce qui n'est matériellement pas le cas. Mais il ne faudra pas oublier ce sentiment (ou ce fantôme de sentiment) du lecteur. La saisie 2 (S2) est, paradoxalement, plus évidemment exclue encore : elle impliquerait une distanciation analytique très forte des héroïnes, bien difficile à admettre en l'occurrence, sans artifice de lecture assez violent. Et le modèle de la saisie 3 (S3) ? Elle permet [...] toutes les intégrations-fusions imaginables, ce qui est effectivement exigé dans cette phrase. Mais justement, l'intégration-fusion semble ici excessive : trop lisse, trop belle, et, finalement, comme se donnant presque elle-même en objet de discours. À l'intérieur de cette fusion, s'instaure comme une distanciation qui souligne à tout le moins, la manipulation d'une instance émettrice par l'autre instance (celle du niveau inférieur) : la saisie 3 (S3) ne suffit plus. Il faut pouvoir rendre compte de la fusion actantielle du type de la saisie 3 (S3), de l'impression que le narrateur (actant émetteur de niveau I, quelle que soit la stratification interne du I) est d'une certaine façon partie prenante de l'histoire racontée, et aussi de l'extériorité stylisée qui marque ce narré; ce dernier trait peut se gloser en disant que l'objet du récit est alors qu'une histoire est racontée. C'est tout ce mixte qu'il s'agit d'expliciter», Approches de la réception (op. cit.), pp. 82-3.À titre purement informatif, rappelons que le texte ayant généré ce commentaire est le suivant : «Elles aimaient bien tremper leur lèvre supérieure dans la coupe légère, et sentir le pétillement des bulles qui piquait à l'intérieur de leur bouche et leurs narines», Le Clézio, La Grande vie.Sources des illustrations :Spécimen 1 : Aldrovandi, Ulysse (et Ambrosino, Bartholomeo), Monstrorum historia cum paralipomenis historiae omnium animalium Bartholomaeus Ambrosinus (Bologne, N. Tebaldin, 1642, cote BIUM 881).Spécimen 2 : Boaistuau, Pierre, Histoires prodigieuses (Paris, 1566, cote BIUM 42.194).Spécimen 3 : Liceti, Fortunio, De monstrorum caussis, natura et differentiis libri duo (Padoue, P. Frambotti, 1634, cote BIUM 6.964).Spécimen 4 : Rüff (ou Rueff), Jacob, De conceptu et generatione hominis, de matrice et ejus partibus, nec non de conditione infantis in utero... (Francfort sur le Main, 1587, cote BIUM 71.560).Spécimen 5 : Schenck, Johann Georg, Monstrorum Historia memorabilis, monstrosa humanorum partuum miracula, stupendis conformationum formulis ab utero materno errata, vivis exemplis, observationibus et picturis referens (Francofurti, 1609, ex officina typographico Matthiae Beckeri, impensis viduae Theodori de Bry, et duorum eius filiorum, cote BIUM 72.438).Spécimen 6 : Paré, Ambroise, Vingt cinquième livre traitant des monstres et prodiges, Œuvres (Paris, G. Buon, 1585, cote BIUM 1.709).
05/09/2007 | Lien permanent
Petit traité des vertus réactionnaires d'Olivier Bardolle

 À propos d'Olivier Bardolle, Petit traité des vertus réactionnaires (L’Éditeur, coll. Idées et Controverses, 2010).
À propos d'Olivier Bardolle, Petit traité des vertus réactionnaires (L’Éditeur, coll. Idées et Controverses, 2010).04/01/2011 | Lien permanent
Ce qu’on doit à Frédéric Bastiat, par Roman Bernard

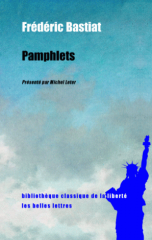 À propos de Pamphlets de Frédéric Bastiat paru aux éditions Les Belles Lettres, 2009, coll Bibliothèque classique de la liberté dirigée par Alain Laurent.
À propos de Pamphlets de Frédéric Bastiat paru aux éditions Les Belles Lettres, 2009, coll Bibliothèque classique de la liberté dirigée par Alain Laurent.11/02/2010 | Lien permanent | Commentaires (45)
Lumineux Gustave Thibon

 Judas en serial killer, Gustave Thibon en vieille fille.
Judas en serial killer, Gustave Thibon en vieille fille. De Gaulle contre Maurras. À propos d'un ouvrage de Philippe Barthelet critiqué par Alain Santacreu.
De Gaulle contre Maurras. À propos d'un ouvrage de Philippe Barthelet critiqué par Alain Santacreu. Quelques lectures du stalker. Entretien Laurent Schang/Philippe Barthelet à propos de Gustave Thibon.
Quelques lectures du stalker. Entretien Laurent Schang/Philippe Barthelet à propos de Gustave Thibon.L’évidence est une joie lumineuse : paraphrasant la sentence de César que cite Gustave Thibon, «Humanum paucis vivit genus», nous pourrions écrire de celle-ci qu’elle aussi trouve sa nourriture dans le génie de quelques hommes qui, comme l’auteur de L’Ignorance étoilée, ont su atteindre les profondeurs par l’ascèse d’une écriture dépouillée de toute afféterie. Les lecteurs de Thibon savent ainsi de quelle impeccable maîtrise, d’une maîtrise que nous pourrions dire «classique» si ce terme n’avait été trop abusivement utilisé, sa langue pare la fulgurance aphoristique, apprise à la rude école de Simone Weil et de Nietzsche. À leur tour, ces entretiens (1) que Philippe Barthelet a intelligemment proposés à Thibon témoignent parfaitement de cette qualité intrinsèque de l’écriture de ce penseur encore méconnu, digne de l’inquiétude philosophique et spirituelle d’un Gabriel Marcel, auquel la simplicité apparente de sa prose, d’ailleurs, renvoie plus d’une fois. Chez ces deux, une sorte d’amour, de philosophie du concret, des petites choses dans lesquelles Walter Benjamin lisait l’infini, ne se dépare jamais d’un regard poétique qui creuse au plus profond. Simplicité et joie de la beauté, de Dieu, des grandes amitiés, des lectures bien faites. Hugo par exemple, ce grand nom de la poésie française mal aimé et réduit, selon l’auteur de L’Illusion féconde, à trop de clichés, paraissant à la fois être l’ami avec qui on ne cesse de dialoguer et celui qu’on ne se lasse pas de lire. Ainsi Thibon, ayant faite sienne la vertu métaphysique du «par cœur», connaît-il impeccablement des pages entières du poète de La fin de Satan, l’un des recueils justement loués : cette connaissance intime de la littérature par la répétition aimante, une espèce d’habitus du cœur, constitue un vivier inépuisable, une forêt mystérieuse et giboyeuse, toujours à découvrir, où les proies sont nombreuses, au contraire des quelques fantômes que les petits messieurs de la déconstruction s’amusent à désosser comiquement. Celui qui nourrit une pareille dilection pour la chose écrite, allant jusqu’à l’incorporer à sa plus intime substance, à sa chair et son esprit devenus lettres vives, ne peut certes pécher par orgueil. Il y a ainsi, chez Thibon, une humilité pleine de sagesse, apprise au contact de la terre comme à la lecture des Géorgiques de Virgile.
L’adret de Thibon est lumière sereine, celle que découvrit sans nul doute un Jünger, retour de ses chasses subtiles, la parole intime des êtres lilliputiens résonnant dans son cœur et son esprit. Thibon lui aussi se plaît à déchiffrer le langage des choses et des êtres, soumis à la rivalité sans merci d’une technique devenue folle. L’ubac de l’auteur est donc parsemé d’inquiétude. Son regard, lorsqu’il se lance à l’assaut du redoutable colosse d’acier et de verre moderne, vacille sous la menace de ce qui risque de nous submerger. Précisons tout de suite que Thibon, jamais, à la différence d’un Günther Anders qui pouvait intituler l’un de ses textes d’un titre programmatique, Je suis désespéré et que voulez-vous que j’y fasse ?, jamais ne semble succomber à cette maladie moderne qu’est le désespoir, septicémie des lâches mais aussi scorbut des plus courageux qui s’amputent ainsi de leurs forces.
Ainsi, la première colère de l’auteur n’est jamais pure réaction puisque, pour trouver son élan et ne pas risquer de piteusement caler, cette ire s’appuie sur une immense culture, une «fidélité à l’éternel» : «Au lieu que maintenant on a cette chance merveilleuse de pouvoir être anticonformiste vis-à-vis de l’époque par fidélité à l’éternel. Une chance qui ne sera sans doute saisie que par un petit nombre. Mais ce petit nombre tiendra tout entre ses mains…» (p. 216). Cette chance est l’une des dernières qu’il nous est donnée de ravir. Et d’abord, il s’agit de la saisir afin de retrouver la Nature, non pas à la mode écologiste actuelle, cette congère idéologique qui nous sert quelques feuilles de salade mal assaisonnées, mais afin de tenter d’en briser le charme qui, par notre faute, continue un peu plus d’alourdir cette rieuse éternelle : «L’homme a tellement dominé la nature qu’elle lui obéit passivement, comme une esclave – mais elle ne lui confie plus ses secrets, comme ferait une amante» (p. 50). La métaphore est instructive. Ce retour à la Nature serait donc comme une espèce d’intime co-naissance, selon l’expression de Claudel tellement rabotée par l’usage universitaire, un effort tendu à l’extrême pour la retrouver, elle qui demeure, presque sans voix, derrière le miroir énigmatique depuis que nous l’avons entraînée dans notre perte, notre dérobade à la Parole nous enjoignant de nous montrer ayant signé notre faiblesse. C’est dire que nous voyons la Création en énigme, comme au travers d’un miroir selon le troublant constat paulinien (2).
Tenter ce retour, en mimer, au moins, la progression confiante, c’est, à n’en pas douter, retrouver également la figure du Christ, ce nouvel Adam qui sut accomplir par son verbe l’antique profération édénique, redonner un nom aux êtres et aux choses qui l’avaient perdu. Revenir à la Nature, écouter son cœur secret, c’est, comme Bernanos parlant du visage du Christ qui affleurait sous nos traits, pourvu que nous osions creuser, retrouver celui que les vieux mages appelaient le Roi, Inri : Igne Natura Renovatur Integra, comme le savait Héraclite l’Obscur bien avant que ne naisse le fils de Dieu.
Ainsi Thibon n’a-t-il de cesse de pourfendre la masse inutile d’airain venue, au fil des siècles, recouvrir la force vive de la Parole : «Il nous reste à tout retrouver, tout ce qui a été perdu – retrouver en particulier le Christ en agonie sous tous les Christs triomphants que nous a peinturlurés une religion réduite à une morale, et une morale réduite elle-même à quelques pratiques tout extérieures…» (p. 219). On se doute qu’une telle charge, si elle était lue par ceux à qui elle s’adresse, nommons-les : l’immense majorité de nos prêtres qui, en effet, ont réduit le scandale de la foi à une pratique poussive de demi-mesures, aurait quelque mal à ne pas les ébranler. Du reste, ce commandement, ce retour aux sources de la Parole n’est rien de plus que l’éternelle exigence de ceux qui, fous aux yeux du monde, ont espéré retrouver le feu ardent sous l’épaisse croûte de cendres et de scories, un Kierkegaard, un Lequier, un Hello, un Bloy, un Gadenne encore.
C’est ce mouvement qui façonne la tension si particulière de la prose de Thibon, à la fois familière, presque timide et forte dans sa description de la banalité moderne, parfois de sa véritable nullité ontologique, mais aussi tendue comme une proue vers la certitude qu’une fois, par le Christ, la réponse nous a été donnée, qui nous attend impatiemment. Entre ce présent que ne célèbre aucune joie (3) et la volonté de trouver la source rayonnante, ce passé lumineux qui infuse notre avenir (mais aussi notre présent, seulement pour qui sait voir sous les apparences), trouve sa place, que nous pourrions nommer aorasique (4), la prose de Thibon. Remercions Philippe Barthelet, qui naguère affirmait que l’écrivain authentique, toujours, était dressé face au Serpent de mer (5), de nous avoir fait écouter une dernière fois, avant qu’elle ne s’éteigne, la patiente ivresse de la voix de Gustave Thibon.
Notes
(1) Entretiens avec Gustave Thibon de Philippe Barthelet, éditions du Rocher, 2001. Toutes les références entre parenthèses renvoient à cette édition.
(2) «Signe assez grave de notre croissante opacification : le monde sensible est un voile, et ce voile a cessé d’être transparent. Et comme toute chose vaut beaucoup mieux par sa transparence que par son opacité, son être même étant opaque, le monde réduit à lui-même (qui est le monde moderne) se réduit en fait, malgré les apparences et sa présomption, à presque rien…», p. 141.
(3) Comme l’auteur le dit dans son Illusion féconde (Fayard, 1995), p. 91 : «Ce qui me révulse le plus dans notre époque, c'est ce mélange nauséabond de licence et de circonspection. Tout est permis à condition que rien ne fasse mal ou n'engage une responsabilité. Liberté sexuelle, mais assortie du préservatif, de la pilule, de l'avortement. La prophylaxie tenant lieu de morale, le péché aseptisé…».
(4) Que définit ainsi bellement l’auteur (pp. 90-91) : «on ne peut être qu’ivre du vin perdu, on ne connaît les choses dans leur profondeur qu’au moment de les perdre – ce que les Grecs appelaient aorasie».
(5) «Si l’on voit dans le serpent de mer une figure de l’esprit du temps, la scène m’est apparue comme une allégorie assez parlante de ce que devrait être l’office de celui qui veut penser ou écrire. Que le serpent de mer se torde et écume, laissons-le faire, c’est là son métier», in Les Aventuriers de l’esprit, entretiens réalisés et présentés par Olivier Germain-Thomas (Éditions de la Manufacture, 1991), p. 145.
06/09/2009 | Lien permanent
Entretien avec Serge Rivron, 4

10/09/2008 | Lien permanent

























































