« Impasse phénoménologique ? Sur L’Histoire d’une vie et sa région sauvage de L. Tengelyi, par F. Moury | Page d'accueil | Les voies du Stalker, 4 : Fabrice Trochet pour Un grain de sable »
22/06/2006
Albert Londres : un débat occulté sur un mythe à déconstruire, par Jean-Pierre Tailleur

Crédits photographiques : Lintao Zhang (Getty Images).
Voici un nouveau texte consacré à l'inénarrable Pierre Assouline, signé par mon ami Jean-Pierre Tailleur, auteur de l'ouvrage Bévues de presse. De Jean-Pierre Tailleur, la Zone a publié une série de textes consacrés au maljournalisme, au Prix Albert Londres évoqué plus bas ou encore au livre d'Yves Agnès, Le grand bazar de l'info.
Le prix Albert Londres 2006 vient d’être décerné à la journaliste correspondante en Iran du Figaro (cf. plus bas). Une fois de plus, ses reportages ne semblent pas être des modèles du genre, à cause de leurs indulgences à l’égard du régime islamiste. Cela mérite un retour sur le mythe du «grand reporter» du début du XXe siècle, tel que l’a entretenu son biographe le plus médiatisé, Pierre Assouline.
«Au début de 1917, [Albert Londres] écrit un superbe article sur un sujet des plus énigmatiques : l'équipée de deux cents poilus de l'armée d'Orient chez les six mille moines du mont Athos [en Grèce]», raconte Pierre Assouline dans sa biographie du reporter dont le nom est supposé être synonyme de... grand journalisme. «Un morceau d'anthologie dans lequel il n'y a pas une ligne pour révéler au lecteur la raison de cette escapade...» (1).
L’article en question, paru dans Le Petit Journal en février 1917, est assez consternant tant sur le plan littéraire que journalistique. Les poilus (moines et militaires) cités sont tous anonymes, et le récit de leur rencontre est tout aussi impressionniste. Une phrase centrale de ces quatre feuillets illustre le manque de rigueur et d’exigence dudit grand reporter mythique : «La raison [de l’équipée], je crois bien, doit encore être une de ces choses que l'on ne peut pas dire, et je ne le dirai pas, pour cela d'abord et ensuite parce que c'est sans aucune importance pour l'histoire que je vous raconte, vu que l'histoire que je vous raconte n'est que l'occupation d'une terre par des poilus et que jamais poilu n'a su pourquoi il occupait ce qu'il occupait.» (2)
C’est mal rédigé, c’est avare d’informations, c’est cul-cul-la-praline même, et c’est pourtant tiré d’un article présenté comme un modèle de journalisme par son distingué biographe. Pierre Assouline note certes que le récit de cette escapade de soldats français au mont Athos est incomplet mais il le présente pourtant comme un «morceau d’anthologie». Plus loin, il ajoute que Londres ne s’est pas contenté de faire du reportage en Grèce : le correspondant du Petit parisien aurait également organisé un attentat (finalement non exécuté) contre un général anglais qui ne servait pas les intérêts de la France. Mais cela ne suffit pas à l’ancien chroniqueur de France Culture pour faire descendre son modèle de son piédestal.
On ne peut pas reprocher à Assouline d’avoir occulté les faces peu honorables du passé professionnel de Londres. Sa biographie raconte également comment il entraîna avec lui un autre grand reporter du début du XXe siècle, son camarade Édouard Helsey, dans des démarches plus que douteuses. Il exerça des pressions sur le Quai d’Orsay, en effet, afin que des fonds secrets du ministère des Affaires étrangères leur financent un déplacement en Russie bolchevique. «Il propose rien moins que recruter des hommes de main afin de lancer des attentats contre les nouveaux dirigeants jugés les plus dangereux [Lénine et Trotski notamment], ou pour commettre des sabotages», écrit Assouline. «Helsey est effrayé. Albert Londres est allé […] beaucoup trop loin. On le sent, on le sait prêt à tout. Il semble ignorer les limites et les points de non-retour. Ce n’est même plus une question de déontologie, ils n’en sont plus là à ce stade de leur coupable entreprise. Il s’agit de morale».
De tels commentaires n’ont pas suffi à déconstruire le mythe artificiellement entretenu d’Albert Londres. Son biographe ne contourne pas les défauts du personnage, mais il les minimise dans un flot d’anecdotes ou les transforme en qualités. «Sous sa plume, nombre de pays semblent des contrées grotesques dirigées par autant d’Ubu-roi. Il est définitivement plus journaliste d’humeur que d’analyse. Il n’explique pas, il montre. Ne démontre pas mais raconte. C’est sa force» explique Assouline. «Londres a un grand souci du rythme général, de la composition d’ensemble, de l’attaque, de la chute, des effets secondaires, et surtout de l’ellipse. Rien n’est chez lui écrit au hasard. Tout est pesé. Littérairement et poétiquement s’entend, car l’exactitude historique et politique paraissent secondaires.»
Assouline reconnaît qu’il manquait à son héros une qualité essentielle pour les journalistes, la précision. Mais selon lui, Londres avait «un sens aigu de l’ellipse, du paradoxe et du raccourci dans le seul but de gagner en impact». Il abusait des dialogues reconstitués, «qui sont souvent le sel de ses articles», donnant aussi l’impression de rencontrer beaucoup de monde ? Sur ce point non plus, le biographe et ses lecteurs ne semblent pas avoir été vraiment choqués.
L’indulgence d’Assouline à l’égard de son sous-ecrivain et sous-journaliste mué en modèle par la presse française, est particulièrement frappante quand il revient sur le particulièrement «londrissime» reportage intitulé Les chemins de Buenos Aires. Durant cette enquête sur les prostituées françaises en Argentine, Assouline explique que «le redresseur de torts n’est pas venu respirer l’air du Río de la Plata mais travailler intensément […] à un reportage qui surprendra. Contre toute attente, il se lance dans une défense et illustration de la prostituée, assortie de grandeur et servitude du proxénète… Une double réhabilitation, qui ne laisse pas de surprendre au prime abord».
À Buenos Aires, notre grand reporter modèle ignore les Argentins, explique le biographe, car «il les déteste et les présente comme de tristes sires entièrement voués au culte de l’argent […]. D’après son enquête, elles se divisent en deux catégories : les malheureuses, qui représentent 80% de cette population, et les vicieuses qui font le reste. Ses chiffres ne viennent pas d’un Institut de sondages, de statistiques ou de démographie mais de son petit calepin. L’intime conviction basée sur l’observation personnelle, élevée au niveau de science. Autrement dit, pour parler comme lui, le pifomètre.» Assouline ajoute que selon Londres, «le Milieu c’est l’Armée du Salut. Sans lui les filles seraient toujours à la rue, mais sans défense, sans ami, sans protection. En un mot : sans amour».
Un tel constat aurait dû provoquer des débats au moment de la parution de cette biographie, mais il n’en fut rien. L’alchimie assoulinienne, consistant à transformer des pratiques journalistiques plus que douteuses en trésors d’enquêtes, a bien fonctionné avec la complicité de ses confrères. «À la lecture de son Chemin de Buenos Aires, on hésite entre divers sentiments : la révolte, la nausée, l’incrédulité, le fou rire… À partir des matériaux qu’il rapporte d’Argentine, le lecteur peut se faire une idée et aboutir a des conclusions tout a fait opposées, ce qui est peut-être le secret d’un reportage réussi.»
Les éloges et l’indulgence d’Assouline à l’égard d’un journaliste qui a réalisé des enquêtes approximatives, marquées par des conflits l’intérêt, ne sont pas isolés. Le Prix Albert Londres, décerné pour des articles généralement produits hors de France eux aussi, perpétue tous les printemps le mythe du journaliste modèle et voyageur. Jusque dans les écoles de journalisme et à l’instar des enlèvements surmédiatisés de correspondants français en Irak, cette légende permet de cultiver une illusion de grandeur d’une profession bien plus précaire que puissante ou exotique. Dans le même contexte culturel, certains lauréats qui ont commis des fautes professionnelles prouvées, continuent de bénéficier du label Albert Londres. On peut s’étonner de l’absence absolue de débat, dans la profession, au sujet de la qualité des travaux couronnés tous les ans. La cuvée 2006 du Londres en a d'ailleurs offert une récente illustration, le prix Journalisme écrit ayant été décerné à la journaliste Delphine Minoui, correspondante du Figaro en Iran. Ses articles ont beau être fortement contestés par certains Iraniens, qui lui reprochent son excès de complaisance à l’égard du régime des Ayatollahs, la question n’est pas discutée dans les médias français. Etant trop dérangeante pour des journaux timorés et corporatistes, elle sort de leurs couvertures radar.
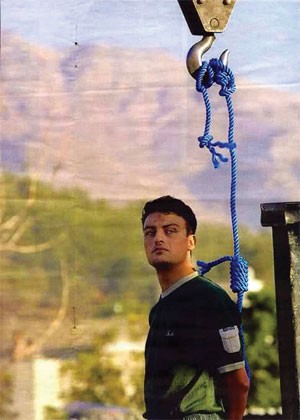
Il y a un lien entre la déconstruction insuffisante de ce mythe et la vulnérabilité relative de la presse française. Celle-ci ne peut pas prétendre constituer un véritable quatrième pouvoir, en effet, si elle ne revient pas clairement sur ses fautes et ses faiblesses, à commencer par celles de son prétendu modèle. Quitte à reconnaître l’intérêt de certains reportages de Londres, notamment son récit – aux dimensions si actuelles – sur les juifs d’Europe centrale et de Palestine il y a 80 ans.
Notes
(1) Pierre Assouline, Albert Londres, vie et mort d'un grand reporter (Balland, 1989, repris par Gallimard dans la collection Folio).
(2) Dans Câbles et reportages, une anthologie d’articles d’Albert Londres (éditions Arléa, 1993).




























































 Imprimer
Imprimer