« Le réalisme critique de Schlick, par Francis Moury | Page d'accueil | Infréquentables »
22/11/2010
De si jolis chevaux de Cormac McCarthy

Crédits photographiques : Paul Taggart, Herd in Iceland.
 Cormac McCarthy dans la Zone.
Cormac McCarthy dans la Zone.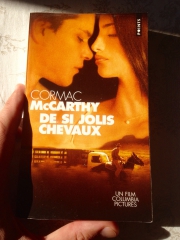 Acheter De si jolis chevaux sur Amazon.
Acheter De si jolis chevaux sur Amazon.Premier volume de La trilogie des confins, De si jolis chevaux publié en 1992, semble, par son décor, la suite logique, mais épurée, beaucoup moins violente à l'évidence, du roman fascinant, grouillant de mille larves, hanté par la présence du maléfique juge Holden, qu'est Méridien de sang.
S'amorce aussi, après le labyrinthique Suttree, la recherche du minimalisme, la quête de l'épure stylistique, l'écrivain privilégiant ainsi les phrases réduites à leur plus fine nervure, chacun des os du squelette relié à celui qui le précède et à celui qui le suit par une simple conjonction de coordination (une accumulation de et), quête et recherche encore de descriptions sommairement plantées au moyen d'un verbe de sémantisme vide (comme il y avait), de la sécheresse des dialogues qui culminera dans Non, ce pays n'est pas pour les vieux hommes et, bien sûr, le chef-d'œuvre de la maturité de Cormac McCarthy, La Route.
L'histoire elle-même est d'une banalité revendiquée, qui met en scène deux personnages errants, une constante s'il en est de l'imagination romanesque de McCarthy. Deux jeunes hommes, John Grady Cole et Lacey Rawlins, quittent leur Texas natal et décident d'aller au Mexique, où ils seront emprisonnés, battus, menacés d'être tués. Tous deux reviendront chez eux mais John Grady Cole, lui, pour immédiatement repartir, hanté par le souvenir de la très belle Alejandra qui l'aime mais a renoncé à le voir, hanté aussi par l'immensité des paysages qu'il a traversés, hanté par l'âme des chevaux qu'il connaît et comprend comme nul autre, hanté, enfin, par le meurtre qu'il a dû commettre pour se sauver de la lame d'un cuchillero et par le meurtre du jeune adolescent Blevins (que l'on dirait le frère de l'Harrogate de Suttree), qui sera froidement exécuté par des policiers mexicains.
Hommes frustres, paysages avares, pulvérulents, chevaux sauvages ou bien dressés, chevaux sauvages qu'il faut débourrer pour qu'ils acceptent de porter les hommes et, les portant, partagent quelques-uns de leurs craintifs secrets. Cormac McCarthy, après William Faulkner, est sans doute l'un des écrivains qui a évoqué les chevaux de la plus remarquable des façons.
En voici un premier exemple, en ouverture, quasiment, du roman, où se lit la juxtaposition de membres de phrases que j'évoquais, comme si la langue de McCarthy voulait elle-même mimer la furieuse cavalcade des hommes et des bêtes : «Quand le vent était au nord on pouvait les entendre, les chevaux et l’haleine des chevaux et les sabots des chevaux chaussés de cuir brut et le cliquetis des lances et le frottement continuel des barres des travois dans le sable comme le passage d’un énorme serpent et sur les chevaux sauvages les jeunes garçons tout nus folâtres comme des écuyers de cirque et poussant devant eux des chevaux sauvages et les chiens trottinant la langue pendante et la piétaille des esclaves suivant demi-nue derrière eux et cruellement chargée et la sourde mélopée sur tout cela de leurs chants de route que les cavaliers psalmodiaient en chemin, nation et fantôme de nation passant au son d’un vague cantique à travers ce désert minéral pour disparaître dans l’obscurité portant comme un graal étrangère à toute histoire et à tout souvenir la somme de ses vies à la fois séculaires et violentes et transitoires» (1).
L'histoire des chevaux et celle des hommes sont indissociablement liées, c'est peut-être l'une des dimensions les plus évidentes de notre roman. Histoire paradoxale puisque le cheval, plus ancien que l'homme, connaît des secrets que l'homme a oubliés et que, parfois, il retrouve lorsqu'il rêve (2). Mais qu'est-ce qu'un cheval sauvage, qui n'a point dû reconnaître la rude et aimante main de son maître et même, de son créateur qui, John Grady en aura la profonde surprise, peut respirer au même rythme intime que sa monture ? Dans un extraordinaire passage, Cormac McCarthy, endossant, ce qu'il ne fait qu'une seule fois, la première personne du singulier de son personnage favori (John Grady Cole) mais surtout, peut-être, celle du romancier en tant que créateur absolu, s'adresse directement aux chevaux : «Sans la charité de ces mains tu ne peux rien avoir. Ni nourriture ni eau ni descendants. C’est moi qui amène les juments des montagnes, les jeunes juments, les juments sauvages et ardentes. Tandis que sous la voûte des côtes entre ses genoux battait par la volonté de qui le cœur enveloppé de viande violette et palpitait le sang et bougeaient par la volonté de qui les entrailles dans leurs massives circonvolutions bleues et se tendaient et ployaient se tendaient et ployaient sur leurs articulations par la volonté de qui les os puissants des cuisses et le genou et le canon et les tendons semblables à des haussières de chanvre et tout cela capitonné et noyé dans la chair avec les sabots creusant des puits dans la brume matinale collée au sol et la tête qui tournait d’un côté puis de l’autre et le large l’écumant clavier de ses dents et les globes brûlants de ses yeux où flambait le monde» (p. 147).
Beauté des chevaux qui portent les hommes vers la ruine ou bien la réalisation de leurs désirs, beauté du monde qui les porte, ces chevaux et ces hommes, et qui n'est peut-être, ce monde, que la forme solide, immobile apparemment mais en réalité frémissante du désir de s'enfuir, de la vitesse et de la grâce chevalines. Un rêve, de nouveau : «Cette nuit-là il rêva de chevaux […] et ils couraient lui et les chevaux le long des hauts plateaux où le sol grondait sous leurs rapides sabots et ils déferlaient et tournaient et couraient et leurs crinières et leurs queues flottaient autour d’eux comme de l’écume et il n’y avait rien d’autre en ce monde d’en haut et tous tant qu’ils étaient ils se déplaçaient dans une résonance qui était entre eux comme une musique et nul parmi eux cheval poulain ou jument ne connaissait la peur et ils passaient au galop dans cette résonance qui est le monde lui-même et qui ne peut être dite mais seulement célébrée» (p. 184).
Beauté de la nuit (3), des éléments qui se déchaînent, décrits au moyen d'images saisissantes (4) tout entières ordonnées par la seule volonté de l'homme qui est, selon McCarthy, de saluer l'univers grandiose et terrible. Cormac McCarthy est bien, avec Robert Penn Warren, l'un des derniers grands aèdes de notre époque si ce n'est le dernier d'une telle puissance, lui qui ne craint pas de placer l'homme au centre d'une création qui, sans sa présence, serait probablement tout aussi belle (comment le savoir ?) mais radicalement inhumaine, froide, morte, triste peut-être comme l'affirma Walter Benjamin, sans voix, sans visage.
La voix du monde, sa prose, ont toutes deux besoin du regard de l'homme qui est déjà réflexion, et mots de la pensée qui agence subtilement ce qui est vu, ce qui est au-delà même de la vision, gouffre sans fond où le regard tombe infiniment. Tout ce qui est vu peut être vu, tout ce qui est vu appartient au domaine du visible, l'invisible n'existe donc pas, il n'est point d'au-delà de notre vision et ce qui ne peut être vu n'existe donc tout simplement pas, comme semble nous le suggérer McCarthy. Ainsi, quelle image étonnante tout de même, qui retrouve quelque peu de l'intuition phénoménologique géniale exprimée par Husserl dans La Terre ne se meut pas : «Le feu n’était plus qu’un tas de braises et il était allongé et contemplait les étoiles à la place qui leur était assignée et l’ardente ceinture de matière fusant là-haut sur l’arc de l’obscure voûte et il posa les mains sur le sol de chaque côté de lui et les pressa contre la terre et dans ce baldaquin de noir brûlant sans chaleur il tournait lentement au plein centre du monde qui était là tout entier tendu et frémissant et qui bougeait, énorme chose vivante sous ses mains» (p. 137).
Il n'est dès lors pas étonnant que, figure de proue attachée à un immense navire fendant le vide, ce soit l'homme qui conduise sa course folle, alors même que les plus grands romans de McCarthy ont à cœur de dépeindre des personnages aux prises avec l'hostilité d'une nature sauvage ou redevenue complètement sauvage. En fait, tout se passe comme si le monde n'était rien sans sa plus magnifique création, l'homme, qui est la vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'esprit et l'âme du monde par lesquels celui-ci prend conscience de sa grandeur et de sa fragilité, création somptueuse et mortelle à laquelle il a semblé devoir aboutir et, en même temps, comme si monde et homme, créateur et créature, étaient deux entités non seulement radicalement étrangères l'une à l'autre mais par essence ennemies, qu'il doit combattre.
Rappelons que, dans ce roman tout comme dans Méridien de sang, les civilisations, même les plus hautes, celles qui ont réalisé la plus idoine harmonie entre l'homme et son milieu, passent et meurent... C'est d'ailleurs l'un des grands arts de Cormac McCarthy que de parvenir à suggérer l'emprise fantomatique d'un paysage qui, pourtant stérile et mort depuis des siècles ou des millénaires, semble recouvrir des monceaux d'os de créatures qui, peut-être, furent plus grandes et plus sages que nous ne le sommes. Il n'y a point d'arrières-mondes dans les romans de McCarthy, pour la seule raison que c'est celui qui nous entoure, dans son immédiate réalité et sa répugnante brutalité, qui semble pétri avec une matière ayant porté des arches très anciennes d'humanité, à présent enfouies dans ses profondeurs mais continuant mystérieusement à irriguer de ses sucs les terres arides.
Extrême sauvagerie, qui n'est peut-être que l'état où monde et hommes sont dissociés, parce que l'animalité de l'un ne peut comprendre la subtile beauté, le réseau des significations, de l'autre.
Mais aussi remarquable compénétration entre l'homme et le monde, les grands romans de Cormac McCarthy sont faits de cette oscillation entre le plus grand éloignement et ce que nous pourrions appeler une harmonie métamorphique, qui rapproche McCarthy d'Emerson et, plus près de nous, de Guy Davenport.
Nous comprenons que c'est l'homme qui, devenu ou s'estimant, seulement, maître du hasard, a contaminé l'univers en lançant, pour la toute première fois dans ce qui allait devenir l'histoire, la formidable liberté, l'irrésistible force du tout premier choix. Voyons ce passage, qui nous fait immédiatement songer à la scène où Anton Chigurh expose sa philosophie concernant le hasard et la nécessité : «Mon père était profondément convaincu, déclare ainsi la grand-tante et marraine d'Alejandra à John Grady Cole, de l’interdépendance des choses. Je ne crois pas que je partage sa conviction. Il affirmait que la responsabilité d’une décision ne peut jamais être abandonnée à une puissance aveugle mais qu’elle ne peut être attribuée qu’à des décisions humaines de plus en plus éloignées de leurs conséquences. L’exemple qu’il donnait était celui d’une pièce qu’on lance en l’air pour tirer au sort et qui a été jadis un morceau de métal dans l’atelier où l’on frappe les monnaies et de l’ouvrier monnayeur qui a pris ce morceau de métal sur le plateau où il était posé et l’a placé dans la matrice dans l’une ou l’autre de deux positions possibles et de son geste découle tout ce qui va suivre, cara y cruz. Peu importe par quels détours on est passé et par combien. Jusqu’à ce que notre tour arrive enfin et que notre tour passe» (p. 260).
Le thème apparaît de nouveau, quelques pages plus loin (5), et nous ne pouvons nous défaire de l'impression selon laquelle McCarthy, lui-même, paraît hésiter quant à la voie à suivre : chanter la beauté du monde si elle nous est complètement étrangère, au-delà même de l'habituelle problématique des mots séparés des choses qu'ils désignent, n'est-ce point une action aussi héroïque que vaine, profondément désespérée ? Ne faut-il pas plutôt penser que la beauté, bien réelle, du monde et de la création, se cache autant qu'elle se révèle, se révèle par sa seule manifestation paradoxale qui est le secret, un secret qui exige attention autant que courage, épreuve initiatique, parcours qu'il faut entreprendre, récompense gagnée après rude bataille, toutes stations qu'a arpentées le personnage principal du roman de McCarthy, sans jamais trahir son farouche idéal, puisque, trahir, c'est d'abord ne pas même se respecter, puisque trahir c'est renoncer à soi-même (6) ? : «Il pensait que dans la beauté du monde il y avait un secret qui était caché. Il pensait que pour que batte le cœur du monde il y avait un prix terrible à payer et que la souffrance du monde et sa beauté évoluaient l’une par rapport à l’autre selon des principes de justice divergents et que dans cet abyssal déficit le sang des multitudes pourrait être le prix finalement exigé pour la vision d’une seule fleur» (p. 316). Vieille idée, quoique parée de nouvelles métaphores qui exige, pour prix d'une unique seconde de bonté, de douceur, de beauté, des sacrifices inimaginables, des souffrances atroces, des crimes abjects.
Seul celui qui s'est coupé des siens, de celle qu'il aime, qui a tué un homme, qui connaît le poids du remords parce qu'il n'a pas levé son petit doigt lorsque l'un de ses compagnons d'errance a été abattu comme un chien, seul cet homme est à même de comprendre qu'existent des regards vides (comme celui du cuchillero), des repaires où luisent des yeux perçants, des bruits d'un autre monde, des vents néfastes qui sillonnent les immenses terres désertiques qu'il traverse sur son cheval. Ces vents sont des vents mauvais, noirs comme celui qui a emporté l'un des personnages les plus misérables de Paul Gadenne ou ceux, tout chargés de gémissements et de choses informes, goules et démons (7), qui balaient à l'heure des sorcières, minuit, le paysage de la paroisse morte, Fenouille : «Il imaginait la douleur du monde comme une sorte d’informe créature parasite cherchant la chaleur des âmes humaines pour y couver et il croyait savoir ce qui vous exposait à ses visites. Ce qu’il avait ignoré c’était que cette créature-là était dénuée de raison et n’avait donc aucun moyen de connaître les limites de ces âmes et ce qui l’effrayait c’était qu’il n’y eût peut-être pas de limites» (p. 288).
Rarement autant que dans ce roman, Cormac McCarthy a été tout près de révéler le chiffre de sa vision terrifiante qui mêle indissociablement beauté et effroi, une vision, faut-il le préciser, profondément humaniste, en raison même de la brutalité avec laquelle elle expose la nudité de l'homme. Nombreux (autant que discrets : silences respectueux, sourires, gestes de salutation) sont les signes qui témoignent de la présence, sur la route périlleuse empruntée par les deux jeunes amis, de bons samaritains, souvent des Mexicains d'ailleurs : «Et plus tard et longtemps après il aurait de bonnes raisons d’évoquer le souvenir de ces sourires et méditer sur la bonté dont ils étaient le fruit car elle avait le pouvoir de protéger et de conférer honneur et dignité et d’affermir les résolutions et elle avait le pouvoir de vous guérir et de vous guider en lieu sûr quand toute autre ressource était épuisée depuis longtemps» (p. 247).
Notes
(1) Cormac McCarthy, De si jolis chevaux [All the pretty horses, 1992, volume 1 de la Trilogie des confins] (traduction de François Hirsch et Patricia Schaeffer, Actes Sud, 1993, Seuil, Points, 1998), pp. 11-12.
(2) «[…] il rêva de chevaux et les chevaux dans son rêve se déplaçaient gravement entre les pierres inclinées pareils à des chevaux arrivés sur un site très ancien où un ordre du monde avait fait faillite et quoi qu’il y ait eu jamais d’écrit sur les pierres les saisons l’avaient effacé et les chevaux se méfiaient et se déplaçaient avec une grande circonspection porteurs comme ils l’étaient dans leur sang du souvenir de ce lieu et d’autres où il y avait eu un jour des chevaux et où il y en aurait encore. Enfin ce qu’il vit dans son rêve c’était que l’ordre qui était dans le cœur du cheval était plus durable d’être inscrit là où nulle pluie ne pouvait l’effacer» (p. 314).
(3) «Quelque part dans cette nuit vide d’habitants ils entendirent une cloche qui tintait et la cloche se tut comme s’il n’y avait jamais eu de cloche et ils arrivèrent sur le dais circulaire de la terre qui était la seule chose sombre sans lumière pour l’éclairer et qui portait leurs silhouettes et les projetait parmi les foisonnantes étoiles de sorte qu’ils ne se déplaçaient pas au-dessous d’elles mais au milieu d’elles et ils allaient sur leurs montures à la fois jubilants et circonspects, pareils à des voleurs débouchant soudain dans cette sombre matière électrique, pareils à de jeunes voleurs dans un verger lumineux, précairement vêtus contre le froid et avec dix mille univers entre lesquels choisir» (p. 38). Encore : «Dans cette fausse aube bleue les Pléiades semblaient s’élever et sombrer dans l’obscurité au-dessus du monde et emporter avec elles toutes les étoiles, le grand diamant d’Orion et Céphée et la signature de Cassiopée, toutes remontant comme une nasse marine à travers la nuit phosphoreuse» (pp. 70-1).
(4) «Ils étaient tassés dans leur selle l’œil vague et se regardaient. Enveloppés de cumulus noirs les éclairs lointains fusaient sans bruit comme d’une lampe à souder à travers la fumée d’une fonderie. Comme si des travaux étaient en cours sur quelque pièce défectueuse dans l’obscurité métallique du monde» (p. 78). Ou bien encore : «Il y avait des orages au sud et des masses de nuages qui se déplaçaient lentement sur la ligne d’horizon leurs longs tentacules sombres traînant dans la pluie» (p. 105).
(5) «Quelquefois je crois que nous sommes tous comme ce monnayeur myope devant sa presse, qui prend les morceaux de métal aveugles un par un sur le plateau, tous tant que nous sommes si jalousement penchés sur notre besogne, résolus à faire que même le chaos ne soit pas autre chose que l’ouvrage de nos mains» (p. 272).
(6) «Bien avant le lever du jour je savais que ce que je cherchais à découvrir c’était quelque chose que j’avais toujours su. Que tout courage est une forme de fidélité. Que c’est toujours à soi-même que le lâche renonce en premier. Après cela toutes les autres trahisons deviennent faciles» (p. 265).
(7) «Ce n’était pas un bruit qu’ils avaient déjà entendu. Dans le crépuscule grisâtre ces hoquets répercutés par l’écho étaient comme l’appel de brutales espèces éphémères lâchées sur cet espace désolé. Une chose imparfaite et difforme au cœur de l’existence. Une chose grimaçant au fond des yeux de la grâce telle une Gorgone dans une mare automnale» (p. 83).




























































 Imprimer
Imprimer