« Mesure de la France de Pierre Drieu la Rochelle | Page d'accueil | Si le soleil ne revenait pas de Charles Ferdinand Ramuz »
28/12/2020
Que ma joie demeure de Jean Giono, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Lori Grace Bailey (The Guardian).
 Un roi sans divertissement.
Un roi sans divertissement. Le hussard sur le toit.
Le hussard sur le toit.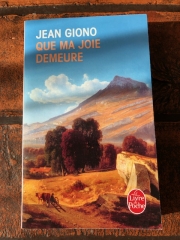 «Vous savez ce que je veux dire par temps présents. Il y a environ cinquante ans qu’on a commencé à se servir de la technique industrielle. C’était le début de la passion géante pour l’argent.»
«Vous savez ce que je veux dire par temps présents. Il y a environ cinquante ans qu’on a commencé à se servir de la technique industrielle. C’était le début de la passion géante pour l’argent.»Jean Giono, Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix.
Éléments contrastés autour d’un illuminé troublant
Un an après Le Chant du monde (1934) où le passage des saisons insinuait la concorde ou la discorde entre les hommes jusqu’à ce que le printemps ressuscité disperse les ultimes reliques d’un hiver de mort, Jean Giono, avec Que ma joie demeure (1), imagine un plateau de Provence où les hommes pourraient vaincre les assauts imprévisibles de la déréliction et vivre continûment dans le bonheur, alliés de la nature et farouches opposants aux fausses joies de la modernité. L’écrivain des Vraies Richesses (1936), déjà, s’esquisse dans ce roman où l’argent est stigmatisé comme l’archétype de la désunion et de la pauvreté spirituelle. L’action se déroule sur le plateau de Grémone, une incarnation littéraire du plateau du Contadour, situé entre Manosque, Sisteron et Carpentras. On y côtoie une vingtaine d’âmes réparties au sein de plusieurs fermes de dimensions variables, dont celle nommée la Jourdane, épicentre de cette histoire puisque Jourdan, le fervent mari de Marthe, ouvre cette chronique dans une attente messianique sur le point de se réaliser, devenant ainsi l’intercesseur des siens auprès d’un prophète natif a priori d’une Provence mythique, idéale et révolue. C’est du reste en pleine nuit que le miracle a lieu, dans la paradoxale clarté nocturne qui saisit le cœur de Jourdan, à un moment où il se figure la rudesse de «la vie des plateaux» (p. 9), brûlant de voir venir un homme «avec un cœur verdoyant» (p. 13) afin qu’il attise par ici le feu agonisant de la joie de vivre. Et cet homme tant attendu, tant espéré par le rustique Jourdan, prend forme dans les ténèbres informes mais brillantes de cette nuit particulière (cf. pp. 14-20), âgé d’une trentaine d’années, lesté d’une ample jeunesse christique et constatant tout de go la tristesse générale qui règne sur ces hautes terres de Provence (cf. p. 20).
L’homme si tôt venu, littéralement auroral avant l’aurore, s’apparente à un émissaire de la nature, à un évangile vivant qui annonce la bonne nouvelle d’un éternel printemps, arrivé là comme un soleil qui semble ne jamais devoir disparaître derrière les montagnes ou les nuages. Se faisant appeler Bobi, surnom davantage que prénom, faible principe d’identité au milieu du grand chaos naturel où toutes choses coïncident mystiquement, ce Sauveur s’exprime moins par ses paroles que par ses silences méditatifs (cf. p. 25). Quant à sa parole proprement dite, elle est le signe flagrant d’un savoir archaïque, d’une perception qui précède tout embryon de culture. «Je sais toujours […] ou à peu près» (p.27) avoue Bobi dans la simplicité de celui qui comprend le monde non pas en fonction de ses terminaisons mais en fonction de ses élans, de ses poussées, là où la Vie subsiste et préexiste au territoire des êtres achevés, des formes finies. Par conséquent Bobi n’a pas un œil qui avise des juxtapositions, des successions ou des chronologies distinctes. Sa sensibilité, au contraire, lui fait percevoir la continuité de tout ce qui existe en amont des systèmes de discrimination qui postulent un écart entre l’homme, l’animal, le végétal et le minéral. C’est à la racine de la vie que Bobi nous exhorte de vivre (cf. p. 29), dans la durée pure qui ne connaît pas la régulation mathématique du temps humain, dans le souffle divin qui ne connaît pas l’essoufflement des mélancolies mondaines. Cela explique sans doute que cet homme si étrange, si serein, si prodigieusement inspiré au départ, ait les yeux qui brillent même dans la plus profonde obscurité (cf. p. 30). En effet, lorsque certains se sentent prisonniers d’une crypte mentale ou d’un assaut de tous les abîmes, lui, Bobi, n’a de cesse de regarder plus loin, beaucoup plus loin, à la source illuminée où la Vie naît et renaît inlassablement – du moins en première lecture, au commencement de ces annales d’une parousie qui sera brusquement interrompue.
Il faut tout de suite spécifier, au risque de galvauder ces préliminaires enthousiastes en prolongeant notre dernière nuance, que l’apparition de Bobi sur ces terres est davantage malvenue que bienvenue compte tenu des usages en vigueur. En dépit du coup de foudre quasiment flaubertien que Jourdan ressent lorsque Bobi fait irruption dans la nuit, tel un Frédéric Moreau stupéfié par l’amour au chapitre d’ouverture de L’éducation sentimentale, cette présence inattendue par tous les autres personnages va largement tracasser les habitudes séculaires du plateau. Si, au début, les changements recommandés par Bobi vont indéniablement apporter de la joie, de la douceur et de la fraternité, il n’en sera pas de même sur le long terme, comme si l’utopie originelle – pratiquement communiste – était condamnée à dégénérer en dystopie, la blancheur immaculée de l’espoir se trouvant chaque fois menacée par le qui-vive d’une irréductible noirceur consubstantielle à l’univers bicolore de Jean Giono. Autrement dit, concédons-le, Bobi est le messager d’une Provence idéalisée à l’excès, presque désincarnée tant elle paraît trop belle pour être vraie. Cette Provence-là, mythifiée abusivement, ne tient pas la distance de la réalité, et Bobi lui-même, au demeurant, se voit rappelé par les offices de la chair après les avoir en quelque sorte niés sa vie durant, comme si le destin le sommait de réviser bon nombre de ses certitudes séraphiques. C’est cela, en outre, qui constitue probablement la neutralisation de ses bonnes volontés et de ses doctrines éthérées. Le fait de succomber à la tentation féminine, d’être bousculé par la jeunesse ambiguë d’Aurore (cf. pp. 129-130) ou vaincu par la plantureuse concupiscence de Joséphine (cf. pp. 146 et 328-9), tout ce faisceau de voluptés plurielles, antagonistes, bigarrées, le renvoie pour ainsi dire à un ordre humain qui remet en question l’inhumanité virtuelle de son programme de bonheur monochrome. Il n’existe pas de ligne émotionnelle continue dans le monde des vivants, et, en ce sens, il n’est pas si regrettable que le platonisme de Bobi soit finalement détruit, fût-ce par la licence provisoire de Joséphine et par l’éventuelle jalousie mortelle d’Aurore.
Ainsi, d’abord prophétique et angélique, Bobi, au fur et à mesure de son séjour parmi les domaines agricoles de Grémone, décline à l’état de demi-Christ, ramené à la condition d’une flamme vacillante. En bout de course, fatalement, il prend congé de ce monde peut-être trop mouvementé eu égard à ses désirs de joie reposante (cf. pp 392-411). On s’interroge donc sur le statut de la Vie dont le malheureux Bobi est le dépositaire assez incontestable et légitime : s’agit-il d’une Vie dont les vivants ne veulent pas ou s’agit-il d’un flux invisible et inaltérable dont il ne fallait pas chercher à modifier singulièrement les phénomènes visibles ? La seconde hypothèse a notre préférence car la Vie, comme le vent de l’évangile, souffle où elle veut (2), et c’est par défaut de libéralité, par inadvertance également, que Bobi a semé des graines de désolation là où il pensait sincèrement appuyer les forces du ravissement, les pouvoirs de solidarité et la dynamique de l’immuable nativité où toute mort est d’emblée surmontée.
Bien sûr, nul ne le contredira, Bobi est touchant lorsqu’il décide par exemple de faire de ce plateau une nouvelle arche de Noé, ceci afin de conjurer l’opinion soutenant que certains animaux sont inutiles (cf. p. 31), mais, dans le même temps, sa phraséologie fantasmatique se heurte vite au principe de réalité. Ce n’est que rétrospectivement que nous établissons ce diagnostic éreintant à propos des actes et surtout des idées de Bobi, une fois que tout a été consommé, cependant cette espèce d’idéalisme récurrent, à la longue, peut lasser tout autant qu’irriter, et cela se manifeste virilement au moment où Aurore reproche à ce bizarre Messie de ne pas avoir de cœur, de ne pas aimer, d’être sec et impuissant (cf. p. 228). Par son prénom et par sa révolte, Aurore symbolise une aube possiblement plus authentique, un panache astral plus fiable, plus crédible que le rayonnement de Bobi qui a de prime abord impressionné Jourdan et qui devient de plus en plus sujet à caution. Il se peut alors que la toute jeune Aurore ait perçu la part crépusculaire de Bobi, laquelle, évidemment, se compense par une part solaire incompressible. Cela se peut en effet puisque Bobi, aussitôt récusé par Aurore, va successivement rêver de ces imputations (cf. pp. 234-5), s’en tourmenter (cf. p. 251) et en faire le matériau d’une incertitude grandissante au sujet de sa mission ici-bas (cf. p. 269). Et quoique Aurore reviendra désemparée auprès de lui pour susciter son pardon (cf. pp. 324-5), Bobi n’est pas totalement dupe de ses manquements individuels, sachant que sa passion pour Joséphine a relativement brisé le miroir de son Absolu (alors même que celle passion eût pu l’édifier à de plus vastes et plus véridiques flamboiements).
On peut du reste admettre que Bobi aurait préservé son œuvre s’il n’avait pas pris la clé des champs à la suite du suicide d’Aurore, emportée par un coup de fusil qu’elle s’est tiré en pleine bouche (cf. pp. 380-3). Est-ce là, dérivant pathétiquement de Bobi, une preuve de capitulation ou la crainte des réactions humaines ? A-t-il, en fuyant, abandonné tout espoir de changer le cours du monde ou a-t-il redouté la colère d’un petit peuple en passe d’ouvrir les yeux sur ses échecs ? Le suicide d’Aurore, par ailleurs, est la seconde mort volontaire qui endeuille le plateau après la pendaison de Silve (cf. p. 71). Il aggrave le Mal qui ronge cette région hissée sur les tréteaux de la nature, «notre mal» confesse même Jourdan (p. 71), et, d’une certaine manière, il sanctionne l’impuissance de Bobi pour guérir les hommes de leur insondable neurasthénie (car peut-on promettre que l’ombre s’en ira pour toujours quand on est soi-même astreint à l’instabilité la moins avantageuse ?).
Vivre et laisser vivre, c’était en apparence le souhait de Bobi, mais l’on ne peut s’empêcher d’affirmer que le suicide d’Aurore trahit un déficit quelconque dans les velléités de cet enchanteur déchu. On ne peut s’empêcher non plus de suggérer que Bobi n’avait pas les épaules aussi larges que ses ambitions. Il n’aura fallu que deux femmes pour le détourner de ses desseins – ou pour le rapatrier sur la terre ferme, sur le limon du corps, complétant de la sorte ses vœux d’irradiante cosmicité en l’impliquant dans l’insurrection de ses propres atomes. Tour à tour, supposons-le, Aurore et Joséphine perfectionnent la sensibilité de Bobi, l’amenant à l’expérience véritable de l’Incarnation en le détachant du Ciel de son ordinaire catéchisme cosmique. Progressivement l’Idéal s’estompe au profit du Réel grâce à l’empire des femmes, toutefois Bobi, tel un Roquentin désarçonné par la découverte de l’existence (3), donne le sentiment de ne pas vouloir s’engager plus en avant dans l’imprévisible symphonie de la Vie. Il résulte de cette suggestion que la Vie telle que la concevait Bobi n’avait peut-être pas autant de capacité chaotique que cela, que sa conception de l’infinie génération n’était pas si radicale qu’elle en avait l’air, du fait même qu’il avait inconsciemment tendance à y déposer un enzyme de rationalité. Ou alors, encore plus audacieusement, il est même possible que les habitants du plateau, dans leur propension à alterner entre la joie et la tristesse, entre le sourire et la grimace, soient de meilleurs délégués du Chaos primitif en raison de leur simple consentement à cette alternance des affects. Là où Bobi a essayé de proposer une régularité, une organisation insubmersible, les autres, à l’exception de Jourdan, avaient potentiellement compris que la Vie n’est pas susceptible d’une stabilisation. Vivre, assurément, c’est accepter tous les ouragans, jusqu’aux plus contradictoires sensations, jusqu’aux plus insupportables polémologies, et, ce disant, nous présumons que Bobi a quelquefois omis de se rapprocher d’Héraclite, du devenir innocent de toutes choses, par amour incoercible pour Parménide et son fleuve de glace transi dans l’Être.
Dans le fond, à supposer qu’on accorde du crédit à nos spéculations, Bobi est arrivé dans une Provence aussi scabreuse et scandaleusement vivante que la cité de Knoxville (Tennessee) où Cornelius Suttree fréquente toutes les variétés du désaxement humain. Mais la différence est de taille entre le personnage de Jean Giono et le personnage de Cormac McCarthy (4), hormis en ce qui concerne leur aspect christique et la sensation graduelle de leur crucifixion. À l’endroit même où Bobi s’acharne à corriger l’humanité de l’intégralité de ses décadences, Suttree, lui, n’aspire aucunement à endiguer la somme de Mal dont il est le témoin parfois désabusé. La sagesse de Suttree repose dans cette faculté stoïcienne classique qui consiste à savoir distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas. Il a deviné qu’il ne sert à rien de vouloir tout sauver. Il a également l’intuition que pour protéger le monde, il convient paradoxalement de laisser prospérer un peu de Mal, puis de croire, in fine, aux saintes puissances dissimulées ou détournées par la damnation des péchés capitaux. D’où cette émouvante amitié qui unit Suttree et le détraqué Harrogate, parce que derrière ce profil d’onaniste qui se soulage dans la fraîche carnation des pastèques, derrière ce marginal qui terrorise et massacre un cochon, il y a, sublime et déconcertant, le décret de Dieu, l’enfant de Dieu eût dit McCarthy, l’inaccessible sainteté des hommes qu’il faut postuler malgré la détresse et l’agitation anarchique de la civilisation. Qu’on s’entende alors définitivement : nous ne disons point que Giono n’a pas saisi ce que McCarthy a embrassé de toute sa prodigieuse littérature, nous disons seulement que Bobi ne se situe pas tout à fait au niveau d’acceptation de Suttree. Celui-ci se soumet à la nécessité chaotique tandis que celui-là voudrait soumettre la nécessité chaotique à une nécessité cosmique trop ordonnée. Faut-il pour autant disqualifier tous les enseignements proférés ou habilement gardés sous silence par Bobi ? Faut-il s’en tenir à son pessimiste «Tout a raté» (p. 388) lorsqu’on le suit effondré pendant son exode terminal, de toute évidence accablé par le cycle macabre du suicide ? Ce serait lui faire une injustice et ce serait par ailleurs être infidèle aux revendications de Jean Giono, à sa digne espérance de ne pas voir la Provence entièrement subordonnée à la technique, à la psychologie industrielle et à l’iconologie maléfique de l’argent. Détaillons ainsi l’inoubliable villégiature de Bobi sur le plateau de Grémone et tirons-en les leçons qui s’imposent.
Le mémorable professorat de Bobi
En allant tout d’abord au plus saillant, nous dirons que Bobi est un montreur d’harmonie comme il y avait jadis des montreurs d’ours. Son intention est de réduire l’empire de la culture et d’amplifier la présence de la nature, la première étant un facteur de disharmonie au sein de la seconde. Il voudrait que l’on ressente la nature comme la preuve fondamentale de tout ce qui est, comme l’inépuisable jouvence matricielle d’où tout provient et vers quoi tout retournera. Selon Bobi, la société du plateau de Grémone est vieille, morne, épuisée, ayant besoin d’une cure purificatrice afin de l’aider à renouer avec la jeunesse primordiale, avec la joie, le délire prometteur des bourgeons, le sang du monde en l’occurrence – qui est «sang d’appétit» et non «sang de dégoût» (p. 52). Il s’annonce ainsi sous les traits d’un guérisseur (cf. pp. 45-8), d’un engageant redresseur du bois courbe dont l’homme est fabriqué et que Kant pointait adroitement du doigt (5), en sus d’être un accordeur virtuose des courants cosmiques. Dans cette optique extrêmement conforme aux attributs d’un prophète ou d’un rebouteux advenu just when needed, Bobi se fend d’attitudes ou de paroles succinctes à travers lesquelles il justifie une «passion pour l’inutile» (p. 33), subodorant, à la façon célèbre de Théophile Gautier (6), que la Beauté gît dans l’inutile et que la Laideur se nourrit d’Utilité (cf. p. 64). Il renverse de la sorte une croyance largement admise où le Beau s’associe pesamment à des intérêts précis, et, par surcroît, il critique à la dérobée les usages de la technique, petite sœur de l’Utile et semeuse de troubles dans le lien qu’on entretient avec la nature.
Ces réflexions liminaires, en outre, induisent une mutation des manières de travailler, d’autant plus que Jourdan se lamente de «faire du travail triste» (p. 75). Il s’agit au préalable de se débarrasser de la lèpre de l’argent, de l’acte qui consiste à transformer le labeur en monnaie sonnante et trébuchante (cf. pp. 54-5). La démonétisation du travail doit donc s’accompagner d’une révision du rythme de production et initier un art de «travailler doucement pour [le] plaisir» (p. 221), voire un art de «vivre doucement» (p. 345), pour ne pas dire un renoncement à toute productivité en vue de privilégier uniquement la créativité qui assurera un équilibre parfait entre les hommes et la nature. Par conséquent, en se dessaisissant de cette raideur laborieuse, les autochtones du plateau de Grémone pourront entamer une métamorphose cruciale, abdiquant leurs psychés dures comme la pierre, peu enclines au changement, et invitant en eux-mêmes le végétal qui peut «fleurir souvent» (p. 63). Non pas que Bobi tienne à l’écart toutes les silhouettes ahurissantes du règne minéral, mais, eu égard à ce qui est préférable pour les hommes, il préconise une souplesse maximale plutôt qu’une pente de rigidité. C’est en se faisant luxuriants, en devenant des fleurs extravagantes – tels ces narcisses gratuitement cultivés par Jourdan (cf. p. 75) – que les hommes réussiront mieux à participer à la co-fécondation de tous les éléments qui composent la nature. Le mélange des règnes vivants réprime du reste toute obsession de hiérarchisation, toute sanction d’inutilité qui voudrait soutenir que telle ou telle partie de la nature a moins d’intérêt à vivre qu’une autre. Cette mixtion cardinale culmine dans le passage des «noces des chevaux» (cf. pp. 259-265) où l’on assiste à une spectaculaire chorégraphie des grandeurs naturelles, à une danse qui n’est pas sans évoquer la jubilation dionysiaque telle qu’elle fut pratiquée par un Alexis Zorba (7) et seulement enseignée par Bobi, ce dernier ayant de la peine à vivre lui-même les contenus de sa pédagogie.
Mais quoique ce professeur confie souvent à autrui le soin de concrétiser son arsenal théorique davantage qu’il ne l’applique à sa propre personne, il n’en demeure pas moins palpitant, vibrant d’une vie exemplaire, locuteur d’une langue de la génération qui rend muette toute corruption (cf. pp. 89-91). Il bâtit des syncrétismes surprenants et bientôt épaulé par un cerf allégorique dont les bois confinent à des arborescences fantastiques (cf. pp. 92-107), Bobi poursuit son sacerdoce diplomatique, acharné à créer de la concorde entre les ressortissants de Grémone et les animaux du plateau. Par ailleurs ce concordat progressif trouve son reflet strictement humain lors d’une fête dominicale où les chants glorifient la bonne chère et s’agrègent en une chorale improvisée où les hommes et les femmes, à l’unisson, entonnent l’hymne éclatant de la Nature (cf. p. 108-161). Pendant ce dimanche de festivités impromptues, le sang bat la mesure de la vie, chassant les néfastes pulsions de mort (cf. pp. 156-7), et, alors, comme tout peut arriver en ces moments de grâce, on aperçoit Zulma, une jeune fille, complice avec le cerf, les deux créatures de Dieu marchant d’un même ton «dans une sorte de gloire» (p. 136). Au reste, cette impression générale d’entre-tissage d’un maximum de relations se matérialise encore plus lorsqu’on installe un métier à tisser à la Jourdane (cf. pp. 331-5), un outil que l’on compare à un «cerf» (p. 340), au cerf magique rapporté par Bobi et digne assesseur zoologique de ses missions communautaires.
L’expérimentation rigoureuse de cette éthique de la nature fait rejaillir l’enfance et Jourdan, par exemple, se met à voir chaque chose comme si c’était la première fois qu’il les voyait (cf. p. 228). À cela s’ajoute un réquisitoire contre la propriété et les morales de propriétaire (cf. pp. 164-7 et 348), rappelant, par le truchement vaticinateur Bobi, des pages ardentes et visionnaires de Rousseau ou de Proudhon, de Bloy aussi. La propriété serait l’ennemie du bonheur, l’anéantissement de toute réciprocité, or Bobi insiste sur le «besoin de joie» (p. 170), sur l’impératif de la propager, la divulguer, la restaurer, confondant son discours de félicité avec l’extase de «la danse à laquelle doivent obéir les océans, la lune et les étoiles et qui entraîne doucement le sang quand la bête dort» (p. 176). Bien que partiellement étranger à ce flux et ce reflux où l’univers entier s’incarne, bien que réticent à se lancer à corps perdu dans la chair même des choses, puis quasiment mortifié d’avoir cédé au stupre de Joséphine, le méfiant Bobi augure néanmoins une rédemption en désirant perpétrer «le lyrisme de l’espérance des hommes» (p. 177). Il voudrait que son public fasse contrepoids au plomb de son idéalisme, qu’eux, à l’inverse de lui, n’aient pas peur de se sentir arrachés «du monde par le noir travail de l’amour» charnel (p. 355). À son excès de mesure et de pusillanimité qui ne dit pas son nom, à sa réserve empirique et à sa sombre conception de l’amour, Bobi rétorque par la démesure discursive du «paradis terrestre» (p. 293) tel qu’il l’entend, c’est-à-dire à l’instar d’une hypertrophie de tout ce qui est naturel et d’une atrophie de tout ce qui se rattache à la civilisation. Sans aucun doute serait-il heureux d’apprendre que Marthe, la femme de Jourdan, a nettement éprouvé cette sensation d’hubris de la nature (cf. p. 293).
L’incomplétude messianique de Bobi et sa transfiguration finale
L’errance ultime de Bobi sous l’orage et l’emprise de la perplexité (cf. pp. 392-411) se rapproche d’un épisode traditionnel d’irrésolution et de doute sinon métaphysique, du moins hyperbolique. En cette nuit finissante mais appesantie par le ciel tumultueux, Bobi ressemble au Christ interrogatif du Mont des Oliviers. En outre, conduisant un âpre dialogue avec lui-même, Bobi endure la division, le déchirement, l’empreinte d’un Tentateur autrement plus redoutable que les femmes. Non seulement cela confirme son imperfection, son manque d’unité idoine pour un oracle, mais cela justifie également son tempérament timoré avec Joséphine et son défaut de générosité avec Aurore. Plus enclin à se laisser séduire par le diable que par les joies ancestrales de la chair, Bobi se révèle platement asexué, cible exclusive du Malin qui fertilise hardiment les âmes les plus humides. Tandis que la rédemption lui aurait peut-être tendu les bras dans le giron pérenne d’une féminité démultipliée, tantôt du côté de l’insatiable appétit de Joséphine, tantôt du côté de l’insolent rayon d’Aurore, Bobi, au contraire, s’est retiré dans le surplomb de sa timidité, dans le cratère de son volcan assoupi, se contentant la plupart du temps de diffuser la doctrine d’un irénisme fastidieux, rehaussé toutefois de fulgurances qui ont fait du chemin chez les uns ou les autres.
On aboutit donc à cette notion d’inaccomplissement pour caractériser Bobi. Presque tout en lui est inachevé, vilainement contrarié, imprécis, abstraction faite de son plaidoyer cosmique dont la répétition finit par oublier l’évidence chaotique de la nature. Il y a tant d’idéalité en Bobi qu’il n’est pas du tout certain que du sang coulerait de son corps si on le piquait avec une épingle – tel que le demandait pour lui-même Shylock dans Le Marchand de Venise afin de vérifier son appartenance à l’humanité. Exsangue et pourvu d’une intériorité marécageuse, Bobi, tragiquement et d’une façon apocalyptique, s’enflamme réellement lorsqu’il est foudroyé par un éclair (cf. p. 411), ce qui met un terme brutal à sa pérégrination ensorcelée. Le voilà enfin doté d’une âme de feu héraclitéenne, salutairement brûlé, électrisé par la nature qui ne peut jamais être commensurable à telle ou telle projection d’un monde organisé, en cela même que le Cosmos n’est pas un synonyme du Chaos – et encore moins de la Physis universellement fluente et ondoyante d’Héraclite. De plus, hypothétiquement réduit en cendres par cet éclair, Bobi rejoint l’humus fondateur de la vie, devenant authentiquement tellurique après avoir été inefficacement céleste. Aussi, terrassé par cette foudre au fond de laquelle repose éventuellement une particule d’ineffable vengeance divine, Bobi disparaît, laissant toute la place au triomphe de la vraie nature, transfiguré en Christ de lumière et de joie pure. Il est même envisageable de penser que cette explosion subite de la foudre répond à l’explosion qui a tué Aurore, comme si, finalement, Aurore était devenue la foudre elle-même qui remet Bobi dans l’axe d’une plus haute participation au secret de la vie. Elle l’avait en quelque sorte déjà prévenu par son suicide, par l’éclatement choquant de son crâne, par l’exhibition de son sang qui jetait sur le pourtour de son cadavre une étonnante affirmation de la vie au cœur même de la mort violente. Ce sang répandu avait pour vocation de tourner les sangs de Bobi, ou, en tout cas, de dégeler le glacier parménidéen qui s’était emparé de ce prophète apocryphe qu’Aurore avait su percer à jour. Et Bobi s’est en effet activé, réveillé à la vue de ce sanglant soleil du suicide, de ce soleil rouge comme un «méridien de sang» de McCarthy, métamorphosé en orage humain jouant la même partition que l’orage sous lequel il devait se mettre à déambuler, jusqu’à servir de paratonnerre au plateau de Grémone, sauvant cette fois ce petit monde pour de bon, l’exonérant de sa présence qui fit tomber l’Idéal au rang d’une Idéologie.
Notes
(1) Jean Giono, Que ma joie demeure (Le Livre de Poche, 2017).
(2) Jean, 3, 8.
(3) Cf. Jean-Paul Sartre, La Nausée.
(4) Cormac McCarthy, Suttree.
(5) Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique.
(6) Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin.
(7) Cf. Nikos Kazantzakis, Alexis Zorba.




























































 Imprimer
Imprimer