« Schmock ou le triomphe du journalisme. La grande bataille de Karl Kraus de Jacques Bouveresse | Page d'accueil | La palinodie d’Alexandre Grothendieck à la lumière de René Guénon, par Gregory Mion »
26/12/2022
Des arbres à abattre (Une irritation) de Thomas Bernhard, par Gregory Mion

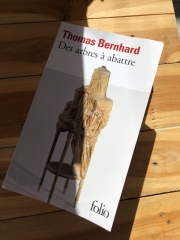 «Il s’empressa donc de dire qu’il n’avait pas pensé à mal.»
«Il s’empressa donc de dire qu’il n’avait pas pensé à mal.»Hermann Broch, Les Somnambules.
«Joe a encore plus de vanité que vous n’en avez jamais eue, et vous en aviez déjà beaucoup pour votre part.»
William M. Thackeray, La Foire aux Vanités.
Si Thomas Bernhard a eu les effets désirables et indésirables d’un produit de contraste dans le milieu culturel autrichien, révélant de ce climat bon nombre de ses horreurs qu’on aurait sûrement aimé ne pas connaître mais que l’on soupçonnait cependant, il n’en a pas moins été, à l’inverse, un pur produit assimilé de cette exaspérante Kulturszene, tel un poisson dans l’eau, fût-il à ses heures de gloire un requin égaré parmi un désolant conglomérat de sardines. D’autre part, si Thomas Bernhard n’était pas né en 1931 mais après l’année 1936, précisément après le 12 juin 1936, on aurait pu croire, dans un élan de croyance à l’égard de la transmigration des âmes, que l’âme accidentellement libérée du corps de Karl Kraus, une âme ignée, une âme furieuse et inextinguible en sa fureur, s’est aussitôt réinstallée dans le corps de celui qui devait devenir l’homme de lettres le plus scandaleusement provocateur de l’Autriche entre les années 1950 et les années 1980 – le corps valétudinaire de Thomas Bernhard pimenté par un esprit de feu.
Et telle fut la carrière littéraire de Thomas Bernhard : une attraction et une répulsion mêlées, une relation d’amant capricieux avec sa maîtresse mondaine, un espoir d’être grand au cœur d’un environnement essentiellement composé de nains et de lilli-putains, ce qui, nous en conviendrons, rapetisse le moindre des espoirs d’être un pur géant de l’art. Mais à rebours des psychologies mégalomanes ou tombées dans une brume qui les empêche de se saisir pour ce qu’elles sont vraiment, Thomas Bernhard, lui, n’a jamais cherché à sauter par-delà le vieux mur de son espoir et à s’imaginer plus beau qu’il ne l’était, car, mieux que personne, il a fait l’inventaire de ses compromissions et il en est arrivé à des conclusions assez peu reluisantes sur sa psyché en même temps qu’il n’a pas épargné la Psyché sidéenne et putassière non seulement des artistes de son pays, mais aussi, par voie logique de complément, de tous les politiciens et autres fonctionnaires gravitant autour de l’Astre de la Création et des Problématiques Culturelles en Autriche. De sorte que s’il y a eu un talent incontestable chez Thomas Bernhard, s’il y a eu chez cet assaillant névrotique un don travaillé de l’écriture, il y a également eu chez lui, dans ses appartements secrets, un certain don de la servilité contrariée et peut-être encore un certain art de lécher, un art d’user de sa langue élaborée sur les zones excitables de l’Intelligentsia de Vienne, de Salzbourg et de toute espèce de soi-disant place forte des arts, une propension à éveiller quelque appendice ou orifice idoine, un aveu de dégradation de la chose artistique, en fin de compte, parce qu’il ne paraît pas rigoureusement cohérent d’associer un succès littéraire se regardant comme authentique à une performance regardée comme intime.
Évidemment que Thomas Bernhard eût volontiers participé à notre goût de l’ironie et il n’y a guère qu’en France où l’ensemble des anchois, maquereaux et autres harengs de l’art ne verraient pas d’incohérence à pratiquer les lois perverses du plus énorme Putanat du monde (la maison de tolérance de la littérature française) tout en prétendant appartenir au clan si convoité des squales ou des épaulards. On ne trouvera jamais pareille hypocrisie sous la plume de Thomas Bernhard, et tantôt requin, tantôt sole de petit bateau, il revient sur les hauts et les bas de ses paradoxales fréquentations artistiques dans son inégalable et réjouissant Des arbres à abattre (1), sous-titré Une irritation, façon d’admettre immédiatement le degré d’aigreur de son texte, faux roman et véritable récit déguisé, façon encore de nous prévenir que nous allons pénétrer à l’intérieur d’une forêt hantée, au fin fond d’une forêt corrompue, au sein d’une succession d’arbres qu’il serait souhaitable de déraciner au plus vite et dont l’auteur – ou notre vaillant et sincère cicérone – ne s’estime pas du tout indépendant.
Maniant brillamment la répétition et s’abouchant tout aussi brillamment avec un ressentiment anaphorique digne des plus intarissables sources de la mauvaise humeur ou de la bile enténébrée, le témoin à charge Thomas Bernhard, en deux cents pages monolithiques et accusatrices dont il est par ailleurs coutumier, nous introduit aux vils arcanes de l’élite culturelle viennoise par l’intermédiaire des époux Auersberger (nom à peine modifié des réels époux Lampersberg) qui furent ses directeurs de conscience esthétique durant les années 1950 et avec lesquels il rompit pendant plusieurs décennies, jusqu’à se retrouver de nouveau sous leur innommable coupe au début des années 1980, par inadvertance présumée et par sentimentalisme avéré, lorsqu’il devait les recroiser au gré d’un hasard qui respire la nécessité et que les Auersberger devaient lui apprendre – quelque chose qu’il savait déjà – le suicide d’une vieille connaissance – Joana en l’occurrence –, morte pendue, morte misérablement, plus ou moins désaccordée du maudit diapason de la Haute Culture autoproclamée, délaissée par un premier mari qu’elle contribua de toute sa féminine assiduité à incorporer dans le corps maladif de cette Haute Culture, puis ré-acclimatée avec un compagnon de secours qui ne sut nullement la secourir dans son irréversible descente aux enfers de femme déclinante, trahie et sûrement plus douée que beaucoup de ceux qui lui ont survécu, à commencer par son ex-mari opportuniste.
Ainsi le flâneur Thomas Bernhard, haïssant les villes perverties (pléonasme pour ce Jean-Jacques Rousseau du Mozarteum) et pourtant les fréquentant souvent, détestant Vienne et ne pouvant s’en passer une bonne fois pour toutes, ainsi flânait-il probablement moins par désir de rêverie gratuite que par trouble appétence de se comporter à l’instar d’un récidiviste des mondanités, espérant, recherchant et peut-être même mendiant une rencontre pseudo-fortuite en sachant parfaitement dans quels quartiers il s’attardait comme s’attarde un éconduit sous le balcon de sa fatale obsession, se doutant nettement qu’il existe des endroits possédés par le démon et que les Auersberger, eux comme tant d’autres de leur démentielle catégorie, ne peuvent être accostés qu’ici plutôt qu’ailleurs, ne peuvent être atteints qu’en des endroits spécifiques de la Cité viennoise des Hérétiques. Par conséquent il arriva ce qui était écrit sur les terribles manuscrits de la destinée dépravée des gens de Vienne se glorifiant de noblesse et de créativité controuvées, il arriva que Thomas Bernhard, sur ces latitudes et ces longitudes concrètement démoniques, entra en morbide collision avec les époux Auersberger sournoisement frappés du deuil de Joana, hypocritement affectés, mimant ou sur-mimant les éléments du tableau périodique de l’obséquiosité circonstancielle en allant au-devant de l’ancien Débutant des Lettres qui sut naviguer par la suite parmi les insignifiants planctons de l’art en devenant romancier et dramaturge, lui adressant la parole comme on l’eût adressée à quelqu’un de récemment visité, le mettant au parfum de l’inconcevable suicide de cette si précieuse amie, puis lui glissant au passage, comme on glisserait un gros billet dans la main d’un petit-neveu qu’on ne voit qu’une fois tous les cinq ans et duquel on essaie d’acheter le syndrome de la famille contentée, lui glissant donc, incidemment, une invitation pour l’un de leurs sacro-saints dîners dits artistiques sur la Gentzgasse, à leur domicile d’héritiers, centre voire épicentre de la Capitale des Génies Européens, septentrion fédérateur des artistes les plus en vue et les plus prometteurs de la divine Autriche, phare éternel du raffinement et surtout sémaphore impérissable de la cooptation farouchement itérative – comme l’est Paris ne l’oublions pas.
Bien entendu il arriva encore que Thomas Bernhard acceptât l’invitation, d’autant que celle-ci, outre qu’elle avait pour mandat de se dérouler en soirée, après les rustiques funérailles de Joana par-delà les pourtours citadins, se donnait aussi pour sacerdoce de fêter un comédien de renom, un acteur de théâtre tout ce qu’il y a de plus sérieux et de plus mythique, convié à partager le couvert en son suprême honneur chez les Auersberger, non seulement pour le célébrer du point de vue de sa remarquable et infatigable carrière, mais également pour mettre en exergue sa performance inaugurale dans le Canard sauvage d’Ibsen, ceci dès le rideau tombé au Burgtheater, l’une des scènes faramineuses de Vienne malgré les rumeurs et les médisances qui voudraient affirmer le contraire. Il est alors advenu que le psychisme tourmenté de Thomas Bernhard a été pris dans les filets des Auersberger accidentellement ou essentiellement rencontrés au fond des eaux usées de la ville, il est advenu qu’il s’est laissé reprendre au jeu de cette séculaire tartufferie, qu’il a verbalisé ou signifié par quelque signe mielleux de non-refus son accord de participer à ce dîner à mi-chemin du cérémonial macabre et de l’apothéose d’un vétéran cabotin, rempli de vilaine curiosité assurément, mais plus que tout autre chose faible, archi-faible, influençable, obéissant, décevant ô combien !, harponné par des Achab de kermesse sur un Pequod de pêche aux canards, enclin à revenir aux origines de l’onanisme de compétition nationale, là où tous les onanistes de l’Autriche déclarée officiellement culturelle se réunissent pour se tripoter le Moi en simulant des efforts surhumains afin de dissimuler une congénitale disposition à l’onanisme social – chez les Auersberger est-il besoin de le rappeler.
Dès lors la voix intérieure de Thomas Bernhard nous fait le descriptif détaillé du logement des Auersberger et de leurs occupants propriétaires ainsi que de leurs blafards convives, une voix enfiévrée, maniaque, paranoïaque sur les bords, une voix qui ne supporte pas d’avoir accepté l’invitation de ce couple exécrable mais qui l’a tout de même acceptée, une voix presque à nulle autre pareille et qui transforme son aigreur en commandant et belliqueux Grossglockner du style, jubilante de méchanceté sans commettre pour autant l’impair de se réserver le meilleur rôle puisque n’importe quel individu présent chez les Auersberger ne peut se soustraire à la honte abyssale d’être là et au mépris insondable des véritables autorités intellectuelles et artistiques qui ne sont forcément pas là, cochant toutes les cases de la soumission psychologique et de la reptation sociale. C’est du reste sur le coussin d’un redondant fauteuil à oreilles que Thomas Bernhard accumule ses observations et ses intermittents souvenirs, tantôt décochant une flèche humiliante, tantôt recevant une flèche de sa mémoire outragée, alternant, nous l’avons d’ores et déjà stipulé dès notre exorde, entre, d’une part, l’incarnation de l’impitoyable juge qui débite ses successives sentences à l’encontre d’une coupable race de décadents, et, d’autre part, la personnification ultime du dilettante crépusculaire qui sait au plus profond de lui-même qu’il ne vaut guère mieux que ses cibles de prédilection dans la mesure où il provient du même moule de pourriture, du même ferment d’infection, de la même graine de malfaisance, d’où l’amplification de sa colère envers cette mafia petite-bourgeoise et son propre caractère versicolore où les sangs épais de la vassalité assumée côtoient les sangs de braise de la toute-puissance justifiée. Et ce qui domine, ce qui se dégage en tant que flagrant motif de ce désolant diagramme de la faiblesse créatrice s’arrogeant les prérogatives d’une force archaïque, c’est le halo fétide d’une incurable dépression, le nœud d’une mélancolie dévastatrice, tous ces parasites absolus et lestés d’une indicible muflerie, de même que le relatif parasite Thomas Bernhard qui se désigne quasiment comme tel durant les dernières pages de ses fielleuses récriminations, toute cette engeance fonctionnant à l’instar d’un réacteur nucléaire de la neurasthénie, de l’affaiblissement et de l’agonie certifiée d’une civilisation depuis longtemps menacée par ses indubitables sangsues : non pas le métèque, non pas l’ouvrier, non pas le délinquant de droit commun, mais l’homme des arts et des humanités, l’homme aristocrate par mensonge, l’homme institutionnel dont la cruauté métabolisée en société répand une souffrance maximale et un éther vicié dans le pays où il sévit. C’est la raison pour laquelle Thomas Bernhard a fait de Vienne un pôle de l’annihilation de tout élan vital et de toute vérité artistique, un refuge du nazisme tardif ou survivant, un réseau ultra-hygiénique de la pulsion de mort qui compromet la condition humaine à la fois en Autriche et dans toutes les nations limitrophes de cette infernale terre, pour ne pas dire dans toutes les nations qui commettent l’imprudence de recevoir des artistes ou des politiques autrichiens de l’époque contemporaine, lesquels sont autant de bagagistes zélés de Satan.
La radicalité de ce que nous avançons ici n’est que le fidèle reflet des radicalités choisies par Thomas Bernhard dans ce livre ou dans d’autres. Reste qu’en le lisant et en le relisant avec un plaisir évident, nous ne pouvons que souhaiter l’émergence d’un tel trouble-fête en France à dessein de remettre à l’endroit ce qui est cul par-dessus tête dans notre pays axiologiquement mourant. Nous manquons en effet d’un franc-tireur issu des opérations commando d’un Karl Kraus ou de quelque autre frère positionné à l’avant-poste du désastre et s’en alarmant effrontément, d’un frère intégré à la vermine et non à la marge cela va de soi, nous manquons, dans l’édition parisienne, dans nos salles de rédaction et dans tous les couloirs de l’establishment hexagonal, d’un homme ou d’une femme capable de réaliser un aussi solide attentat psychique, d’un guerrier développant la faculté de s’engager dans une aussi endurante perspective de nuisance parmi les plus arrogants nuisibles de la planète. Cette impossible figure nous manque mais nous rend assoiffé malgré tout d’une actualité reconstituée par l’intermédiaire d’un genre de révisionnisme littéraire où tel écrivain – après Balzac, Maupassant, Bloy et Patrice Jean pourquoi pas – aurait fait chauffer les pales d’un hélicoptère de combat et serait parti à l’aube – dans sa fiction justicière – pour arroser de napalm les châteaux et les forteresses des Auersberger de nationalité française. Nous autres davantage que les Autrichiens, n’en doutons pas une seconde, possédons une abondante pègre de cuistres et de monopolisateurs des opportunités de créer, et chaque lecteur, en suivant la trame horripilée de Thomas Bernhard, substituera aux ânes bâtés d’Autriche nos ânes bâtés de France. La matière de tels effectifs microbiens étant pléthorique au sein de nos frontières, c’est aisément, bien sûr, que nous parviendrons à confondre un binôme de pédants français aux époux Auersberger se vantant dorénavant d’avoir l’intégrale de Wittgenstein sur leurs étagères, tout comme nous saurons recruter parmi nos écri-naines redoutablement arrivistes une Jeannie Billroth s’estimant au-dessus de Virginia Woolf (peut-être Jeannie Ebner dans la réalité), sans oublier l’inénarrable paradigme de la professeur de lycée de capitale qui tapine davantage qu’elle n’enseigne (Anna Schreker dans le putatif roman de Bernhard).
Quant au comédien qui sert d’alibi au dîner et qui rapplique très tardivement de sa grande Première du Canard sauvage ibsénien, son surgissement effectif chez les Auersberger implique une relance de l’acrimonieux moteur de Thomas Bernhard, un déplacement dans l’espace et dans le temps, puisque le narrateur abandonne son fauteuil à oreilles pour s’asseoir à table et que les réminiscences anciennes ou récentes s’estompent significativement au profit de ce qui a lieu et de ce qui se dit pendant le repas, pendant une soupe de pomme de terres et un sandre inappropriés à des heures aussi indues, quoique le sandre soit d’une notable fraîcheur – pas grand-chose d’intéressant hormis d’insipides considérations sur le théâtre, sur les fluctuations de la critique, sur le tout-et-le-rien d’une assemblée de commensaux blasés. Mais bien qu’affectant les bonnes manières et s’appesantissant de toutes les frivolités d’usage lorsqu’il est question de parler pour ne rien dire ou presque, chacun défèque à tour de rôle dans sa cuvette préférée les dénigrements et les diffamations qui lui siéent et ceux qui attendent l’occasion de déféquer ne peuvent s’empêcher de se pencher sur la cuvette allégorique d’un voisin afin d’humer ce qui vient d’être déféqué, puis afin de voir, naturellement, les mensurations de ces médisants fécalomes, les dégradants résultats de ces hommes et de ces femmes qui n’ont pas pu se retenir « [d’ouvrir] la poche anale » (2). Ainsi les échanges vont et viennent selon des états d’âme que Freud eût explorés à satiété, les paroles s’évacuent sans que Thomas Bernhard, en performant Kanalarbeiter, n’en laisse échapper la moindre miette excrémentielle, et cela se poursuit un long moment avant que le comédien ne soit offensé par une interrogation équivoque de Jeannie Billroth. S’ensuit une mémorable mercuriale contre Jeannie Billroth par le comédien courroucé qui au fur et à mesure de ses contre-attaques procède à une décantation alchimique de l’écrivassière enfin ramenée à sa vraie substance de médiocrité. Cet entracte de véracité est d’autant plus étonnant qu’il intervient au cœur d’une fabrication permanente du mensonge. La réaction du comédien est tellement inattendue qu’elle devient l’action qui soumet tous les autres à l’inaction éberluée. D’abord méjugé par Thomas Bernhard, le comédien remonte soudainement dans son estime en cela qu’il a commis oralement ce que l’écrivain ne paraît pouvoir accomplir que par les voies détournées de l’écriture. Doit-on penser que le comédien n’a plus rien à perdre là où Thomas Bernhard semble encore douter d’être en capacité de se révolter avec autant d’homogénéité dans le panache ? Se peut-il que Thomas Bernhard, en dépit de ses décennies de schisme et de ses régulières bravades, n’ait pas la conscience tranquille vis-à-vis de ceux qui lui ont en quelque sorte mis le pied à l’étrier ? Et plus explicitement encore, est-il envisageable que Thomas Bernhard ne nous fasse part de son irritation que parce qu’il est certain au dernier degré d’être à jamais relié à cette matrice de faux jetons – et non parce qu’il serait irrité par une bêtise dont il se sent affranchi ? En tout cas l’épilogue de cette légendaire horripilation va dans le sens de nos hypothèses, dussent-elles un peu atténuer le portrait d’un chevalier total soucieux d’orchestrer la justice des arts et des lettres et le rapatrier au rang d’un écuyer à temps très partiel. Rares en outre sont ceux qui peuvent se prévaloir d’une intégrité exemplaire dans ce si malodorant milieu de la culture et le mérite de Thomas Bernhard est d’avoir honnêtement épongé ses dettes mentales tout en ayant fourni un implacable décryptage de la mentalité mandarinale. Et la proportion de ses dettes étant inférieure à la proportion de son crédit d’individualité, nous ne pouvons que saluer cet homme relativement hybride qui a su voir le Mal en lui avant de le désigner chez autrui – ou cet homme qui sait confesser ce qu’il a de foncièrement pitoyable afin de redoubler d’efforts dans son exercice récurrent de l’impitoyable réprobation.
Notes
(1) Éditions Gallimard, coll. Folio, 1997. Le texte a été traduit de l’allemand en 1987 par Bernard Kreiss (et publié originellement par Thomas Bernhard en 1984).
(2) Antonin Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, thomas bernhard, gregory mion |  |
|  Imprimer
Imprimer

























































