« Pour sauver la raison (et l’humour !), relisons Chesterton, par Radu Stoenescu | Page d'accueil | Le seigneur des porcheries de Tristan Egolf ou le péché de lèse-évolution »
05/05/2023
L’Amérique en guerre (33) : Morts violentes d’Ambrose Bierce, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Stuart Franklin (Magmum Photos).
 L'Amérique en guerre.
L'Amérique en guerre.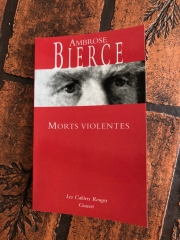 «Je fus souvent dans ma famille un sujet d’étonnement. Ça continue.»
«Je fus souvent dans ma famille un sujet d’étonnement. Ça continue.»Xavier Grall, L’inconnu me dévore.
Ce sont deux guerres civiles qui amorcent et désamorcent la foudroyante existence d’Ambrose Bierce. Il y a d’abord eu la guerre civile américaine, lorsque Bierce n’avait pas tout à fait vingt ans et qu’il devint officier topographe dans les rangs du Neuvième régiment de l’Indiana au service de l’armée fédérale, puis, à un demi-siècle de distance de cette grande déchirure, de cette dissension qui s’obstine aujourd’hui encore à hanter et à désunir les États-Unis, il y a eu la guerre civile du Mexique, la décennie troublée des années 1910, période durant laquelle un écrivain américain septuagénaire prend la décision de rejoindre les partisans de Pancho Villa, les impassibles cavaliers de celui qu’on surnomma le Centaure du Nord, disciple de l’apostolat démocratique de Francisco Madero, jeune homme d’un mirifique idéal qui sut certainement séduire un vieil homme étranger qui avait lutté jadis pour les idéaux de l’Union contre les dogmes réputés infernaux de la Confédération. Ainsi nous savons que le vétéran Bierce part pour le Mexique pendant l’année 1913, nous l’imaginons au moins aussi enthousiaste que Jack Kerouac et Neal Cassady le seront plus tard à l’idée de rejoindre la terre mystique des Aztèques, nous aimons à l’envisager comme l’un des personnages de Conrad Aiken qui se figurent qu’il y a et qu’il y aura toujours un cœur pour les dieux du Mexique (1), un pouls, un mouvement, une poche de vie dans un monde mort, et en cela, évidemment, nous n’interprétons pas l’expédition de l’auteur du Dictionnaire du diable à l’instar d’un suicide truqué, d’un appétit de nécrologie spectaculaire ou d’un last and desperate shot at glory, mais, plutôt, à l’instar d’une renaissance et d’une ultime sanction adressée à son pays qui n’a pas su régler ses durables instincts sécessionnistes et qui aurait pu – s’il l’avait bien voulu – s’adosser à son voisin terrible, à cette nation révoltée qui cherchait à accoucher de ses divines promesses, à ce peuple fort qui n’avait pas abandonné la conception de ce que pouvait être un peuple. On connaît du reste la célèbre lettre du 26 décembre 1913 dans laquelle Ambrose Bierce écrit «Être un gringo à Mexico – ah ça c’est l’euthanasie !», on sait que cette missive constitue ses derniers mots rédigés de sa main prolifique et qu’elle est postée depuis les territoires légendaires de Chihuahua City, on a glosé à profusion sur cet apparent consentement à la mort douce au sein même de la violence révolutionnaire, cela dit, de nouveau, nous préférons faire de cet ultima verba le signe d’un recommencement de la vitalité, la belle opportunité d’un vieillard qui a retrouvé l’élan de vivre et de mourir pour une noble cause, peut-être par lassitude d’une Amérique du Nord où les vivants sont déjà les macchabées d’un Capital en voie d’irréversible expansion, et, donc, rien ne nous empêche d’admettre que Bierce a vécu beaucoup d’années après qu’on a cessé d’avoir de ses nouvelles, tel un François Villon moderne et d’outre-Atlantique, et qu’il aura même survécu à son guide Pancho Villa, pour décéder octogénaire ou nonagénaire, voire centenaire et doyen anonyme d’un quelconque pueblo mésoaméricain, aussi concentré en élan vital qu’une plante désertique subsistant sous les brûlantes chaleurs du vaste Sonora.
Ces fascinantes résolutions d’Ambrose Bierce permettent de prendre la mesure de ses Morts violentes (2) – de ses Tales of Soldiers and Civilians – où le nouvelliste, quelque trente ans après sa longue expérience de la guerre de Sécession, déjoue finalement le zèle de toutes ses sentinelles inconscientes afin de faire monter à la surface de la conscience nationale la sinistre épave de ce désastre ayant fécondé de sa noire semence le Mundus Novus autrefois désigné par la blanche espérance d’Amerigo Vespucci. Chacun des textes de ce recueil d’histoires courtes procède à un amalgame de témoignages directs, de vécus immuables et donc rétifs à toute licence romanesque, et de réalités sordides réinventées par une plume au sommet de son talent, faisant de tous ces éclats de la guerre autant de minces et flambants rouages d’une immense horlogerie tragique (3), parfaitement ciselée dans une écriture économe de ses moyens mais prodigue de ses effets, sonnant des glas terrassants sur l’Amérique septentrionale à jamais blessée. On croirait lire par conséquent la récurrente rubrique nécrologique de tout un pays plutôt qu’une succession de morts atroces racontées avec un mélange d’ostentation et d’inquiétant hors-champ, les descriptions les plus crues et les plus laconiques n’étant pas délestées d’une certaine impression de catastrophe généralisée, d’une létalité plus insidieuse qui dépasse de beaucoup les seules mensurations des cadavres accumulés, des corps cliniquement recensés par l’affolante minutie de l’écrivain. Ainsi la morgue à ciel ouvert dans laquelle avance le narrateur mémorialiste s’alourdit d’une épaisse mise en bière de la Constitution des États-Unis, comme si, définitivement, les serments de 1787 étaient devenus caducs, ensevelis pour l’éternité sous les charniers de la guerre civile et ses lendemains très ambigus. De telle sorte que l’on ne perçoit nulle fierté ou nul indice moralisateur de la part de Bierce ou de son double littéraire, aucune espèce de sentiment de vanité d’avoir appartenu aux troupes des nordistes, des simili-vainqueurs, puisque ceux-ci, autant que les sudistes défaits, auront concouru de tout leur jeune sang à l’impensable parricide de l’œuvre des Pères Fondateurs, crachant a priori sur les tombeaux respectifs de Benjamin Franklin, de George Washington, de John Adams, de Thomas Jefferson, de John Jay, de James Madison et d’Alexander Hamilton, incapables, d’un côté ou de l’autre des lignes de front, de cesser d’entretenir la discorde et la triste et orgueilleuse virilité inhérente aux soldats qui n’ont plus que cela pour braver leur condition, pour tourner le dos à l’entreprise de dévirilisation qu’ils ont subie, privés d’une éventuelle paternité, déshumanisés au carré par de froids et belliqueux démagogues, agitateurs de cervelles perméables et fomentateurs de finasseries déguisées en arguments.
Les uns et les autres, les tuniques bleues et les tuniques grises, n’ont alors pas vu qu’ils étaient les victimes d’une frauduleuse actualité et qu’ils n’auraient pour déplorable destin que l’inactualité «des tombes [vouées à être] depuis longtemps oubliées» (p. 182), telles ces «tombes délaissées» qui ponctuent d’un marbre brisant le Middlemarch de George Eliot après que les anonymes de ce monde ont sauvé ledit monde en se dévouant dans la contrebande des justes pour lesquels aucune renommée n’est admissible, façon de croire a posteriori que le funeste aveuglement des soldats et les crachats sacrilèges qu’on leur avait imputés pourraient trouver une rédemption au cœur de ces perpétuités tombales parce que tous ceux qui reposent sous une terre qu’on ne regardera ni ne foulera plus sont ceux qui participaient à leur manière paradoxale à «la croissance du bien dans le monde» et dont les actes «n’ont rien d’historique» (4) – car mourir par exemple dans la masse mourante et méconnaissable de la guerre de Sécession, mourir massivement, mourir confusément est un anonymat qui ressemble davantage à une armée de misérables honnêtes gens trompés par une minorité de traîtres, mystifiés par une petite mafia de félons soucieux d’être inscrits sur les tablettes de l’Histoire selon les arabesques de n’importe quelle calligraphie convoyeuse de gloire.
C’est pourquoi nous parvenons à pardonner Ambrose Bierce pour autant qu’il faille lui pardonner quelque chose : nous l’amnistions de sa mélancolie terrorisée qui peut accabler ou rebuter, nous le lisons moins pour saisir le grégarisme des troupiers que pour remettre en perspective l’aberrante indépendance des chefs, nous le relaxons de sa culpabilité sous-jacente, de son effroi contagieux et de son désarroi devant la jeunesse dupée au Nord comme au Sud, et notre pardon – qui vaut ce qu’il vaut – désire tracer une ligne de partage des eaux entre les eaux bénites du sang versé des innocents et les eaux maudites des mandataires du sang, des Trafiquants du Sang, de ces obscurs décisionnaires qui décident l’indécidable, de ces «âmes turpides qui vont aux turpitudes», de ces «âmes serviles qui vont aux servitudes», pendant que «les imbéciles vont à l’honnêteté» (5) avec une infaillible régularité de fantoches, le soldat qu’on envoie au casse-pipe incarnant l’invariable représentant de l’imbécillité multipliée par la probité, l’irrévocable spécimen de celui qui n’arrive à rien sinon à la mort précoce et injustifiable dans la mesure où des arrivistes arrivent à tout dans les bureaux démentiels qui mettent les guerres en ordre de marche. De ce fait ne commettons jamais l’erreur de condamner la soldatesque et sa cécité pardonnable au même titre que nous condamnons les impardonnables bureaucrates qui jettent des poudres aveuglantes dans les yeux de l’innocence, vils calculateurs qui calculent jusqu’au moindre centimètre carré de terrain exploitable pour que la guerre se déroule et qu’elle distribue son carnage, pour que leur encre de fonctionnaires éjacule une volupté de minuscules jouisseurs du pouvoir, qu’elle se soulage d’un effronté contentement d’hédonistes de la nuisance, et que toute cette méprisable confrérie de libertins ministériels se prenne derrière ses dossiers militaires pour des géants, des titans, pour de toutes nouvelles divinités susceptibles de refaçonner la Création, pour des courageux qui n’ont que leurs fonctions exécutives pour dissimuler leurs lâchetés. Et c’est à cause d’eux bien entendu qu’il «n’est pas de pays si désert et si accidenté que les hommes n’en fassent le théâtre de la guerre» (p. 16), parce que ce sont eux, inéluctablement eux, qui arrachent à l’intouchable Nature ses pudeurs sacrées, ses vêtements bibliques, la profanant, l’abusant, la prostituant sous les exhortations maléfiques d’une Culture de la destruction et du blasphème systématiques, s’enfonçant dans les plus improbables des espaces naturels pour y introduire le priapisme de la fatuité prétendument civilisée mais totalement barbare. On comprend dès lors le traumatisme enfoui d’Ambrose Bierce, traumatisme exhumé victorieusement par la littérature, la profonde commotion de celui qui fut un scrupuleux officier en topographie pour ces ordonnateurs de la désunion humaine et ces régisseurs de la dénaturation du tableau de l’univers non-humain.

La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.




























































 Imprimer
Imprimer