« Les voies du Stalker, 2 : entretien avec Michel Lévy-Provençal (Mikiane) | Page d'accueil | Lettre sur Benjamin Fondane, par Daniel Cohen »
27/05/2006
Marc-Édouard Nabe le si peu bloyen + Entretien avec Pierre Glaudes

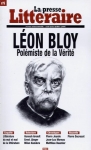 Il me faut être tout à fait juste. Après avoir très durement critiqué La Presse littéraire de Joseph Vebret pour son dramatique débraillé rédactionnel, je fais le constat à présent d'une nette amélioration de la qualité d'ensemble du tout dernier numéro de cette revue, désormais trimestrielle et réduite à un format plus agréable que le précédent.
Il me faut être tout à fait juste. Après avoir très durement critiqué La Presse littéraire de Joseph Vebret pour son dramatique débraillé rédactionnel, je fais le constat à présent d'une nette amélioration de la qualité d'ensemble du tout dernier numéro de cette revue, désormais trimestrielle et réduite à un format plus agréable que le précédent. Constat également valable pour son dossier, tout entier consacré à Léon Bloy, initiative suffisamment rare pour être saluée. Et puis... Nous voici tout de même à quelques salutaires années-lumière du lamentable Philippe Sollers, écrivant-tartuffe auquel a été consacré le précédent dossier de La Presse littéraire.
Une déception tout de même, due à Giovanni Dotoli, dont l'article, qui s'approche, je l'en loue, des normes universitaires habituelles à l'un de meilleurs connaisseurs de Bloy, Émile Van Balberghe, me semble toutefois trop vague, hésitant entre l'affirmation d'un Bloy poète et celle d'un Bloy visionnaire.
En fin de compte, je n'ai pas bien su que penser de sa thèse brouillonne. Il faut préférer, de Stéphane Beau, plutôt que ses ridicules et verbeux comptes rendus d'ouvrages (le comble du grotesque et de l'insignifiance critique me paraît atteint avec le papier de Beau sur American Vertigo de Bernard-Henri Lévy), l'article somme toute honnête qu'il a consacré aux relations complexes entre Bloy et Huysmans, même si ce travail souffre à l'évidence de ne point s'être inquiété du fait que, sur ce thème de l'amitié orageuse entre les deux célèbres écrivains, une bonne dizaine d'articles beaucoup plus fouillés que le sien existent, et depuis quelques années tout de même.
Comme toujours, les articles de Raphaël Juldé sont à son image monochrom(at)ique : lisses, honnêtes, agréables à lire, parfois même, apparemment lorsque leur auteur a délaissé, l'espace d'une inspiration vite condamnée, sa légendaire consommation de jus d'orange... assez verts si je puis dire et ils restent donc parfaitement insignifiants.
Jean-Jacques Nuel, évoquant dans un excellent petit texte la récente réédition du Pal par les éditions de L'Obsidiane, a fort raison de moquer la préface que Patrick Kéchichian, notre risible pamphlétaire ouaté, a donnée à ce beau volume rassemblant les cinq numéros de cette revue éphémère et d'une violence qui aujourd'hui ferait détaler tous les lapins du journalisme. Clôturant ce dossier qui certes ne m'a rien appris mais qui, de toute évidence, intéressera les lecteurs connaissant peu les livres du Mendiant ingrat, la courte étude aux accents fâcheusement métaphoriques d'Amadeo del Duca évoque l'intérêt que Léon Bloy porta aux écrits et à la figure du peu connu Jehan Rictus. Rappelons que c'est Bloy qui le tout premier a salué Les Chants de Maldoror...
Quoi d'autre ? Un bizarre article de Méryl Pinque qui, portant mention dans son sous-titre du diable, n'évoque pas une seule fois l'hôte inconvenant de toute entreprise littéraire (et bien sûr, plus largement : artistique, comme Gide l'écrivit à la suite de Blake) un tant soit peu sérieuse.
Il est vrai que Pinque, comme elle me l'a elle-même appris, ne croit pas au diable mais seulement à la part diabolique tapie en l'homme, nuance d'importance... Certes, si tout un chacun peut ignorer (ce qui est moins grave que de les mépriser) certains textes des plus hautes instances catholiques, qui, sur la redoutable question de l'existence du démon, sont pourtant dénués de la plus petite ambiguïté, j'aurais toutefois attendu, de la part de Pinque, un peu plus de profondeur et de discernement littéraires (Sade et Bataille : oui mais...) quant aux auteurs et à la façon même dont elle a évoqué ce sujet qui me passionne de longue date.
Délaissons à présent les meilleures plumes, c'est dire, de La Revue littéraire pour nous aventurer dans ses pénéplaines et ses basses fosses. Je remercie d'ailleurs chaleureusement Joseph Vebret qui pour une fois a joué son rôle de physionomiste (je préfère le terme peu hermétique de videur) à l'entrée de sa bien peu regardante auberge espagnole, puisque les plus nullissimes plumes qui déparaient, jusqu'à maintenant, La Presse littéraire ou bien La Revue du cinéma, j'ai nommé Adeline Bronner et Élizabeth Flory, ne sont pas ou peu présentes.
En attendant de relire et de corriger, comme elle sait si bien le faire, les tirages de la torcheculative Gazette des Lettres cavernicoles du Bazois-en-ânesse, Flory l'autofictive a tout de même lâché dans ce numéro de La Presse littéraire quelques lignes sans saveur ni tenue, passant, selon ses habitudes, de la dinde chypriote à la poule bressane.
Laissons nos deux très fines illettrées à leurs travaux de tricotage d'une critique plus ténue que la gaze et revenons à Bloy, démon coruscant des lettres françaises admiré par un Kafka, par un Borges, par un Barthes même, ce qui n'a tout de même pas suffi, malgré les objurgations que m'a adressées à ce sujet Sarah Vajda, à me le rendre intéressant (il est vrai que l'article du critique sur l'écrivain n'est tout de même pas exactement décoiffant), par un Nabe aussi... Justement, Zannini.
Voici un vieil entretien que je fis jadis paraître dans ma revue, Dialectique et qui, dans une version abrégée, fut repris par Bruno Deniel-Laurent pour le numéro hors-série de Cancer ! consacré à Léon Bloy. Interrogeant Pierre Glaudes, de loin le meilleur connaisseur de l’œuvre de Bloy en France, cet échange fut réalisé par Rémi Soulié et moi-même. Que Marc-Édouard Nabe, s'il me lit, s'inspire de ces lignes érudites, lui qui affirme (dans le premier numéro de La Vérité, novembre 2003) que les cancéristes n'ont rien compris au génie bloyen. C'est peut-être vrai, peu importe, aucun d'entre eux n'ayant prétendu être écrivain. Encore moins se réclament-ils à hue et à dia du rugissant polémiste. Nabe lui, ne cesse de le citer, multipliant depuis son Régal des vermines, sur l'auteur du Salut par les Juifs, les mots d'auteur dignes du plus louche éclat de quincaillerie orientale. En fait, ce que Nabe oublie, c'est que Bloy n'a gueulé et éreinté les imbéciles de toutes espèces, et Dieu sait qu’elles sont nombreuses, que dans l'unique espérance de hâter la Venue, en condamnant, en somme, les imbéciles à l’Enfer que l'on pourrait dès lors affirmer être comme l'éternité d'une venue qui jamais ne vient. Alain Zannini, lui, se complaît (il y patauge même) dans une colère de salon parisien et une outrance sexuelle qui, bien avant de détuméfier son monstrueux organe (est-ce si sûr ?), fatigue son lecteur le plus attentif et ne parvient guère à nous suggérer l'existence d'une autre vérité par-delà le miroir déformant de l'apôtre, vérité qui, dois-je vraiment le rappeler, était l’unique nourriture de Bloy.
L'Enfer de Nabe, c'est lui-même, le cachot le plus sûr ayant été inventé pour emmurer vivant le nain prolifique. L'Enfer de Bloy, c'est une réalité qui serait totalement essorée de Dieu. Est-elle seulement pensable pour celui qui crut dénicher l'éclair du divin jusque dans les glaviots les plus insipides du Bourgeois ? Ce que j'écrivais à propos du roman Alain Zannini dans ma Critique meurt jeune se vérifie donc à mesure que je lis Nabe/Zannini : l'homme est consumé par une haine maladive (qui n’est pas toujours drôle, à la différence des diatribes bloyennes) étouffant sa charité et l’écrivain, lui, qui est exactement le même, je le précise à tout hasard, que le personnage public (c'est bien leur stricte identité qui constitue la seule et unique croix de Nabe, apparemment de plus en plus lourde à porter pour le gringalet), s’est enlisé dans les dunes du désert irakien même s'il reste un redoutable chameau.
Un dernier mot enfin. S’il faut absolument les comparer, alors je n’hésite pas un instant avant d'affirmer que la sincérité totale, parfois pataude il est vrai, de l’écrivain Dantec est évidemment infiniment plus bloyenne ou bernanosienne que les pitreries réalisées devant le miroir de Zannini/Nabe et, si je dois avancer un sentiment sur l’homme que je connais et apprécie, Dantec me paraît un être d'infiniment plus de... poids que l'éthéré Zannini, petit maigrichon occupé de lui seul, écrivain raté, c'est lui qui le gueule sur tous les toits; on ne va tout de même pas, à présent qu'il daigne la retourner contre lui, chicaner sur la légendaire sincérité de Nabe n'est-ce pas ?
Il est certes vrai que l'envie provoque parfois, sans que l'on sache bien quelle responsabilité incombe à celui qui la déclenche et la subit, de telles cruelles ironies. Contemplant ainsi le triste spectacle que nous donne Nabe, je suis à peu près certain que le fantôme de Léon Bloy, peut-être pas encore fatigué de traîner tout près de son héritier auto-proclamé, doit partir d'un immense rire. Et il y a fort à parier, ultime facétie de l'Invisible qui en est un prodigue coutumier, que Nabe dont l'oreille absolue n'est apparemment pas qu'une légende inventée par ce musicien de l'ironie, est le premier à entendre ce long rire dévastateur.
Voici la première partie de notre entretien.
Rémi Soulié : Pierre Glaudes, vous êtes à la fois un universitaire «classique» par votre formation et atypique par votre manière certes très savante mais surtout très personnelle d'aborder les textes. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à Léon Bloy ?
Pierre Glaudes : Je suis venu à Léon Bloy par Huysmans, ce qui paraît un peu monstrueux pour les bloyens classiques ou les huysmansiens de «stricte obédience». J'avais d'ailleurs effectué un travail en deuxième cycle universitaire sur le pessimisme de Huysmans qui m'avait conduit à lire les ouvrages parus dans les années 1880-1887, période qui m'intéressait dans l’œuvre de Huysmans et, naturellement, j'avais été amené à lire Le Désespéré. De surcroît, Bloy m'a peut-être plus encore intéressé que Huysmans dans la mesure où il correspond assez bien à l'un des critères qui définissent pour moi ce qu'est un grand écrivain : une formidable résistance de l'écriture. Avant de pouvoir dire que l'on domine cette écriture, qu'on en comprend les enjeux et le fonctionnement, il faut beaucoup de temps et je ne suis pas sûr que l'on puisse même parvenir à des certitudes en cette matière – alors qu'elle paraît beaucoup plus accessible ou probable ou possible lorsque l'on considère des écrivains de second ou de troisième rayon.
R. S. : Qu'est-ce qui selon vous constitue la singularité radicale de Léon Bloy, d'un point de vue religieux, d'un point de vue politique et d'un point de vue stylistique ?
P. G. : Vous posez-là une bien vaste question. Il faut éviter de considérer Bloy comme un Décadent. Sa singularité ne se résorbe pas dans la littérature fin-de-siècle, pour une raison très simple : lui-même a toujours démenti la moindre affinité avec les groupes littéraires de son époque; sa situation dans l'espace littéraire, il l'a vécue comme une sorte de paradoxe ou de solution temporaire qui ne le dispensait pas de viser plus haut ou au-delà de la littérature, vers la sainteté. Il y a pour Bloy un au-delà de la littérature qui l'amène forcément à penser la littérature de la manière la plus paradoxale qui soit : elle n'est possible qu'à condition de se déposséder soi-même de toute parole pour laisser résonner en soi une autre parole. La littérature devient le lieu paradoxal d'émergence d'une autre parole, qui est évidemment quelque chose comme un écho du Verbe. La deuxième singularité qui détache Bloy des Décadents et même de ceux que l'on a coutume d'appeler les Symbolistes, c'est sa théorie de la figure, qui est enracinée dans une tradition médiévale évidemment chrétienne, laquelle conduit à ce qu'il a appelé lui-même le «symbolisme universel» : au nom de celui-ci, Bloy lit tout événement, toute histoire, à commencer par l'Histoire, comme une sorte de reformulation mystérieuse et symbolique du texte fondamental dans lequel toute l'Histoire se résorbe, le seul texte qui fut jamais, la Bible.
Juan Asensio : Dans l'introduction au Journal de Bloy, vous mentionnez le nom de George Steiner ; nous savons par quels mots douloureux se termine son ouvrage le plus célèbre, Réelles Présences : «Il est une journée bien particulière de l'histoire occidentale dont ni l'histoire, ni le mythe, ni les Écritures ne parlent. Il s'agit d'un samedi. Et ce samedi est devenu le plus long des jours. […] notre époque est celle du long samedi. Entre la souffrance, la solitude, l'inexprimable destruction d'une part et le rêve de libération, de renaissance de l'autre.» Jacques Vier pense que l’œuvre de Bloy se situe, elle, comme celle de Pascal, dans un perpétuel Vendredi : «Tout se passe, pour Léon Bloy, comme si les infidélités et les apostasies croissantes maintenaient le Golgotha, oserait-on dire, au préjudice de la Résurrection. Le monde auquel appartient Léon Bloy l'enclôt dans un Vendredi Saint permanent [...].» Que pensez-vous d'une telle affirmation ?
P. G. : Vous présentez deux points de vue, celui de George Steiner et celui de Jacques Vier, qui ne sont pas exactement les mêmes. Steiner parle d'un perpétuel Samedi, en référence au Samedi Saint, alors que Vier parle d'un perpétuel Vendredi Saint. De ces deux affirmations il me semble que la première convient le mieux à Bloy. Pour lui, le paradoxe central de l'Histoire n'est pas celui du Vendredi Saint ni du Dimanche de Pâques mais bien celui du Samedi, qui est le temps de l'attente. Ce paradoxe tient à ceci que la Rédemption est accomplie tout en restant malgré tout inaccomplie. Cette sorte de contradiction dans les termes est parfaitement déchirante. Pour expliquer cet inexplicable mystère, Bloy est conduit à penser l'Histoire de Dieu comme celle des atermoiements mystérieux de la Providence et à référer ces atermoiements à une inexplicable contradiction au cœur de la Trinité elle-même, contradiction qu'il pense en termes de conflit entre le Fils et l'Esprit – ce qui est sans doute la clé de sa réflexion théologique et qui le conduit à ce paracléto-luciférianisme que l'on a souvent remarqué. La contradiction est que l'Esprit, temporairement et mystérieusement, est travesti en son contraire, Bloy jouant sur la polysémie de Lucifer, à la fois ange du matin donc porteur de lumière, et ange du soir prince des ténèbres.
J. A. : Le problème de la représentation littéraire du Mal, nous le savons, fut la préoccupation constante de ces écrivains éminents que furent Maistre, Claude de Saint-Martin, Barbey, Blanc de Saint-Bonnet, Bloy ou Bernanos. N'est-ce pas, justement, cette radicale nouveauté de la tentative de représentation menée par ces auteurs qui, aujourd'hui, nous permet d'affirmer sans ambages leur étonnante modernité ? N'est-ce pas aussi le fait que, avec une remarquable continuité, ces écrivains ont tenté d'évoquer le mystère de la transcendance en empruntant la voie souterraine du démoniaque – comme le rappelle le célèbre proverbe portugais chéri par Claudel – qui confère à leur œuvre la portée soulignée par Pierre Boutang dans ses Abeilles de Delphes : «Le mal et la bassesse sont la seule transcendance qui puisse, à la rigueur, éveiller un monde assez oublieux des hiérarchies pour se faire raison de son ignominie et la résorber dans la nature».
P. G. : Je serai beaucoup plus bref pour répondre parce que je suis absolument d'accord avec vous, c'est d'ailleurs un point que j'aurais dû ajouter pour compléter ma réponse. En effet, cette réflexion théologique de Bloy a l'immense mérite de ne pas trop rapidement diluer la question du Mal dans une histoire du salut. Cette contradiction déchirante au cœur de la théologie bloyenne qui laisse en suspens, en proie à une aporie, la question de l'histoire du salut, a pour effet de faire venir au premier plan l'énigme du Mal, et c'est en ce sens qu'elle est profondément moderne.
J. A. : De la même façon, mais en somme inversée ou retournée, l'écriture bloyenne se propose de signifier la présence de Dieu, dans une voie d'approche que nous pourrions qualifier d'apophatique. Vous le dites mieux que moi, à propos des succulentes Histoires désobligeantes : «La Réalité divine, parce qu'elle excède les possibilités du langage, ne saurait être présente qu'en creux, si elle n'est approchée de biais. D'où les lacunes des Histoires désobligeantes, les blancs qu'aucune information ne vient combler, lorsque Dieu apparaît : une nappe de silence se répand sur les contes et communique au lecteur un sentiment d'étrangeté.» L'extrême ambiguïté de la démarche de Léon Bloy n'est-elle pas à rapprocher de celle qu'illustrent certains textes de mystiques (je songe, par exemple, à ceux d'Angèle de Foligno traduits par Ernest Hello), tentative d'ailleurs reprise par Bernanos dans Monsieur Ouine ?
P. G. : Oui, c'est bien une démarche apophatique que celle de Bloy. Le Dieu bloyen n'est pas essentiellement un deus absconditus tel que le conçoivent les tenants de la doctrine augustinienne, mais plutôt un deus ignotus, un Dieu qui s'est retiré et qui se tait. Dès lors, on ne peut Le connaître que par la voie négative, en effet. Dieu est en effet l'in-quelque chose; l'in-fini, l'in-commensurable, l'in-connaissable, l'in-nommable par certains côtés. Le Dieu bloyen est innommable. Si cette démarche s'enracine à l'évidence dans la mystique, elle n'en est peut-être pas moins en relation problématique, dans un siècle qui proclame la mort de Dieu ou qui est hanté par cette possibilité, avec l'a-théologie de Bataille ou de Klossowski.
R. S. : Gripari voyait en Léon Bloy un «Céline chrétien». Qu'en pensez-vous ?
P. G. : La formule est consacrée, mais elle relève un peu du lieu commun. Je trouve qu'elle est contradictoire, oxymorique : Céline chrétien, ce n'est plus tout à fait Céline, et Léon Bloy célinien, ce n'est plus tout à fait Léon Bloy. Cela dit, on voit bien ce qui peut motiver le rapprochement : le génie de l'invective que l'on trouve évidemment chez l'un et chez l'autre. Il me semble néanmoins que comparaison n'est pas raison. Même si indéniablement Céline ressemble par certains côtés à Léon Bloy, on pourrait tout aussi bien pointer du doigt tout un ensemble de différences qui les séparent radicalement. Il y a, aussi, un aspect essentiel de Bloy que l'on minore trop souvent : sa violence n'est compréhensible qu'en relation dialectique avec sa douceur, de même que sa scatologie n'est pensable que dans un lien indissociable avec une eschatologie. De même, le grotesque bloyen n'est jamais séparable d'une ambition sublime. Bloy n'était pas simplement un vomisseur, quelqu'un qui avait toujours l'invective à la bouche. Il a vécu dans une petite communauté qu'il a su constituer peu à peu autour de lui, les Van der Meer de Walcheren, les Termier, les Maritain, Auric, Rouault et tant d'autres qui en ont été les témoins.
J. A. : Nous pourrions dire de Léon Bloy qu'il fut l'écrivain de l'attente : attente de la Venue annoncée par une myriade de signes secrets ou grotesques (ainsi, notre auteur s'apparente-t-il à ces écrivains de la Renaissance pour lesquels tout était signe de Dieu). Il écrit d'ailleurs, en 1917 : «Sans doute il faut attendre et toujours attendre, je l'ai beaucoup dit. Cependant l'heure attendue ne peut pas être bien éloignée maintenant. Il n'y a plus d'espérance humaine. Les aveugles s'en aperçoivent enfin et les pires brutes commencent à sentir la nécessité d'un renouveau. Il faut que tout meure ou que tout change. On est à l'automne du monde. La végétation des âmes est interrompue et l'hiver approche avec toutes les épouvantes.» C'est cette perpétuelle et douloureuse attente, confortée d'ailleurs par ce qu'il est convenu d'appeler «le secret» de Bloy, qui sans doute empêcha l'auteur de désespérer lorsqu'il traversa les sombres heures de la misère. Dans quelle mesure prudente (prudente, parce que l'auteur lui-même refusait la comparaison) peut-on, selon vous, rapprocher l'expérience de Bloy de celle du prophète ?
P. G. : Vous touchez là aussi un point essentiel, la question du prophétisme de Bloy. Évidemment, son œuvre est hantée par la figure du prophète. Bloy a campé par bien des côtés un personnage de prophète des temps modernes. Lui-même a proposé, notamment dans son Journal, maintes réflexions sur l'identité, la définition même d'un regard prophétique sur les choses. Reste que lorsqu'on l'a pris au mot et lorsqu'on a vu en lui un vrai prophète, sa réaction a été tout à fait inattendue. Autrement dit, Bloy, quand on le prend au mot du prophétisme, nous rappelle sans cesse qu'il ne parle que par images, qu'il n'est qu'un écrivain et que d'une certaine manière, on ne saurait le confondre avec un véritable prophète. Il y a une contradiction, une tension propre à Bloy, entre ce qui est une tentation, un horizon, un modèle possible de la parole qu'il voudrait incarner, et un inaccessible vers lequel la prudence, l'humilité et peut-être une part d'effroi l'empêchent d'aller. Je crois que la question n'est pas simple et qu'elle touche justement au plus profond: ce qui peut séparer un homme, dans le plus profond de son ontologie, d'un écrivain qui forcément campe une figure dont l'espace de réalisation première est, doit rester et reste l'imaginaire.
R. S. : Existe-t-il à vos yeux un héritage littéraire de Léon Bloy dans la littérature française contemporaine ?
P. G. : Indéniablement, des écrivains se réclament de Bloy ou du moins, ils se présentent comme des lecteurs férus ou intéressés. On connaît le cas de Michel Tournier qui n'est pas bloyen mais qui s'intéresse au rire de Bloy, à ce qu'il appelle le rire blanc de Bloy. Jean-Edern Hallier, Philippe Sollers, lorsque nous avons préparé le Cahier de l'Herne sur Bloy, dans les années quatre-vingt, ont manifesté de la sympathie et de l'intérêt pour lui. Parmi les plus jeunes, il y a évidemment Marc-Édouard Nabe, amateur et propagateur de Bloy. Lui-même tient un Journal, sinon inspiré du moins nourri de la lecture du Journal du Bloy.
Entretien réalisé à Toulouse le 29 mars 2000, publié dans le n° 8 de la revue Dialectique puis dans le hors-série de la revue Cancer ! consacré à Léon Bloy.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, léon bloy, marc-édouard nabe, pierre glaudes |  |
|  Imprimer
Imprimer




























































