« Seconde Odyssée. Ulysse de Tennyson à Borges d'Évanghélia Stead | Page d'accueil | Histoire secrète du Costaguana de Juan Gabriel Vásquez »
09/04/2010
Pierre-Emmanuel Dauzat et Michel Surya ou Judas revu et corrigé
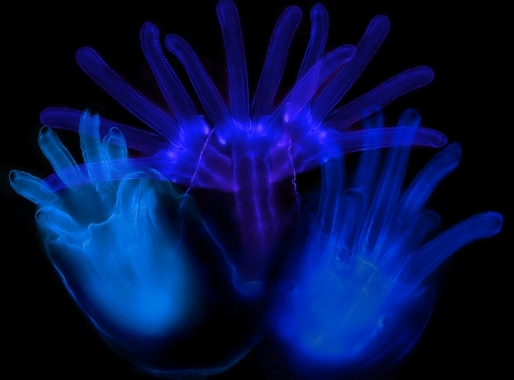
Crédits photographiques : Albert Tousson et Tomek Szul (Department of Cell Biology The University of Alabama at Birmingham).
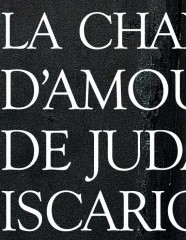
Remise en une d'une note publié le 23 février 2007.
 Le Cerf vient de publier, dans une traduction française augmentée par l'auteur, le petit livre très dense, extraordinairement précis et documenté bref, maîtrisant remarquablement un sujet difficile et source de sempiternelles querelles entre spécialistes, de Hans-Josef Klauck consacré à Judas (Judas, un disciple de Jésus, dans la collection Lectio Divina). Pour caractériser en revanche l'ouvrage (lui aussi ayant pour thème Judas) de Pierre-Emmanuel Dauzat que j'évoquais ci-dessous, et afin de ne point trop accabler son auteur..., je pourrais utiliser l'adjectif impressionniste ou plutôt, comme Klauck l'écrit lui-même, romantique : «On pourra être surpris, écrit Klauck, de ce que dans ce qui précède on n’a pas tenté d’absoudre Judas de toute faute. Il me semble qu’une telle tentative, quel que soit le caractère honorable de ses motifs, est le fruit d’un faux romantisme qui ne résiste pas à un examen réfléchi des textes» (Hans-Josef Klauck, op. cit. (Cerf, coll. Lectio Divina, 2006 [1987]), p. 165).
Le Cerf vient de publier, dans une traduction française augmentée par l'auteur, le petit livre très dense, extraordinairement précis et documenté bref, maîtrisant remarquablement un sujet difficile et source de sempiternelles querelles entre spécialistes, de Hans-Josef Klauck consacré à Judas (Judas, un disciple de Jésus, dans la collection Lectio Divina). Pour caractériser en revanche l'ouvrage (lui aussi ayant pour thème Judas) de Pierre-Emmanuel Dauzat que j'évoquais ci-dessous, et afin de ne point trop accabler son auteur..., je pourrais utiliser l'adjectif impressionniste ou plutôt, comme Klauck l'écrit lui-même, romantique : «On pourra être surpris, écrit Klauck, de ce que dans ce qui précède on n’a pas tenté d’absoudre Judas de toute faute. Il me semble qu’une telle tentative, quel que soit le caractère honorable de ses motifs, est le fruit d’un faux romantisme qui ne résiste pas à un examen réfléchi des textes» (Hans-Josef Klauck, op. cit. (Cerf, coll. Lectio Divina, 2006 [1987]), p. 165).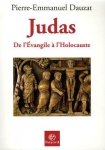 Bordant, presque systématiquement, mes longues, difficiles et périlleuses recherches en démonologie, la figure maudite de Judas n'a jamais cessé de me fixer de son regard mauvais, à la fois torve et désespéré. J'ai d'ailleurs écrit, sur l'apôtre-félon, un étrange manuscrit dont je m'étais résolu à en publier, dans la Zone, quelque extrait [avant de le supprimer], presque définitivement résigné à ne pouvoir faire paraître mon texte, pourtant court et, selon les commentaires autorisés d'un Michel Surya (nous y reviendrons) fasciné par le difficile sujet, excellent.
Bordant, presque systématiquement, mes longues, difficiles et périlleuses recherches en démonologie, la figure maudite de Judas n'a jamais cessé de me fixer de son regard mauvais, à la fois torve et désespéré. J'ai d'ailleurs écrit, sur l'apôtre-félon, un étrange manuscrit dont je m'étais résolu à en publier, dans la Zone, quelque extrait [avant de le supprimer], presque définitivement résigné à ne pouvoir faire paraître mon texte, pourtant court et, selon les commentaires autorisés d'un Michel Surya (nous y reviendrons) fasciné par le difficile sujet, excellent.J'attendais donc avec une réelle impatience la publication de ce livre tout entier consacré à l'histoire et au mythe de Judas que Pierre-Emmanuel Dauzat, rencontré lors d'un cocktail saluant la parution du Cahier de l'Herne consacré à George Steiner, m'avait déclaré, alors, de sa voix prudente et timide, écrire sans relâche. Je viens d'en terminer la lecture et mon sentiment est pour le moins foncièrement dubitatif, pas tant sur le seul travail de compilation (encore que...) accompli par Dauzat que sur les conclusions auxquelles parvient son enquête et surtout sur l'étrange sueur qui transpire de ces lignes. Quant à la méthode analytique choisie, l'essai de Dauzat hésite entre une approche rigoureusement historique, balayant les représentations littéraires (avec quelques trop rares excursions dans les domaines de la peinture et de la musique) de Judas au travers des âges, et une autre voie, plus thématique, davantage consacrée à dresser un portrait physique de l'apôtre : l'extrême foisonnement des mentions de Judas dans la littérature apocryphe chrétienne est ainsi bien trop vite balayé.
Des défauts beaucoup plus graves que cette drôle de forme entachent cependant cet essai. D'abord, il est pour le moins étonnant, alors que des dizaines de pages sont consacrées au cas tout de même peu intéressant, d'un strict point de vue littéraire, du Judas de Roman Gary ou de celui de Scholem Asch, parfait inconnu, que la plus petite ligne n'évoque point le Judas de Chesterton ou encore celui de Conrad tel que le génial romancier l'a peint dans Lord Jim. On me rétorquera que le principe d'un corpus est justement d'opérer un tri et je répondrai qu'il eût mieux valu dans ce cas, plutôt que de recycler de vieilles pages (Dauzat ayant déjà écrit sur Romain Gary), évoquer, pourquoi pas sous un nouvel éclairage, des textes moins célèbres mais tout aussi riches, sinon plus, que ceux que Dauzat a retenus. J'ai tout de même été sensible au fait que l'auteur mentionne, toutefois bien trop sommairement et comme s'il était pressé de passer à autre chose, la figure du traître, fort discrète au demeurant mais pas moins complexe, que Paul Gadenne imagine dans ses remarquables Hauts-Quartiers. Dauzat, tout de même, aurait encore pu signaler, fût-ce de quelques mots, la figure démoniaque telle que Georges Bernanos (qui, nous rappelle pourtant l'essayiste, priait, enfant, pour le salut de l'âme de l'apôtre félon) l'a campée dans La Joie : énigmatique suicidé dressé en face du Christ agonisant, que Chantal de Clergerie, l'âme pure, ne peut se résigner à abandonner dans son cachot infernal. Bernanos n'a pas attendu Dauzat pour appliquer la parole folle, extraordinaire, du saint : ad in inferno damnatos extendebat caritatem suam, et cela même sans tenter d'excuser le traître. Foin des pleurnicheries et des gémissements contristés : il s'agit d'aller chercher le maudit où il se trouve, en Enfer. Bernanos et d'autres grands romanciers, à coup sûr, y sont descendus. Dauzat, lui, plane loin au-dessus de la fournaise, au chaud, si je puis dire, dans son petit bimoteur larmoyant, se contentant de lâcher quelques tracts avertissant les damnés de l'imminence du pardon universel, distribuant les bons et les mauvais points. Sur un tel sujet, n'étions-nous pas en droit d'attendre autre chose que le devoir appliqué, moralisateur, d'un pion dolent ? Peut-être, oui, une véritable plongée dans les ténèbres...
D'autres défauts, rhédibitoires cette fois-ci, font de cet essai une étude à mon sens partiellement ratée, à la fois ambitieuse par son sujet et ridiculement atrophiée dans ses pourtant vagues prétentions universitaires, à vrai dire quasiment inexistantes : la rigueur scientifique est pour le moins, sous la plume de notre essayiste, une constante floue, une constante inconstante si je puis dire. On me fera remarquer, une fois de plus, que le lectorat visé par ce type d'ouvrage n'est pas forcément élitiste. J'aurais toutefois beau jeu de répondre que la précision est une donnée appréciable, y compris des non-spécialistes, surtout, peut-être, dans ce genre d'ouvrage bâtard, voguant entre deux eaux. C'est donc moins la méthodologie (même si les premiers chapitres de l'ouvrage, je l'ai dit, ont quelque peine à choisir entre l'étude historique et la voie thématique) suivie par le célèbre traducteur de George Steiner que ses commentaires, à vrai dire constants et singulièrement sots, qui m'ont profondément agacé. Ces curieuses incises sans incisives, le jeu de mots facile convient assez bien à la désinvolture de roquet herméneutique que pratique à l'occasion Dauzat, à la fois coléreuses et étrangement femmelines, c'est-à-dire aigries, impuissantes, l'auteur semble, avec une magnifique obstination, les réserver à un seul écrivain, Pierre Boutang et, au travers de sa remarquable Ontologie du secret que Dauzat devrait d'ailleurs se dépêcher de vite relire en ne tentant point d'y flairer quelque antisémitisme larvé, à ces auteurs qui, tels Drumont et Maurras (surnommé, un peu facilement, le «fou du roi»), ont stigmatisé, à travers Judas, le Juif. Certes, ces commentaires ne seraient que stupides et désobligeants, suffisant donc à nous détourner d'un essai splendide (ce que le livre de Dauzat n'est point) s'il n'y avait, là aussi d'une façon récurrente et proprement accablante pour le lecteur, de sempiternelles jérémiades versées d'abondance sur le sort ignoble qui, au travers des âges, a été réservé à Judas. C'est que Pierre-Emmanuel Dauzat, partant du constat que tous nous avons, en quelque sorte, condamné l'apôtre à se pendre, n'a de cesse de larmoyer sur son sort et de tenter, de fait, de l'arracher de la Géhenne dans laquelle il s'est volontairement exilé, afin de précipiter le triomphe du Fils de Dieu : bien sûr, c'est là que l'intention dépasse, de très loin, la réalité de l'acte, le sauvetage est moins réel que fantasmé puisque Dauzat, je l'ai dit, refuse de suivre le guide dans le royaume ténébreux. L'idée, d'ailleurs, n'est point nouvelle, empruntée à des auteurs tels que Thomas De Quincey, John Donne (Dauzat a été l'impeccable traducteur de son étonnant Biathanatos, ce livre admiré de Borges) ainsi qu'à de vieux ouvrages de patristique comme l'Adversus Haereses d'Irénée de Lyon, qui déjà s'insurgeaient contre les écrits apocryphes présentant Judas comme le nécessaire collaborateur de la mission christique.
Ce dernier reproche est à mon sens d'infiniment plus de poids, qui pourrit de l'intérieur les bonnes intentions affichées par l'essayiste et grève radicalement la portée de l'ouvrage, dès lors rien de moins que suspect, voire insidieusement traître. D'un côté en effet, Dauzat, à juste titre me semble-t-il, se scandalise, dès l'introduction de son essai, que le christianisme ne soit plus qu'un pieux lavement pour ectoplasmes érotico-sulpiciens. De l'autre pourtant, son essai lui-même contribue à cet affadissement généralisé, nous verrons pourquoi : «Quand la déchristianisation progresse, écrit-il, que des livres mal fagotés rêvent on ne sait trop quelles amours mortes entre Marie-Madeleine et le Christ ou Judas, à moins qu’on ne fantasme quelque refoulement homosexuel, que le sens même de l’onction se perd parce qu’on ne sait plus le sens des mots, on est frappé du peu qui subsiste, et qui subsiste envers et contre tout. On n’est plus sûr de rien, mais s’il n’en reste qu’un, ce sera celui-là : Judas.» (11; les pages entre parenthèses renvoient à notre ouvrage). une fois le Christ mort et enterré si je puis dire, seul subsiste dans nos cervelles confuses, surtout depuis le siècle passé amateur de diableries (cf. p. 22), la figure de l'éternel pendu, oscillant au-dessus du puits de notre mauvaise conscience. Judas deviendrait dès lors de chair, réalisant à rebours le miracle de l'incarnation, alors que le Christ se perdrait définitivement dans les limbes d'une mythologisation commode (cf. p. 24 : «Qui consent encore quelque droit à la foi ne manquera pas de se désoler d’un temps où l’on met les morts à table, où l’on croit plus à Judas qu’à Jésus, où l’on rend le second au mythe pour mieux accabler le premier»). Judas serait en somme comme une espèce de bubon dans lequel toute la haine occidentale se serait concentrée à l'endroit d'une unique cible que l'on soupçonnera vite être : le Juif. Qu'importe même, nous dit Pierre-Emmanuel Dauzat, que la haine contre le Juif se soit cristallisée dans la figure du proscrit absolu, de cet usurier maudit à l'époque du Moyen Âge (cf. p. 117) puisque la «récupération laïque, athée et psychologique [de la figure du traître donne] de nouveaux usages aux mythes quand le filon chrétien» s'épuise. «Ce basculement du sacré vers le profane, poursuit l'auteur, explique en même temps l’universalisation du mythe de Judas […]» (223). En somme, chaque époque doit avoir son Judas comme elle a aussi son Juif, sorte de bouc émissaire idéalement fabriqué pour servir de combustible perpétuel pour des autodafés qui n'ont point toujours, hélas, été de purs symboles. Dauzat écrit ainsi, fort justement : «Le XXe siècle avait vu très tôt une renaissance de l’association Judas/Juif sous sa forme la plus néfaste. Tout Juif est un Judas et ne mérite en aucune façon notre compassion. N’en avons-nous pas déjà assez avec la Passion ? Et Judas, malgré le XVIIe siècle, malgré sa promotion dans quelques grandes œuvres de fiction modernes, plus rarement de théologie, restait la trame implicite de nos haines» (312-313).
Tous ces développements, comme tant d'autres qui n'ajoutent strictement rien de plus au propos étiré un peu trop longuement par l'auteur, sont convenus qui analysent la permanence de la figure de Judas comme l'ersatz ténébreux de nos frayeurs, de notre haine qui, pour se vider, doit diriger son venin contre une chair éternellement souffletée, brutalisée, torturée. Permettez-moi une image qui me vient immédiatement à l'esprit : les bourreaux ont besoin d'avoir sous la main un innocent, un Ilan Halimi qui aura eu le tort de croiser, un jour, le chemin implacable des chiens. Judas tire sa grandeur noire du fait que sa torture durera, elle, pour les siècles et les siècles, sans rémission possible : plus que l'Inconsolé, il est le Martyrisé par excellence. Reste à savoir de quelle nature est cette haine. S'agit-il seulement de celle manifestée, d'âge en âge brutal, à l'endroit du Juif qui a livré le Christ ? S'agit-il, comme le soutient plus insidieusement George Steiner (et Dauzat ne peut tout de même méconnaître, sur cette question, les positions de l'auteur dont il a traduit en français pratiquement tous les ouvrages), de la haine que les chrétiens vouent, par Juifs interposés si je puis dire, à l'endroit du Christ qui les empêcherait, par l'observation rigoureuse des Béatitudes, de se vautrer dans la fange, tentante, du pourceau ? Je crois que c'est effectivement cette haine seconde, retournée contre le propre principe d'absolue innocence qui l'a stigmatisée et vaincue, haine seconde plus discrète mais pas moins infiniment dangereuse, dont Dauzat suggère l'existence derrière toute promotion d'un Judas antisémite. «Alors que Judas, écrit ainsi l'auteur, dans la tradition chrétienne occidentale, était une figure de la «haine nécessaire», sa transplantation en Orient en a fait une figure du pardon ou de la compassion nécessaire. La migration géographique de Judas s’est doublée d’une migration mentale positive, dont les retombées se manifestent dans les meilleurs fictions occidentales» (303). Peut-être, oui. Mais à trop prétendre que le salut se trouve en Orient, on risque alors de ne point comprendre quelle étrange sophistique conduit Dauzat à affirmer une si pathétique ineptie : «Nous n’avons toujours rien compris. Nous avons voulu la mort de Judas, nous l’avons eue. Et la haine est inassouvie. Il ne reste qu’à la retourner contre nous. Si enfin la prétendue «haine de soi du Juif» pouvait devenir une «haine de soi du chrétien» ! Ce serait une forme d’œcuménisme contrite, mais peut-être plus efficace. Une eucharistie un peu moins imbécile» (314). Une eucharistie qui, en somme, alimenterait la perpétuelle mauvaise conscience de l'Occident chrétien ? Une communion qui ferait sa chair non point d'un Corps glorieux mais d'une charogne, de ce cadavre que, tous, nous cachons voluptueusement dans quelque placard, comme Hanecke le pense ? C'est bien, j'en ai hélas peur, le pain rassis, l'ignoble eucharistie que Dauzat veut nous faire goûter.
Nous voici donc parvenu au pli le plus secret de l'argumentation élaborée par Dauzat qui, je l'ai écrit plus haut, est aussi l'ultime retournement inscrivant son propre essai dans une logique auto-destructrice. D'un côté, l'auteur se lamente de la confusion généralisée dont se nourrit notre époque insouciante, pleure sur son idéal perdu. De l'autre, obstinément désireux de délivrer le pauvre Judas du poids de sa trop grande faute, que nous aurions tous finalement commise, il décide de jouer les bons Samaritains, se charge, tel un moderne christophore, non seulement de sa part du fardeau pesant mais distribue en outre, à chacun d'entre nous, sa petite quantité de peine, son bout de ficelle tragique, avec laquelle il faudra ne point hésiter à se pendre avec maints cris de repentance. Bref, en déresponsabilisant Judas, en le rendant finalement sympathique, digne de pitié, en conspuant ces auteurs de toute façon suspects (Maurras, Boutang, etc.) qui ont insisté sur le caractère proprement démoniaque du geste de l'apôtre sans lui témoigner la plus petite compassion (prétend-il), Pierre-Emmanuel Dauzat accroît il me semble la confusion, mélange un peu plus les identités, fait du Christ un diable de Fils de Dieu et de Judas un sympathique mais piteux ladre, condamné au tragique par son mauvais calcul, son marchandage d'amateur. L'ambivalence borgésienne est au comble de la confusion lorsque l'auteur écrit : «À supposer que la geste chrétienne ait eu une dimension métaphysique, Jésus, dit le Christ, et Judas, dit l’Iscariote, incarnaient deux rapports au monde, deux options sur l’ici-bas et l’au-delà, deux réponses à la question de la vie avant la mort ou après. C’est selon. Le monde désenchanté ne nous laisse même plus un tombeau vide, mais deux instruments de supplice : la croix et la corde» (319-320). Il n'y a donc plus ni Christ, depuis longtemps évadé de son tombeau de toute façon vide, ni Judas, simple défroque qui finalement pourrait recouvrir n'importe quelle dépouille pourvu qu'elle présente ce caractère de complexité (plutôt que d'ambivalence) propre à la figure de Judas. L'adultération (cf. p. 305) des deux figures, ni bonnes ni mauvaises mais toutes deux profondément ambiguës, à la fin de notre «déprimant dossier Judas» (27), est donc totale, puisque, nous affirme Dauzat, le christianisme est suffisamment pervers pour nous demander de croire à une rédemption qui a nécessité, pour se réaliser, une trahison (cf. p. 311).
Comment dénouer cet inextricable enchevêtrement de fausses évidences, d'apparents paradoxes qui, s'ils ne peuvent assurément conforter une foi sincère, robuste, se nourrissant du mystère plutôt que cherchant à le tabuler sottement, offriront tout de même quelques minutes de récréation esthétique aux dévots les plus crédules ? Peut-être en opposant aux petits jeux goûtés par l'auteur les exemples de ces romanciers qu'il n'a pas cru bon d'évoquer de plus de quelques lignes insignifiantes (ainsi de Bernanos) ou louvoyantes, ridicules et tout simplement fausses (de Gadenne, absurdement qualifié de «très chrétien», Dauzat suspecte les «amours délicates» et moque le personnage de «valet de Judas, hybride du père lubrique et suicidaire de Maurras et du pudique et compatissant abbé Oegger» qu'il mettra en scène dans Les Hauts-Quartiers cf. p. 216). Une étude détaillée, chez ces deux romanciers, de la figure de Judas, suffirait je pense à éclairer Pierre-Emmanuel Dauzat quant à l'ineptie confondante de sa thèse : atténuer le Mal, tenter, à tout prix, de sauver Judas, quitte à le transformer en une espèce pour le moins comique d'usurier de la rédemption c'est non seulement, à coup sûr, excuser l'apôtre, le décrocher mollement de sa branche mais encore, tout aussi assurément, affadir la puissance miraculeuse du Christ. Pourtant, je me dois de rappeler que ni Gadenne ni même Bernanos n'ont cru bon de devoir accabler Judas : le peignant dans son horreur, ils l'ont estimé digne de compassion, car c'est l'évidence des forts que de prier pour ce qu'ils ne peuvent tolérer mais ne peuvent se résoudre à ne point tenter d'aimer. Pourtant encore, Dauzat, qui n'a de mots assez forts pour vanter les qualités (bien réelles) de L'Œuvre de trahison de Mario Brelich, paraît avoir bizarrement oublié que le romancier n'a pas hésité, par la bouche de son enquêteur Dupin, à postuler l'identité entre Judas et... Satan !
Dauzat, qui, en blanchissant Judas, ne croit donc pas en lui, ne croit pas plus en sa mystérieuse prévarication, en sa ténébreuse trahison, en sa surnaturelle grandeur dans le Mal et ne croit, pas davantage, au Christ, voici l'étrange image négative qui transparaît derrière un positif (c'est le cas de le dire) bien trop grossier, révélé dans un bouillon suspect d'acide. J'en aurais fini avec cet ouvrage torve, qui avance masqué pourrait-on dire, en affirmant que Dauzat, pour se détacher du Christ, a tout simplement décidé de s'affliger du sort de Judas, accablant celui-ci d'ouragans lacrymaux qui ne peuvent guère tromper que les mauvais lecteurs, certes nombreux, attendons de pouvoir lire sur cet ouvrage leurs comptes rendus... forcément larmoyants. Ainsi, Pierre-Emmanuel Dauzat, tout spécialiste qu'il est de l'antiquité chrétienne, semble avoir oublié son petit catéchisme qui tient pourtant en ces quelques mots fort simples : il faut aimer le Christ en dépit même de Judas, j'allais écrire, pour vous, pour le choquer : grâce à Judas. Il faut aimer Judas dans sa noirceur, non point comme l'un de nos modernes tartuffes sociologues, qui excusent par avance (la société anxiogène, vous comprenez, a poussé le pauvre diable à passer à l'acte...) le comportement le plus ignoble et, ce faisant, condamnent de fait le meurtrier à errer dans les limbes de la tiédeur, sans haine certes, mais aussi sans amour véritable, donc sans possibilité de rédemption. C'est paradoxalement la compassion poisseuse que l'auteur témoigne à l'apôtre félon qui constitue, pour ce dernier, la plus certaine condamnation. Dauzat n'aime ni l'un ni l'autre, le Maudit et le Béni : le premier, il ne l'aime que faussement, comme aiment les impuissants qui versent des larmes sur ce qu'ils ne peuvent plus étreindre, parce qu'il n'aime pas, parce qu'il n'aime plus le second, le Saint. Finalement, l'auteur a bien raison de constater qu'il est plus facile de croire à la haine qu’à l’amour. Et il a encore raison, avec Hebbel, de rappeler que «ce n’est pas le Dieu qui trône parmi l’encens, mais bien le Dieu renié et
 déchiré, le Dieu mort et lui seul qui possède la force d’une Résurrection éternelle» (322). Mais le reste de son raisonnement est faux (1) : non seulement le tombeau n'est pas vide mais ce sont justement les romanciers que Dauzat moque maigrement qui, sans atténuer aucunement la faute de Judas, en la présentant au contraire dans son indicible horreur, ont fait du Christ autre chose qu'un piètre consolateur. Quoi ? Il l'a pourtant dit, notre prudent : un Dieu renié et déchiré. Ainsi revu et corrigé (selon le titre du beau et étrange roman de Péter Esterházy publié récemment chez Gallimard, où est évoquée la figure de Judas, le père du romancier hongrois ayant lui aussi trahi), Judas l'Iscariote n'est, dans le livre de Pierre-Emmanuel Dauzat, qu'un commode alibi, un démon de pacotille, délacé de son gibet pour distiller une haine bien peu concentrée sur un christianisme accusé de tous les maux.
déchiré, le Dieu mort et lui seul qui possède la force d’une Résurrection éternelle» (322). Mais le reste de son raisonnement est faux (1) : non seulement le tombeau n'est pas vide mais ce sont justement les romanciers que Dauzat moque maigrement qui, sans atténuer aucunement la faute de Judas, en la présentant au contraire dans son indicible horreur, ont fait du Christ autre chose qu'un piètre consolateur. Quoi ? Il l'a pourtant dit, notre prudent : un Dieu renié et déchiré. Ainsi revu et corrigé (selon le titre du beau et étrange roman de Péter Esterházy publié récemment chez Gallimard, où est évoquée la figure de Judas, le père du romancier hongrois ayant lui aussi trahi), Judas l'Iscariote n'est, dans le livre de Pierre-Emmanuel Dauzat, qu'un commode alibi, un démon de pacotille, délacé de son gibet pour distiller une haine bien peu concentrée sur un christianisme accusé de tous les maux.Note
(1) Par un dernier geste de charité chrétienne sans doute, je ne m'étendrai guère sur les ridicules et prétentieuses phrases qui clôturent l'essai de Dauzat, dans un Épilogue intitulé La corde et la croix, où l'auteur écrit (p. 309), sans doute pour des lecteurs bien plus platoniciens que je ne le suis : «Judas renaît près de chaque individu crucifié sur une abstraction. On est coupable par simple dissémination d’un concept : en soi-même, en tous et en chacun; on est coupable au titre de la participation platonicienne, ontologiquement fautif, simple unité suspendue à la majesté de l’Idée qui vous porte sans vouloir relâcher son étreinte.» Je veux bien assumer la culpabilité de Judas mais en quoi, suis-je tenté de demander à l'auteur, ce partage du fardeau atténuerait-il l'horreur de la trahison, l'horreur de ma propre trahison ?
 Si Dauzat, à force d'affadissements éplorés, finit par adultérer la sombre beauté du geste de Judas, l'énigme démoniaque que son histoire constitue et ainsi transformer le Christ et Son traître insigne en personnages de vaudeville, je me demande si Surya, lui, ne s'est point rendu coupable d'un peu flatteur manquement qui ne pouvait naître qu'à l'occasion d'une affaire elle aussi impliquant la figure de l'apôtre. J'évoquais ainsi, au début de cet article, la réponse pour le moins surprenante que me fit ce fameux écrivain et éditeur qui venait de terminer la lecture de mon manuscrit sur l'apôtre Judas (que, croyez-moi, je ne cherche tout de même pas, dans mon texte, à sempiternellement excuser, ni même à transformer en une sorte de boat-people de la geste chrétienne). Je reproduis cet échange ci-dessous qui pose à la fois, sous la plume de Surya rien de moins qu'exigeante je veux bien le croire, la reconnaissance de la qualité de mon texte et le fait que, contre cette dernière, de consternantes raisons empêchent notre courageux Bakounine des lettres de s'engager plus avant :
Si Dauzat, à force d'affadissements éplorés, finit par adultérer la sombre beauté du geste de Judas, l'énigme démoniaque que son histoire constitue et ainsi transformer le Christ et Son traître insigne en personnages de vaudeville, je me demande si Surya, lui, ne s'est point rendu coupable d'un peu flatteur manquement qui ne pouvait naître qu'à l'occasion d'une affaire elle aussi impliquant la figure de l'apôtre. J'évoquais ainsi, au début de cet article, la réponse pour le moins surprenante que me fit ce fameux écrivain et éditeur qui venait de terminer la lecture de mon manuscrit sur l'apôtre Judas (que, croyez-moi, je ne cherche tout de même pas, dans mon texte, à sempiternellement excuser, ni même à transformer en une sorte de boat-people de la geste chrétienne). Je reproduis cet échange ci-dessous qui pose à la fois, sous la plume de Surya rien de moins qu'exigeante je veux bien le croire, la reconnaissance de la qualité de mon texte et le fait que, contre cette dernière, de consternantes raisons empêchent notre courageux Bakounine des lettres de s'engager plus avant :«Paris, le 20 mars 20006.
Cher monsieur.
J’ai reçu et lu votre Chanson d’amour de Judas Iscariote. La première chose dont je m’étonne, c’est que vous ayez pu songer à me l’adresser. Je peux former cette hypothèse : que vous ne sachiez pas qui je suis, ce que j’écris et ce que je publie (la revue et la maison d’édition Lignes). Mais cette hypothèse tient mal : il semble en effet que vous soyez au courant de tout. Cette autre hypothèse se proposerait alors : vous le sauriez mais vos préventions politiques pèseraient moins que l’amour que vous avez de la littérature. Je peux d’autant mieux l’imaginer que je ne pense pas autrement. Et vous auriez pu penser que je réagirais de même.
Cela ne nous aide guère cependant : mes amis, ce que je défends (politiquement du moins), ce que j’écris et pense moi-même incarnent tout ce que vous invectivez à longueur de blog. Et inversement, ce que vous défendez est ce contre quoi tout en moi s’insurge.
Alors ? Alors je ne publierai pas votre livre. C’est dommage, parce qu’à quelques minimes détails près, c’est le plus souvent un très beau livre que vous avez écrit et que j’ai lu. Je le dis d’autant plus volontiers que Judas est une figure qui m’intéresse au plus haut point et que je ne peux être, à son sujet, qu’extrêmement exigeant.
A ce très beau livre, je souhaite un éditeur que n’arrêtent pas les considérations qui m’arrêtent et dont je me devais de vous faire part.
Bien à vous.
Michel Surya».
Je ne puis m'empêcher de citer ma réponse :
«Paris, le 2 avril 2006.
Monsieur,
je commence d’abord par vous remercier d’avoir pris le temps de lire le manuscrit que je vous ai envoyé puis d’y répondre, ma foi assez aimablement.
Cette réponse justement, me pose problème et j’ai quelque difficulté intellectuelle et morale à concevoir qu’elle puisse vous satisfaire. Car enfin, ayant constaté que, dans mon geste, il n’y avait pas la plus petite dimension politique (effectivement : la littérature passe avant tout), ayant vous-même qualifié mon texte de «très beau livre», vous ne pouvez cependant vous résoudre à le publier sous le prétexte, si je vous ai bien compris, que je serais un vilain garnement absolument opposé aux idées que vous et les vôtres défendez, est-ce bien cela ?
J’ai envie de vous demander : mais quel est donc le rapport invisible, cher monsieur, entre un manuscrit sur un thème qui vous tient à cœur, Judas, et nos orientations politiques personnelles, d’ailleurs supposées plutôt que réelles ?
Je vous le dis donc sans ambages : cette position, la vôtre, est pour le moins parfaitement ridicule, odieuse dans sa douteuse moralité et, quant à ce qu’elle laisse entrevoir du courage de l’homme, suffisamment éclairante. Une fois encore, une fois de plus, vous confirmez ce que je sais, hélas, depuis longtemps : l’édition française n’a plus aucun courage, qu’il s’agisse de celle réputée de droite comme de celle dite de gauche (pardonnez-moi ces banalités, entraînées en somme par votre propre réponse) et elle ne peut qu’être déshonorée par de pareilles attitudes frileuses, bien-pensantes, percluses de trouille, en un mot… abjectes.
Bien cordialement.
Juan Asensio.»
Enfin, pour clore cet échange épistolaire, voici la réponse de Surya à ma deuxième lettre. Son auteur m'y semble pour le moins étrangement tortueux, refusant désormais d'accorder la plus petite attention (qu'il me déclarait pourtant) à l'endroit de mon manuscrit. Il ne s'agissait donc que de sympathie ? Vraiment ? J'en doute. Certains patrons de l'édition française en sont donc là : non point à tenter de défendre un texte peut-être difficile écrit par un auteur infréquentable, qui heurte en tout cas leurs petites convictions politiques (je n'en démords point, l'intéressé ayant lui-même évoqué ce point...) mais à vouloir aimer les aimer. Aimer qui donc, allez-vous me demander ? Mais voyons, aimer les vrais auteurs, ceux qu'il importe de publier, ceux qui jamais ne feront de peine à monsieur Michel Surya en disant du mal de celles et ceux qu'il aime aimer, bref, qui lui sont sympathiques. Je m'inclinerai jusqu'à ce que mon front touche le sol lorsque l'on parviendra à me prouver qu'existent encore, dans ce beau pays qui fut, naguère encore, rien de moins que maladivement littéraire, des éditeurs capables d'accepter un texte envers et contre celle ou celui qui l'a écrit. Tout le reste n'est que convenance de salon et petites affaires entre amis.
«Paris, le 10 avril.
Monsieur.
Votre lettre fait un peu pitié. Il ne s'agissait en somme que d'un refus, lequel ne mérite certes pas que vous vous échauffiez de la sorte et en appeliez à des mots aussi considérables (un peu trop grands pour vous et pour la circonstance).
Pas même un refus «politique» (!) comme vous feignez de le croire. Non, je fais des livres que j'admire dont, en outre, j'aime aimer les auteurs (dont je demande qu'ils me soient au moins sympathiques). Ce que vous n'êtes pas même. Ce que votre lettre, tristement, confirme.
Bien à vous.
Michel Surya.»




























































 Imprimer
Imprimer