« Journal d'une lecture, 5 : Le Tunnel de William H. Gass | Page d'accueil | Synesthésies, 2 »
26/01/2008
Apologia pro Vita Kurtzii, 5 : No Country for Old Men de Cormac McCarthy

Crédits photographiques : Mark Dadswell (Getty Images).
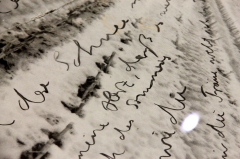 Apologia pro vita Kurtzii.
Apologia pro vita Kurtzii. Cormac McCarthy dans la Zone.
Cormac McCarthy dans la Zone.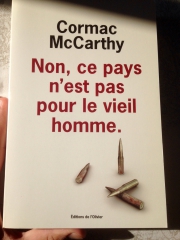 Acheter Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme sur Amazon.
Acheter Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme sur Amazon.Il faudra que j'attende encore quelques heures pour savoir si les frères Coen se sont trompés. Il faudra que j'attende encore quelques heures pour savoir si les célèbres réalisateurs, en adaptant l'avant-dernier roman traduit en français de Cormac McCarthy, Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme, n’ont réalisé qu’un film idiot privilégiant, banalement, la violence extrême qui exsude de ces pages écrites en quelques mois. Il est ainsi piquant de remarquer que, anticipant toutes les possibles, voire très probables erreurs d’interprétation, la prestigieuse Library of Congres a catalogué ce roman sous les entrées suivantes : 1) Drug traffic-Fiction, 2) Treasure-trove-Fiction, 3) Sheriffs-Fiction et enfin 4) Texas-Fiction… Apparemment, nul ne semble avoir songé au fait que la catégorie Metaphysical-Fiction, si d'aventure elle existe, rendrait assez bien compte, sans toutefois en épuiser la richesse, de l’histoire contée par Cormac McCarthy. Je me console cependant en pariant sur le fait suivant : nous n’attendrons en revanche que quelques jours (mieux, elles se tiennent déjà, l’œil vitreux et l’écaille blafarde, sous nos yeux (1)), avant d’avoir, sur les étals de notre glorieuse République des Lettres (2) aussi peu achalandés que ceux d’une épicerie de la Roumanie communiste, le déplaisir de lire les critiques dites littéraires qui évoqueront ce roman, le dépeignant, tout aussi banalement et sottement que le ferait n’importe quel demi-solde journalistique amateur des romans de Chandler, Cain ou Ellroy, comme un «polar pur et dur» ou, pourquoi pas, un «western moderne ultra-violent», stigmatisant au passage, comme il se doit, les réflexions quelque peu réactionnaires qui émaillent le roman, puisque c’est désormais dans ce genre de plastique sale que le chroniqueur moderne emballe la carne de sa sottise.
Notes de l'introduction :
(1) Dans la revue Transfuge qui est devenue une copie glacée à peine supérieure à celles de Technikart ou des Inrockuptibles, le scribouilleur ayant rendu compte du roman de McCarthy n'a pu s’empêcher de lâcher, comme un pet, le mot «réactionnaire», censé je l’imagine fortement incommoder les narines délicates de ses lecteurs, s'il en a. Philippe Garnier, pour Libération, a écrit un texte bien trop long et surtout fort bavard qui dépasse tout de même les platitudes appliquées parues dans Le Monde des livres (sous la plume de Raphaëlle Rérolle), la très fade paraphrase de Chronic’art (sous celle de Julie Coutu) et quelques banalités navrantes recueillies dans Lire (signées par Baptiste Liger).
En fin de compte, l’une des meilleures (et toutes premières) critiques a été signée par Jean-Louis Kuffer sur son excellent blog intitulé les Carnets de JLK.
(2) Et, lorsqu'il s'agit de La république des livres, Pierre Assouline qui ne comprend décidément rien à la littérature, qui semble même oublier les caractéristiques du livre qu'il a lu (à savoir et en tout premier lieu, son dépouillement) et paraphrase La route plutôt qu'il ne l'analyse tout en agrémentant sa bouillie de son habituel et généreux moulin à clichés (les toutes premières lignes de son texte sont indignes d'un vulgaire échotier), illustre sa note de photographies qu'il a lui-même prises. Erreur bien sûr, erreur évidente : ce texte magnifique ne peut supporter que l'épure, par exemple celle de Barnett Newman... On considérera la stupidité et la vulgarité absolues de la majorité des commentaires suivant cette note monochromique comme une incorrection supplémentaire, le coup de canif rageur du crétin sur la toile du maître (le texte de Cormac McCarthy bien sûr, pas celui de Pierre Assouline qui, ma foi, semble s'accommoder de la stupidité de ses lecteurs).
«On ne doit rien aux morts.
Chigurh incline légèrement la tête. Vraiment ? dit-il.
Comment ça se pourrait ?
Comment ça ne se pourrait pas ?
Ils sont morts.
Oui. Mais ma parole n’est pas morte. Rien ne peut changer ça.
Vous le pouvez vous.
Je ne pense pas. Même un athée pourrait trouver utile de suivre le modèle de Dieu. Très utile, en fait.»
Cormac McCarthy, Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme, dialogue entre Clara Jean Moss et Anton Chigurh.
«Les vices sont soumis à la pesanteur, et c'est pourquoi il n'y a pas de profondeur, de transcendance dans le mal.»
Simone Weil, La pesanteur et la grâce.
Pas de transcendance dans le Mal ? C'est ce que découvrit, au bout de sa nuit de débauches stériles, le Gilles de Rais épuisé et pathétique que peignit Joris-Karl Huysmans dans Là-bas.
C’est encore une évidence qui paraît ne point faire l’ombre d’un doute pour nombre d’écrivains qui, de Bernanos à Green, paraissent avoir tout de même quelque temps hésité sur le statut (d’abord ontologique, ensuite, bien évidemment, romanesque) qu’ils devaient donner au Mal : les atours d’un démon romantique accompagnant Faust dans ses pérégrinations ou Melmoth dans son errance, répondant aux invocations bravaches de Manfred ou bien, à l’opposé, cet homme des foules plus baudelairien qu’on ne le soupçonne qui trouvera, si je puis dire, son accomplissement dans les médiocres Ouine, Peredonov ou Ratti, ces fonctionnaires du néant ? C'est une thèse à laquelle, en revanche, Cormac McCarthy (1) semble de moins en moins accorder de crédit. Dans son dernier roman traduit en français, Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme (2), la moindre phrase semble battre en brèche l'idée d'un Mal qui serait privé d'une profondeur démoniaque, alors même que la moindre phrase, justement, est souvent d'une confondante simplicité, tant stylistique que descriptive : le romancier n’hésite pas, ainsi, à commencer quelque description de paysage par une phrase de sémantisme vide ou bien à enchaîner monotonement plusieurs conjonctions de coordination censées évoquer l’accumulation de gestes (3). L’apparence même de ce roman, sa construction classique, à un lecteur pressé, pourraient sembler avoir été bâclées. Peut-être parce que l'auteur a confié avoir achevé ce livre, remarquablement traduit (et correctement relu, cela devient suffisamment rare pour que nous l'indiquions) en six mois ? Peut-être parce qu’il ne s’agit là que d’une commande destinée, on le sait, à être aussi vite transposée à l’écran qu’elle aura été publiée et même donc, écrite ?
Cette pureté et cette linéarité (seulement apparentes, on s'en doute) de l'action, ce refus de nous donner, à la différence des longues pages évoquant les magnifiques paysages où se déroulait la sombre errance des personnages de Méridien de sang, d’amples et poétiques descriptions, ne doivent cependant pas nous induire en erreur. Nous ne tenons pas, entre nos mains, n'importe quel petit livre écrit par l'un de nos pathétiques romanciers nationaux, aussi vite pressé de jouir mal qu’il l’est d’écrire, tout aussi mal d’ailleurs. Le roman de McCarthy, au contraire, nous révèle, dès que nous y prêtons un peu d’attention, une richesse stupéfiante. Je donne ainsi un premier indice de la transcendance évoquée plus haut, lequel, en même temps, nous indique bien évidemment que le véritable romancier peut parvenir à ses fins à partir du matériau le moins noble, qui plus est le plus abondamment travaillé (ici, une banale histoire, mille et mille fois réécrite, de passeurs de drogue et de tueurs convoitant un butin dérobé par un homme qu'ils vont tenter à tout prix de retrouver) : Anton Chigurh (à prononcer, apparemment, comme le mot sugar), le tueur qui méthodiquement éliminera, sans la moindre trace de pitié, tous ceux qui auront osé se dresser sur son chemin. Est-ce tout ? Anton Chigurh ? Oui. Car il y a, dans ce personnage étonnant qui semble incarner une espèce de fatidique vengeance divine à laquelle nul ne peut prétendre échapper (pas même en jouant, comme il s'amuse à le demander à deux reprises, à pile ou face), plus qu'un souvenir du ténébreux juge Olden du Méridien de sang : une réincarnation du sombre personnage, mais comme allégée, débarrassée du lourd bagage culturel qui était celui du juge, un parfait diabolique dont l’essence paraît s’être concentrée sous l’apparence d’un homme tout à fait banal, ressemblant à tout le monde écrit McCarthy. En guise de science, Chigurh délivre un savoir qui a fait de lui un maître invisible, silencieux et secret, au service de la mort. Apparemment incapable d'éprouver le moindre remords, qu'il s'agisse de tuer un inconnu, une femme ou l'une de ses anciennes connaissances à l'époque où il officiait (en quelle qualité ?) au Vietnam, il ne manifeste toutefois pas la joie sadique du juge plongé dans les délices de l'horreur, moins décrite d'ailleurs qu'elle ne nous est habilement suggérée par McCarthy. Il est vrai que, dans ce dernier roman, les ellipses sont fréquentes mais, épurées à l'extrême, elles paraissent toutefois suggérer, plus que celles trouant la trame romanesque de Méridien de sang, un royaume où nulle pitié ne saurait être tolérée et cela, en raison même de quelque faute mystérieuse qui aurait été commise non seulement par chacun des personnages du roman (ainsi du shérif Bell, décoré pour un haut fait d'armes qui est une imposture, comme lui-même le confessera dans une scène bouleversante) mais, plus radicalement et mystérieusement, par les premiers colons des États-Unis.
Le second indice de cette profondeur nous est donné par les longs monologues du shérif Bell, chargé de l'enquête (qui n'aboutira à aucune arrestation), personnage désabusé qui comprend de moins en moins la violence détruisant une société américaine qu'il ne reconnaît plus, jusqu'à faire mine d'hésiter encore devant l'évidence qui, brusquement, se dresse pourtant devant ses yeux : «Je crois que si on était Satan et qu’on commençait à réfléchir pour essayer de trouver quelque chose pour en finir avec l’espèce humaine ce serait probablement la drogue qu’on choisirait. C’est peut-être ce qu’il a fait. J’ai dit ça à quelqu’un l’autre matin au petit-déjeuner et on m’a demandé si je croyais en Satan. J’ai dit c’est pas de ça qu’il s’agit. Et on m’a répondu je le sais mais t’y crois ? Il a fallu que je réfléchisse. Sans doute que j’y croyais quand j’étais jeune. Arrivé à la quarantaine j’étais un peu moins ferme dans mes convictions. À présent, je recommence à pencher de l’autre côté. Il explique pas mal de choses qui n’ont pas d’autre explication. Qui n’en ont pas pour moi.» C'est que cet homme sensible (une seule scène l'oppose de façon symbolique à Chigurh qu’il ne rencontrera jamais, Bell tentant de ne pas écraser un oiseau pourtant mort sur la route alors que l'autre veut abattre le volatile), commence à sonder les profondeurs d'une foi simple de laquelle il s'était un temps détourné. Les signes, alors, par exemple ceux, innombrables et particulièrement révoltants dans leur banalité même, communiqués par les journaux, ne peuvent que conduire le shérif Bell à une sombre certitude : le Mal ne fait qu'empirer, il suffit, comme il l’avoue, d’ouvrir les yeux et de ne surtout point se raconter de mensonges pieux, le Mal et les meurtres qui assurément vont venir, comme ceux, inexplicables ou presque, commis par le tueur invisible Chigurh, ne seront sans doute rien face à ceux qui se préparent dans un monde ravagé, comme une lointaine aurore de sang qui annoncerait l’apocalypse.
De sorte que la beauté de ce roman tout bruissant de terreurs à venir ne se révèle qu'à la condition de ne point oublier le motif essentiel que Cormac McCarthy tisse, certes discrètement, au travers des pensées torturées de Bell. C'est sans doute quelque très ancienne faute je l’ai dit (une fois de plus, comme il le faisait, longuement, dans Méridien de sang, le romancier évoque, dès les premières pages du livre, la vision de peintures rupestres (4)) commise dans une époque dont plus personne ne garde le souvenir, ni même la redite plus ou moins légendaire transmise de génération en génération (5) d’une histoire de la conquête de l’Ouest remplie de bruit et de fureur, c'est sans doute quelque meurtre inouï qui a condamné l'homme à l'errance, et la terre à la sécheresse, et la nature à la tristesse, et l’âme à tenter de saisir un bonheur frelaté dans les paradis délétères de la drogue et c’est cette même faute encore qui a conduit les États-Unis sur la pente légère mais pas moins inexorable d’un déclin moral évident. La Première Guerre mondiale ? La Seconde ? Le conflit, de sinistre mémoire dans les esprits des Américains, du Vietnam ? Non : selon Bell, le ver était depuis longtemps déjà dans le fruit, ces trois conflits, le dernier surtout d’ailleurs, n’ayant en somme que parachevé l’œuvre de ruine des consciences. Comme le dit le shérif : un peuple qui ne croit plus en rien ne peut se battre, fût-ce contre l’ennemi le plus anodin. Comment, dès lors, se battre contre ce qui ne ressemble à rien de ce que l’on a connu ? Comment tenter de stopper un tueur tel que Chigurh ? La raison est autre, et la faute donc. C'est donc sans doute la disparition de Dieu dans l’esprit et le cœur des hommes qui a provoqué tant de meurtres, remarquables (et cependant banals dans leur atroce mécanicité) comme ceux que commet Chigurh ou absolument insignifiants comme ceux qui font les délices des journaux que Bell éprouve de plus en plus de mal à lire puisque la seule nouvelle essentielle, celle qui ferait triompher la vérité, le retour du Christ (6), n'est plus même comprise comme une chimère de fou ou de prophète d'asile.
Désormais, nous pouvons tenter de comprendre quelle fonction Cormac McCarthy a voulu donner à l’évocation brutale de la violence et, surtout, au rôle de son tueur, Anton Chigurh, moins psychotique que réellement maléfique. Ce terme même peut nous induire en erreur qui nous ferait faussement penser que le Mal, malgré, dans ce roman, ses pompes et ses incontestables réussites, sa profondeur écrivais-je, pourrait triompher de l’opiniâtreté des hommes libres. Car Chigurh est moins l’incarnation du démon, de la mort (7), de quelque sombre annonciateur de l’Antéchrist (8) ou même d’un déterminisme absolu (9) qu’il n’est le bras invisible de la justice de Dieu comme le dépeignent nombre de romanciers de langue anglaise (tels que De Quincey, Melville ou encore Stevenson) que McCarthy, sans aucun doute, ne peut manquer d’avoir lus. Ainsi peuvent s’expliquer les étonnantes paroles du tueur, lesquelles condamnent l’acte et la parole à voyager, de par le monde, en une absolue compénétration : au contraire, dès que la moindre faille apparaîtra entre les deux, dès que la parole aura été trahie par l’acte, le Mal pourra s’y glisser, et la faute, subtilement, comme dans Macbeth, faire office de coin, invisible et pourtant tapie comme une bête prête à bondir, dans l’entre-deux du toujours-déjà-là qu’évoquait Paul Ricœur. Chigurh est forcé de tuer Llewelyn tout comme il sera forcé, non sans lui avoir patiemment expliqué les raisons de son geste apparemment absurde et cependant rien de moins que nécessaire, de tuer son innocente jeune épouse puisqu’il a donné à son mari sa parole de le faire. D’ailleurs, la ruse diabolique du tueur ne consiste-t-elle pas à faire remarquer à sa future victime que c’est bien son mari (qui pouvait refuser de voler le sac contenant l’argent par lequel tout le drame est arrivé), et non lui, qui pourra seul être désigné comme étant le responsable de sa mort ? Ensuite, c’est parce que la jeune femme, selon Chigurh, a elle aussi commis quelque vieille erreur fatidique et pourtant oubliée qu’il s’est interposé sur son chemin, afin d’exécuter une (et non point : sa) justice sanglante de toute éternité inscrite. Si l’innocence est un mensonge, si l’innocence est une chimérique aberration, on comprend que renoncer au meurtre, pour le meurtrier, serait ipso facto une absurdité, puisque l’exception invaliderait le cours de l’univers et en détruirait les fondations. Mais, a contrario, c’est bien le fait d’avoir effleuré ce qui pourrait ressembler à l’incarnation du Mal absolu qui a fait prendre subitement conscience au shérif Bell qu’il était, lui aussi, le doux, le vieil homme de plus en plus dépassé par les événements, responsable du Mal se propageant dans le monde à la vitesse de chevaux au galop. C’est bien la certitude d’être confronté à un tueur surnaturel qui a aussi permis à Llewelyn de tenir son rang d’homme faisant face à la mort.
Cette liberté absolue de l’homme en proie à ses démons, Chigurh tente d’en donner une contrefaçon surhumaine en se faisant, dès les premières pages du roman, arrêter volontairement. S’évader de sa geôle puis tuer le policier qui le surveille seront deux façons de se prouver, comme il le déclare lui-même, qu’il peut se libérer d’une servitude qu’il a choisie volontairement. De la même façon, il tiendra d’ironiques propos au tueur à gage qui a été embauché pour le liquider, en insistant sur le fait que lui seul, Chigurh, en obéissant à la loi d’airain du déterminisme, est parfaitement libre, surtout face à un événement comme la mort où tous, insiste le tueur, jouent le même pathétique rôle, répètent les mêmes phrases vides de sens, vont jusqu’à reproduire les mêmes gestes de désespoir qui jamais ne l’attendriront. Au moment de mourir, certes l’ancien officier des forces spéciales, qui a connu Chirgurh durant la guerre du Vietnam, détournera lui aussi son visage mais par ce geste d’insouciance ou plutôt de pure liberté, il moquera l’arme du tueur, enchaîné à sa froide logique. Cette liberté parodique est celle de l’homme errant, sans attaches ni famille : Chigurh ressemble ainsi au tueur en série simplet que Cormac McCarthy évoqua dans Un enfant de Dieu, ou à l’étrange personnage, à la fois diabolique, misérable et grotesque, nommé Harrogate dont le romancier dépeint dans Suttree les improbables et picaresques aventures (10). Pourtant, Chigurh, comme tous les personnages orphelins imaginés par McCarthy, n’est absolument pas libre. Dépourvu de sentiments, de rêves, d’espoirs, de failles ou de liens (en tous les cas, s’il en possède, le romancier les cache aux lecteurs), Chigurh ne semble pas même vivre mais, quels que soient les dangers affrontés, survivre. Rien ne vient à bout de ce mort vivant qui paraît ne pas même éprouver de douleur physique. Ainsi, la liberté vide du tueur maniaque est-elle, au contraire, battue en brèche par celle, bien réelle, incarnée par Llewelyn Moss qui, pris de scrupules d’avoir abandonné à une mort certaine l’un des tueurs blessés qui lui réclamait un peu d’eau, reviendra sur la scène du carnage. Cette liberté fausse est également vaincue par celle, aussi risiblement humaine qu’on le voudra, qu’incarne le vieux shérif Bell qui lui doute, espère follement, méprise, a peur, aime sa femme, se révolte, est secrètement blessé, souffre. Peut-être cette liberté, réelle et fragile, ne se traduit-elle que par le fait que Bell ne puisse se prétendre quitte et dédouané de rien : aucun être ne lui est indifférent, pas même un oiseau mort sur une route, toute action lui paraît secrètement reliée par quelque chaîne invisible à une multitude d’autres, bonnes ou (surtout) mauvaises. Bell, parce qu’il nourrit un fort sentiment d’appartenance à sa famille, à son pays, à l’immense et sanglante histoire qui a élevé ce dernier à une hauteur prophétique, face à des fantômes qui le hantent, face au souvenir d’hommes que sa couardise a abandonnés durant la Seconde Guerre mondiale, pour toutes ces raisons qui sont autant de liens indéfectibles, Bell est libre. C’est justement parce que le vieux shérif, qui démissionnera à la fin du roman, jouit d’une vie «prise dans la musique des sens» (11), c’est parce que son impuissance tragique est aussi la réelle grandeur, la profondeur et la pesanteur de l’homme, qu’il approche paradoxalement de la vision pure et vivifiante des «monuments de l’incoercible intellect» qu’évoque le poète et que le romancier magnifie dans la toute dernière scène de son livre, décrivant un rêve où le shérif est guidé par la pâle lumière que, la nuit, son propre père agite devant ses yeux pour lui indiquer la route.
Notes :
(1) Et bien d’autres écrivains anglo-saxons, que l’on songe au britannique David Peace. Cette différence, notable si on la compare à l’actuelle littérature de langue française, embourbée dans le marécage zolien de l’immanence solipsiste et le tripotage de vit microbien, mériterait à elle seule une étude.
(2) No Country for Old Men est le premier vers du poème intitulé Sailing to Byzantium de William Butler Yeats, ainsi bizarrement traduit par Yves Bonnefoy (dans Quarante-cinq poèmes suivi de Résurrection, Gallimard, coll. Poésie). Il faut croire que le crédit dont jouit, en matière de traduction, ce poète est pour le moins conséquent puisque, en choisissant la version donnée par Bonnefoy, l’impasse est faite par l’éditeur sur la totalité du vers de Yeats («That is no country for old men») qu’ainsi tronqué il aurait donc fallu traduire, sans que cette solution soit d’ailleurs très satisfaisante, de façon plus brutale que ne l’a fait Bonnefoy : «Pas de pays pour les vieillards/vieux». Toutefois, en dépit de ce titre finalement affreux, il faut noter que la traduction donnée par François Hirsch est tout bonnement remarquable, alors même que ce dernier aurait pu, sur les brisées du très lyrique Méridien de sang qu’il a également traduit, céder à la tentation de surcharger, et donc, trahir, l’extrême sécheresse de l’écriture de No Country for Old Men. Sans autre mention, les indications de page renvoient donc à cette édition impeccable donnée par l’Olivier.
(3) Un autre exemple de cette rusticité de l’écriture de McCarthy nous est donné par ce passage, cette fois paratactique qui, en séparant des membres de phrases qui auraient pu être liés, accentue l’effet d’une description impressionniste, intemporelle, des lieux : «Il regarde de l’autre côté du pont mais les trois jeunes sont partis. Une lueur grumeleuse à l’est. Au-dessus des basses collines noires de l’autre côté de la ville. L’eau s’écoule lente et sombre au-dessous de lui. Un chien quelque part. Le silence. Rien», p. 112.
(4) «À cet endroit les rochers sont couverts de pictogrammes gravés dans la pierre il y a peut-être un millier d’années. Les hommes qui les ont dessinés des chasseurs comme lui [Llewelyn Moss]. De ces hommes-là il n’y a pas d’autre trace» (Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme, op. cit.), p. 16. On notera que l’évocation de cette préhistoire est immédiatement occultée, comme si le passé sanglant des hommes, fût-il le plus lointain, demeurait actif alors même que n’en sont conservés que quelques traces devenues indéchiffrables.
(5) «Les histoires passent de génération en génération et la vérité on passe par-dessus. Comme on dit. Ce qui j’imagine pourrait signifier pour certains que la vérité ne fait pas le poids. Mais je ne le crois pas. Je crois qu’une fois que les mensonges ont tous été dits et oubliés il reste la vérité. La vérité ne varie pas d’un endroit à un autre et ne change pas à tous moments. On ne peut pas la corrompre, pas plus qu’on peut saler le sel. On ne peut pas la corrompre parce qu’elle est ce qu’elle est. C’est la chose dont on parle. Je l’ai entendu comparer à un roc – dans la Bible sans doute – et je ne serais pas en désaccord avec ça. Elle sera encore ici, même une fois que le roc aura disparu. Je suis sûr qu’il y a des gens qui ne seraient pas d’accord avec ça. Pas mal de gens en fait. Mais j’ai jamais réussi à savoir s’il y a parmi ces gens-là quelqu’un qui croit à quelque chose et à quoi», p. 117.
(6) «Il m’arrive de me réveiller en pleine nuit et je suis certain aussi sûr qu’on est mortel que rien sauf la deuxième venue du Christ ne peut ralentir ce train-là», p. 150.
(7) C’est par exemple la thèse développée par John Cant dans son article, Oedipus Rests : Mimesis and Allegory in No Country for Old Men, The Cormac McCarthy Journal, vol. 5, édité par John Cant, sans lieu d’édition, 2006, pp. 97-121. Cf. l’excellent site américain dédié aux romans de Cormac McCarthy.
(8) «Y a quelque part un prophète de la destruction bien réel et vivant et je ne veux pas avoir à l’affronter. Je sais qu’il existe. J’ai vu son œuvre», p. 8.
(9) «Je n’ai pas voix au chapitre. Chaque instant de votre vie est un tournant et chaque instant un choix. Quelque part vous avez fait un choix. Tout a découlé de là. La comptabilité est rigoureuse. La forme est tracée. Aucune ligne ne peut être effacée. Je n’ai jamais cru que vous aviez le pouvoir de faire tourner une pièce à votre guise. Comment le pourriez-vous ? En ce monde chacun suit son chemin et il est rare qu’on en change et encore plus rare qu’on en change brutalement. Et le tracé de votre chemin était visible depuis le début», p. 239. Remarquons que le dialogue entre Chigurh et la femme de Llewelyn, laquelle n’en a plus que pour quelques secondes à vivre, est immédiatement suivi par une illustration ironique du hasard souverain : la voiture que le tueur conduit est violemment percutée par des adolescents drogués qui ont brûlé un feu rouge.
(10) Suttree lui-même est un vagabond mais le regard de respect et d’amour que son créateur porte sur sa longue déveine suffit à nous indiquer la dimension symbolique de cette errance, dont la rédemption finale nous est suggérée par mille signes : ce personnage n’est de toute façon pas prêt, à la différence de son grotesque compagnon Harrogate, à faire n’importe quoi pour réussir.
(11) «Caught in that sensual music all neglect / Monuments of unageing intellect », selon les vers de William Butler Yeats dans Sailing to Byzantium traduits par Yves Bonnefoy.






























































 Imprimer
Imprimer