« Gerbert d’Aurillac, héritier de Boèce, an 1000, par Francis Moury | Page d'accueil | La connerie de Philippe Sollers se porte bien »
10/01/2009
Antoine de Baecque et l’ontologie historiale du cinéma, par Francis Moury
 Notes philosophiques, historiques, esthétiques et critiques sur Antoine de Baecque, L’histoire-caméra (Éditions Gallimard, coll. Bibliothèque illustrée des histoires, 105 illustrations, 2008).
Notes philosophiques, historiques, esthétiques et critiques sur Antoine de Baecque, L’histoire-caméra (Éditions Gallimard, coll. Bibliothèque illustrée des histoires, 105 illustrations, 2008).«Dans le monde tragique d’Eschyle, la crainte est le sentiment humain dont la présence est le plus sensible. […] Naturellement, c’est le plus souvent au chœur qu’il appartient d’exprimer cette crainte ou cette angoisse : il est assez étroitement mêlé à l’action pour en être vivement affecté et cependant il reste, par nature, impropre à la conduire activement. Sauf dans les Choéphores et les Euménides, tous les chœurs d’Eschyle sont formés de gens épouvantés. […] Enfin dans les Euménides, si le chœur n’exprime plus l’effroi, c’est qu’au contraire il le sème, le célèbre, l’incarne, au point que, lors de la représentation, la terreur causa, si l’on en croit la Vie d’Eschyle des accidents dans le public; [...]»
Jacqueline de Romilly, La Crainte et l’angoisse dans le théâtre d’Eschyle (Éditions Les Belles lettres, coll. Études anciennes, série grecque, deuxième tirage, 1958-1971), pp. 11-13.
«Dans l’art, il faut voir non pas je ne sais quel jouet plaisant ou agréable, mais l’esprit qui se libère des formes et du contenu de la finitude, – la présence et la conciliation de l’absolu dans le sensible et l’apparence, – un déploiement de la Vérité qui ne s’épuise pas comme histoire naturelle, mais se révèle dans l’histoire universelle dont il est le plus bel aspect, – la meilleure récompense pour le dur travail dans le réel et les efforts pénibles de la connaissance.»
G.W.F. Hegel, Morceaux choisis, 8e section, L’Art, §243, Grandeur de l’art (Introduction et traduction française par Henri Lefebvre et Natan Guterman, Gallimard, coll. N.R.F., 1939), p. 280.
«Dans le cinéma, la fumée d’elle-même s’élève, la feuille réellement tremble : elle s’énonce elle-même comme feuille tremblante au vent. C’est une feuille telle qu’on en rencontre dans la nature et c’est en même temps beaucoup plus, dès le moment qu’étant cette feuille réelle, elle est aussi, elle est d’abord réalité représentée. Si elle n’était que feuille réelle, elle attendrait d’être signifiée par mon regard. Parce que représentée, dédoublée par l’image, elle s’est déjà signifiée, proférée en elle-même comme feuille tremblant au vent. […] J’y ajouterai toujours de moi-même; le sens de ce mouvement dans son immanence me demeurera fermé. Au cinéma, c’est ce sens immanent lui-même qui, à la fois, se propose et se cèle.»
Roger Munier, L’image fascinante, in revue Diogène n° de juillet 1961, cité par Jean Mitry, Esthétique et psychologie du cinéma, tome I, Les structures, §2, L’image filmique (Éditions universitaires, 1963), p 128.
«Comme, à vos yeux, toutes les formes sont nées au contact de la peur, faut-il pousser votre raisonnement à l’absurde, et dire que le cinéma tout entier s’apparente à un «cinéma d’épouvante»?
Oui [...].»
Jean-Marie Sabatier, Les Classiques du cinéma fantastique, §I, Pour une approche du cinéma fantastique (Éditions Balland, 1973), p. 14.
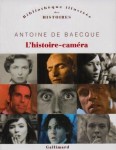 L’histoire-caméra d’Antoine de Baecque est le premier livre consacré au cinéma par Gallimard dans sa belle collection intitulée Bibliothèque illustrée des histoires : cette reconnaissance matérielle qui lui permet de prendre place entre des anthologies iconographiques d’une haute tenue intellectuelle et plastique, aussi bien vouées à La Mort et l’Occident de 1300 à nos jours qu’à Saturne et la Mélancolie établit donc une nouvelle date éditoriale par elle-même dans l’intégration du cinéma au corpus universitaire des arts plastiques. Ce volume relié (avec signet et tranchefil, doté d’une belle jaquette reproduisant des visages issus de neuf films tournés de 1952 à 1999) de presque 500 pages sur papier glacé contenant une centaine d’illustrations N.&B. et couleurs – certaines sont des photogrammes (parfois flous, parfois nets) ou des captures précises de DVD opérées par l’auteur mais d’autres sont de magnifiques reproductions d’affiches originales – une bibliographie, un Index nomini, un Index des titres de films, est autant un livre d’histoire qu’un livre de philosophie, un livre d’esthétique du cinéma qu’un livre d’histoire du cinéma, et il aurait donc pu, étant donné le contenu et le style de son questionnement, tout aussi bien trouver place (les illustrations en moins) dans la Bibliothèque de philosophie du même éditeur.
L’histoire-caméra d’Antoine de Baecque est le premier livre consacré au cinéma par Gallimard dans sa belle collection intitulée Bibliothèque illustrée des histoires : cette reconnaissance matérielle qui lui permet de prendre place entre des anthologies iconographiques d’une haute tenue intellectuelle et plastique, aussi bien vouées à La Mort et l’Occident de 1300 à nos jours qu’à Saturne et la Mélancolie établit donc une nouvelle date éditoriale par elle-même dans l’intégration du cinéma au corpus universitaire des arts plastiques. Ce volume relié (avec signet et tranchefil, doté d’une belle jaquette reproduisant des visages issus de neuf films tournés de 1952 à 1999) de presque 500 pages sur papier glacé contenant une centaine d’illustrations N.&B. et couleurs – certaines sont des photogrammes (parfois flous, parfois nets) ou des captures précises de DVD opérées par l’auteur mais d’autres sont de magnifiques reproductions d’affiches originales – une bibliographie, un Index nomini, un Index des titres de films, est autant un livre d’histoire qu’un livre de philosophie, un livre d’esthétique du cinéma qu’un livre d’histoire du cinéma, et il aurait donc pu, étant donné le contenu et le style de son questionnement, tout aussi bien trouver place (les illustrations en moins) dans la Bibliothèque de philosophie du même éditeur.Antoine de Baecque réfléchit, à travers des cas précis et emblématiques, sur les rapports authentiquement ontologiques qui lient le cinéma et l’histoire. Intrinsèquement, dans la mesure où le cinéma est un témoignage matériel qui se rajoute dorénavant aux autres témoignages des autres arts, et dialectiquement, dans la mesure où le cinéma reconstitue l’histoire : il existe, pour parler à la manière de Spinoza, un cinéma historicisé et un cinéma historicisant.
Cette ambivalence, poussée plus avant, est déjà le cœur du célèbre «complexe de la momie» analysée par André Bazin, dans une perspective pleinement ontologique. L’Arrivée d’un train en Gare de La Ciotat filmée par les frères Auguste et Louis Lumière, est datée et le train filmé existait. Ses premiers spectateurs craignirent d’être écrasés, comme on sait. Capturer le temps, par défi, par hasard, comme par nécessité, c’est l’un des aspects ontologiques du cinéma. Et le temps, c’est de l’histoire. Jusqu’ici, tout paraît simple. Les exemples les plus élémentaires de ce rapport dialectique temps/cinéma sont les meilleurs du livre.
Oui Peter Watkins, un peu comme Gualtiero Jacoppeti à la même époque 1960- 1970 (soit dit en passant : l’idée était dans l’air du temps mais Antoine de Baecque n’en crédite que Watkins) introduit une vision télévisuelle «live» dans le film historique ultra-violent (La Bataille de Culloden) ou dans ses pseudo-documentaires fantastiques/politiques à tendance toujours virulente et contestataire (La Bombe, Punishment Park) mais qui réussissent encore aujourd’hui à échapper au pur formalisme.
Oui encore Sacha Guitry filme réellement – contrairement à ses critiques de droite, de gauche, et universitaires de l’époque – quelque chose de réel et de central de l’histoire de la France dans Si Versailles m’était conté (1954) avec cette réserve que certains autres films français véritablement tournés à Versailles étaient parfois remarquables et tout à fait dignes d’être remémorés, contrairement à ce que dit Baecque. Nous songeons notamment au fantastique, érotique et très inquiétant L’Affaire des poisons (1955) d’Henri Decoin qui annonce un peu, dans le registre du film d’aventure historique, le malsain et la violence du Hellfire Club / Les Chevaliers du démon de R.S. Baker et M.N. Berman.
Oui derechef le problème du musée et de l’image, dans les Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, est autant influencé par «votre terrible Hegel» (Godard dixit) que par «votre gentil Walter Benjamin» (Idem), et par André Malraux que par Henri Langlois.
Oui enfin l’ambivalence culturelle proprement historique – car elle n’apparaît parfaitement, et si clairement, que parce que le temps a permis de la décanter – de la «Nouvelle Vague française» est avérée : c’est le meilleur chapitre du livre avec celui sur les «formes forcloses».
Antoine de Baecque démontre que la Nouvelle vague fut d’abord l’héritière intellectuelle des Hussards «antimodernes» au sens que donne Antoine Compagnon – cité d’ailleurs mais dans le chapitre sur le démodernisme dans le cinéma russe de la chute de l’ère soviétique – à ce terme. Ainsi Louis Malle adaptant en 1963 Le Feu follet de Pierre Drieu la Rochelle ou encore – nous rajoutons cette référence – travaillant avec Roger Nimier en 1957 sur l’adaptation du scénario de Calef, Ascenseur pour l’échafaud; ainsi Godard admirant Malraux au début du régime gaulliste. Elle devient miroir angoissé et très introspectif, anti-spectaculaire, de la Guerre d’Algérie. Recommandons ici, outre ses beaux textes très justes sur Adieu Philippine (1963) et Cléo de cinq à sept (1962), les deux belles analyses par Baecque des deux grands films d’Alain Cavalier que sont Le Combat dans l’île (1962) et L’Insoumis (1964). Elle est enfin le miroir «gauchisant» de Mai 1968 et la référence agissante de la (de notre) post-modernité cinématographique, dans la mesure où, selon Antoine de Baecque, la Nouvelle vague française ferait encore sens aujourd’hui.
Bémol tout de même car lorsqu’on visionne Vivre sa vie (1962) qui n’est pas cité par Baecque mais qui demeure peut-être le meilleur film de Godard avec Le Mépris (1963) et Week-end (1967) tout compte esthétique fait (alors que Le Petit soldat (1960-1963) si vanté par Baecque est un film de potache anecdotique qui n’a plus d’intérêt que purement filmographique ou purement historico-politique) on est assurément en présence d’un film encore efficace, portant sens directement par-delà son temps, alors que face à Les Cousins (1959) de Chabrol, on n’est pas forcément en présence d’un sentiment de Nouvelle vague, plutôt d’une «qualité française» améliorée, ce qui n’est nullement déméritant à nos yeux dans la mesure où la perfection formelle et dramaturgique de la Nouvelle Vague, c’est peut-être bien Chabrol qui a su la finaliser de la manière la plus équilibrée avec Les Biches (1968), La Femme infidèle (1969), Que la bête meure (1969), Le Boucher (1970), Les Noces rouges (1973), Nada (1974), sans oublier le plus ancien À double tour (1959) et le plus tardif La Cérémonie (1995). Il y a même encore, de toute évidence, de la Nouvelle vague – et de l’Actor’s studio tout autant ! – dans le cinéma français des années 1990-2000 : voir ce grand film noir réflexif qu’est La Haine (1995) ou la manière dont Bertrand Tavernier tourne ses deux meilleurs films qui sont aussi deux films noirs policiers : L627 (1992) et L’Appât (1995) qu’il ne faut pas confondre, bien sûr, avec le titre homonyme d’exploitation française du western classique américain d’Anthony Mann.
Historiquement, philosophiquement, métaphysiquement, les choses deviennent plus délicates avec la thèse initiale du livre, celle des «formes forcloses» sur laquelle Antoine de Baecque ente sa réflexion d’histoire du cinéma. Est-ce que le «regard caméra» définit le cinéma moderne ? Est-ce que le cinéma moderne est en outre définissable à partir des «regards-caméra» saisis par les documentaristes militaires anglais et américains, lorsqu’ils filmèrent les survivants des camps de concentration européens ? Car le livre d’Antoine de Baecque débute par une double affirmation, très soigneusement étayée et très bien étudiée : Europe 51 (1952) de Rossellini d’une part, Nuit et brouillard (1956) d’Alain Resnais d’autre part sont les deux films fondateurs de la modernité authentique de la seconde moitié du XXe siècle car ils regardent la mort, le mal absolu et la déréliction dans les yeux, et qu’ils nous regardent dans les yeux. Le cinéma antérieur ne pouvait pas l’exprimer car il manquait la «Shoah» et le traumatisme de la mort de masse exprimé par les yeux (médiatisés dans un autre contexte) d’Ingrid Bergman – ses yeux et les yeux de celles ou ceux qui la regardent en des séquences précisément repérées – et par le rapport dialectique établi par le montage dans le documentaire de Resnais, introduisant entre les documents bruts filmés par d’autres en 1945 et les plans d’ensemble des lieux désertés, abandonnés, filmés par Resnais en 1955, la médiation de sa mise en scène. C’est une thèse qui en vaut une autre, loin qu’elle soit l’unique et la seule possible. Elle mérite d’être discutée.
Bien sûr, sans la vision indélébile (différée ou «in situ», selon les biographies) des camps de concentration – et Antoine de Baecque l’établit très précisément par des documents de première ou seconde main, tous scrupuleusement cités en notes – ni Orson Welles en 1946 (Le Criminel), ni Charlie Chaplin en 1947 (Monsieur Verdoux), ni Alfred Hitchcock en 1953 (passionnante interprétation, très étayée historiquement, de la mise en scène et du montage de Mais qui a tué Harry ? qu’on considère souvent par ailleurs, et à juste titre, comme une comédie macabre ennuyeuse, mineure et sans grand intérêt), ni Samuel Fuller en 1959 et 1980 (Verboten ! / Ordres secrets aux espions nazis, et le très inégal mais passionnant The Big Red One) n’eussent été filmographiquement ce qu’ils furent.
Certes.
Mais il y a eu d’autres «regards caméra» avant 1952 et 1956. Sans même remonter à Dziga Vertov et à sa «caméra-œil» puisqu’elle est l’inverse dans sa proposition ! Et la faculté de l’esthétique de suggérer l’indicible du mal absolu (qui existait avant la «Shoah» : le mal échappe au temps dans la mesure où il ressort de la nature intemporelle de l’homme : il est passible d’histoire mais aussi de religion et de philosophie pour cette raison) et de l’horreur (il y a eu des meurtres de masse dès l’histoire de la haute antiquité, bien que la «Shoah» fût un meurtre de masse inédit et spécifique en raison de la ruse silencieuse proprement diabolique avec laquelle il fut perpétré, et il suffit pour s’en convaincre de lire un traité d’histoire ancienne, par exemple, si notre mémoire est bonne, le très sérieux G. Lafforgue, L’Orient et la Grèce jusqu’à la conquête romaine (éd. P.U.F., coll. Le Fil du temps, 1977) a été maintes fois utilisée par les cinéastes de la période antérieure. Et le meurtre de masse, qu’il s’agisse de la Shoah ou d’un autre, n’est pas l’alpha ni l’oméga du mal : il en est une figure parmi d’autres. Autrement dit, on semble nous dire que la «Shoah» marque une date dans l’histoire du cinéma, à la fois ontologiquement et techniquement et elle permet de définir le cinéma «post-Shoah» comme moderne, le cinéma «pré-Shoah» comme ancien. C’est abusif même si c’est suggestif. La première partie de la proposition nous paraît parfaitement pensable et très bien illustrée mais la seconde partie de cette même proposition nous semble excessive.
Il est au demeurant curieux, dans un tel contexte, que le génial documentaire homonyme de Claude Lanzmann ne se voit accorder d’attention que dans une simple note, évidemment laudative: le film de Lanzmann est pourtant un cas limite de l’esthétique documentariste qui aurait mérité, étant donné la thèse d’Antoine de Baecque, un chapitre à lui seul, à défaut d’un livre. Car si la «Shoah» est la base des formes forcloses qui ouvrent le cinéma moderne, alors quid du Shoah (1985) de Claude Lanzmann ? Et si dire dans cette note p.106 qu’il est en lui-même «le sujet d’un livre à part entière» nous semble exact, cela demeure un peu court étant donné le contexte et en dépit de la citation intéressante d’une lettre du cinéaste Arnaud Desplechin de 2001 qui assure – d’une manière d’ailleurs tout aussi réductrice et fausse – que l’histoire de la Nouvelle-vague s’ouvre par Nuit et brouillard et se clôt trente ans plus tard par Shoah. Aucun mouvement esthétique ne meurt jamais vraiment une fois qu’il est né : il y a de la Nouvelle vague mais il y a encore aussi de l’expressionnisme ou du baroque dans le cinéma moderne et contemporain. C’est une loi connue de la temporalité esthétique, de l’évolution de la vie des beaux-arts. Relire Alain, et bien d’autres grands philosophes classiques à ce sujet.
Autre point gênant, relatif au chapitre sur les films «démodernes» du cinéma russe post-soviétique. L’analyse du Stalker (1979) de Tarkovski qu’on y lit est fine, détaillée mais range le film au milieu d’œuvres médiocres et sans intérêt autre, pour le coup, que purement historique. Similitude chronologique étalée sur une dizaine d’années, et Stalker en précurseur puisque filmé avant la chute de l’U.R.S.S. On lit la dizaine de pages qui lui sont consacrées en cherchant, en vain, le terme «christianisme», sans trouver davantage mention du fait que Tarkovski soit croyant comme fait génétique de son cinéma tout entier. Tarkovski l’a pourtant écrit. Antoine de Baecque ne nous parle que de ce processus esthétique de la démodernisation à l’œuvre dans Stalker. Dont acte, on peut le nommer ainsi : pourquoi pas ? Mais on rate la substance élémentaire du Stalker en ne l’abordant que par cet aspect, en négligeant qu’il est un acte explicite de foi militant. Le contexte où Baecque emploie le terme de «démoderne» permet certes de l’employer : ce terme n’est donc pas en cause. Mais c’est ici qu’une interprétation purement historicisante d’un cinéaste manque bel et bien le sens profond de son œuvre. Ce n’est pas, au demeurant, qu’on soit gêné d’être nous même, quelque part et par contrecoup, ignoré : on l’attendait de la part de quelqu’un qui semble admirer Lacan et Walter Benjamin comme de grands philosophes – alors que ce n’est pas le cas : le premier fut simplement un sophiste très cultivé qui avait débuté par un intéressant essai sur la psychose paranoïaque, l’autre fut un philosophe plus authentique mais demeure néanmoins mineur – et on n’est guère surpris qu’il n’ait pas daigné lire les analyses respectives du Stalker parues sur ce même blog, rédigées d’abord par Juan Asensio ici puis par moi-même là.
Par ailleurs, lorsqu’on lit, à la page 96, que «Maurice Blanchot pourrait apporter une autre clé d’interprétation [...] «La mort, écrit-il dans L’Espace littéraire, est le travail de la vérité dans le monde», on se dit que la culture est certes une chose sympathique mais qu’il en faut alors franchement davantage pour faire illusion ! Du point de vue de l’histoire de la philosophie comme de la philosophie elle-même, il ne faudrait pas laisser croire au lecteur ignorant que Blanchot a découvert le contenu conceptuel qu’il a formulé : c’est un contenu évidemment et purement hégélien simplement repris à compte (d’auteur) par Blanchot (lecteur). Antoine de Baecque le sait-il ou feint-il de l’ignorer ? On ne pourra pas dire qu’on ne lui laisse pas une porte de sortie honorable ! Bref…
Le dernier chapitre sur L’Amérique à découvert nous semble souffrir d’une faiblesse à la fois théorique et historique – au sens restreint de «histoire du cinéma», cette fois-ci – qui dépareille un petit peu l’ensemble, en raison de sa facilité et de ses lacunes, de sa rapidité peut-être aussi car c’est un domaine que nous connaissons bien. L’affiche de L’Aventure du Poséidon (1972) qui l’ouvre nous laissait pourtant augurer un beau chapitre mais on regrette presque l’article de Pierre Baudry sur Réalité de la production, production de la réalité : sur les films-catastrophe, in Le Cinéma américain (collectif sous la direction de Raymond Bellour, éd. Flammarion, tome 2, 1980, pp. 261-275) . On a ici droit aux thèses rebattues de ce brave Thoret reprises et citées en long et en large ! Encore une fois, même principe : un fait historique est érigé en moteur esthétique. Et tout s’ordonnerait autour de lui : ici la «Shoah», là l’assassinat du président Kennedy ou la guerre du Vietnam, là un peu plus loin le 11 septembre 2001. Ce sont des paradigmes arbitraires qui ne rendent pas compte de l’histoire du cinéma, pas davantage de l’histoire tout court dont ils ne sont pas les moteurs mais les éléments. Parler de la poussière blanche recouvrant Tom Cruise, poussière symbolisant la chute des Twin Towers comme élément sémantique allusif dans La Guerre des mondes (2005) de Spielberg : pourquoi pas ? Mais Antoine de Baecque fait l’impasse sur l’original réalisé par Byron Haskin en 1952 qu’il se contente de citer sans l’analyser ! Dans un livre qui est tout de même un livre d’histoire du cinéma (historicisant comme historicisé) et qui s’intéresse à la manière dont le temps et le cinéma interfèrent, il y aurait eu matière à comparaison entre l’original et le remake ! Le passage sur le sens dévolu au monstre dans le cinéma de science-fiction japonais et américain des années 1950 est d’ailleurs un des rares passages faibles, presque rassis, du livre. Antoine de Baecque ne s’intéresse visiblement que modérément à ce cinéma (le premier Godzilla d’Inoshiro Honda est si peu considéré qu’il est daté de 1955, à l’unique page 388 qui le cite; heureusement l’index final des titres rétablit la date correcte de 1954) et le peu qu’il en sait est rabattu vers une fonctionnalité rapiécée et sans pertinence réelle.
Et puis enfin un regret de taille : on ne comprend pas l’absence du genre historique majeur de l’histoire du cinéma, au sens du cinéma historicisant, à savoir le péplum. Antoine de Baecque nous répondra peut-être : «mon livre est sur le regard, pas sur l’objet regardé». Non : l’objet du livre tel qu’il est défini inclut précisément les deux éléments mis en relation. On aurait pu comparer la manière dont Cléopâtre est vue par De Mille, par Cottafavi, par Manckiewicz, et quelques autres cinéastes avec la manière dont à l’occasion elle regarde les autres, peut-être même dont elle regarde la caméra – donc les spectateurs – comme effet de mise en scène «signifiante». On n’a pas recherché si de tels regards existent dans les films de référence mais qui sait ? Il faudrait les revoir et on en trouverait peut-être de passionnants à étudier. Car le péplum antique puis barbare, bien davantage encore que le western ou le film d’aventure historique médiéval ou de cape et d’épée, est le genre historique par essence, et un genre réfléchissant, profondément hégélien. Certes il existe un genre encore plus reculé temporellement par son objet, à savoir le film préhistorique (notamment les classiques du cinéma fantastique, répartis sur une période allant grosso modo des années 1945 aux années 1965, que sont Tumak, fils de la jungle, Un million d’années avant Jésus-Christ, Femmes préhistoriques et même le mineur mais intéressant Teenage Caveman de Roger Corman) mais il est numériquement beaucoup moins représenté en individus que le genre précédent, qui compte des centaines de titres et qui est un genre permanent de l’histoire du cinéma des origines muettes à nos jours puisque les sujets et les films ne cessent d’être refaits d’une période du cinéma à l’autre. Il existe ainsi dans l’histoire du cinéma américain et italien plusieurs versions muettes puis parlantes, en noir et blanc puis en écran large et couleurs de Messaline, de Maciste en enfer, et il y a au moins deux Batailles des Thermopyles, deux Alexandre le Grand, deux Ben-Hur, deux Spartacus sans oublier Le Fils de Spartacus réalisé par Sergio Corbucci !
Pourquoi, par quelle aberrante décision esthétique ou thématique, avoir rayé de la table virtuelle des matières d’un livre consacré à L’histoire-caméra un genre qui nécessitait, plus que tout autre de par sa nature même, une telle mise en perspective critique ? Ici encore, la politique des auteurs, défendue par Les Cahiers du cinéma dont Antoine de Baecque est un pilier contemporain, ne suffit pas à compenser une politique du genre, en l’occurrence du genre populaire noble par excellence qu’est le péplum. On aurait pu distinguer, en outre, des péplums fantastiques, des péplums religieux, des péplums historiques purs. Un simple exemple : les Vies de Jésus – ou fragments de Vie de Jésus intégrés à d’autres films – sont aussi nombreuses et variées dans l’histoire du cinéma, grâce au genre «péplum», que dans l’histoire générale, l’histoire religieuse et l’histoire littéraire. D’un côté Renan, Lagrange, Daniel-Rops, Mauriac, de l’autre côté Julien Duvivier, William Wyler, George Stevens, Nicolas Ray, Pier Paolo Pasolini et j’en passe ! Ce n’est pas rien : il y avait matière à penser philosophiquement, avec la même exigence manifeste, un cinéma populaire historicisé et historicisant tout aussi bien dont la matière sont les mythes, les religions, l’histoire antique ancienne puis tardive.
Une occasion manquée. Ce n’est d’ailleurs pas la seule : pourquoi toujours Godard et pourquoi pas José Benazeraf comme cinéaste emblématique d’une histoire-caméra ? Car des regards-caméra chez Benazeraf, il y en a un paquet et ils sont souvent hallucinants de beauté et non moins chargés de sens dialectique ! Cela dit, de tels regrets qui initient le désir de réécrire une partie d’un livre ou de le repenser sur tel ou tel point, sont toujours la preuve qu’il est intellectuellement stimulant : à lire sans hésiter, donc !





























































 Imprimer
Imprimer