« La chanson d'amour de Judas Iscariote devient un livre | Page d'accueil | La confession négative de Richard Millet : la guerre comme exercice d’écriture, par Jean-Baptiste Fichet »
02/08/2009
La Mort de Virgile d'Hermann Broch ou l’attente éperdue du vrai langage

Crédits photographiques : U.S. Air Force, Tech. Sgt. Cohen A. Young.
Ce texte est extrait de La Critique meurt jeune parue aux éditions du Rocher en 2006. Il constitue plus précisément la deuxième partie d’un long article évoquant d'abord Le Maître du Haut Château de Philip K. Dick puis L’Avenue de Paul Gadenne, qui fait immédiatement suite à l'extrait ci-dessous.
Signalons la parution assez récente, aux excellentes Éditions de l'Éclat, de la Théorie de la folie des masses (Die Massenwahntheorie), dans une édition établie par Paul Michael Lützeler et une traduction de Pierre Rusch et Didier Renault.
«La modernité, c’est le renoncement à la possibilité d’avoir un alibi.»
Peter Sloterdijk, L’Heure du crime et le temps de l’œuvre d’art.
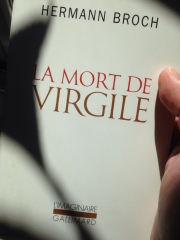 Acheter La Mort de Virgile sur Amazon.
Acheter La Mort de Virgile sur Amazon.Il n’est vraiment pas exagéré de prétendre, comme l’a écrit Hannah Arendt, qu’Hermann Broch, l’un des plus grands écrivains du siècle passé, a été, moins que tout autre ce qu’il est convenu d’appeler, avec une grimace de mépris plus que jamais compréhensible, un homme de lettres (1). Bien sûr, il est tout aussi évident de prétendre que cet immense écrivain, qui décida de se consacrer à sa trilogie des Somnambules dès 1928, après s’être honorablement acquitté d’une carrière dans le monde des affaires, a porté très haut l’honneur d’être un créateur. Dans cet apparent paradoxe se cache une vérité pourtant banale, qu’il n’est sans doute pas inutile de répéter à l’heure où il est de plus en plus difficile de faire la différence entre un artiste et un clown, l’un et l’autre jonglant désormais avec les applaudissements : c’est en méprisant la pose, la tour de verre esthétique ou le refuge académique que les plus grands écrivains – je songe évidemment à Rimbaud mais nous pourrions évoquer le cas de Georges Bernanos qui décida d’abandonner l’écriture romanesque pour secouer de son incessante polémique le joug d’une Modernité devenue folle – ont approché au plus près du cœur secret de l’art. C’est en affirmant sans relâche que le langage est impuissant, dans son imperfection même, à signifier quoi que ce soit, qu’un écrivain tel qu’Hermann Broch a pu faire de son œuvre le véhicule qui l’a mené jusqu’aux confins de la diction et… sans doute au-delà (2). Et la métaphore n’est certes pas exagérée lorsqu’il s’agit de La Mort de Virgile (3), publié dans de sombres temps, véritable plongée au plus intime des liens inextricables qui unissent le mystère de la création artistique au langage, fulgurante vision du Royaume qu’il ne nous est pas permis de contempler, à moins que, comme dans le cas de Broch, une licence douloureuse soit accordée à l’écrivain, qui rédigera ainsi la première version de son texte (intitulée Le Retour de Virgile, que le romancier lira à la radio en 1935, le jour de la Pentecôte) alors qu’il croupissait en prison.
Quelques mots de l’histoire que nous conte Broch. Situé en septembre 19 avant J.-C., le récit du romancier autrichien raconte les dix-huit dernières heures de la vie du poète Virgile qui revient, mourant, d'un voyage en Grèce. Cette descente vers la mort nous est contée en quatre mouvements inspirés par les quatre éléments naturels : l'eau consacrée à l'arrivée, le feu à la descente, la terre à l'attente et l'éther au retour. Prétextant d’une légende rapportée selon laquelle, au moment de mourir, le poète voulut détruire son plus fameux poème, L’Énéide, resté inachevé, Broch développe, à la façon d'un grand chant (métaphore qu’emploie George Steiner à propos de ce roman), les thèmes de la vie et de la mort, les liens, je l’ai dit, qui enserrent dans une même trame impénétrable la parole et la création ainsi que la responsabilité du poète, totale selon l’auteur, face à l’irruption du Mal. La présence du Mal est irréductible à quelque détermination trop empirique, fût-ce la maladie qui va emporter Virgile, fût-ce encore la misère noire du peuple qui assaille le poète lorsqu’il est transporté vers les appartements luxueux d’Auguste. Au contraire, Broch, d’emblée, affirme la réalité d’un principe ontologique entièrement négatif qui aurait vampirisé la création : «Le Mal, un déferlement immense d’une malédiction indicible, inexprimable, inconcevable […]» (p. 21). Face à l’antique péché, Virgile selon Broch doit, à l’exemple du personnage de Dostoïevski, affirmer sa responsabilité totale, y compris bien évidemment pour les méfaits qu’il n’a pas commis. L’allusion est suffisamment claire concernant le personnage du Christ qui, littéralement, va hanter tout le roman, pour que nous nous étonnions du fait que peu de commentateurs, à notre connaissance, ont souligné cette attente eschatologique qui fait de La Mort de Virgile une véritable apocalypse littéraire. Cette responsabilité totale exige l’acte suprême face auquel, tôt ou tard, tout grand créateur a été confronté : le sacrifice, à l’évidence celui du manuscrit de L’Énéide, dont l’achèvement mime celui de chacune de nos vies (4), œuvre géniale qu’Auguste sauvera des flammes – moins métaphoriques qu’il n’y paraît – mais aussi celui du poète en tant que bouche capable de proférer le chant du monde. Ce sacrifice doit annoncer de nouveaux temps : seul il a le pouvoir de faire advenir un chant neuf. Ainsi n’est-il absolument pas une forme voilée ou mensongère d’une nouvelle attitude seulement esthétique qui voilerait de la sorte sa tragique et ridicule impuissance.
Car l’art, aussi élevé soit-il dans son dessein philosophique, par exemple lorsqu’il tente de donner de l’invisible une image visible par le truchement du symbole (cf. p. 326), doit être surmonté par l’artiste devant se libérer du véritable «cachot» (5) (le mot est de Broch) qu’il a érigé autour de son intention première : la connaissance, et une connaissance bien précise, moins illumination gnostique (6) malgré les soupçons que certains passages du roman renforcent qu’attente exacerbée du Sauveur. Ainsi Virgile, dans son immense grandeur, n’est-il qu’un prédécesseur, un «veilleur» (cf. p. 210) nous dit Broch, une sorte d’Orphée (7), encore moins puissant que ce dernier qui parvint tout de même, quelques instants, à suspendre la création au pouvoir de son chant (8), dont la tâche sacrée est de demeurer, face à tous les dangers, le gardien du langage, son rédempteur profane. Car le souci du langage est ou plutôt devrait être rien moins qu’une attention esthétique : selon Broch, l’artiste qui véritablement décide de plonger dans le tohu-bohu de la langue ne peut qu’y reconnaître la présence, invisible et pourtant certaine, d’un principe premier, Dieu ou dieux selon le romancier, auquel il devra immanquablement, sous peine de trahison et de manquement à sa parole, rapporter le fabuleux instrument – et bien sûr, dans le même mouvement, le ridicule instrument – dont il use, le langage. Virgile est donc, à tous les sens du terme, à la charnière : charnière entre deux époques historiques mais aussi entre deux modalités de manifestation du divin. Parce qu’il écrit, parce qu’il s’est inspiré d’Orphée, parce qu’il a écouté ce que des centaines de voix plus anciennes que la sienne lui ont murmuré, parce qu’il a fait de son œuvre et surtout de la dernière, L’Énéide, le lieu d’une écoute respectueuse du bruissement infini de la langue, Virgile est hanté par le passé, qui le nourrit et qu’il n’aura aucune difficulté à retrouver dans la multitude des pages que Broch consacre à son délire ou à la lente surrection de ses souvenirs les plus intimes. Mais, parce qu’il a compris, dans un noir éblouissement, après sa traversée de la ruelle maudite, que lui aussi participait de l’immense et insupportable vacarme, que sa voix aussi était contaminée par le germe pestilentiel, que son art, justement, ne pouvait rien faire pour sauver les misérables de leur misère, pour faire taire le rire diabolique qui poursuit le poète dans sa longue veille fiévreuse, il doit se résoudre à attendre et espérer la venue de plus grand que lui, ce reste mystérieux dont parle l’Ancien Testament qui seul pourra rédimer la terre gaste. Virgile, comme le dit magnifiquement Broch qui se souvient bien sûr de celui qui fut le guide de Dante aux Enfers, n’est «pas encore et déjà, tel sera [s]on sort à tous les tournants de l’histoire» (p. 249). L’art est cette écoute du passé qui est attente de l’avenir inouï. L’art pourtant n’est absolument rien d’essentiel s’il n’est que ce passage, certes impérieux et seul garant de son authenticité, de sa sincérité.
Ce n’est pas la moindre des originalités de La Mort de Virgile que de présenter le Sauveur comme le pressentiment, par le poète mourant, d’une voix, à vrai dire de la Voix, unique et véritable, qui est aussi une chair, la Chair, comme nous l’a enseigné le très beau livre de Michel Henry Paroles du Christ (9). Les exemples sont innombrables qui donnent les caractéristiques de cette voix; caractéristiques à vrai dire négatives puisque Broch, comme les mystiques, ne peut définir cette Voix au-delà de tout langage que par la négation, par la radicale différence qui sépare ce vrai langage, ce langage de la réelle présence, du faux langage qu’utilisent les hommes pour profaner la beauté. A ce titre, je cite longuement l’admirable passage s’étendant sur plusieurs pages (pp. 85-89) qui représente sans aucun doute l’un des nœuds fictionnels du roman de Broch, à partir duquel le reste de l’œuvre pourra s’étendre, comme autant de branches partant d’un tronc commun, vers le bas et vers le haut, mais aussi vers le passé et vers l’avenir, vers le visible et l’invisible. D’abord, les voix humaines, leur inextricable imbroglio : «Oh ! fourrés des voix qui enveloppent chacun de nous; chacun y marche à l’aventure durant toute sa vie, il marche, il marche, et pourtant il est cloué sur place dans l’impénétrable forêt de voix, il est pris dans les racines de la forêt, qui s’enfoncent par-delà tous les temps et tous les espaces». Le royaume des voix humaines est donc enchevêtré et sombre mais, déjà, l’intime compénétration du langage et de la vie la plus modeste est posée avec une force qui semble surgir des tout premiers vers de La Divine comédie, où l’égarement du poète au milieu d’un âpre chemin est paradoxalement souligné par une parole intime, plénière, qui s’élance à l’assaut de l’Enfer, qui va mener Dante au royaume d’où toute parole devrait être bannie. Mais la surrection de la vie peut sembler n’être qu’un leurre, car le danger, car le lion cherchant qui dévorer, rôde au plus près des hommes. Ce danger n’est rien de physique mais d’ordre ontologique, puisque c’est la parole même des hommes qui est porteuse du mauvais germe, c’est le langage même que nous utilisons qui est contaminé : «chacun est menacé par les voix indomptables et par leurs tentacules, par les ramures de voix, par les voix branchues, qui s’enchevêtrent entre elles et autour de lui, qui divergent entre elles, qui s’élancent tout droit pour se recourber et se raccrocher l’une à l’autre; voix démoniaques dans leur indépendance, démoniaques dans leur isolement, voix d’une seconde, voix d’une année, voix d’une éternité, qui s’entrelacent pour former le clayonnage qui limite le monde, qui limite le temps, incompréhensibles et impénétrables dans leurs hurlements muets». C’est chacun d’entre nous qui est le vecteur de l’antique péché, du mensonge premier : «nul n’échappe au vacarme de la voix, nul ne peut y échapper, car chacun, qu’il le sache ou non, n’est rien d’autre lui-même qu’une des voix, il appartient lui-même à ces voix et à leur menace impénétrable, indissoluble et indivisible». On le comprend, le secours, si tant est qu’il ne soit pas une vaine chimère, ne peut donc venir que de l’extérieur, comme un éclair trouant les entrelacs de la forêt impénétrable, et à la seule condition qu’il dépasse la condition terrestre tout en l’assumant, puisque la terre ne peut demander à la terre d’assumer son mal : «oh !, pour un mortel, cette espérance eût été téméraire, une abomination pour les dieux, elle se fût brisée contre les parois de l’inaudible, évanouie dans les fourrés des voix, dans les fourrés de la connaissance, dans les fourrés des époques, évanouie en un soupir qui s’éteint. Car la source des voix, jaillissant à l’origine des temps, est inaccessible». Dès lors, puisqu’il s’agit de faire retour à cette Source première ou sacrée, puisqu’il s’agit, pour le poète dont c’est le rôle le plus insigne, d’en recueillir pieusement les ultimes traces, comme autant de parcelles éparpillées ou de tessons du Vase brisé par le Serpent, et que, dans cette quête éperdue, il ne pourra comme Virgile qu’avouer son impuissance cuisante, la seule possibilité de salut paraît bien mince, son improbabilité même étant indiquée par les caractéristiques extrêmes de la voix de la grâce, capable de nous apporter ce discours extérieur, cette aide que nos voix confuses réclamaient éperdument : «aucun moyen terrestre n’est suffisant pour résoudre la tâche éternelle, pour découvrir et proclamer l’Ordre, pour parvenir à la connaissance au-delà de la connaissance; non, cela est l’apanage des puissances et des moyens transcendants, d’une force d’expression qui laisse loin derrière elle toute expression terrestre». Cette «force d’expression» n’est encore qu’un terme impropre et bien vague que Broch, dans un véritable travail de décantation de la définition qu’il tente de donner, va s’efforcer d’affiner, approchant sans cesse d’un tuf primordial qui, matrice du langage embrouillé des hommes, va se confondre finalement avec le silence. Suivons la progression qui, du «langage qui devrait rester hors du fourré des voix et de toute linguistique terrestre», nous conduit à «un langage qui dépasserait même la musique», puis à «un langage qui permettrait à l’œil, battant dans l’éclair d’une seule pulsation, d’appréhender la connaissance de l’être dans son unité». Nous sommes ici au cœur du mystère sans doute, puisque le langage rêvé par Virgile (évidemment, on s’en doute, par Hermann Broch lui-même) se confond avec l’Être, est l’Être si je puis dire et que cette parfaite adéquation ne peut qu’être profération inaudible. «Vraiment, conclut le romancier, il eût fallu un nouveau langage, encore inconnu, un langage transcendantal» pour prétendre sauver les hommes, langage qui n’existe pas, que Virgile ne peut que soupçonner, langage du Sauveur dont l’inaccessibilité ne peut que plonger le créateur dans un désespoir plus noir d’avoir été un instant allégé : «oh ! il reconnaissait mieux que jamais la vanité des efforts d’évasion de la masse animale, talonnée par la crainte, lançant des mugissements d’espérance et retombant dans un silence de désillusion».
Le désespoir réel de Virgile et, nous pouvons le dire avec Broch, son échec artistique tout autant qu’humain (humain parce que, d’abord, artistique et artistique parce que, d’abord, humain) tiennent donc à l’impossibilité même pour le plus grand des poètes d’accueillir cette Voix dont il n’entendra aucun des mots : «Tu as vu le commencement, Virgile, mais tu n’es pas encore toi-même le commencement, tu as entendu la Voix, mais tu n’es pas encore toi-même la Voix, tu as senti battre le cœur de la créature, tu n’es pas encore toi-même le cœur, tu es le guide éternel qui lui-même n’atteint pas le but». Je ne sais si nous pouvons parler, théologiquement, d’un désespoir propre à celui qui, annonçant et enfermé dans la prison de l’annonce inlassable, ne peut connaître le nom de Celui qu’il clame dans le désert et meurt dans la certitude qu’il ne Le verra jamais ni n’entendra Sa voix (10). L’exemple de Virgile peut ainsi nous éclairer magnifiquement sur le dilemme absolu vécu par ces hommes qui, à la fois moins et plus que poètes, furent les prophètes de la Bible et le furent parce qu’ils n’en finirent justement pas d’annoncer une Voix dont ils n’eurent pas le privilège de voir les lèvres humaines capables de La proférer. L’enseignement essentiel qu’il faut tirer, je crois, de La Mort de Virgile est tout autre et, en dépit même de la grandeur et de la nouveauté radicale de l’œuvre (11), de nature profondément pessimiste. Car, contrairement à ses propres vœux, ce n’est pas dans ce livre que Broch a pu devenir l’écrivain qu’il rêvait d’être, ayant créé ce nouveau langage mythique seul capable, à ses yeux, de réenchanter notre monde absolument plat, langage considéré comme le précurseur d’une nouvelle religiosité (12). On ne peut en outre s’empêcher de penser, à l’instar de Maurice Blanchot, que Broch, dans les dernières pages de son roman, ne parvient pas à nous convaincre : d’abord parce que Virgile, par sa mort, rejoint le suprême Indifférencié (et donc Indifférent) duquel nul langage ne peut s’échapper. Ensuite parce que nous sommes là sans doute, comme le souligne l’auteur du Livre à venir, justement «en présence de ce langage de beauté et de ce faux savoir métaphorique dont Broch voudrait délivrer l’art» (13). La Mort de Virgile, si elle est bien une œuvre qui «a pour centre sa possibilité» (14), donc l’illustration même de sa quête, paraît toutefois se dissoudre dans le Néant sans Verbe. Non pas une naissance donc, mais une dissolution. Non pas une réconciliation mais la plus grande séparation. Non pas une révélation, mais une annihilation. Non pas une nouvelle langue, mais la rumeur sans début ni fin, sans voix ni visage, du Rien.
Avec plus de simplicité que Broch et une opiniâtreté pas moins admirable que celle dont témoigna le romancier autrichien, Paul Gadenne, qui n’a jamais prétendu inventer quoi que ce soit de nouveau, s’est à mes yeux approché davantage que l’auteur des Somnambules de l’œuvre parfaite, où l’épuration de la sculpture façonnée par le personnage principal, sculpture d’Ève qu’il va mener jusqu’aux limites de l’abstraction, se fait parallèlement à un dépouillement de l’écriture, peut être lue comme la mise en abyme d’un roman qui se fait lui-même nudité, pauvreté et, finalement, prière.
Notes
(1) Hermann Broch ne nous laisse aucun doute quant au rôle qui doit être celui de l’écrivain : «Une pratique littéraire qui, sans égard pour l’horreur du monde, poursuit son petit bonhomme de chemin sur les vieilles routes – parce que l’homme veut écrire et accessoirement vendre des livres – et qui, pour cet office, utilise l’horreur du monde uniquement comme «matière», même si elle le fait avec les sentiments démocratiques les meilleurs du monde – cette pratique-là doit nécessairement aboutir à l’art de pacotille…», lettre à Friedrich Torberg du 10 avril 1943, dans Lettres 1929-1951 (Gallimard, coll. Du monde entier, 1961), p. 212.
(2) Puisque Broch a confessé que la parution de La Mort de Virgile n’était qu’une trouée bien inutile à la fin d’un parcours qui aurait dû rester essentiellement secret : «Avec Virgile j’ai expérimenté en ces temps-là où il n’était pas encore un «livre» et où il n’était pas non plus destiné à en devenir un, quelque chose qui n’avait plus rien à faire avec la «composition littéraire» et j’ai également appris alors que toute composition littéraire, qui ne dépasse pas la composition littéraire, ne peut plus, ne doit plus avoir cours aujourd’hui», lettre du 31 octobre 1948 à Gustav Regler, Lettres 1929-1951, op. cit., p. 346.
(3) La Mort de Virgile (Gallimard, coll. L’Imaginaire, 1997). L’ouvrage a été pour la première fois publié en 1945. Les références entre parenthèses renvoient à notre édition.
(4) «Oh ! Dieu, L’Énéide elle aussi devra rester inachevée, sans continuation possible, inachevée comme toute cette vie !» (p. 80).
(5) «Oh ! celui que le destin a jeté dans le cachot de l’art, peut à peine s’en échapper, mais plutôt demeure encerclé par la frontière infranchissable, où se manifeste l’accomplissement extasié de la beauté, s’il s’avère inférieur à sa vocation, il deviendra, dans ce confinement, un vain rêveur, un petit ambitieux, celui-là se laissera gagner au rêve inutile, à l’ambition mesquine visant à un art dérisoire […]» (p. 129).
(6) «Oui… plus un art, et avant tout la poésie, est conscient de la connaissance à révéler, plus il sait précisément qu’avec son pouvoir allégorique, il ne parviendra pas jusqu’à cette connaissance nouvelle; il sait qu’elle viendra, mais c’est justement pour cela qu’il sait également qu’il devra céder la place à cette allégorie plus puissante» (p. 315). Virgile est parfaitement clair sur le caractère mystique de la connaissance qu’il vise dans cette phrase aux images typiques : «Le poème… il faut que je parvienne à la connaissance… le poème me masque la connaissance, il me fait obstacle» (p. 304).
(7) Explicitement, Broch mentionne plusieurs fois le nom du poète mythique, par exemple p. 349.
(8) Voir ce passage admirable, que je cite longuement : «[…] il n’est guère étonnant qu’on ait attribué à l’art et à la sublimité d’Orphée le pouvoir de forcer les fleuves à changer leur cours, d’attirer par un tendre charme les bêtes sauvages de la forêt, d’amener le bétail paissant dans les prairies à se figer dans une douce attention, exauçant dans le rêve et dans un enchantement magique le désir dont rêve tout esthétisme : le monde assujetti à l’écoute, mûr pour recevoir le chant et les vertus qui jaillissent de celui-ci. Cependant, même s’il en était ainsi, les vertus, l’attention figée, ne subsistent que pendant la durée du chant, et en aucun cas, le chant ne doit résonner trop longtemps, de peur qu’avant qu’il ne soit achevé, les fleuves ne regagnent furtivement leur ancien lit, les bêtes sauvages de la forêt ne recommencent avant son achèvement à assaillir les innocents ruminants pour les égorger, que l’homme ne retombe, avant son achèvement, dans son ancienne cruauté […]» (p. 128).
(9) Avec cette interprétation, je m’efforce de ne pas trahir le silence du texte de Broch sur la figure du Christ puisque j’affirme que celui-ci n’est visible qu’en creux du texte, comme en silence et en absence, comme l’image mystérieuse déposée sur le Saint Suaire : «Oh ! quel nom, puisque le Nom était oublié ? Un instant, un court instant, le visage humain impossible à peindre s’était montré, le visage de dure argile, brune et compacte, d’un sourire bienveillant et fort dans son dernier sourire, le visage paternel éternellement présent dans son dernier repos, puis il s’était de nouveau évanoui dans l’inoubliable» (p. 385).
(10) Les toutes dernières lignes (cf. p. 439) par lesquelles le roman se termine sont explicites, elles qui font coïncider impossibilité de la parole et mort de Virgile.
(11) Broch lui-même affirme que, avec ce roman, il a «ouvert les barrières de nouveaux domaines d’expression». La suite de la réflexion du romancier est cruciale puisqu’elle aborde le danger qui a menacé la rédaction du roman, proche d’être englouti dans la confusion de la langue : «À ces limites, ajoute-t-il, commence le problème de la tour de Babel», lettre à Carl Seelig du 28 août 1938, dans op. cit., p. 194.
(12) Peut-être l’a-t-il pu dans son dernier roman, inachevé, Le Tentateur, que Broch caractérise comme étant «le premier roman religieux, c’est-à-dire un roman où l’élément religieux ne réside pas dans le fait de militer pour la cause de Dieu mais dans celui de revivre une expérience vécue», lettre à D. Brody du 16 janvier 1936, dans op. cit., p. 164.
(13) Maurice Blanchot, Le Livre à venir (Gallimard, coll. Folio essais, 1986), p. 170.
(14) Le Livre à venir, op. cit., p. 169.






























































 Imprimer
Imprimer