« Les rendez-vous de la clairière de Robert Penn Warren | Page d'accueil | Pourquoi nous ne pouvons pas ne pas dire que Jean-Luc Nancy ne sait pas lire »
19/08/2010
Au-delà de l’effondrement, 24 : L’oiseau d’Amérique de Walter Tevis

Crédits photographiques : Win McNamee (Getty Images).
 Tous les effondrements.
Tous les effondrements.«Aujourd’hui, que faire ? Il n’y a plus d’hommes, il n’y a plus de femmes, il n’y a plus d’enfants… peut-être. Toute ressource terrestre semble dissipée.»
Léon Bloy à Paul Jury in Lettres à Paul Jury (texte édité et présenté par Michel Brix, Éditions Du Lérot, Tusson, 2010), lettre du 22 avril 1903, p. 266.
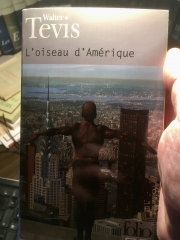 Finalement, dans ce beau roman de Walter Tevis qu’est L’oiseau d’Amérique (Mockingbird, paru en 1980), le plus inquiétant n’est pas la description de l’état d’avachissement généralisé auquel les hommes ont été réduits, ni même le fait que, aussi lentement qu’inexorablement, la population de la planète décroît (1), encore moins les scènes d’immolation collective par le feu de personnes qui ne peuvent plus supporter de vivre sous la coupe de robots qui ne servent plus à rien, abruties de drogues et ne s’approchant les unes des autres qu’à seule fin d’assouvir, le plus rapidement possible, quelque pulsion sexuelle vite étanchée. Le plus effrayant dans ce livre, le meilleur indice de l’état de cette humanité du XXVe siècle finissant, c’est une scène toute banale qui nous le donne, une scène que nous avons tous pu avoir sous les yeux, quelle que soit la spiritualité du ou des messages griffonnés à la hâte par une main que nous supposons être celle d’un jeune homme : «Au sous-sol de l’immeuble dans lequel nous vivons, un très vieux bâtiment qui a été restauré de nombreuses fois, il y a une phrase gravée en lettres grossières sur le mur près du réacteur : L’écriture, c’est de la merde. Le mur est peint en vert pisseux et il est couvert de dessins vulgaires de pénis, de seins de femmes, de couples pratiquant la fellation ou la flagellation, mais les seuls mots qui s’y trouvent sont ceux-ci : L’écriture, c’est de la merde. Et il n’y a pas de paresse dans ce cri, ni dans l’impulsion qui a poussé quelqu’un à écrire ça en grattant la peinture avec la pointe d’une lime à ongles ou d’un couteau. Quand je lis cette phrase dure, définitive, je pense surtout à toute la haine qu’elle reflète» (p. 176, l’auteur souligne). Qui n’a pas lu de tels messages (déclarations d’amour pour le moins explicites, slogans politiques divers et variés, morne épanchement d’un indiscutable talent de poète, phrases aussi énigmatiques, parfois plus belles mais il n'y faut point de grand talent, qu’un vers de René Char ?), griffonnés à la hâte sur les murs des pissotières.
Finalement, dans ce beau roman de Walter Tevis qu’est L’oiseau d’Amérique (Mockingbird, paru en 1980), le plus inquiétant n’est pas la description de l’état d’avachissement généralisé auquel les hommes ont été réduits, ni même le fait que, aussi lentement qu’inexorablement, la population de la planète décroît (1), encore moins les scènes d’immolation collective par le feu de personnes qui ne peuvent plus supporter de vivre sous la coupe de robots qui ne servent plus à rien, abruties de drogues et ne s’approchant les unes des autres qu’à seule fin d’assouvir, le plus rapidement possible, quelque pulsion sexuelle vite étanchée. Le plus effrayant dans ce livre, le meilleur indice de l’état de cette humanité du XXVe siècle finissant, c’est une scène toute banale qui nous le donne, une scène que nous avons tous pu avoir sous les yeux, quelle que soit la spiritualité du ou des messages griffonnés à la hâte par une main que nous supposons être celle d’un jeune homme : «Au sous-sol de l’immeuble dans lequel nous vivons, un très vieux bâtiment qui a été restauré de nombreuses fois, il y a une phrase gravée en lettres grossières sur le mur près du réacteur : L’écriture, c’est de la merde. Le mur est peint en vert pisseux et il est couvert de dessins vulgaires de pénis, de seins de femmes, de couples pratiquant la fellation ou la flagellation, mais les seuls mots qui s’y trouvent sont ceux-ci : L’écriture, c’est de la merde. Et il n’y a pas de paresse dans ce cri, ni dans l’impulsion qui a poussé quelqu’un à écrire ça en grattant la peinture avec la pointe d’une lime à ongles ou d’un couteau. Quand je lis cette phrase dure, définitive, je pense surtout à toute la haine qu’elle reflète» (p. 176, l’auteur souligne). Qui n’a pas lu de tels messages (déclarations d’amour pour le moins explicites, slogans politiques divers et variés, morne épanchement d’un indiscutable talent de poète, phrases aussi énigmatiques, parfois plus belles mais il n'y faut point de grand talent, qu’un vers de René Char ?), griffonnés à la hâte sur les murs des pissotières.À vrai dire, une seconde scène est peut-être plus effrayante encore, qui décrit l’arrivée du héros (corrigeons immédiatement : de la loque humaine qui deviendra homme, et peut-être même héros), Paul Bentley, dans une usine débarrassée de toute présence humaine ou une armada de robots construisent à la chaîne des grille-pain qui, aussitôt assemblés, sont broyés puis recyclés, immédiatement réutilisés pour créer de nouveaux grille-pain : «L’usine fonctionnait en circuit fermé. Rien n’y entrait et rien n’en sortait. Elle aurait pu ainsi faire et défaire des grille-pain pendant des siècles. Et s’il existait dans les environs une station de réparation de robots, les Classe 2 ou 3 qui présidaient à la fabrication auraient pu durer presque éternellement» (pp. 244-5). Truffé de références cinématographiques et littéraires, le roman de Tevis qui nous décrit les ravages d’une société où les hommes ont oublié l’utilité des livres et même celle de lire, s’explique sans doute par la citation des derniers vers de l’un des grands poèmes de T. S. Eliot, Les Hommes creux, qui décrit la fin de l’univers dans une anti-apocalypse, un big crunch se caractérisant paradoxalement par son absence de caractéristiques : la mort de l’homme, sans doute, ne vaut pas la peine de déranger le sommeil d’une libellule ou d’un de ces mocking-birds qui constitue une image lancinante de notre roman.
L’histoire mélancolique et belle que nous raconte Walter Tevis n’est pourtant point désespérée puisque c’est par le réapprentissage de cette science oubliée puis condamnée qu’est la lecture que le banal Paul Bentley qui apprendra à redevenir un homme, un être qui se caractérise en tout premier lieu par son désir de l’autre (2), la femme qu’il aime, la petite fille qu’ils finiront par avoir et un robot immortel dont le seul désir est de se suicider, sauveront, peut-être, l’humanité.
Notes
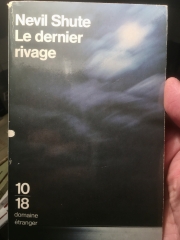 (1) Nous retrouvons quelque peu de cette horreur tranquille, à peine suggérée, ici, par la vision d’un seul cadavre et, à la fin de l’histoire, quelques rues mal balayées, dans un roman australien sans aucune prétention mais diablement efficace, Le dernier rivage de Nevil Shute, (paru chez Stock en 1968). L’auteur nous y décrit l’attente, par le biais de quelques personnages habitant l’hémisphère austral, des vents contaminés par la radioactivité en provenance de l’hémisphère boréal ravagé par une conflagration nucléaire dont un État voyou, l’Albanie, serait à l’origine. Pour Shute, les derniers habitants de l’Australie, se sachant inéluctablement condamnés, se conduisent, durant leurs dernières semaines de vie, en placides gentlemen. L’écriture de Shute se refusant, hormis une seule fois, à toute digression d’ordre métaphysique, purement descriptive et qui privilégie les dialogues, décrivant ce reste d’humanité de fin du monde qui, une fois passée la période de la guerre nucléaire proprement dite, paraît ne plus être désireuse que de paix et d’insouciance, me semble peut-être plus terrifiant, dans son absence de réactions si ce n’est le fait d’ordonner ses affaires et, bien souvent, de se suicider, que n’importe quelle apocalyptique consommation des temps livrant l’homme à ses plus bas instincts. Je disais que Nevil Shute s’était une seule fois autorisé une digression dans le cours de son implacable roman, la voici : «Dans une vingtaine d’années, et probablement beaucoup plus tôt, ces rues et ces maisons seront de nouveau habitables. Fallait-il que la race humaine fût exterminée et l’univers débarrassé de toutes ses souillures pour laisser la place à des occupants plus sages ? Ma foi, cette pensée n’était peut-être pas tellement absurde» (Nevil Shute, Le dernier rivage [On the Beach, 19] (traduit de l’anglais par Pierre Singer, 10/18, coll. Domaine étranger, 1987, p. 226). Il est vrai que les toutes dernières lignes du livre de Shute (cf. p. 263) évoquent aussi une jeune femme qui, ayant selon ses propres pensées délaissé Dieu depuis son enfance, lui adresse une ultime prière…
(1) Nous retrouvons quelque peu de cette horreur tranquille, à peine suggérée, ici, par la vision d’un seul cadavre et, à la fin de l’histoire, quelques rues mal balayées, dans un roman australien sans aucune prétention mais diablement efficace, Le dernier rivage de Nevil Shute, (paru chez Stock en 1968). L’auteur nous y décrit l’attente, par le biais de quelques personnages habitant l’hémisphère austral, des vents contaminés par la radioactivité en provenance de l’hémisphère boréal ravagé par une conflagration nucléaire dont un État voyou, l’Albanie, serait à l’origine. Pour Shute, les derniers habitants de l’Australie, se sachant inéluctablement condamnés, se conduisent, durant leurs dernières semaines de vie, en placides gentlemen. L’écriture de Shute se refusant, hormis une seule fois, à toute digression d’ordre métaphysique, purement descriptive et qui privilégie les dialogues, décrivant ce reste d’humanité de fin du monde qui, une fois passée la période de la guerre nucléaire proprement dite, paraît ne plus être désireuse que de paix et d’insouciance, me semble peut-être plus terrifiant, dans son absence de réactions si ce n’est le fait d’ordonner ses affaires et, bien souvent, de se suicider, que n’importe quelle apocalyptique consommation des temps livrant l’homme à ses plus bas instincts. Je disais que Nevil Shute s’était une seule fois autorisé une digression dans le cours de son implacable roman, la voici : «Dans une vingtaine d’années, et probablement beaucoup plus tôt, ces rues et ces maisons seront de nouveau habitables. Fallait-il que la race humaine fût exterminée et l’univers débarrassé de toutes ses souillures pour laisser la place à des occupants plus sages ? Ma foi, cette pensée n’était peut-être pas tellement absurde» (Nevil Shute, Le dernier rivage [On the Beach, 19] (traduit de l’anglais par Pierre Singer, 10/18, coll. Domaine étranger, 1987, p. 226). Il est vrai que les toutes dernières lignes du livre de Shute (cf. p. 263) évoquent aussi une jeune femme qui, ayant selon ses propres pensées délaissé Dieu depuis son enfance, lui adresse une ultime prière…(2) «Quoi qu’il puisse m’arriver, je remercie Dieu de m’avoir permis d’apprendre à lire et d’avoir pu entrer en contact avec l’esprit d’autres hommes» (p. 350). Le roman de Tevis imagine une société tout entière régie par une stricte obéissance aux principes d’un individualisme absolu, régi par les Règles de Vie Privée (cf. p. 344), où la famille a été abolie, où seul compte le fait d’étancher quelques besoins immédiats par le biais de drogues (appelées sopors) et, diffusés à la demande sur l’universelle télévision, de programmes pornographiques.




























































 Imprimer
Imprimer