« L’abruti de la Quinzaine, par Bernard Leconte (Infréquentables, 15) | Page d'accueil | Les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick, par Francis Moury »
02/04/2011
Match retour de Julien Capron

Crédits photographiques : Toru Yamanaka (AFP/Getty Images).
Rappel
Amende honorable.
Match aller.
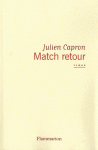 À propos de Julien Capron, Match retour (Flammarion, 2011).
À propos de Julien Capron, Match retour (Flammarion, 2011).LRSP (livre reçu en service de presse).
 Match aller a été publié en poche à l'occasion de la parution de Match retour.
Match aller a été publié en poche à l'occasion de la parution de Match retour.Si j'avais pris la peine de parcourir, voire lire les comptes rendus journalistiques évoquant le troisième roman de Julien Capron, j'aurais sans doute pu comprendre plusieurs choses. D'abord, que ce roman épais, ambitieux comme l'étaient les précédents (ne serait-ce que par la création d'une République imaginaire), est une très belle ode au magnifique sport qu'est le rugby, décrit par Capron à la fois de façon technique et lyrique, l'auteur qui n'a pas son pareil pour évoquer l'atmosphère d'un match de compétition, et ce qui se joue, surtout, dans le corps et le cœur de ces immenses gaillards. Ensuite, j'aurais peut-être appris que, malgré un incontestable talent d'écriture et d'ambition littéraire (l'un sans l'autre ne sont que corps et tête séparés l'un de l'autre), des images fulgurantes («La côte, comme un crayon qui tremble sur une feuille», p. 404) tout de même gâchés, ici et là, par quelques traits faciles donc vulgaires, l'auteur ne parvient que d'une façon assez lâche à nouer deux trames romanesques, celle du championnat décrivant la difficile ascension, la chute subite puis la consécration de l'équipe de Volmeneur soupçonnée de toutes les turpitudes et celle qui fait agir (ou plutôt, réfléchir et déduire) l'Enquêteur Fénimore Garamande, descendant houellebecquien d'un Dupin mâtiné de lettres antiques, confronté à la poursuite des crimes abominables dits de l'Olympe, et, comme si cela ne suffisait point aux épaules d'un seul homme, aux prises aussi avec deux femmes.
Bien sûr, si j'avais lu de telles platitudes, que l'on nous sert désormais, soyez-en assurés, en nous priant d'y trouver matière intellectuelle, comme on veut probablement nous faire croire qu'Aude Lancelin, hormis saupoudrer de sentencieuses stupidités et d'une morgue inamovible une incapacité critique incontestable, a quelque chose à nous dire sur Le Camp des Saints de Jean Raspail, j'aurais été en droit de penser que Match retour aurait pu être, décidément, un roman (ou apparenté) susceptible de trouver grâce aux yeux de l'éditeur le plus exigeant, par exemple Léo Scheer. Jugez donc de la juteuse affaire, et comme elle eût été confortée par la maîtrise technique incontestable de l'auteur, apprise à l'école peu romantique mais si efficace des productions télévisuelles pour lesquelles il travaille : une histoire pas si simple que ça pleine de grands mots majusculables (comme l'Amour, l'Amitié, la Pègre, l'Honneur, la Justice, etc.) saupoudrée de quelques rebondissements de série noire, cousue de quelques ficelles stylistiques pour épater la bourgeoise se piquant d'aimer la littérature et donner un peu de foin à mâchonner aux attachées de presse, et voici l'objet formaté susceptible d'être vendu au public si élitiste de Marie-Claire ou bien à celui de sa version prépubère, Chronic'art, et voici le succès littéraire, critique et financier (tout de même) assuré, au moins aussi considérable que celui des Confidences à Allah de Saphia Azzeddine, une production aussitôt jetée à la poubelle que consommée, la date indiquée sur la couverture étant celle des calendriers éphémères de la réclame plutôt que de la littérature.
Fort heureusement, et pour employer le langage subtil de telle mégère de la Toile, Julien Capron, avec lequel j'ai discuté plusieurs fois et toujours avec beaucoup de plaisir, ne mange pas du pain rassi que le monde si hostile de l'édition (ou apparenté) tend à ses écrivants et ses plus mauvaises plumes. On peut certes réduire Match retour à un ouvrage qui use, souvent abuse, des ingrédients les plus conventionnels propres au polar : suspense, art du portrait, jeux narratifs, rapidité de l'écriture ou bien, au contraire, son ralentissement signalant quelque temps de repos alors que la partie des crimes et de l'enquête va reprendre, description des meurtres, conception de l'intrigue que l'on désirera, toujours, la plus diabolique qui soit, etc. Laissons là ces facilités, tout juste bonnes à orner une quatrième de couverture et les articles si vite évaporables, réductibles le plus souvent à ces mêmes affichettes éditoriales, des journalistes.
L'avenir dira en effet si nous ne sommes pas en train d'assister, avec les trois premiers livres de Julien Capron, à la naissance d'un authentique romancier (ajoutons même l'adjectif chrétien, si l'on y tient), alors que l'œuvre d'un Maurice G. Dantec devient remarquablement insignifiante à mesure que la plus navrante et surtout ridicule réclame hollywoodienne (ou... apparentée...) grignote le peu de substance littéraire qui lui reste et que Michel Houellebecq, comme un fantôme, tourne, depuis deux ou trois romans, autour de la croix, à moins qu'il ne tourne tout simplement en rond, reniflant prudemment, de loin, la chair du Christ alors qu'il lui faudrait consentir à s'agenouiller devant elle, et ne plus tenter de se persuader que faire comme si l'on croyait, ce n'est déjà pas si mal.
Dans les romans boursouflés de Dantec, Dieu, à moins qu'il ne s'agisse plutôt de quelque étrange fabrication démiurgico-divine dont nous laissons à l'intéressé, bien volontiers, le soin de défendre la très improbable orthodoxie, suinte (émanent diraient les pédants) de toutes les lignes ou presque. Et pourtant, l'artefact gnostico-deleuzien qu'on appellera, par commodité, Dieu, paraît absent de chacune des lignes des romans de Dantec écrits après sa conversion, prédite à l'occasion de ma critique de Villa Vortex.
De même, à la lecture des derniers romans de Houellebecq, nous ne savons plus vraiment s'il faut partir d'un grand éclat de rire en constatant le monotone et maladroit pas de deux (mais qui danse donc avec Michel ?) que l'écrivain exécute assez laborieusement ou bien au contraire plaindre celui qui déploie tant d'efforts pour nous rejouer, mais avec infiniment moins de talent et de crâne volonté qu'un Péguy, l'histoire de l'écrivain se tenant, tout penaud et intimidé, devant le porche de l'Église sans jamais oser y pénétrer. Combattre avec l'ange est l'une des plus hautes illustrations de la miraculeuse résistance de l'homme mais je me dis que le plus pacifique des messagers célestes aurait quelque difficulté à empoigner un ectoplasme. Ceci dit, fort intéressante me paraît être l'évolution littéraire de Houellebecq, dans les livres duquel Dieu est absent mais où le Christ, timidement, par le biais de la thématique de la chair (également si présente dans Match aller), fait son entrée plus que discrète, pas moins évidente. Lui aussi, Houellebecq, comme Dantec, va devoir trancher, et il tranchera dans son prochain roman ou ne tranchera sans doute jamais car, s'il ne le fait pas, nous aurons alors la fort désagréable impression que cet écrivain n'a strictement plus rien de nouveau à nous dire et qu'il se contente de ressasser, à bout de souffle et à court de vision, quelques petites histoires capturées à l'épuisette dans la flaque d'eau stagnante où Huysmans a fait barboter Folantin. Il est vrai que c'est là, d'ailleurs, le reproche que lui font déjà un certain nombre de ses contradicteurs les plus féroces.
Au contraire, dans les trois romans de Julien Capron, qui pourtant sont relativement chiches en références directes à Dieu et autres images ou métaphores que nous pourrions sommairement classer dans la catégorie des figures à tropisme religieux, Dieu nous semble être partout, comme un souffle balayant les plus belles pages ou comme une âme bienveillante qui aurait construit, avec une magnanime bonté, un univers de papier, Yoknapatawpha à la française, à seule fin d'y faire exister des créatures imaginaires. Nous Le voyons ainsi à l'œuvre dans l'évidente tendresse avec laquelle Capron observe les mésaventures de ses personnages, juge leurs faiblesses, les engueule, les console, les accompagne, semble avoir lui aussi encaissé tous les coups et blessures que reçoit son cher XV de Volmeneur, livré toutes les batailles que livre le club malchanceux et superbe, qui de la profondeur de la nuit a fait sa devise et sa force. Toutes proportions gardées, le regard que pose le jeune romancier sur ses créatures est celui de Robert Penn Warren sur le plus infime de ses personnages. Nul ne semble leur échapper et, se souvenant sans doute de la phrase de Faulkner à l'adresse de celle qui s'occupa de lui alors qu'il n'était qu'un tout petit enfant, ils endurent ce qu'endurent leurs inventions humaines.
Bien évidemment, plus qu'une note, cette question cruciale, la présence et la figuration de Dieu dans les œuvres romanesques de Dantec, Houellebecq et Capron, mériterait une solide étude comparée pour étayer mes propos. Demeure néanmoins l'impression ou plutôt, pour le dire avec Jean-Philippe Domecq, l'intuition, à ne certes pas négliger, qui est la mienne au sortir de mes lectures plus d'une fois reprises : la grâce d'écriture, que nous pourrions définir comme une réelle empathie avec la création et ses merveilles, la manière, rien de moins que profondément humaine, de veiller sur ses personnages, est absente des romans de Dantec ou, si elle est présente, ce n'est que recouverte d'un monceau de facilités stylistiques indignes d'une véritable quête esthétique et spirituelle et de gadgets pseudo-scientifiques. Dans tel roman de Houellebecq, comme, à mon sens, La Possibilité d'une île et bien sûr le très étrange dernier roman, La Carte et le territoire, cette même grâce d'écriture esquisse sa présence en pointillés, alors que sa recherche haletante est l'objet même de chacun des trois romans de Capron.
Recherche bouleversante, haletante, parce que le Dieu que Capron poursuit, tel le chasseur Nemrod, de roman en roman, est inconnaissable, chassé de la création ou alors oublié par ses créatures qui doivent faire avec des éléments qu'aucun maître n'enchaîne plus : «Un gémissement de sirènes, puis les claquements de gyrophares; dessus, le bruit des vagues, partout les ombres qui parlent de ce qui tôt, de ce qui tard, décomposera l'humain» (p. 60) alors que l'humanité «ne sait ce que veulent les étoiles, quand le soleil, sang du tout, se retire chaque jour sans garantie de retour. Alors; tenir un morceau d'astre, s'abriter dans le tremblement des ombres sur le mur. Habiter» (p. 67) à l'abri de l'obscurité, tout en tentant de déchiffrer, puisque «les mots ne sont que des erreurs figées, que les armes par lesquelles s'imprime dans les âmes le mensonge du monde» (p. 170), l'histoire que racontent les tueurs (cf. p. 123).
Car, Dieu enfui ou éclipsé, reste l'inéluctable, que Bloy appelait l'Irrévocable en en faisant une puissance aveugle de mort, que Capron décèle sous l'héraclitéisme des tueurs de l'Olympe, invisibles, tout-puissants, qui s'ingénient à se gausser de la détermination de la police, avant que l'Enquêteur Garamande ne comprenne que la seule volonté d'un homme a été capable de porter des coups aussi destructeurs aux structures de l'État, à la morale, à l'idée qu'il se fait de l'humanité, tout simplement.
Tout n'était donc qu'apparence, tromperie fomentée par une toute petite poignée de complices jouant aux dieux et laissant sur chaque cadavre un rébus alors que, comme le personnage principal, Garamande, ils se meuvent dans un univers où «les mots c'est devenu bien moins que de la poussière, quand chaque mot d'Homère ou de Virgile est une larme lourde de l'âme des hommes; lourdes de l'âme du monde» (p. 269).
Conséquence de cette aorasie perpétuelle qui fait qu'on n'aime «peut-être toujours que le portrait d'un moment mort, on serre toujours, peut-être, une incarnation passagère, un éclair dont on continue de jouer avec l'ombre» (p. 508), conséquence de ce retrait du divin, fût-il païen, notre langue s'étiole alors que le génie du latin demeure, cette langue faite pour n'interrompre le silence que «pour frapper dans un son de maillet une vérité à la trempe du bronze», cette langue encore «qui touche au cœur du vivre» et dont Capron nous rend la nostalgie lorsqu'il évoque le grand livre qui s'ouvre par Arma virumque cano, dire «l'univers en guerre et dedans l'homme, porteur du murmure de son honneur, que seuls entendent les poètes et les dieux» (p. 313).
Conséquence de cette fuite des dieux, qui de temps à autre consentent tout de même à se montrer «un instant par la déchirure d'une gloire» (p. 507) : le monde qui nous entoure devient impénétrable, refusant de nous livrer sa phrase (cf. p. 492) et l'écrivain est par excellence l'homme qui réintroduit, dans le langage fatigué et le monde cassé, un sens, c'est-à-dire une direction, un but tendant les événements, y compris les plus disparates, ceux qui ne semblent avoir aucun lien entre eux, comme autant d'anneaux entrelacés qui constitueraient la phrase du monde, celle qui résume un match de rugby (1) qui après tout n'est qu'une «terre qui vole de main en main» (p. 401), la vie d'un homme sur le point de mourir (cf. p. 534), la continuité miraculeuse d'Israël (cf. p. 400), les vies d'un homme et d'une femme (cf. p. 484), les saloperies perpétrées par les tueurs (cf. p. 347), notre condition devant le mystère d'une création que nous essayons de toutes nos forces de déchiffrer et même de faire quelque peu nôtre, en lui apposant notre empreinte (2) fût-elle illusoire, nous ne le savons que trop.
Cette quête perpétuelle du sens, cette «soif» (p. 411) de rendre les événements racontables (cf. p. 518), est tout ce qu'il nous reste, depuis la disparition des dieux : «C'est pour cela que nous sommes les histoires que nous nous racontons, passion pour le début, le milieu, la fin, cette tournure de notre esprit de tout leur tordre». Et, dans cette déhiscence de l'être humain vers son Créateur, Julien Capron de voir une volonté implacable, puisque nous ne sommes que «tentative, avant, par la mort, de rejoindre l'éternel» qui d'ailleurs «lui-même s'est dit par des histoires» (Ibid.).
Si la phrase est sens, du moins gage de sens, c'est que, à l'exemple de la fidélité d'un peuple à sa terre dont l'équipe de Volmeneur peut être l'une des figures, elle n'accepte point de ne pas tenter d'englober tout ce qui existe dans la chaîne d'or de la piété : «Nous sommes des séparés, se dit Baruch Klédinstein. Pas seulement au sens où les événements qui ont déchiré Israël et déporté le peuple de la promesse ont fait de nous des hommes qui pensent en langue d’exil et n’habitent que leur fidélité. Il y avait eu l’événement. Avant que se dessinent d’autres visages sur le monde et que d’autres noms barrent les cartes. Il y avait ce silence à jamais de ceux qui étaient morts. Cette autre nation à passer de père en fils et de siècle en siècle de ceux qui avaient été tués, de ceux qui exigeaient pour sol où reposer celui où leurs fils peuvent vivre en paix, de ceux qui demandaient pour mémoire l’acharnement que demeure Jérusalem, pour deuil, la continuation de prière en prière, de rite en rite, du peuple dont ni les catastrophes, ni les haines, ni les persécutions, ni les guerres n’avaient brisé l’alliance avec le Saint-Béni-Soit-Il» (p. 400).
Si la phrase est sens, c'est qu'elle file la métaphore du Dieu comme alpha et oméga de l'univers, Julien Capron différenciant au fond le paganisme du monothéisme par l'incroyable capacité de ce dernier, en reliant la créature à un Créateur qui ne lui est pas étranger, à assurer qu'un ordre existe qui n'est point fallacieux : «Les dieux ne sont pas seulement une réponse commode, la pierre de touche du système en laquelle, à défaut de la prouver, il faut bien croire. Ils sont la réconciliation de notre voix avec toutes celles de l’étranger. Ils sont la confiance. Il appartint aux païens de regarder en l’air. Ils ont vu alors tout un sénat de divinités en débat, pouce levé, pouce baissé, après l’audition des requêtes. Il n’y avait pas encore la brûlure. Cette flamme montée du noyau de l’univers jusqu’au sommet du mon Sinaï, cette sève dont le monde fut la levée et qui fut envoyée en croix pour accomplir la création, ce «je suis avec toi» répercuté jusqu’au cœur de la créature» (p. 410).
Ainsi l'écriture est-elle trace, la dernière peut-être, de Dieu, l'honneur qu'il nous reste aussi depuis que le langage a fait de nous des êtres qui se tiennent droit (cf. p. 252), puisque Dieu n'a pas eu la cruauté de nous priver de l'âme (cf. p. 253), puisque sa face «a les traits de chaque âme qui la reçoit» (p. 275), en chantant le monde, ses horreurs et ses beautés, de résister au souffle de la ruine qui menace : «Ces morts, ces matchs, ces brisures de cœur, tout ça aux yeux de Dieu, une phrase, que seul il a l'altitude de lire. Une phrase que l'éternité prend et qu'elle mène vers un sens que nul ne peut déchiffrer encore et dont ne nous est parvenue qu'une promesse : ce qui vit est la métamorphose acharnée et inventive, l'infinie subtilité, de l'étoile à la goutte, de l'amour de Dieu» (p. 467).
Notes
(1) Voir le passage situé pages 490 et 491 : «Le ballon passait dans les mains des inséparables qui allaient catapulter demain les défenses, Théovitte et Calfin; il se glissait dans la pogne de Sixte, le guerrier noir qui revenait de sa suspension avec la foi d'un miraculé; il passait par le sage Thalalé Jolssin; il rebondissait par Iker Delaventin; il valsait avec Félix Valdafin, demi de mêlé doué et ténébreux, pourri de jalousie pour son remplaçant Dimbiel; il sautait jusqu'à Trinquetaille, sa concentration vers la justesse qu'il aiguiserait encore tout à l'heure en combattant seul à seul les perches sous le vent; il volait vers Judicaël le puissant; vers Casimir le prodige; vers Conbaba le vanneur; et vers Foulques le sec».
(2) «Nous sommes, comme Don Quichotte, ce que nous croyons voir. Nous cherchons dans les choses notre fiction, la résonance de notre fiction, c'est cette question-là dont nous harcelons le sphinx», p. 507. Rappelons que Julien Capron évoquait le roman de Cervantes dans Match aller en des termes comparables à ceux de Match retour : «Ce ne sont pas les réactions en chaîne que maîtrisent les ingénieurs qu’on vit, c’est l’harmonie des choses quand elles deviennent une histoire. Là que nous sommes concernés. Don Quichotte. Nous ne voulons pas voir les choses comme elles sont. Nous voulons vivre comme nous croyons voir. L’âme du monde, face au caché, ce sont les histoires. Qui protègent les têtes du silence au-dessus. Même Dieu, si on suit les croyants, qui a voulu nous ouvrir ses bras sur un il-était-une-fois, continué par chaque témoin au relais de l’alliance», Match aller (Flammarion, 2009), p. 526.




























































 Imprimer
Imprimer