« De l'égarement à travers les livres d'Éric Poindron | Page d'accueil | Le fanatisme de l'Apocalypse de Pascal Bruckner »
25/03/2012
Héliopolis d'Ernst Jünger
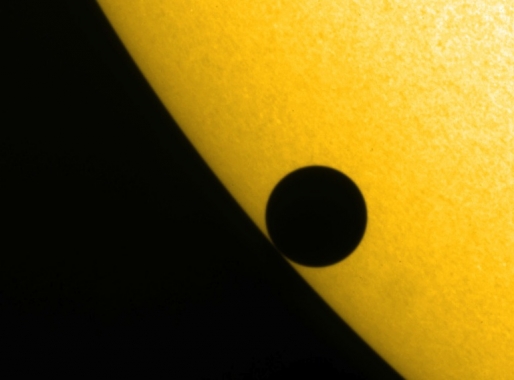
Il se pourrait bien que l'unique sujet d'Héliopolis publié en 1949 à Tübingen en zone d'occupation française soit, bien moins que la recherche d'une philosophie du bonheur pourtant suffisamment importante pour que Lucius de Geer fasse relier par Boudour Péri quelques fragments d'un roman de Wilhelm Heinse consacré à la définition et la pratique de la jouissance véritable, une absence qui se décline en autant d'avatars qu'il y a de créations merveilleuses dans le vaste monde, qui ressemble et diffère en même temps du nôtre, décrit par l'écrivain.
Absence de paix réelle, profonde, dans cette ville magnifique et dangereuse qu'est Héliopolis, qui nous est décrite par les yeux de Lucius de Geer revenant, par bateau, des Hespérides et dont l'approche est signalée par un cadavre exposé à tous les regards (cf. p. 57) sur l'île, de sinistre réputation (1), de Castelmarino, comme l'approche du repaire de Kurtz était indiquée par des boules noires et énigmatiques qui, contemplées avec une longue-vue, apparaissent sous leur véritable nature : des têtes humaines desséchées et rabougries, signalant les limites du territoire où le démon se cache et envoûte de sa voix des guerriers fanatisés.
C'est cette arrivée par bateau, magnifiquement décrite par Jünger, qui suggère tout un passé de violences et de destructions auquel la ville barbare et raffinée d'Héliopolis, partagée par deux pouvoirs antagonistes, a survécu, comme si l'absence manifeste de dangers était le signe d'une violence plus grande, infernale, souterraine, pestilentielle : celle des exactions contre les Parsis et des tortures commises dans les caves, qui finiront pourtant par éclater au grand jour, alors qu'une violence salutaire peut exister, celle par exemple du coup de main par lequel Lucius de Geer illustrera sa bravoure et son intelligence tactique et qui lui fera connaître un véritable état de gaîté enfantine. Comme pour les principaux personnages romanesques de Jünger, Lucius de Geer nourrit avec la violence un rapport complexe, exaltant tout autant qu'ambigu : la violence de l'intelligence et de la bonté désireuse de combattre le Mal n'a strictement rien de commun avec celle des bourreaux qui accomplissent dans l'ombre leurs ignominies.
Il se pourrait même que cette violence fût l'une des plus hautes manifestations de l'esprit et de la vie, comme Jünger l'écrivait dans son Cœur aventureux datant de 1929 (Gallimard, coll. L'Imaginaire, 1995, p. 161) : «les guerres dévastatrices sont les portes les mieux faites pour entrer dans des zones décisives de l’âme, et pour laquelle, lors des nouveaux déploiements de l’image du monde, lors des révolutions, la donnée brutale du sang qui coule est plus bouleversante et plus féconde que tout bouleversement spirituel».
Absence du mystérieux Régent dont la demeure est supra-terrestre et qui prépare une nouvelle ère de prospérité point soumise aux empires, respectivement tyranniques et violents, du proconsul et du bailli (2).
Absence de la beauté si la matière «est comparable à un fruit clos» dont le chef-d'œuvre «ne peut devenir visible que si quelque chose d'extérieur la tranche comme un couteau» (p. 14) puisque la «taille seule fait ressortir les dessins secrets cachés dans les pierres» (ibid.), qu'il s'agisse d'agates ou de cœurs humains, parfois plus durs que ces dernières, et que le monde, en outre, «est comme un livre; de ses feuillets innombrables, nous ne voyons que celui auquel il est ouvert» (ibid.).
C'est par effraction que nous sont livrés la beauté ou le savoir, qui par essence doit rester caché et, parfois, interdit : «Les œufs de dragons, de griffons et du peuple de Neptune, couronné d'écume, ruissellent de feux auxquels s'enflamme une connaissance plus profonde que ne peuvent la susciter le jour et sa lumière» (p. 24).
Absence encore, mais absence créatrice, que celle fixée par le regard artiste ou génial qui seul voit ce qu'il importe de voir et que les autres ne voient pas : l'aile de l'oiseau «appelle en nous l'idée de l'air, la clef, celle de la serrure. Ainsi, dans ces moulins de glacier, c'étaient l'esprit des eaux, les rondes et les remous de torrents depuis longtemps taris, qui me tenaient sous leur empire. Car ces lieux des grandes forces gardent témoignage de leur inépuisable jaillissement» (p. 23).
Cette absence qui n'en est pas une, cette place vacante qui n'est que la marque et le privilège de l'esprit, son règne véritable, la lumière inondant «un paysage dont les lignes sont depuis longtemps tracées dans l'obscurité» (p. 80), sont la dimension réelle dans laquelle l'homme déploie sa puissance en faisant advenir ce qui n'existait pas ou plutôt, ce qui, de toute éternité, existait, mais que sa vision et son génie ont seuls pu faire advenir, s'extraire de sa gangue de pierre ou de ténèbres : «Les mondes nouveaux avaient accru le savoir, la richesse, la puissance. Mais l'on pouvait peut-être aussi dire que tout cela avait déjà vécu en l'homme, puis s'était réalisé dans l'espace. Les leviers de l'esprit avaient acquis un beau jour la longueur qu'exigeait Archimède» (p. 39).
Cet agrandissement de l'empan dans lequel l'homme enferme le monde, cette ouverture, de plus en plus grande, percée dans la muraille qui le sépare du monde entier des choses (3), représentent quoi qu'il en soit de véritables dangers, comme Jünger semble le suggérer lorsqu'il affirme que le moment a vite fait de venir du basculement de l'homme dans une sphère de puissance qui risque de le dévorer : «L'esprit, la volonté de l'homme étaient devenus trop forts pour leurs cadres anciens, pour l'équilibre habituel. C'est par là que commença la fin de l'âge moderne, connue de peu. La barrière intérieure fut la première à se rompre, puis la sécurité extérieure. Des légions d'hommes tombèrent sous toutes les enseignes, dans les forges grises et rouges des nouveaux prométhides, où l'acier se trempait en sifflant dans le sang» (p. 40).
En somme, c'est la potentialité même de l'homme, sa capacité à concevoir toutes les capacités, la formidable souplesse de son intelligence, qui sont la source de son malheur, l'esprit désirant toujours remplir le vide parce qu'il crée («La chose trouvée est le fruit du désir, en est le pôle matériel», p. 213) mais l'esprit chutant en fin de compte dans sa propre béance, liberté à vide où les monstres vont venir se ruer, pour tourmenter la conscience de celui-là même qui les a enfantés, du moins qui leur a donné un nom.
L'intelligence de l'homme lui permet de créer de nouvelles techniques qui, très vite, par leur puissance démiurgique, vont acquérir une aura et même un pouvoir spirituels indéniables (4) dont la dimension grimaçante, infernale, sera le secret de ces esprits dévoyés dont Jünger peuple ses inventions romanesques, qu'il s'agisse du Grand Forestier des Falaises de marbre ou du bailli d'Héliopolis, un personnage dont la voix démoniaque («Pour le bailli, la parole était le moyen élémentaire, la matière en fusion dont naît la politique», p. 278) ne peut que nous faire songer à l'exemple de Hitler (cf. p. 277).
Devant l'horreur que découvrent les gouffres de l'âme humaine, deux voies peuvent être empruntées : la première est celle de l'action violente, qui met un terme à la surrection du chaos et rétablit l'ordre là où le désordre menaçait de rompre les digues de l'harmonie. La seconde est celle de la nostalgie dans laquelle se réfugie le contemplateur solitaire, Lucius de Geer qui a pourtant été un homme d'action, et qui aspire à la quiétude de l'esprit et de l'âme par la connaissance, à la fois celle de l'être aimé et du livre merveilleux du monde : «Ce devait être encore l'une des formes sous lesquelles la vie restait supportable ─ Lucius y avait souvent songé : dans une île des mers tièdes, avec une cabane et une petite barque. Il faudrait y vivre, pêcheur méditatif, jetant son filet dans les gouffres aux trésors de l'onde. Dieu vous soumettrait les énigmes; les récifs rouges, les jardins de la mer, le fond cristallin en regorgeaient. On n'en résoudrait aucune, et serait pourtant satisfait. Et qui donc connaît le sens, ne fût-ce que des moindres hiéroglyphes sur une conque, une coquille d'escargot ? Pourtant, on serait heureux. On entreverrait de loin les Nombres sur lesquels repose le monde, on entendrait les rythmes des ressacs, les accords mélodieux. Voilà comment la vie s'écoulerait, paisible, pareille à celle des premiers ermites, dans une cabane au toit de roseaux, proche de palais d'azur, loin de toute vaine science» (pp. 54-5).
Cette nostalgie, sous différentes parures, est toujours celle d'un âge d'or qui se caractérise moins par le haut degré supposé de son raffinement que par sa capacité d'assurer la transmission des savoirs et de la tradition. Au fond, tout nostalgique conséquent se moque du passé, même si, à l'évidence, le présent lui est inférieur (5), qu'il est prêt à renier pour l'assurance qui lui serait faite de maîtriser les différents maillons de la chaîne d'or qui nous y relie. C'est moins ce qui a été aboli qui l'intéresse que la permanence d'une fonction qui nous permet de comprendre ce qui est grâce à ce qui a été : «Le trésor transmis par les civilisations anciennes avait de quoi occuper, et aussi de quoi contenter une brève vie humaine. Le monde était toujours infini, tant qu'on en conservait en soi la mesure; le temps restait inépuisable, tant qu'on gardait la coupe à la main» (p. 85), de même que, à propos de la mission de Lucius : «Et ceci restait, dans la suite des âges, sa vocation irrévocable : guider avec des mots l'esprit vers l'inexprimable, avec des sons vers des harmonies silencieuses, avec du marbre vers les régions sans pesanteur, avec des couleurs vers l'éclat surnaturel. Ce qu'il pouvait atteindre de plus haut, c'était la transparence» (pp. 105-6).
Ce dernier passage unit les thématiques que nous avons mentionnées : le travail de l'esprit est le plus difficile, qui doit faire advenir, du sein même de ce qui demeure comme pure potentialité, ce qui est, cette invention étant, au fond, une réinvention non pas de ce qui a été déjà découvert mais de ce qui peut être trouvé à l'unique condition que le chercheur glisse ses pas dans les pas de ceux qui l'ont précédé : «Mais toi, tiens-t'en au dogme, Lucius qui voile aux regards humains, sous l'étoffe des images, l'éclat surnaturel. C'est la sagesse des pères qui l'a tissé au cours des siècles. Tu ne trouveras jamais sur terre la vérité suprême, mais une vie menée selon les règles éprouvées par les âges t'en rendra digne, quand tu passeras la dernière porte» (p. 113).
De cette réalité à laquelle est censée nous conduire cette dernière porte, toutefois, nous pouvons avoir quelque intuition et même vision. Son accès concerne, lui, la sphère de la tentation faustienne, comme l'illustre, dans le roman de Jünger, le très beau chapitre intitulé Le récit d'Ortner : «L'homme qui s'empare de pouvoirs magiques, tels que les symbolisent la chape qui rend invisible ou l'anneau qui accomplit vos souhaits, perd l'équilibre, la tension qui nous maintient dans le train du monde; il met la main sur des leviers d'une puissance incalculable» mettant en branle des «forces [qui] ne tarderont pas à se retourner contre lui» (p. 162).
Finalement, cette tentation faustienne n'est pas d'une essence différente que la dynamique du mouvement de dévoilement progressif que nous avons indiquée comme étant le moteur du texte jünguerien : le danger, comme un lion cherchant qui dévorer, guette celui qui ose tenter de s'affranchir, par la drogue, le savoir ou la méditation, des conditions terrestres (6) qui, à la différence des grands modèles gnostiques, ne sont pas condamnées comme étant radicalement mauvaises.
Car c'est bien d'un autre empire que terrestre que le Mal vient lui qui, à l'occasion d'un de ces actes de bravoure ou de folie spéculatives, s'engouffre dans notre monde : «Nous avons évoqué les puissances gigantesques, sans être de taille à supporter leur réponse. Voici que l'horreur nous prend. Il faut choisir : ou bien entrer dans les empires démoniaques, ou bien se replier sur le domaine appauvri de l'humain. Nous n'avons plus qu'à y vivoter, tant que son sol porte encore un maigre regain» (p. 173).
Il n'est donc guère étonnant que, dans ces conditions, ceux qui se sont fait les serviteurs du Mal aient quelque chose de surhumain ou plutôt, de mécanique, d'une technique devenue folle, qui réifie l'humain, dans un rappel évident d'une des scènes les plus frappantes du Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, lorsque Marlow s'approche du repaire de Kurtz (7) : «Il semblait qu'une spécialité du docteur Becker fût, entre autres, de collectionner les têtes, telles qu'elles sont connues dans les régions les plus diverses, soit qu'elles servent de trophées guerriers, ou d'idoles au culte des ancêtres. On voyait des têtes momifiées et décolorées, dont certaines étaient rehaussées avec art de lignes ornementales et de pierres de couleur» (p. 286), ce spectacle horrible provoquant, nous dit Jünger, un «froid glacial» dans le corps et l'esprit de Lucius de Geer, qui songe à la moderne transposition d'une maxime de Francis Bacon, le «Science, c'est puissance» devenant «Science, c'est meurtre» (ibid.).
Il est de fait étonnant de constater que chez Jünger, la massification anonyme des moyens de destruction et de l'horreur rationalisée ne puisse être séparée de l'évocation d'un centre, d'un cœur des ténèbres et du Mal, la cabane d'équarrissage des Falaises de marbre ou Castelmarino dans Héliopolis, que Lucius et une poignée d'hommes raseront de la surface de la terre : «Oui, ces moyens étaient effrayants lorsqu'ils avaient pour fin le massacre d'armées et de peuples, mais plus effrayants encore, peut-être, lorsque l'homme les rassemblait autour de lui pour son plaisir égoïste, et que, baigné de leurs effluves, comme dans les châteaux des princes des génies, il se perdait dans une méditation démoniaque» (p. 305).
Personnification des forces du Mal qui ne peut s'expliquer que par une intention théologique, qui de fait admet, comme son ennemi et sans doute triomphateur, une personnification des forces du Bien, ici incarnée par l'exemple du mystérieux régent comparé à un «nouveau Noé» (p. 346) chargé de sauver l'humanité d'un Déluge destructeur.
Cette présence des forces du Mal nous permet d'ailleurs de ranger Héliopolis, dont le titre ne peut que faire songer à la Civitas Solis de Campanella parue en 1620, dans la catégorie des contre-utopies, si, avec Paul Tillich, l'utopie peut être à bon droit définie comme la négation de toute forme de négativité (8).
Il faudrait sans doute explorer plus avant la dimension spécifiquement religieuse d'Héliopolis qui est à mon sens d'essence messianique, voire millénariste, un déchaînement de violence salvateur préparant une nouvelle ère d'abondance (9), tandis que le peuple persécuté des Parsis, que nous pourrions rapprocher de l'exemple des Juifs tout autant que de celui des premiers chrétiens, représenterait le Reste des textes prophétiques : «Vous touchez ici à des choses importantes», déclare Boudour Péri à Lucius, «Où pourrait-on mieux le comprendre que chez les Parsis ? Là où l'espérance est la plus faible ? N'avons-nous pas cru de tout temps qu'au sein des âges de ténèbres, une nouvelle victoire de la puissance de lumière se prépare ?» (p. 347).
Ce serait, de fait, affirmer, comme Jünger le fait dans les toutes dernières pages de son roman, qu'il est ou serait possible «d'extraire du monde une élite formée par la souffrance», élite (ou Reste donc) qui «s'est isolée dans les luttes et les fièvres de l'histoire, comme une substance animée d'une volonté secrète de salut» (p. 406).
Notes
(1) «Il y a des lieux sur terre où se suivent des sanctuaires, du plus loin qu'on se souvienne; il en est ainsi des lieux de violence. Ces endroits semblent frappés d'une malédiction, qui leur attire des troupes sans cesse renouvelées de victimes. Elles se succèdent à travers le flux et le reflux de l'histoire, et qu'importe qu'elles soient traînées sur l'ordre des tyrans ou au nom de la liberté dans ces lieux d'épouvante, où l'on entendra toujours leur murmure, comme une litanie qui jamais ne s'arrête ? Car nul ne saurait compter ceux qui à chaque instant languissent dans les geôles de ce monde», Ernst Jünger, Héliopolis (traduction de Henri Plard, Le Livre de Poche, coll. Biblio, 1988, l'auteur souligne), p. 56. Toutes les pages entre parenthèses renvoient à notre édition.
(2) Voici de quelle façon le général présente à Lucius les deux grandes forces rivales agitant le monde d'Héliopolis, que nous pourrions affirmer être d'inspirations libérale et socialiste : «Le bailli veut, hors de l'histoire, élever un être collectif au rang d'État; nous, nous tendons à un ordre historique. Nous voulons la liberté de l'homme, de son être, de son esprit et de ce qu'il possède, et l'État dans la seule mesure où ces biens réclament une protection. De là résulte la différence entre nos moyens et méthodes et ceux du bailli. Il est obligé de niveler, d'atomiser et d'aplanir son matériel humain, au sein duquel doit régner un ordre abstrait. Chez nous, au contraire, c'est l'homme qui doit être le maître. Le bailli vise à la perfection de la technique, nous visons à la perfection de l'homme» (p. 179).
(3) À l'évidence, la structuration de l'univers peint par Jünger est d'essence ésotérique : «Le monde est bâti sur le modèle de la Chambre double. De même que tous les êtres vivants sont formés de deux feuilles, il est fait de deux couches, qui sont entre elles dans le rapport de l'intérieur à l'extérieur, et dont l'une possède une réalité plus haute, l'autre une réalité moindre. Mais la réalité moindre est déterminée jusque dans ses plus petits détails par la plus haute» (p. 144).
(4) «La technique entre insensiblement dans sa troisième phase. La première était titanesque; elle visait à édifier le monde des machines. La seconde (sic) fut rationnelle, et aboutit à l'automatisme parfait. La troisième est magique, car elle donne vie aux automates en leur donnant un sens. La technique prend un caractère d'enchantement; elle se plie aux désirs» (p. 224). Le monde que décrit Jünger est celui dans lequel se déroule l'action d'Héliopolis, puisque, à l'évidence, le phonographe qu'il décrit longuement (cf. p. 338-9) ressemble aux modèles de terminaux aussi intelligents que miniaturisés capables de nous offrir une multitude de services allant de la domotique à la recherche d'informations que les techniciens nous promettent pour demain et non plus après-demain. Nul ne sera étonné d'apprendre que, pour Ernst Jünger, le phonographe est conçu comme «l'agent idéal de la démocratie planétaire» (p. 337) y compris dans sa version panoptique ou policier (cf. p. 341), une expression qui conviendrait parfaitement à l'usage des ordinateurs reliés désormais par l'immense réseau de la Toile.
(5) Décadence du présent qui se lit grâce à un exercice de lecture d'un type particulier puisqu'il s'agit de déchiffrer, sur des visages, l'assurance d'une dégénérescence : «Souvent, Lucius, étudiant les lointaines archives et les chroniques des régiments, avait été frappé par une différence dans les visages, qui reflétait cette rupture. Chez ces précurseurs, qui presque tous avaient trouvé la mort dans les flammes, il y avait encore un legs de la vieille aristocratie. Mais venaient ensuite des têtes dont on ne pouvait définir la nature que comme un agréable néant, et qui révélaient le vide des destructions dont elles étaient chargées. Elles n'étaient pas sans régularité, ni sans charme, mais on eût dit que la toile d'un bon portraitiste avait été remplacée par un écran de cinéma» (p. 308).
(6) «L’œil est créé pour un empire d'ombres, non pour la lumière incolore. La lumière, la grande puissance de l'univers, vous consumerait si elle s'approchait de vous sans voiles. La beauté, la vérité, le savoir sont intolérables pour le regard trouble; c'est assez de leur ombre à tous. Pourquoi vous efforcer de dépasser votre cercle ?» (p. 170), telle est la grande question par laquelle les moralistes, car Jünger en est un, aussi subtil qu'on le voudra, se sont efforcés de tempérer la soif de savoir de leur héros.
(7) Il est du reste curieux que Michel Arouimi n'ait pas mentionné cette scène commune entre les deux romans, alors que son ouvrage, du reste fort inégal, qui n'est bien souvent qu'un ennuyeux et indigeste commentaire composé (par exemple sur les poèmes de Rimbaud), une étude qui, de façon souvent ridicule et loufoque, tenter d'établir des rapprochements entre plusieurs textes et, enfin, un essai très artificiellement polarisé par le thème de l'Un et du multiple, évoque les modèles littéraires que furent Rimbaud, Conrad et Melville pour Jünger (voir Jünger et ses dieux. Rimbaud, Conrad, Melville, Éditions Orizons, coll. Profils d'un classique, 2011).
(8) Voir une étude datant de 1951 intitulée Politische Bedeutung der Utopie im Leben Völker.
(9) Étude qui devrait montrer de quelle façon complexe cette évocation d'une attente apocalyptique pouvant être rapprochée de «l'esprit de départ» qu'évoque bellement Jünger (cf. p. 403) s'oppose à ou bien au contraire rejoint l'exaltation d'un temps mythologique qui n'est point figé mais retour sacré d'un même dans lequel l'homme puiserait sa force créatrice : «Le monde est grand et il n'y a pas, au-delà des Hespérides, que le Pays des Castels», comme Ortner le déclare à Lucius, en poursuivant : «Vous serez heureux avec votre compagne dans l'une de ces blanches villes insulaires que vous aimez ─ dans l'une de ces vieilles résidences marines, qui ne sont jamais sorties du mythe. Aux lieux où brillent le soleil et la mer, où fructifient la vigne et l'olivier, où les mendiants mêmes vivent dans une liberté royale, et lorsqu'un œil comme le vôtre embrasse ce spectacle, les sources anciennes jaillissent encore dans leur splendeur intacte, et les choses sont encore dignes qu'on les désire» (pp. 394-5). Ailleurs, Jünger lie ces deux thématiques d'une façon saisissante par l'évocation de l'utopie : «Tout État se doit de créer une utopie, dès qu'il a perdu le contact avec le mythe. C'est en elle qu'il parvient à prendre conscience de sa mission. L'utopie est l'esquisse du plan idéal, qui sert à déterminer la réalité. Les utopies sont les tables de la Loi contenues dans la nouvelle Arche d'alliance; les armées les emportent, invisibles, avec elles» (p. 221). Jünger, dans son Traité du rebelle datant de 1951 (Seuil, coll. Points, 1986, p. 63), notait cette phrase, unissant la résurgence du temps mythique et la déhiscence de l'événement apocalyptique sous les dehors de la guerre : «On ne revient pas en arrière pour reconquérir le mythe; on le rencontre à nouveau, quand le temps tremble jusqu’en ses bases, sous l’empire de l’extrême danger».
Cette étude devrait également évoquer le portrait du «germaniste maladif, mais richement doué» (p. 333) Fernkorn, dont Jünger nous précise qu'on «lui reprochait de ramener trop exclusivement les littératures aux relations théologiques. Quant à l'histoire littéraire, en elle-même, il la prétendait vaine, pour autant qu'elle ne cherchait pas dans l'histoire des religions son principal recours. C'est dans cet esprit qu'il obligeait ses élèves à faire tout d'abord l'inventaire de la foi d'un auteur, source de sa puissance créatrice. Il suivait ces fils jusque dans la sécularisation. On voyait dans son étude sur Bakounine l'exemple classique de sa méthode; il lui avait donné pour épigraphe : Il n'y a d'intéressant sur la terre que les religions» (p. 334).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, ernst jünger, héliopolis |  |
|  Imprimer
Imprimer




























































