« La Folie Baudelaire de Roberto Calasso | Page d'accueil | De l'égarement à travers les livres d'Éric Poindron »
17/03/2012
Au-delà de l'effondrement, 40 : Sous les bombes de Gert Ledig

Crédits photographiques : Muhammed Muheisen (AP Photo).
 Tous les effondrements.
Tous les effondrements.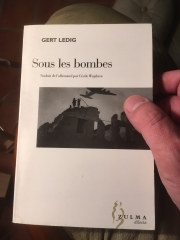 Acheter Sous les bombes sur Amazon.
Acheter Sous les bombes sur Amazon.C'est en lisant W. G. Sebald que j'ai découvert le nom de Gert Ledig, tout comme c'est par l'auteur des Anneaux de Saturne que j'ai découvert celui de Nossack, qui le premier a ouvert cette série consacrée aux récits post-apocalyptiques.
Ce n'est pourtant pas à un récit de bombardement que le texte de Gert Ledig m'a fait penser mais à la chronique hallucinée de la guerre du Vietnam que Michael Heer nous a donnée avec Putain de mort.
Dans les deux cas, la volonté de témoigner surpasse la prétention littéraire, après tout risible lorsque le Mal se déchaîne, le livre de Ledig pouvant être rapproché d'une série de photographies plutôt que d'un texte évoquant une ville en ruine comme Dehors devant la porte de Wolfgang Borchert : des photographies ayant figé le triomphe; fût-il temporaire, de la destruction, la progression des ravages indiquée par la silhouette errante d'un homme hagard ayant tout perdu, un enfant assis au milieu des ruines et qui, en quelques minutes, semble avoir accumulé l'expérience indicible de centaines de siècles de massacres et d'acharnement contre l'ordre, l'équilibre, la beauté, notre siècle est rempli de ces images impressionnantes ou banales, impressionnantes dans leur banalité, de ravages et de catastrophes naturelles.
De fait, comme devant une photographie de guerre, l'imagination peut donner vie à des visages sans nom (la plupart des personnages du texte de Gert Ledig ne sont pas indiqués par autre chose qu'un pronom) et retracer leur histoire et leurs souffrances, même si, en tête de chaque chapitre du livre, figure un court texte présentant plus avant les détails biographiques de tel ou tel personnage, pas forcément évoqué dans le reste du livre d'ailleurs. Le maximum de monstruosité ne peut être séparé d'un sentiment vague, l'impression que, tous, nous sommes concernés, le Mal sans visage se moquant d'une trop grande caractérisation romanesque qui donnerait encore, aux lettres putanisées et roublardes, leur aura de romanesque. L'ère du témoignage est la plus sûr négation de la mauvaise littérature, celle qui édifie sur des ruines encore fumantes. L'ère du témoignage cependant, dans ses productions les plus inconsistantes, est parvenue à donner au Mal le visage apaisant d'une connaissance qui, de temps à autre, esquisse derrière votre porte un pâle sourire auquel il paraît difficile de résister : vous lui ouvrez votre porte et l'invitez, modestement, à partager votre repas.
Souffrances indicibles dont le premier caractère, photographique je l'ai dit, est d'exciter la persistance rétinienne, alors même que l'action que nous raconte Gert Ledig s'étend en un peu plus d'une seule heure, de 13 h 01 à 14 h 10 : je suis resté, bien au-delà de ma lecture, hanté par quelques-unes des scènes décrites dans le livre, comme celle d'un homme et d'une femme prisonniers des décombres, la promiscuité insoutenable puis le viol abject s'ensuivant, ces quelques phrases encore, qui, sous une autre plume que celle de Gert Ledig, sonneraient faux, lui feraient encourir le reproche de mettre en scène une horreur surjouée et que nous savons être vraisemblable sinon vraie, tout simplement : «Deux canonniers portaient les restes d'un homme avec des bêches. Ils le portaient entre eux et couraient en essayant de garder l'équilibre. Ils le déposèrent sur une bâche, près du rempart. De la chair, des cheveux. Un bout d'intestin tomba. Ils ramassèrent précipitamment» (p. 92). Bouts de chairs et monceaux de ruines, la conscience planant au-dessus du carnage ne parvenant même plus (en a-t-elle le droit, d'ailleurs ?) à décrire de façon unifiée le monde cassé et les hommes qui se cachent comme des rats et meurent comme des chiens sans maître.
Horreur insoutenable, abjecte, banale même si elle se donne des airs de nouveauté («Il ne mourut pas d'une façon déjà répertoriée. Il grilla», p. 125), d'autant plus frappante que Gert Ledig n'insiste absolument pas sur ses conséquences morales : comme un regard implacable, il voit ce qui se déroule devant lui, un tapis de bombes alliées s'écrasant sur une ville allemande pas même nommée, quelque fantôme de Georg Trakl (1) se contentant, par quelques mots, de nous frapper de stupeur parce que le but réel ne diffère pas du but avoué, celui consistant à décrire, coûte que coûte : «Lorsque la première bombe tomba, le souffle projeta des enfants morts contre le mur» (p. 13) (2) et nous sidérer, non pour le plaisir de la performance, mais parce que le témoignage commande la relation de ce qui a eu lieu : «Celui qui gémissait était réduit au silence. Celui qui criait criait en vain. La technique anéantissait la technique. Elle tordait les pylônes, déchiquetait les machines, creusait des entonnoirs, renversait les murs, la vie n'était qu'ordures» (p. 48). Ce dernier passage contient peut-être la seule citation quelque peu didactique du livre, que l'on dirait extraite d'un livre de Günther Anders : «La technique anéantissait la technique» : ce simple constat auquel on hésite à prêter une portée philosophique réelle et qu'on dirait figé dans une répétition infernale, admet tranquillement que la technique (la Machine, dirait Anders) engendre la technique, la technique dévorant donc la technique, sans qu'il nous soit possible de séparer ces deux processus si intimement liés. Au milieu se tient le livre écrit, dont on ne sait trop s'il possède quelque force secrète pour résister à l'avancée de la ruine, le livre, après tout, engendrant le livre et le détruisant somme toute.
Aucune morale ne peut être tirée du texte implacable de Gert Ledig, aucune exaltation (du courage des hommes), aucune condamnation (de leur folie), pas même l'assurance que Dieu (3) a forcément dû se retirer (4) de sa Création puisqu'Il a laissé faire cela.
Peut-être, comme d'ailleurs dans le texte de Nossack qui contient une parabole glaciale (5), pouvons-nous méditer sur le sens de l'histoire qu'une femme raconte et qui n'est pas sans nous rappeler le renversement de perspective que Richard Matheson décrit dans Je suis une légende : «Il était une fois un malade que des savants invitèrent à faire un discours. [...] C'était une expérience scientifique, et le malade mental, tout de même assez normal pour parler, s'acquitta de sa tâche avec une grande éloquence mais qui n'avait aucun sens. À la fin, cependant, il se fit ambigu, atteignant presque la logique d'un sage. Il dit : Messieurs, j'arrive au terme de mon exposé. D'après ce que vous venez d'entendre, vous me considérez comme un fou. Mais en êtes-vous si sûrs ? [...] Je suis malheureusement seul, et vous êtes nombreux. Mais pensez qu'un caprice de la nature pourrait facilement tout changer. Si des hommes comme moi peuplaient la terre. Et si vous constituiez une minorité sans espoir. Savez-vous ce qui se produirait ?» (p. 143). L'extermination, sans doute, en règle et tranquillement inscrite en colonnes de chiffres d'entrées et de sorties, de corps réduits à de minuscules quantités miettes nauséabondes, moins que cela même, de fumée impalpable disparaissant dans le lait noir de l'aube.
Les dernières lignes du texte de Gert Ledig accentuent cette impression de folie sans remède : «Les pierres montaient dans le ciel comme des fusées. Les croix de bois du cimetière étaient déjà carbonisées. Dans la salle d'attente de la gare en ruine, des enfants couverts de sang se traînaient sur les marches de pierre. Des bombes arrachèrent le Christ de sa croix, dans une église, la peau blême des corps des nouveau-nés, dans la cave d'une clinique d'accouchement, séparèrent les mains jointes d'une femme, quelque part, et les singes des arbres où ils s'étaient réfugiés, dans le zoo» (p. 197) bien que la voix de Gert Ledig, d'une sobriété que l'on dirait revenue de tout, esquisse tout de même la morale de ce monde devenu fou, laquelle tient en quelques mots, il ne faut rien oublier et ne pas chasser de sa mémoire les événements face auxquels nous demeurons impuissants, la force et peut-être le pouvoir du témoignage résidant dans le seul fait que, réellement ou en imagination, un seul homme a évoqué les morts inconnus et leurs derniers actes, criminels ou admirables, qui seront peut-être comptabilisés au jour du Jugement dernier (6) : «Une heure suffit, pour que l'horreur triomphe. Plus tard, certains voulurent oublier. Les autres ne voulaient plus savoir. Sous prétexte qu'ils ne pouvaient rien y changer» (p. 198)
Notes
(1) Il faudrait rapprocher les styles de Ledig et de Trakl, il me semble assez comparables dans leur procédé de description asyndétique : «Il plongea les mains dans les ruines fumantes. Commença à creuser. De plus en plus vite. Des braises s'élevaient. La tempête aspira le feu. Les flammes léchaient le pourtour de la montagne de gravats» (p. 94).
(2) Gert Ledig, Sous les bombes (traduction de l'allemand et présentation de Cécile Wajsbrot, Zulma, coll. Dilecta, 2005). Toutes les pages entre parenthèses renvoient à cette édition.
(3) Dans le texte de Ledig, les occurrences du terme Dieu mériteraient une étude à part entière. Contentons-nous de remarquer que la toute première ligne du livre est d'une ironique monstruosité puisqu'elle sera suivie de la description de corps d'enfants morts projetés contre les murs par le souffle des bombes : «Laissez venir à moi les petits enfants...» (p. 13). Ironie répétée par la description d'une statue d'ange : «Un ange écarta les bras pour les bénir. Il lui manquait une aile. Il était en marbre» (p. 157) ou par une pensée de Strenehen : «Père [...] qu'est-ce que tu fais ?» (p. 186).
(4) «Il était le dernier. Si ça lui arrivait, personne ne le remarquerait. Il pensa : Même pas Dieu. Je suis trop insignifiant. Il disparut dans la fumée (p. 67), où c'est plutôt le thème de l'indifférence de Dieu qui est évoqué, y compris pour ses serviteurs : «Il pensa : S'il y a un Dieu, il faut qu'il se signale. Peut-être va-t-il apparaître dans les flammes. Une voix paternelle pleine d'amour. Le prêtre écouta dans le feu. Le crépitement du bois. Il n'y avait rien d'autre. Il se remit à crier. C'était de peur, cette fois, et non pour se calmer. Autrefois, il avait espéré ne pas mourir seul. Sur le front du prêtre, les veines gonflaient, tant il criait. Cela dura quatre fois soixante secondes. Il avait établi un record. Avant de brûler» (p. 84). Cette indifférence de Dieu à l'égard de sa propre créature ne peut qu'être, pour celle-ci, qu'occasion de révolte et de blasphème, puisque le prêtre, comme le sergent Jonathan Strenehen que nous suivons alors que son avion a été abattu et qu'il est tombé sous le propre tapis de bombes lâchées par ses camarades, demandent à Dieu d'intervenir directement pour faire cesser ce qu'ils considèrent comme une offense absolue au bon sens, leur propre mort. Bien sûr, cette intervention sera considérée, pour l'incroyant, comme étant une preuve valable de l'existence de Dieu (cf. également p. 159) : «La porte demeurait muette. Il pensa : Si elle s'ouvre, je crois en Dieu. Pas forcément tout de suite, se dit-il. Une minute. La porte ne bougeait pas. La tôle transpirait. Des gouttes se formaient. Strenehen pensa : Dieu, Dieu. Si la porte s'ouvre, il existe» (p. 111).
(5) «Il y avait des étoiles, celles de toujours. Alors quelqu'un se mit à parler en dormant. Personne ne comprit ce qu'il disait. Comme tout le monde fut troublé, pourtant ! Ils se levèrent et quittèrent le feu, l'oreille anxieusement tendue vers l'obscurité glaciale. Ils heurtèrent le rêveur du pied. Alors, celui-ci s'éveilla. «J'ai fait un rêve. Je dois avouer ce que j'ai rêvé. J'étais au pays que nous avons quitté.» Il chanta une chanson. Le feu pâlit. Les femmes se mirent à pleurer. «Je reconnais : nous étions des êtres humains !» Alors les hommes se dirent entre eux : s'il en était comme dans son rêve, il ne nous resterait plus qu'à mourir de froid. Abattons-le. Et ils l'abattirent. Alors le feu les réchauffa de nouveau, et tout le monde était satisfait» in Hans Erich Nossack, Interview avec la mort (Gallimard, coll. Du monde entier, traduction par Denise Naville, 1950), p. 279.
(6) «Mais ce n'était pas le jour», ajoute immédiatement, dans les derniers mots de son texte, Gert Ledig.




























































 Imprimer
Imprimer