« Apologia pro Vita Kurtzii : Suttree de Cormac McCarthy | Page d'accueil | Dune de Frank Herbert, 2 »
23/12/2006
Apologia pro Vita Kurtzii, 2 : Méridien de sang de Cormac McCarthy

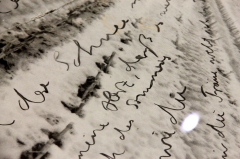 Apologia pro vita Kurtzii.
Apologia pro vita Kurtzii.«Car il ne faut pas considérer que la vie des ténèbres est plongée dans la misère et comme perdue dans l'angoisse. Il n'y a pas d'angoisse. Car la tristesse est engloutie dans la mort, et la mort et l'agonie sont la vie des ténèbres.»
Jacob Böhme cité en exergue par Cormac McCarthy dans Méridien de sang (Seuil, coll. Points, 2006, pour tous les numéros de pages entre parenthèses).
«Quant aux caractères de cette «Race des Ténèbres», ils sont plus nettement définis. Sa présence est universelle, «dans chaque partie du monde […], dans le monde entier […], partout […], d'un côté comme de l'autre».
Saint Augustin, Contra Fortunatum, 21 (le texte latin donne : «in omni mundo […] in toto mundo […] ubique […] utrobique»).
«Cavaliers fantômes, pâles de poussière, anonymes dans la chaleur crénelée. Avant tout on eût dit des êtres à la merci du hasard, élémentaires, provisoires, étrangers à tout ordre. Des créatures surgies de la roche brute et lâchées sans nom et rivées à leurs propres mirages pour s’en aller rapaces et damnées et muettes rôder comme les gorgones errant dans les brutales solitudes du Gondwana en un temps d’avant la nomenclature où chacun était tout.»
Cormac McCarthy, Méridien de sang, op. cit., p. 218.
Poursuivons notre descente. Elle sera salutaire si elle est suivie d'une remontée vers la lumière, aussi incertaine que nous paraisse celle-ci, dans ce lieu où gémissent les damnés. Mais, pour l'instant, descendons je vous prie, me dit doucement l'étrange cicérone aux traits anguleux avant de passer sous le porche immense, sa maigre main, l'index tendu, montrant l'entrée absolument noire.
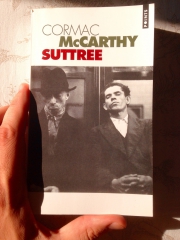 J'achève la lecture du cinquième roman de ce diable (il ne peut être à l'évidence que cela) de McCarthy, Méridien de sang, paru en 1985. C'est tout simplement prodigieux et je suis assez étonné qu'après l'épique Suttree, dont la rédaction a coûté à l'auteur quelque vingt années de travail, le romancier américain soit parvenu à tant de concentration : pas une ligne, dans ce livre noir, qui ne paraisse vivre de sa propre nécessité, absolue, pas une ligne (alors que je ne lis, bien sûr, qu'une traduction donc, a priori, un texte moins dense que l'original) de ce roman qui ne me semble gorgée de quelque suc puissamment corrosif.
J'achève la lecture du cinquième roman de ce diable (il ne peut être à l'évidence que cela) de McCarthy, Méridien de sang, paru en 1985. C'est tout simplement prodigieux et je suis assez étonné qu'après l'épique Suttree, dont la rédaction a coûté à l'auteur quelque vingt années de travail, le romancier américain soit parvenu à tant de concentration : pas une ligne, dans ce livre noir, qui ne paraisse vivre de sa propre nécessité, absolue, pas une ligne (alors que je ne lis, bien sûr, qu'une traduction donc, a priori, un texte moins dense que l'original) de ce roman qui ne me semble gorgée de quelque suc puissamment corrosif.Nombre de critiques anglo-saxons tiennent ce roman pour l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, de la littérature américaine. Ils n'ont pas complètement tort (tout de même, ils ont la mémoire courte : Absalon, Absalon ! et Moby Dick, tous deux admirés d'ailleurs par McCarthy, barrent d'un trait cette prétention qui n'est bien évidemment pas celle du romancier) mais, plutôt que de s'amuser, un peu vainement, à rechercher comme ils le font dans ce livre des bribes d'une quelconque religion gnostique, ils feraient mieux de se souvenir que, sur ces terres démoniaques, un écrivain s'est déjà aventuré, revenant de son périple dangereux marqué durablement. Cet écrivain s'appelle Joseph Conrad et je doute que Cormac McCarthy, immense lecteur, ignore l'aventure de Marlow rencontrant, au fond de la jungle, Kurtz.
Car le juge Holden, géant albinos d'une réalité plus fantasmée que, dit-on, véritablement historique (ainsi n'hésite-t-il jamais à affirmer qu'il n'est rien, allant même jusqu'à ajouter ce propos si typiquement ouinien : «Au fond de votre cœur vous voudriez qu’on vous parle de mystère. Le mystère c’est qu’il n’y en a pas») et homme d'une cruauté inimaginable, est moins quelque incarnation grotesque du diable ou d'un archonte désireux d'étendre à la terre entière l'empan de sa puissance surhumaine que l'un des fils stériles de Kurtz, peut-être le plus accompli, si je ne tiens pas compte de l'exemple de Monsieur Ouine. Les points de convergence, entre ces deux personnages, sont innombrables, j'en donne quelques-uns seulement. Même inépuisable soif d'un savoir paraissant s'étendre à tous les domaines de connaissance : comme Kurtz, Holden est le produit le plus abouti de la vieille Europe mais, à sa différence, il ne semble point dédaigner ses faveurs. Plus que Kurtz encore (et nous nous rapprochons de nouveau de Ouine, du Teste de Valéry), Holden développe la tentation totalitaire d'une science absolue, qui engloberait de ses rhizomes le plus petit recoin de l'univers pour que celui-ci ne semble plus devoir échapper à l'attention dévoratrice du juge, arraisonneur suprême si je puis dire : «Tout ce qui existe, déclare-t-il ainsi, dans la création à mon insu existe sans mon consentement.
Il promena son regard sur la sombre forêt où était établi leur bivouac. Il désigna d’un mouvement de tête les échantillons qu’il avait recueillis. Ces créatures anonymes, dit-il, on pourrait croire que c’est peu de chose en ce bas monde ou même rien du tout. Pourtant la plus petite miette peut nous dévorer. La plus petite chose sous ce rocher là-bas qui échappe au savoir de l’homme. Seule la nature peut asservir l’homme et c’est seulement lorsque l’existence de la moindre entité aura été traquée dans son ultime retraite et forcée de comparaître nue devant lui qu’il sera vraiment le suzerain de la terre» (pp. 250-1). La femme de Teste n'affirmait-elle pas que, devant lui, elle se sentait comme une mouche prise au piège (probable souvenir d'une mémorable tirade shakespearienne, As flies to wanton boys are we to the gods...) ? Jambe-de-Laine ne confiait-elle pas au jeune Steeny que rien, absolument rien n'échappait à l'attention, toujours éveillée, de Ouine ? Ainsi le carnet de notes que tient, scrupuleusement, le juge Holden, dans lequel il consigne toute découverte d'os bizarre ou de pierre ayant retenu son attention de fin géologue ressemble-t-il au livre total, absolu, rêvé par Teste, maître de toutes les destinées, y compris les plus minuscules : «Ce qui doit être ne s’écarte pas d’un iota du livre où ce qui doit être est écrit, déclare le juge. Comment pourrait-il en être autrement ? Ce serait un faux livre et un faux livre n’est pas un livre» (p. 179).
Même admirable capacité, chez Kurtz, Holden (mais aussi Ouine et Teste) à fasciner leurs auditeurs par le don d'une parole tout entière dévouée aux puissances des ténèbres : dès les premières pages du roman de McCarthy, Holden, accusant un prêtre de pédophilie (Ouine, lui aussi, tentera de corrompre le prêtre de la paroisse morte), a failli provoquer son lynchage par les fidèles de la messe qu'il célébrait avant d'être interrompu par le juge qui avouera, sans ciller, quelques heures plus tard, qu'il ne savait rien de cet homme avant de pénétrer dans son église. Même volonté d'exterminer toutes ces brutes, selon la phrase bien connue écrite par Kurtz en marge de l'un de ses mémoires sur la situation déplorable dans les colonies africaines pillées pour l'ivoire dont elles regorgent. Partant, même fascination pour les actes d'un homme capable de dépasser l'homme : ainsi Holden paraît-il être également quelque souvenir de Marlon Brando incarnant Kurtz dans le film de Coppola. Lui aussi, ayant contemplé l'horreur de ses propres yeux, a rapporté de sa catabase un savoir ténébreux (et nietzschéen assurément) qu'il exposera plusieurs fois au cours du roman mais jamais de façon aussi nette et précise que durant les toutes dernières pages, déclarant au personnage du gamin devenu grand : «Écoute ce que je vais te dire. Plus la guerre sera déshonorée et sa noblesse mise en doute, plus ces hommes d’honneur qui reconnaissent la sainteté du sang seront exclus de la danse qui est le droit du guerrier, et ainsi la danse deviendra une fausse danse et les danseurs de faux danseurs. Et pourtant il y en aura toujours un ici qui sera un vrai danseur et devines-tu qui ça pourrait être ?
Vous êtes rien du tout.
Ce que tu dis là est plus vrai que tu ne le penses. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Celui-là seul qui s’est offert tout entier au sang de la guerre, qui a été jusqu’au fond de la fosse et qui a vu toute la plénitude de l’horreur et qui a compris enfin qu’elle parle au plus intime de son cœur, seul cet homme-là sait danser» (p. 412).
Même étonnante calvitie, ce qui n'est certes pas qu'un détail, comme si Kurtz et Holden avaient été désireux de se dépouiller, au contact de la sauvagerie, entendant les voix venues du plus profond de la nuit, des derniers restes de leur humanité, symbolisée par une chevelure qui, dans le roman de McCarthy, est systématiquement maltraitée, voire, le plus souvent, lorsqu'elle pare les têtes indiennes, scalpée. Il y a toujours, dans la vision d'un crâne (et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans le roman de McCarthy : fracassés, réduits en cendres, scalpés je l'ai dit, déformés...), quelque réminiscence de notre plus lointain passé.
Ce point justement est peut-être la plus évidente ressemblance entre les deux livres : le voyage de Marlow vers Kurtz, Conrad insiste sans relâche sur cette dimension, ne peut être qu'une remontée vers l'aube (noire) des hommes. Le juge Holden à son tour, découvrant les vestiges d'une ancienne et mystérieuse civilisation, nous livre ses méditations sur la dégénérescence de l'humanité, que seule la force et la guerre pourraient sauver. Voici ses paroles (je souligne) : «Ce qui est vrai d’un homme, dit le juge, est vrai de beaucoup. Le peuple qui vivait ici autrefois s’appelle les Anasazis. Les anciens. Ils ont abandonné ces régions, chassés par la sécheresse ou la maladie ou par des bandes errantes de pillards, abandonné ces régions depuis des siècles et il n’y a d’eux aucun souvenir. Ce sont des rumeurs et des fantômes dans ce pays et ils sont hautement vénérés. Les outils, l’art, la maçonnerie, tout cela porte condamnation des races qui sont venues après. Mais il n’y a rien à quoi elles peuvent se raccrocher. Les anciens s’en sont allés comme des fantômes et les sauvages rôdent à travers ces canyons au son d’un antique ricanement. Dans leurs huttes grossières ils sont tapis dans l’obscurité et ils écoutent la peur qui suinte de la roche. Tout mouvement d’un ordre supérieur à un ordre inférieur est jalonné de ruines et de mystères et des déchets d’une fureur aveugle. Voilà. Ici sont les ancêtres morts. Leur esprit est enseveli dans la pierre. Il repose sur cette terre avec le même poids et la même ubiquité. Car quiconque se fait un abri de roseaux et de peaux de bêtes s’est résigné dans son âme à la commune destinée des créatures et il retournera à la boue originelle avec à peine un cri. Mais celui qui bâtit avec la pierre s’efforce de changer la structure de l’univers et il en était ainsi de ces maçons aussi primitives que leurs constructions puissent nous paraître» (p. 185).
Cette plongée dans le passé le plus lointain, rappelée par le romancier par certaine image privilégiée unissant la description du paysage et la mention de quelque monstre affleurant à sa surface pulvérulente, rappelée encore par de superbes évocations de la puissance élémentale et primesautière du feu («Les flammes se tordaient au vent et les braises pâlissaient puis s’assombrissaient puis pâlissaient encore puis s’assombrissaient comme la pulsation sanguine d’une chose vivante gisant éviscérée sur le sol devant eux et ils contemplaient le feu qui contient en lui quelque chose de l’homme lui-même tant il est vrai que sans lui l’homme est diminué et coupé de ses origines et comme exilé. Car chaque feu est tous les autres feux, le premier feu et le dernier feu qui sera jamais», p. 307), cette plongée dans le passé est enseignement pour le temps présent, compris moins comme un terrain de jeu où les hommes se livreraient à leurs salutaires (et scandaleux pour la morale des faibles) penchants pour la violence et la guerre que comme l'intime certitude que de ce présent naîtra, hélas, un futur encensant la faiblesse, la déchéance, la dégénérescence des instincts premiers. Nietzsche encore, mais un Nietzsche pratique, tailladant de ses propres mains ses ennemis, s'enfonçant, fumant de sang, dans la mêlée prodigieuse où s'entrechoquent les armes. À sa façon, le juge Holden est un étrange et monstrueux Baptiste annonçant les temps futurs qu'il souhaite de pure violence, la guerre étant à ses yeux le jeu suprême et, in fine, Dieu lui-même : «S’il avait été dans le dessein de Dieu d’arrêter la dégénérescence du genre humain, est-ce qu’il ne l’aurait pas déjà fait ? Les loups font eux-mêmes leur sélection, mon ami. Quelle autre créature pourrait le faire ? Comme si l’espèce humaine n’était pas encore plus prédatrice ? C’est le sort de l’univers de fleurir et de s’épanouir et de mourir mais dans les choses humaines il n’y a pas de déclin et le zénith annonce déjà la venue de la nuit. L’esprit de l’homme est épuisé à l’apogée de sa réussite. Son midi est à la fois son crépuscule et le soir de sa journée. Il aime jouer ? Alors, il faut un enjeu. Ce que vous voyez ici, ces ruines que des tribus de sauvages contemplent avec stupeur, est-ce que vous ne croyez pas que ça recommencera un jour ? Oui. Et encore un autre jour. Avec d’autres hommes, avec d’autres fils» (p. 186).
Enfin, formellement, Méridien de sang est à rapprocher de la structure lacunaire et elliptique de Monsieur Ouine et du Cœur des ténèbres : Ouine est-il pédophile ? Kurtz a-t-il assisté à quelque cérémonie païenne inimaginable ? Le juge Holden a-t-il tué (ou violé, ou dévoré ?), dans les toutes dernières lignes du roman, le personnage intitulé le gamin ? Nous n'en savons rien et peu nous importe d'ailleurs, puisqu'il faut comprendre que pour ces trois écrivains, le Mal réside moins dans le spectacle le plus consommé de l'horreur que dans sa très fine suggestion, comme le rappelait Enrico Castelli dans un ouvrage désormais classique consacré à l'esthétique du démoniaque.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, romans, démonologie, cormac mccarthy |  |
|  Imprimer
Imprimer


























































