« Night of the Demon de Jacques Tourneur, par Francis Moury | Page d'accueil | Howard McCord dans la Zone »
05/02/2014
En marchant vers l'extrême d'Howard McCord
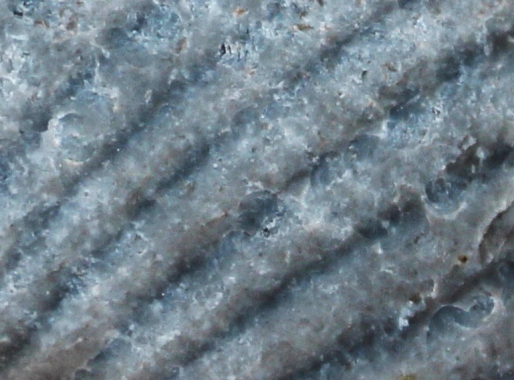
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 L'Homme qui marchait sur la Lune.
L'Homme qui marchait sur la Lune. Howard McCord : le littéral au bout de la langue, par Gregory Mion.
Howard McCord : le littéral au bout de la langue, par Gregory Mion. Acheter En marchant vers l'extrême sur Amazon.
Acheter En marchant vers l'extrême sur Amazon.Le lecteur désireux de découvrir le second titre d'Howard McCord disponible en France doit se procurer la belle traduction donnée par François Hirsch (1) de Walking to Extremes. Nous pourrions qualifier l'étrange enseignement que renferme ce livre, et cela bien que l'expression puisse paraître moins inadaptée que prétentieuse puisqu'il s'agit de tenter d'évoquer de quelle manière l'homme peut appréhender la solitude extrême ou bien le «thème du solitaire dans un désert mental» (p. 11), de phénoménologie du vide qui est silence bruissant pourtant de mille enseignements et, moins paradoxalement qu'il n'y semble, de lumière régnant uniformément sur l'espace souverain, sur l'Ouvert, eût dit Rilke.
Si le désert est une expérience fascinante, affirme Howard McCord, c'est que l'homme y est confronté, sans médiation puisque le désert n'admet aucune interférence entre l'homme et le langage, directement à ce qui, par essence, lui est radicalement étranger, et pour la description duquel aucun des mots dont il dispose ne semble convenir. Il faudrait même se débarrasser des mots, nous répète bien des fois Howard McCord, puisqu'il y a «dans les paysages autant d'informations que dans les mots» (p. 12) et même, puisqu'il y a «plus d'intelligence dans une piste de cerf que dans le langage humain» (p. 35), puisque le langage dont nous nous servons pour désigner le monde est purement contingent, le lien entre le monde et le langage étant rituel étant donné qu'il provient de l'usage, et non du sens (cf. p. 42), les «langues les phrases et les paradigmes [acquérant] la pure signification de la forme que leur donne notre passage» (p. 38), comme s'il s'agissait, plutôt que de prétendre écrire, d'écouter attentivement ce que la nature chuchote et de quêter sa présence : «Une présence s'annonçait à mes vagues perceptions : c'était une langue qu'on était en train de parler sous mes pieds» (p. 39). Ailleurs, l'auteur évoque une langue qu'il ne peut entendre «que comme on écoute les cours d'eau, ou le vent dans les arbres» (p. 117).
Si la langue est impuissante à dire, ne serait-ce qu'évoquer le paysage que traverse le grand marcheur, si la langue semble même n'avoir aucune influence sur le cours du monde entier des choses puisque Howard McCord a appris en marchant que la langue ne rompait pas le silence, pas plus que lui-même ne dérangeait «un caillou en posant le pied dessus», vu qu'il a appris qu'aucun mot ne pouvait lui donner ce qu'il voulait, sa démarche n'étant pas «davantage facilitée par les schémas syntaxiques», puisque l'écrivain sait que la langue «est le marteau entre l'homme et un clou à planter» et qu'elle n'est qu'une «humble approximation de la manière dont nous voudrions que poussent les arbres pour nous abriter» (p. 41), alors peut-être faut-il tenter de se passer de cet outil rudimentaire qu'est la langue, pour essayer de s'imprégner d'une connaissance directe, beaucoup plus subtile que ne l'est le langage, et qui permettra par exemple à Howard McCord de comprendre quel est l'ordre de perception d'un arbre (cf. p. 40), comme s'il s'agissait en somme de se fondre dans le désert, de faire que sa propre marche devienne langage, comme si le grimpeur connaissait ce qui l'entoure, la dure réalité du désert, dans ses jambes, ses bras, les mouvements du corps étant finalement comparables aux tropes et aux rotations (cf. p. 42). Celui qui marche longuement, quitte à se perdre, pour se perdre en lui-même (cf. p. 120), dans le désert, finit par devenir presque invisible, et peut ainsi s'approcher des animaux si craintifs que sont les gazelles.
Marcher dans le désert, c'est se dépouiller, le désert pouvant à bon droit être considéré comme le «suicide de la langue [...], où le bol du silence peut être soulevé, vidé», puisque nous «ne connaissons pas la source des formes qui sont imposées à nos perceptions», tout comme nous «ne connaissons pas l'origine des noms» (p. 42), ce mystérieux surgissement premier demeurant pour toujours hors de notre portée, comme si le début inconnaissable du langage, lorsque les mots et les choses étaient étroitement liés par plus qu'un lien purement artificiel, ne devait pas nous faire regretter ce que nous avons perdu ou même n'avons jamais possédé ailleurs que par le biais de songeries ésotériques sur quelque langage magique.
Comme si, encore, le langage humain était beaucoup moins important que les «courants souterrains [qui] circulent», le marcheur devant «reconnaître leur passage, leur poussée» (p. 48), tout comme il dit non seulement reconnaître mais aussi accueillir «les pouvoirs qui ont élu domicile dans les pierres, les arbres, les chutes d'eau, les vents aberrants», et qui sont «les pouvoirs de la terre et de la vie», «étrangement timides, et presque toujours silencieux» (p. 49), Howard McCord affirmant qu'il n'écrit pas «ces choses par naïveté, par vanité, ou même plaisanterie» et qu'il a bel et bien été «en présence de mystères» (p. 50) que les vrais marcheurs doivent toujours s'efforcer de respecter : «Ceux qui ignorent son pouvoir [celui d'une pierre] passent sans s'arrêter et ne font qu'errer dans le canyon comme ils peuvent, pareils à des petits enfants qui ont reçu la permission d'entrer dans une maison inconnue, mais seulement pour regarder. Ceux qui s'arrêtent saluent le gardien, et demandent : les clés de toutes les armoires leur sont confiées, et leurs yeux verront tout ce que leur esprit est prêt à appréhender, et un bon vent soufflera dans les espaces cachés par leurs yeux» (ibid.). Un peu plus loin, Howard McCord n'hésite pas à parler des «trolls des lieux sauvages [qui] ne doivent pas être craints», et qui «sont là parce que la beauté doit être aimée et l'est toujours», les choses se connaissant «elles-mêmes, et cette connaissance se [reflétant] de telle sorte que nous pouvons la saisir», ce qui est tout de même une façon de nuancer le sombre constat posé précédemment d'une communication impossible entre l'homme et ce qui l'entoure, la terre étant un tambour, la folie du troll consistant «à marcher au-dedans de nos corps en des lieux bénis», cette folie étant encore celle «d'un savoir qui est un accord bien que nous ne puissions prononcer qu'un seul mot à la fois» (p. 52).
Ce mot, il est important de pouvoir l'accueillir, donc de nous mettre dans l'état où nos sens pourront le comprendre et le prononcer en silence : marcher dans le désert permet ainsi, au moins, à celui qui l'arpente, de comprendre «à quel point [ses] sens sont brouillés» et «avec quelle ignorance [il observe] sans doute toute chose» (p. 54).
Si le désert offre «une solitude sacramentelle», «purifiante, réparatrice, blessante» (p. 55), si le désert est «un monde qui ne peut pas se corrompre, si ce n'est sous l'effet du temps qui donne sa fragilité même à une pierre» (p. 62), si le désert «commence avec réserve, avec réticence» (p. 93), s'il est «un vide inaltérable» (p. 57) qui n'a pourtant de sens que s'il permet de comprendre, à celui qui l'expérimente dans la joie et l'horreur, que la «seule liturgie possible est [celle de sa] simple présence, par laquelle une autre peut être célébrée, la joie née de la contemplation» (p. 59), si le désert est le lieu d'une «recherche de je ne sais quelle illumination spirituelle, d'une vision que l'isolement et les privations pourraient apporter, de quelque chose d'assez proche des motivations qui conduisaient les Pères du Désert à leurs ermitages et leurs austérités» (p. 101), alors il faut profiter de l'expérience sensorielle extrême et même, spirituelle qu'il nous propose, et cela bien que Howard McCord nous avoue qu'il est incapable de prier au désert, comme dans les églises (cf. ibid.) (2). Il faut recevoir ce qu'il offre, pour parvenir à connaître «les liens originels des choses, le maillage compliqué qui a l'unité définitive d'un point», le marcheur étant finalement celui qui est «captivé par la dignité et la solitude de chaque chose en [sa] présence» (p. 71).
Curieusement, c'est le désert arctique qui permet cette connaissance de soi, mais aussi quelque vision, fût-elle aussi fugace qu'un mirage tremblant de chaleur, de la complexité transcendante unissant le plus petit grain de sable aux fournaises stellaires, bien davantage que le désert du Nouveau-Mexique, que McCord évoque dans le chapitre intitulé La jornada del muerto, aux accents parfois dignes d'un McCarthy, en tout cas soulignés, peut-être inconsciemment, par le traducteur commun à ces deux écrivains, François Hirsch.
Ce chapitre semble davantage se focaliser sur une évocation historique de la difficile colonisation par des Blancs (Espagnols, Américains) de terres inhospitalières, particulièrement cruelles, alors que celui que nous avons longuement analysé rejoint les méditations de William Gasper, le tueur de L'Homme qui marchait sur la Lune, qui évoquent les jeux infinis entre la conscience et la réalité qui l'entoure ou bien on ne sait plus en fin de compte, que cette même conscience secrète.. Curieusement, alors que la longue marche dans le désert arctique est une plongée dans la conscience du marcheur que nous avons qualifiée d'expérience phénoménologique, celle qui traverse la Jornada del Muerto, en retrouvant les voix anciennes qui ne survivent plus qu'à l'état de mots poussiéreux contenus par de vieilles archives, est une plongée dans les motivations secrètes d'hommes eux-mêmes réduits en poussière, foules «perdues, désespérées, mourantes, fières, sauvages, craintives, dédaigneuses – quoi qu'elles aient été de leur vivant, elles était toutes égales à présent, ombres et fragments imaginaires qui s'agitent dans mon esprit comme des feuilles desséchées dans le vent» (pp. 143-4). Ailleurs, l'auteur évoque les fantômes qui ne manquent jamais de l'accompagner lorsqu'il marche dans le désert, alors même que ces présences, parfois, peuvent être bien réelles, comme l'évoquent les dernières pages du livre (cf. pp. 173-4).
En fin de compte, ce qui frappe dans ce livre étrange, improbable même dans sa volonté de forcer le silence pour le rendre vibrant comme la perception sensorielle (3), c'est la permanence d'une thématique unique, parlons donc d'un monisme spiritualiste plutôt que religieux, que McCord fait se diffracter en plusieurs rayons dont il détaille les différentes caractéristiques synesthésiques (4), comme si son texte était en fin de compte le prisme illusoire et impossible avec lequel il prétendrait reconstituer l'unité primordiale d'une lumière qui ne se donne aux hommes que dans son infinie et bénéfique luxuriance.
Notes
 (1) Ayant été enthousiasmé par ma lecture de L'Homme qui marchait sur la Lune, je décidai de contacter son auteur qui, très aimablement et au rebours de la prétention comique dont font preuve tant de pseudos-auteurs français lus par quinze ou vingt personnes, m'envoya spontanément quelques-uns de ses livres, tous dédicacés. Je jugeai que Walking to Extremes qui par ses thématiques évoquait le roman que j'ai cité, était susceptible d'intéresser les lecteurs français. Il fallait bien évidemment trouver un traducteur doué, ce qui excluait automatiquement de faire appel à Christophe Claro, puis, bien évidemment et c'est sans doute là a tâche de loin la plus harassante, un éditeur aimant prendre des risques, quoique relatifs tout de même. Il me sembla donc logique dans un premier temps d'évoquer une possible parution française de Walking to Extremes à son éditeur historique, Gallmeister, et à celui qui traduisit l'étrange roman de McCord dans notre langue, Jacques Mailhos. Gallmeister refusa pour des raisons comme toujours vagues lorsqu'il s'agit de se défausser, puis ce fut au tour de Jacques Mailhos de décliner la proposition que lui fit David Serra, auquel j'avais fait lire L'Homme qui marchait sur la Lune et qui s'enthousiasma pour cet écrivain. C'est donc le patron des Éditions Ring qui contacta François Hirsh que nous avions mentionné tous deux, remarquable traducteur, entre autre, des principaux romans de Cormac McCarthy.
(1) Ayant été enthousiasmé par ma lecture de L'Homme qui marchait sur la Lune, je décidai de contacter son auteur qui, très aimablement et au rebours de la prétention comique dont font preuve tant de pseudos-auteurs français lus par quinze ou vingt personnes, m'envoya spontanément quelques-uns de ses livres, tous dédicacés. Je jugeai que Walking to Extremes qui par ses thématiques évoquait le roman que j'ai cité, était susceptible d'intéresser les lecteurs français. Il fallait bien évidemment trouver un traducteur doué, ce qui excluait automatiquement de faire appel à Christophe Claro, puis, bien évidemment et c'est sans doute là a tâche de loin la plus harassante, un éditeur aimant prendre des risques, quoique relatifs tout de même. Il me sembla donc logique dans un premier temps d'évoquer une possible parution française de Walking to Extremes à son éditeur historique, Gallmeister, et à celui qui traduisit l'étrange roman de McCord dans notre langue, Jacques Mailhos. Gallmeister refusa pour des raisons comme toujours vagues lorsqu'il s'agit de se défausser, puis ce fut au tour de Jacques Mailhos de décliner la proposition que lui fit David Serra, auquel j'avais fait lire L'Homme qui marchait sur la Lune et qui s'enthousiasma pour cet écrivain. C'est donc le patron des Éditions Ring qui contacta François Hirsh que nous avions mentionné tous deux, remarquable traducteur, entre autre, des principaux romans de Cormac McCarthy. (2) Ailleurs, Howard McCord se demande sans détours pourquoi le désert a «toujours été associé à la niaiserie de la religion» (p. 138), s'amusant du fait que «seuls ceux qui ont soif croient en Dieu. Hydratez-vous. L'illusion passera» (p. 139).
(3) «Quelque chose de direct, quelque chose d'intéressant : un lézard, un cactus en fleur, une trace insolite. Je réfléchis trop [et] je continue d'essayer de marie les mots avec les expériences, d'aligner le langage sur les perceptions» (p. 148), Howard McCord décrivant son goût de la marche pour «le mettre en mots, en faire un artéfact que d'autres peuvent expérimenter» (p. 149).
(4) «Les couleurs comme un plain-chant, un chœur pour les yeux» (pp. 128-9). Voir aussi, à propos d'une description de la musique que compose le vent : «Les notes les plus basses gîtent bien au-delà de ce que les yeux ont la capacité de voir, et la note la plus proche est la plus in-ouïe, comme une balle tirée dans le cerveau» (p. 160).































































 Imprimer
Imprimer