« La Politique considérée comme souci de Pierre Boutang | Page d'accueil | Les Anneaux de Saturne de W. G. Sebald »
04/09/2014
Je n'ai aucune idée sur Hitler de Karl Kraus

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Karl Kraus dans la Zone.
Karl Kraus dans la Zone. Je n'ai aucune idée sur Hitler est l'adaptation scénique réalisée par José Lillo de La Troisième nuit de Walpurgis, également publié par les excellentes éditions Agone, dont nous avions longuement rendu compte dans cette note.
Je n'ai aucune idée sur Hitler est l'adaptation scénique réalisée par José Lillo de La Troisième nuit de Walpurgis, également publié par les excellentes éditions Agone, dont nous avions longuement rendu compte dans cette note.Le lecteur paresseux pourra découvrir l'implacable Kraus par le biais de ce condensé de lucidité et de colère, qui n'hésite pas à moquer Heidegger, alors qu'il est aujourd'hui encore placé au firmament de la pensée par une série de commis indéchiffrables comme l'hermétique Gérard Guest, Kraus écrivant ainsi, sur le bon berger du Todtnauberg extirpé de la masse grouillante des larves nazies, ces lignes assassines : «Entreprise d'une bureaumantocratie livrant des guerres de libération pour mieux asservir. Grouillement d'individus prêts à l'emploi : hommes de plume, adorateurs de la santé. Et maintenant ces hommes de main qui font dans la transcendance et proposent dans les universités et les revues de faire de la philosophie allemande une école préparatoire aux idées de Hitler. On trouve parmi eux le penseur Heidegger, qui aligne ses fumeuses idées bleues sur les brunes et commence à reconnaître clairement que l'univers intellectuel d'un peuple est «le pouvoir de conserver fermement ses forces relevant de la terre et du sang comme pouvoir d'intime excitation et de vaste ébranlement de son être» (p. 43) (1). Et Kraus bien sûr, attentif comme nul autre aux langages viciés, ne manquera pas de moquer le pseudo-style de Heidegger, traduisant en quelque sorte en langage nazi, pour le besoin des bêtes, le charabia du Maître : «Il faut agir dans le sens de la résistance interrogative et nue au milieu de l'incertitude de l'étant dans le tout», concluant : «Heureusement, le journal qui le cite donne tout de suite un point de repère : «Goûte et adopte ce qu'il y a de mieux : le fromage Berna» (p. 44).
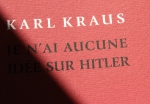 Heidegger n'est pas le seul à subir les foudres de Kraus, qui critique aussi vertement l'attitude et les mots de Spengler et Benn (cf. pp. 49-50), mais innocente, en somme, Nietzsche, qui écrivit, comme le polémiste le rappelle, des phrases absolument claires quant à ses aristocratiques opinions, comme celle-ci : «Honte à ceux qui veulent à toute force se présenter maintenant devant la masse comme ses sauveurs !» (p. 49).
Heidegger n'est pas le seul à subir les foudres de Kraus, qui critique aussi vertement l'attitude et les mots de Spengler et Benn (cf. pp. 49-50), mais innocente, en somme, Nietzsche, qui écrivit, comme le polémiste le rappelle, des phrases absolument claires quant à ses aristocratiques opinions, comme celle-ci : «Honte à ceux qui veulent à toute force se présenter maintenant devant la masse comme ses sauveurs !» (p. 49).Je parlais de lucidité, mais, en fait, ce terme ne convient guère car, comme Karl Kraus lui-même le concède, il suffisait, alors comme aujourd'hui ainsi que Thierry Discepolo a raison de le relever dans sa préface, de savoir lire la presse pour comprendre de quoi il en retournait avec les porcs criminels nazis, séides d'une «dictature qui, aujourd'hui, maîtrise tout à l'exception de la langue» (p. 20). Kraus, commentant ironiquement sa propre phrase qui fit tant couler d'encre aux imbéciles, et qui donne son titre au livre, écrit ainsi : «Tout au long de ma non-activité, je me suis servi de la presse – où je suis allé chercher toutes les preuves contre une existence qu'elle a corrompue – et je conserve des centaines de milliers de documents sur sa responsabilité directe ou indirecte : réserve inexploitée, capable de donner une image de toute la déformation de l'époque» (p. 27), car c'est bel et bien la dissection de la presse qui selon Kraus non seulement lui permettra de «maîtriser l'abondance de formes de cette troisième nuit de Walpurgis» (ibid.), mais lui permettra aussi de renvoyer le poison à son expéditeur, cause de toutes les corruptions, la presse bien sûr : «Le journalisme n'est à la hauteur d'aucune catastrophe car il est lié à toutes» (p. 65).
Le jugement de Kraus, aussi exagéré qu'il puisse paraître aux modernes adorateurs d'une immédiateté sans intelligence, est non seulement terrible mais en partie parfaitement juste : «le national-socialisme n'a pas détruit la presse, c'est au contraire la presse qui a créé le national-socialisme» (p. 113), l'écrivain poursuivant : «Ce sont des éditorialistes qui écrivent avec du sang. Oui, des feuilletonistes de l'action. Mais si l'on prend la «mise au pas» de la presse comme un acte politique, elle ne représente rien d'autre que sa propre et ultime possibilité, la dernière marche qu'elle ne peut dépasser en vertu de sa complexion qui, par nature, est la prostitution. J'infère la guerre et la faim de l'usage que la presse fait de la langue, du renversement du sens et de la valeur, de la façon de vider et de déshonorer tous les concepts et tous les contenus» (p. 114).
D'abord frappé par le mutisme conséquence d'une véritable sidération face à la farce noire nazie, Kraus doit tenter de remonter la pente, sortir du gouffre d'abjection dans lequel les nazis ont prétendu le faire descendre, avec le reste des Allemands, juifs ou non-juifs : «Voilà pourquoi ceux qui réclament une «voix» devraient se rendre compte que, même cri sorti d'un chaos étouffant, elle a pourtant vocation à être parole et qu'une volonté de mise en forme, qui, par nature, incline à être dominée par sa matière, ne prend pas position mais cherche un appui dans l'assaut multiple et répété d'un mal qui viendrait plus facilement à bout d'elle qu'inversement» (p. 21).
Passé ce premier moment de stupeur éprouvé face à une remontée de la boue originelle, «imagination pleine d'invention, richesse de formes toujours nouvelles de tortures et d'humiliations, romantisme de la profanation de l'humain» (p. 93), Kraus ne cessera de répéter que seuls ceux qui ne veulent pas entendre ou voir seront coupables : «Si l'on se bouche les oreilles, on n'entend plus aucun râle». La suite du texte mérite d'être cité intégralement : «Ce chambardement, du jour au lendemain, il a transformé les valets les plus aptes à trouver un emploi dans une entreprise civilisatrice en adorateurs du feu et en zélateurs d'un mythe de sang, si bien qu'on a désormais du mal à les reconnaître; ce bouleversement produit par des idées, aussi simple que l’œuf de Colomb – quand il est en plus entretenu par une débauche de symboles, de drapeaux et de feux d'artifice telle que l'évolution n'en a encore jamais soupçonnée, sans compter l'hypertrophie des clichés dans les discours et la presse, que l'éther et les usines à papier accompagnent jusqu'à la limite de leurs capacités, le voilà qui progresse telle une commotion endémique à laquelle rien de ce qui a encore souffle ne semble pouvoir résister et devant laquelle celui qui s'en détourne a soudain l'impression de manquer de tact, comme quelqu'un qui n'ôterait pas son chapeau à l'enterrement de l'humanité» (p. 22).
Si, comme il l'écrit, Karl Kraus souhaite, au «déclin du monde», se «retirer dans [s]es quartiers» (p. 29), il ne s'est du moins jamais tu et a cherché sans relâche, comme un autre résistant, certes beaucoup moins tonitruant que le polémiste autrichien, Victor Klemperer, les «trésors linguistiques» que les nazis auront laissé au monde «comme de jolis bibelots» (p. 39) disposés sur des monceaux de cadavres.
Il est du reste frappant de constater que Kraus, comme Klemperer, a été particulièrement attentif à décrire ces «abats lexicaux aussi appétissant que Hapag et Wipag, Afeb et Gesiba, Kadewe et Gakawe et autres formules magiques» (p. 68), monstruosités linguistiques qui sont «des formes de mise en veilleuse d'une langue qui, tant qu'elle n'est pas totalement réduite à des sigles, donne une marge suffisante à une mise au pas» (p. 69).
Ces formules ne peuvent manquer de nous faire songer, aujourd'hui, à la petite entreprise de déshumanisation du langage à laquelle se livre le Rassenwart (2) Renaud Camus devenu souffleur de meeting frontiste, parlant de «Grand Remplacement», de «Déculturation» et, vocable en apparence neutre derrière lequel ne manqueront pas de se cacher bien des tragédies si ce ventriloque faisait triompher ses pseudo-idées politiques, «Remigration». J'ai longuement évoqué la destruction de la langue à laquelle se livre, paradoxalement puisqu'il prétend en être le gardien inflexible, Renaud Camus, vieux fou narcissique égaré dans son château pliesque, plié et replié sur une haine recuite et une monstrueuse indifférence à la souffrance des hommes.
Qui veut savoir, sait, qui souhaite ouvrir les yeux sur l'horreur ne doit pas se force à les fermer ou même, sans les fermer, faire comme s'il n'avait rien vu, rien entendu, enfin, qui veut savoir et comprendre ce qui se déroule sous ses propres yeux n'a même pas besoin de lire la presse, puisque l'horreur est parfaitement déroulée, pour chaque situation de l'abjection nazie dirait-on, par le Faust de Goethe ou Macbeth de Shakespeare. Karl Kraus, seul, pratiquement, à cette époque-là du moins, à lire et comprendre de quoi il en retourne dans la «lecture de millions de gens qui ont tout sous les yeux et ne remarquent rien» (pp. 76-7), Karl Kraus qui écrit en outre qu'il «suffit d'écouter la radio quand on recherche la vérité» (p. 87), est un témoin aussi fascinant qu'intéressant de l'horreur en marche, dans le langage avant que d'arpenter martialement, à découvert, dans la nuit allemande déchirée par les faisceaux des projecteurs de grandioses mises en scène, et, ainsi, mieux que nul autre il illustre cette évidence : «Ce n'est pas contre ce qui arrivait à l'homme qui écrit mais contre ce qui arrivait à l'homme tout court qu'il fallait écrire ou agir» (p. 63), puisque, et cette autre évidence doit être inlassablement répétée», une seule "heure arrachée à la plus misérable des existences, vaut bien une bibliothèque brûlée» (p. 64).
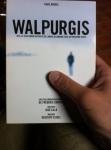 En complément de la lecture des textes de Karl Kraus, il est possible d'écouter José Lillo réciter celui que nous venons d'évoquer, par le biais d'un film de Frédéric Choffat, Walpurgis, ici détaillé.
En complément de la lecture des textes de Karl Kraus, il est possible d'écouter José Lillo réciter celui que nous venons d'évoquer, par le biais d'un film de Frédéric Choffat, Walpurgis, ici détaillé.Notes
(1) Les chiffres entre parenthèses renvoient à ce livre, comme toujours impeccablement relu, des éditions Agone, les italiques étant celles du texte.
(2) Ou gardien de la race, fonctionnaire nazi chargé de veiller à la pureté de la race.




























































 Imprimer
Imprimer