« Mike Kasprzak ou l’intransigeance de la vocation littéraire, par Gregory Mion | Page d'accueil | Soumission de Michel Houellebecq, ou la shahada de Folantin »
06/01/2015
Les Origines de Reiner Schürmann
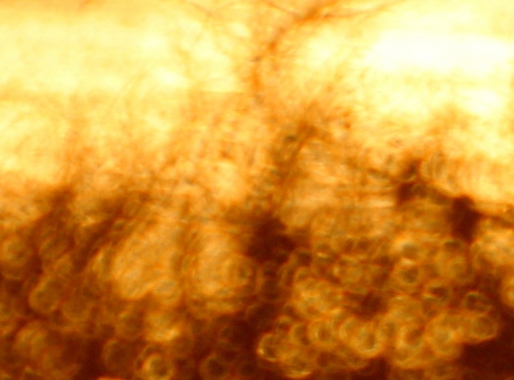
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 C'est en 1976 que Fayard publie Les Origines de Reiner Schürmann, soit quatre années après sa très belle étude sur les sermons de Maître Eckhart, ce récit, jamais réédité par l'éditeur comme tant d'autres bons livres, semblant à bien des égards une prolongation des thèmes que Reiner Schürmann a développés dans son essai sur le grand mystique rhénan, ou peut-être même l'explication romanesque d'une seule citation de celui-ci, extraite d'un entretien spirituel intitulé Des gens qui ne se sont pas laissés et sont encore pleins de volonté propre, dans lequel nous pouvons lire, à propos de l'homme, qu'il «doit d’abord se laisser lui-même; il aura, de la sorte, laissé toutes choses. En vérité, l’homme qui laisserait un royaume, voire le monde entier, et se conserverait lui-même, n’aurait rien laissé. Mais l’homme qui se laisse lui-même, quoi qu’il conserve, richesse, honneur, n’importe quoi, cet homme a tout laissé» (Maître Eckhart, Traités et Sermons, Flammarion, coll. GF, 1993, p. 80).
C'est en 1976 que Fayard publie Les Origines de Reiner Schürmann, soit quatre années après sa très belle étude sur les sermons de Maître Eckhart, ce récit, jamais réédité par l'éditeur comme tant d'autres bons livres, semblant à bien des égards une prolongation des thèmes que Reiner Schürmann a développés dans son essai sur le grand mystique rhénan, ou peut-être même l'explication romanesque d'une seule citation de celui-ci, extraite d'un entretien spirituel intitulé Des gens qui ne se sont pas laissés et sont encore pleins de volonté propre, dans lequel nous pouvons lire, à propos de l'homme, qu'il «doit d’abord se laisser lui-même; il aura, de la sorte, laissé toutes choses. En vérité, l’homme qui laisserait un royaume, voire le monde entier, et se conserverait lui-même, n’aurait rien laissé. Mais l’homme qui se laisse lui-même, quoi qu’il conserve, richesse, honneur, n’importe quoi, cet homme a tout laissé» (Maître Eckhart, Traités et Sermons, Flammarion, coll. GF, 1993, p. 80). Le titre du livre de Reiner Schürmann ne laisse aucun suspens quant au sens de la quête à laquelle nous sommes conviés dans ce texte étrange, souvent magnifique, écrit dans un style heurté, rapide, comme pressé de reprendre son incessante errance et de ne surtout pas s'attarder sur place et qui me fait songer à l'écriture saccadée et frappante de René Ehni, ou bien, au contraire, plus ample, non pas immobile mais élégiaque : «Savoir d'où, comment et pourquoi j'ai été lié aux exterminations» (1). C'est en fin de compte la seule question qu'un homme né en Allemagne en 1941 comme Reiner Schürmann, bien trop jeune donc pour conserver un souvenir autre que vague de la Seconde Guerre mondiale, peut se poser et même, a le droit de se poser : «Et j'ai su : j'ai été conçu dans la jubilation, parce que quarante millions de Français faisaient dans leur froc comme un seul homme» (pp. 20-1). Voilà qui d'emblée vous pose une naissance, la place sous l'influence de mauvaises fées ou d'une force obscure dont l'auteur se fera l'écho, et dont le développement sera sans cesse hanté par des images de mort, comme celles d'un bébé de 7 mois avec lequel les soldats nazis jouent au football, «pas seulement un geste, cela a duré vingt minutes» (p. 153) surgissant au détour des scènes de la vie quotidienne les plus banales : «Climatiseurs, ascenseurs, incinérateurs, crématoires» (p. 173). N'ayant aucune compétence philosophique particulière, je me garderai bien de prétendre que cette démarche, forme d'anamnèse herméneutique qui parfois se libère du carcan de la raison pour côtoyer le précipice d'une écriture hallucinée (comme le montrent les dernières pages des Origines), est également à l’œuvre dans l'essai de Schürmann sur Heidegger que Mehdi Belhaj Kacem affirme être l'un de ses livres de chevet.
 Voilà qui marque, assurément disais-je, une naissance, et vous donne l'envie irrépressible de vous coltiner directement l'Histoire plutôt que de lire des livres qui lui sont consacrés car, une fois «distillé en dates pour manuels, même un passé de terreur prend un aspect ordonné» (p. 21). La Seconde Guerre mondiale : talisman et nœud gordien de l'horreur, caverne dans laquelle il ne faut pas craindre de plonger ou bien craindre d'y plonger mais y aller quand même, car vous ne pouvez tout simplement pas faire autrement, faire comme si l'horreur n'avait strictement rien à voir avec vous, vos actes, votre langage, vos mots : «Moi je refuse de m'adapter. Je refuse de lécher des bottes et d'envoyer des vœux de Noël. Je refuse d'oublier mon enfance terrorisée, de passer aux affaires du jour, de rigoler des monstres nocturnes, de couvrir les râles avec des formules de politesse. Je refuse aussi de rendre la guerre responsable de tout. Mais, sans elle, me serais-je levé si tôt ? Aurais-je appris à maudire les consolations ? Aurais-je talonné l'origine, l'unique, comme un extasié et un incrédule ?» (p. 30).
Voilà qui marque, assurément disais-je, une naissance, et vous donne l'envie irrépressible de vous coltiner directement l'Histoire plutôt que de lire des livres qui lui sont consacrés car, une fois «distillé en dates pour manuels, même un passé de terreur prend un aspect ordonné» (p. 21). La Seconde Guerre mondiale : talisman et nœud gordien de l'horreur, caverne dans laquelle il ne faut pas craindre de plonger ou bien craindre d'y plonger mais y aller quand même, car vous ne pouvez tout simplement pas faire autrement, faire comme si l'horreur n'avait strictement rien à voir avec vous, vos actes, votre langage, vos mots : «Moi je refuse de m'adapter. Je refuse de lécher des bottes et d'envoyer des vœux de Noël. Je refuse d'oublier mon enfance terrorisée, de passer aux affaires du jour, de rigoler des monstres nocturnes, de couvrir les râles avec des formules de politesse. Je refuse aussi de rendre la guerre responsable de tout. Mais, sans elle, me serais-je levé si tôt ? Aurais-je appris à maudire les consolations ? Aurais-je talonné l'origine, l'unique, comme un extasié et un incrédule ?» (p. 30).Si la terreur dont il s'agit est parfaitement identifiée, il n'en reste pas moins que son appréhension excède, dirait-on, les capacités de l'imagination et du langage. Il est à ce titre frappant de constater la place qu'occupe la thématique du langage dans le récit de Reiner Schürmann, qu'il s'agisse de sa plénitude ou, comme je l'ai dit, de sa misère : «Je souffrais de quelque chose de très précis. D'une sorte de question colossale, sans mots» (p. 15). Comme l'origine si lointaine et pourtant toute proche (cf. p. 23), comme les origines «envasées», comme les algues, les «racines dans la boue des trépassés» (p. 29), le langage est aussi proche que lointain et, toujours donné comme la possibilité d'un rire (qui est «parent du langage», p. 46) ou bien encore la description de la joie de vivre d'une femme aimée, Joan (cf. p. 34), n'en est pas moins absent : «Progressivement on m'a ôté la parole. La chose la plus grave pour un homme. La réduction à l'état inorganique» (p. 45), avant que d'être, rapport ambivalent voire aporétique avec la source de notre appréhension même du monde, détesté ou bien, plus que présent, présent jusqu'au trop-plein, réduit alors à de faux-semblants, à un «système de défenses subtiles [qui] fausse la parole» (p. 50).
Tombé dans quelque trou sans fond, «dans une grotte, loin de toute vie humaine, de tout langage» (p. 56), Reiner Schürmann (tout du moins, son narrateur) va donc devoir tenter de donner un sens à sa quête de ses origines mais, plus subtilement bien sûr, à celle de l'origine. Les premières, «arabes, juives, allemandes», ne comptent pas, seule compte la seconde, que plus d'une fois l'auteur assimile à la pure disponibilité de la présence qui est «humble obéissance» (p. 62) aux choses et aux êtres, et c'est sans doute cette même adhérence au présent et à la présence, alors que nous ne vivons «avec courage [que] dans un monde d'idées, d'habitudes, d'êtres humains à connaître et à aimer, de tâches à accomplir» (pp. 65-6) qui redonnera au narrateur, avec la certitude de vivre, bon sang vivre et rien de plus, celle du moment où la vie coulera, circulera normalement, de même que les mots qui, jusqu'alors, se répandaient en désordre (cf. p. 66).
Il faut ne pas craindre de larguer les amarres, de quitter celle qu'on aime, la belle Juive du kibboutz (2), que l'on retrouvera de toute façon si l'on croit au destin, si ironique avec les hommes, car la vraie défaite, c'est d'avoir des origines assignable, et qu'il faut en conséquence partir, tout en laissant, tout de même, un signe : «Je m'en irai. Mais, sur cette terre, aimée absurdement, je laisserai un magazine ouvert sur la banquette. Comme dans un train, avant d'aller aux lavabos» (p. 72). C'est sans doute encore trop, et qui souhaite vraiment disparaître ne laisse aucune trace, fût-elle maigre et difficilement interprétable.
C'est que nous devons faire l'expérience, comme Maître Eckhart, cet «expert en itinérance» selon l'auteur, de la plus parfaite dépossession, car tout ce qui «pourra être accompli, ma génération l'accomplira faute de mieux. Sans mystique de réconciliation ni désespoir. L'unique expérience spirituelle à notre portée : laisser être. Ne pas s'agripper à l'ordre premier». Cette modestie frappe, mais vivre après Auschwitz, tout comme écrire ou penser Dieu (3) après la surrection du Mal absolu sur Terre ne peut être qu'affaire de discrétion, alors même que les seules certitudes qui vaillent désormais sont celles du corps : «L'assurance du corps. Dans ce domaine surtout, jusqu'à aujourd'hui, nous capitulons sans conditions. Nous avons été soumis à l'arrachement d'un organe très important dont j'ignore le nom. A petits coups d'aile, dans la pénurie de la parole, nous avançons. Toute l'énergie absorbée pour renoncer à la violence» (p. 78).
L'errance est finalement la mère du plus profond détachement, détachement qui est en tout premier lieu liberté par rapport à ses propres origines : «La rue est presque déserte. Le vent a chassé promeneurs et mendiants. De quel côté aller ? Les genoux brûlent. Errance, ma vraie patrie. On ne sait rien d'un homme quand on connaît ses origines, ses fins» (p. 84).
En somme, Reiner Schürmann, comme Rilke, se met à la disposition de l'Ouvert, ni commencement ni début reconnaissables à une quelconque place, bien que cette forme de disponibilité, qu'il faudrait sans doute se garder de trop rapprocher de celle de Gide, ne soit pas un simple abandon, ni même une béance : «Laisser pour que tout soit. Ne pas faire main basse, ni sur le passé, ni sur les images. L'origine se réserve. A moins de désapprendre la possession. De desserrer toute les emprises» (p. 87, l'auteur souligne).
Puisque l'auteur nous confie que les départs brusques sont devenus sa demeure, qu'il n'a en outre plus assez de mots «pour joindre un sujet et un prédicat» (p. 94) et qu'il désire l'«abolition du langage», plus de «lèvres qui bougent», plus «cette élongation verbale du passé dans le présent» (p. 98), en d'autres mots, plus de passé puisque le langage est «son allié naturel» (p. 99), puisqu'il faut se débarrasser des «mots-gentillesse» qui «guérissent et donnent le départ» alors qu'ils ne font que mentir, sont «faux jetons» comme des «pères de famille dévoués», altruistes mais qui cependant, «dans l'amour, ne songent plus à personne», obnubilés qu'ils sont «par leur propre plaisir», alors qu'ils le «prennent où ils peuvent», du «sordide au sublime avec la même fougue», il faut ne pas craindre de se jeter dans la fosse béante, hurlante, qui a souillé la langue et en constitue l'origine, l'origine de cette souillure «Admettre que mon origine soit cela. Endlösung : solution finale. Je le reconnais. Mais au passage. Dans l'instant fugitif où les attaches se délient. L'escalier de la mort à Mauthausen. Chaque prisonnier devait traîner une pierre lourde de soixante-dix kilos. Cent quatre-vingt-six marches à monter. A droite et à gauche, des officiers armés de cravaches. Les prisonniers squelettiques. Un tiers meurt sur le parcours. La pierre dégringole. Le suivant attend en bas. Il la saisit à bras-le-corps. S'il arrive en haut, il l'ajoute à la construction. Chaque jour, l'escalier s'élève un peu plus haut. Devant les caméras du Parti, un officier, champion d'haltérophilie, a montré que c'était faisable. Arrivé en haut, il a salué les photographes : «Eine Kleinigkeit !» (Très peu de chose !)» (p. 100).
Ainsi l'auteur peut-il, logiquement, affirmer que le célèbre «problème allemand» est «d'abord une reconquête de la parole», puisque la parole déserte le vaincu et que ce dernier, avant d'être vaincu, a souillé le langage, comme Kraus et Klemperer n'ont cessé de le montrer et démontrer. Comment reconquérir la pureté perdue, si elle a jamais existé (et certainement pas, nous l'avons vu, dans quelque mythique et suspecte origine) ? L'oubli peut-être, l'oubli sans doute : la «déjection instantanée, rêve d'une génération qui ne rayonne que de sa désespérance» (p. 110), en tout cas l'abolition du passé, discrète pointe apocalyptique dans le récit de Reiner Schürmann, lorsqu'il imagine un monde privé de mémoire (cf. p. 111), cette libération, du moins le craint-il, ne pouvant sans doute être accordée à l'homme que par la violence (cf. p. 113) qu'il faut peut-être, tout compte fait, ne pas craindre d'appeler sur sa tête, y compris par le langage, la «seule convoitise» de l'auteur (p. 163). C'est ainsi une forme de violence (un accident), mais aussi l'irruption d'une voix de vieille femme incompréhensible, qui clôt le très beau chapitre décrivant la vie, toute simple, pleine de lumière et de senteurs, du narrateur accompagné de son ami Louis et de la belle Joan, et c'est sur une autre irruption de violence que s'achève le roman.
Il est parfaitement clair que les thèmes que nous venons d'évoquer, qu'il s'agisse de l'errance, du détachement ou de la dépossession, sont indissociables d'une pensée de la judaïté dont Joan se fait l'écho, elle qui affirme, comme Zissimos Lorentzatos, que le centre a été perdu (cf. p. 121) et qu'il est de toute façon bien impossible pour un Juif de sarcler les souvenirs (4).
C'est dans l'errance, une fois encore, que réside la chance de pouvoir trouver la clé de l'énigme, et il n'est pas plus étonnant que l'auteur ne parle que de voyage et non d'errance, voyage qu'il définit magnifiquement lorsqu'il écrit : «Voyager n'est pas une distraction. C'est une saisie. L'ancienne émergence de toutes choses devient proche. La cohésion invisible des séjours fuyants se rend présente et s'énonce. Voyager pauvrement : le détachement continuel de la périphérie. Devenir poreux pour recevoir le centre. On ne voyage pas pour son plaisir. L'évidence nous envahit qui paralyse la démonstration. L'unique savoir naît ainsi. La multiplicité se révèle irréductible, donnée» (p. 128, je souligne).
Tout aussi logiquement, l'auteur va faire du désert, où se lève une parole venue du fond du temps, l'unique lieu qu'il convient de découvrir : «Apprendre le détachement, ne plus posséder ces images. Avec elles, mon identité s'en irait. Sur le chemin de la dépossession, laisser même le pourquoi de l'errance. Le chemin du désert. Au désert, il n'y a pas place pour deux, l'Un seul est. Au désert, rien ne sert de crier : il n'y a pas vers qui élever les mains. Au désert, les images sont de la tromperie. Les traces des vivants y sont balayées : le fond des choses périt. Les venues de l'origine s'effacent en même temps que les allers de l'homme. Je ne veux plus être des appelés, rappelés, blessés à jamais par ce qu'on leur a fait faire. Par ce qu'a fait d'eux la guerre. Seulement, les images restent. Et le désir de les frotter avec du sable» (p. 131).
Il reste une autre solution, probablement plus simple, en fin de compte, qu'une vie érémitique au désert : la passion du moment vécu avec celui ou celle que l'on aime, le pur présent de l'amour, qui s'étiole hors de la réelle présence, la présence physique de celle ou celui qui est aimé, comme l'écrit Joan au narrateur, dans une lettre dont l'auteur nous offre aussi la version allemande : «Loin de toi, je suis démunie d'idées, de rires. les mots sont si pauvres, mais il y a le vent qui me rappelle tes cheveux, le soleil ta peau, et le silence, tes baisers. Ta gravité et ton délire attachaient le jour à la nuit. Tu es si près de moi, pourquoi ton corps est-il loin ?» (p. 136), comme l'éprouve encore le narrateur au contact de son ami Louis, homme libre par excellence qui «s'étire comme un chat» (p. 139), sans «mots accumulés dans la gorge comme des cobayes surgelés» (p. 137).
Ce refus des souvenirs (cf. p. 172), cette coïncidence avec le présent, qualifié d'«aujourd'hui écumant de faste» (p. 192) est peut-être l'unique réalité qui, trouvée, nous empêche de posséder la moindre chose, y compris nous-même (5) ou le paysage, qui est simplement là, «sans pourquoi» (p. 143) comme la rose du mystique. Mais, à ce compte, il faudrait aussi pouvoir se libérer du langage, trop souvent réduit à n'être qu'une «prolifération sonore qui ne transporte rien, n'ouvre à rien, ne communique rien» (p. 149), pour «que craque cette Histoire où nous sommes retenus» (p. 155) et qu'explose le carcan des nations où s'est cristallisé «cette accumulation de haines» (p. 191), pour retrouver la parole, le mot unique dans lequel le monde tout entier tiendrait son énigme (6) : «Je suis silencieux parce que le mot n'a pas été inventé. Mais est-ce un mot seulement ? Parce qu'il y a un trou dans le langage. Un trou que le pullulement des informations et des renseignements dissimule à peine. Le jour de mes quatre ans, bien contre mon gré, j'y ai jeté un œil. Au milieu de la rue en flammes, une absence s'est fait sentir. Une interrogation sans borne. Je ne comprenais pas que je réclamais une explication. Mais je n'ai pas oublié ce besoin aigu. Aujourd'hui encore, l'explication dernière m'est refusée. Parfois, de loin, je crois entendre un murmure de délivrance qui se prépare. Je m'imagine alors qu'un jour nous saurons. Nous comprendrons que depuis toujours une unique parole transparaissait à travers nos mots vivaces. Que depuis toujours elle nous prononce» (p. 150).
La quête des origines, après bien des détours et même, parfois, de surprenantes abdications pour celui qui se prétend libre de toute attache (cf. p. 178, où le narrateur exprime un «soudain besoin de racines" lorsqu'il se trouve dans l'éternel mécaniciste des États-Unis), après la découverte, tout de même convenue, que le passé ne peut s'en aller (p. 161) comme s'il s'agissait d'un fantôme chassé d'un seul geste, et que l'amour lui-même peut se révéler, souvent, un piège grotesque et risible (7), la quête des origines se confond donc avec la quête de l'origine, qui est aussi la quête de l'Un : «Le monde est-il une éternelle supplication à quelque soleil absent ? Sa voix s'est-elle brisée à force d'implorer l'Un ?» (p. 184).
Cette quête peut-elle aboutir, l'Histoire peut-elle craquer «où nous sommes retenus» (p. 155) par un événement dont Reiner Schürmann ne nous dit en fin de compte que très peu de choses, et qu'il ne fait que pressentir, frôler tout au long de son récit poignant : une libération de l'homme qui serait spirituelle, jamais matérielle ? C'est finalement parce qu'il n'a pas réussi à se laisser lui-même, selon les recommandations de Maître Eckhart, que le narrateur des Origines échoue, même si, dans les toutes dernières lignes du roman, il affirme ne plus «voir que les choses présentes» (p. 218) après avoir détruit ou rêvé de détruire un pupitre, le pupitre «devant lequel il parlait à Nuremberg» (p. 204), il étant Hitler bien sûr, après avoir donc détruit, enfin, son passé, l'avoir «lapidé» (p. 205) même et donc être parvenu à ne plus rien avoir à nommer et avoir aussi décelé, vu «l'origine par-delà les origines» (p. 216). Le narrateur affirme qu'il veut «voir la vie à l’œuvre» (p. 218). Peut-être l'a-t-il vue, mais sur cette énigme se termine le roman de Reiner Schürmann, alors que résonne l'exigence de Maître Eckhart : «L’homme qui s’est laissé lui-même et qui a tout laissé, qui ne cherche plus en rien son bien propre et qui opère toutes ses œuvres sans pourquoi et par pur amour, celui-là est totalement mort au monde, il vit en Dieu et Dieu vit en lui» (8).
Notes
(1) Reiner Schürmann, Les Origines (Fayard, 1976), p. 11. Une réédition de ce texte, augmentée d'une préface de François Dastur et d'une postface de Gérard Granel, grand spécialiste de l'auteur puisqu'il a publié en 1996 son opus magnum, Des hégémonies brisées, a été publiée par les Presses universitaires du Mirail à Toulouse en 2003. Je n'ai pu la consulter avant de rédiger cette note.
(2) Et puis, de toute manière, il y a «toujours une femme bienveillante qui vous dit : Ne restez pas ici, c'est mauvais pour vous» (p. 75).
(3) Il n'est pas besoin de citer la thèse fameuse de Hans Jonas mais de rappeler, une fois de plus, Maître Eckhart dans son sermon n°14 : «Si l’homme était véritablement humble, Dieu devrait soit perdre toute sa déité et en sortir entièrement soit s’infuser et émaner totalement dans cet homme. Hier soir il m’est venu cette pensée : la hauteur de Dieu dépend de mon abaissement, plus je m’abaisserai plus Dieu sera élevé» et «Cela veut dire un Dieu abaissé. Cela me plut tellement que je l’écrivis aussitôt dans mon livre», in op. cit., pp. 308-9.
(4) Très belle définition, si je puis dire, du peuple juif, dans ces mots : «Un peuple qui, de mémoire d'historien, a vécu dans le cri. Familier de la douleur» (p. 123).
(5) Maître Eckhart écrit ainsi dans un de ses Entretiens spirituels intitulé Des gens qui ne se sont pas laissés et sont encore pleins de volonté propre : «Il doit d’abord se laisser lui-même; il aura, de la sorte, laissé toutes choses. En vérité, l’homme qui laisserait un royaume, voire le monde entier, et se conserverait lui-même, n’aurait rien laissé. Mais l’homme qui se laisse lui-même, quoi qu’il conserve, richesse, honneur, n’importe quoi, cet homme a tout laissé», in op. cit., p. 80.
(6) «Saint Jean dit : «Au commencement était le Verbe», signifiant par là que l’homme doit être auprès du Verbe – adverbe», Maître Eckhart, dans son Sermon n°9 intitulé La raison retire à Dieu l’enveloppe de sa bonté et le saisit dans sa nudité, op. cit., p. 279.
(7) «Elle passe du sortilège à la menace. Branle-bas de nos poussées en désordre. Nous nous ressemblons trop, et l'idée d'inceste m’écœure. Notre langage, le sien comme le mien, est à double fond. Parlant d'amour, mais suppliant en vérité : ôte de moi ce passé qui me prend à la gorge. Hier, une complicité sensuelle était née, désuète comme un début d'érection. Maintenant la déconfiture est là, plus navrante qu'une émission précoce» (p. 159).
(8) Dans son sermon n°29, intitulé Dieu ne contraint pas la volonté, Il lui donne la liberté, in op. cit., p. 329.






























































 Imprimer
Imprimer