« Le corps politique de Gérard Depardieu de Richard Millet | Page d'accueil | Robert Louis Stevenson dans la Zone »
06/09/2015
Le Trafiquant d'épaves de Robert Louis Stevenson

Photographie (détail) de Juan Asensio.
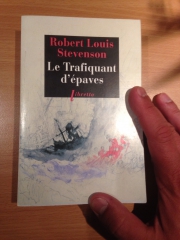 Acheter Le Trafiquant d'épaves sur Amazon.
Acheter Le Trafiquant d'épaves sur Amazon.Dans sa belle préface au Trafiquant d'épaves, Michel Le Bris parle d'un «roman singulier» qui est «totalement cohérent», d'une «fascinante ambiguïté morale, le premier d'une manière qui marquait à l'évidence un tournant dans l’œuvre de l'écrivain, trop tôt interrompue par la mort, où la fatalité de l'échec apparaît comme le véritable sceau de la grandeur de toute aventure», ne faisant «rien d'autre qu'annoncer les grands livres à venir de Conrad» (1).
C'est pourtant un autre roman de Stevenson qui a annoncé la complexité du Trafiquant d'épaves, saluée par Henry James lui-même parlant de tour de force, et qui a été publié en 1889 : Le Maître de Ballantrae, admirable tour de force, pour le coup, d'une profondeur et d'une ambiguïté qui me paraissent supérieures à celles du Trafiquant d'épaves.
C'est du reste un peu la même impression qui, à mesure que le lecteur s'enfonce dans l'un et l'autre roman, grandit, celui d'une implacable maîtrise certes mais, surtout, grondant comme une ligne de basse qui, parfois, surgirait de la mélodie comme l'arête tranchante d'un monstre des profondeurs déchirerait la surface des flots, celui d'une véritable terreur. Ce n'est pas sans raison, encore une fois, que Michel Le Bris évoque la part d'indicible à laquelle la littérature se confronte car, si «tout était dicible, tout serait dit, depuis longtemps» (p. 18), même s'il tient Le Trafiquant d'épaves pour «le premier véritable roman-racontar, yarn littéraire, des mers du Sud» (p 20), et ce n'est pas non plus sans une pointe de moquerie qu'il prétend, sur les brisées de Borges qui admirait ce livre (2), que le roman de Stevenson «attend encore d'être lu» (p. 22). S'il attend encore d'être lu, c'est peut-être parce nous avons et continuons d'être gorgés d'horreur, une horreur de moins en moins indirecte et spéculaire, une horreur de plus en plus dicible et même, exploitable. Nos yeux et nos consciences se ferment à la subtilité de romanciers tels que Stevenson ou le Jünger des Falaises de marbre, et nous voulons des récits simplistes, qui collent le plus près possible au déclenchement de l'horreur, qui nous en abreuvent, plutôt que de nous faire frémir par sa seule suggestion évanescente.
Pourtant, la simplicité, l'épure de la narration sont impressionnantes, telles que Stevenson les déploie durant les longs premiers chapitres qui plantent le décor et surtout s'attardent à évoquer l'histoire et la personnalité de deux de nos héros, Loudon Dodd et celui qui finira par devenir son ami, Jim Pinkerton, avant que l'histoire ne devienne décidément plus tortueuse, car nous avons vite fait de deviner que Stevenson ne laisse rien au hasard, et que ce n'est pas sans de profondes raisons, des raisons éminemment littéraires, qu'il nous donne l'impression d'éclater son récit en passages voire chapitres inutiles, ceux-là même qui, sans doute, ont dérouté les premiers lecteurs de ce roman kaléidoscopique.
De fait, rien ne se disloque, si ce n'est telle épave pourrie que Loudon Dodd, à la recherche d'un trésor qui ne s'y trouvera point, explorera de fond en comble et à laquelle il finira par mettre le feu, et, c'est lui-même qui nous le dit, sa propre personne : «Disons plutôt que c'est moi qui me suis disloqué : je n'avais pas les épaules» (p. 40). La «partie de colin-maillard qu'on appelle la vie» (p. 70) est donc d'abord celle du récit, Stevenson figurant la réalité nouvelle, et de quelle façon magistrale, selon laquelle le monde s'est désormais transformé, et les assurances anciennes ont disparu, «à l'instar de toutes ces vieilles monarchies féodales» (p. 77), tandis que gronde la puissance de l'individu-type du Nouveau Monde qui, s'il n'est pas plus moral qu'un autre (il l'est même moins) ou même fort, n'a peur de rien, est persuadé que le futur, comme une femme, se conquiert, que l'«essor à venir» (p. 81) est déjà sous nos yeux, et s'élance sur les mers en s'imaginant que son poing, refermé avec une surprenante rapacité, suffira à toutes les tamiser, et jusqu'à la dernière goutte, d'amertume ou de sang.
C'est une galerie de demi-soldes plus ou moins sans le sou, finalement point très différents de ceux qu'il peindra dans Le Creux de la vague (notons que l'expression est présente, du moins dans la traduction française, cf. p. 421) qui déambulent, le plus souvent mystérieusement, comme hantés par quelque idée ou souvenir trop affreux pour être dits (cf. p. 187) dans ce roman, et dont Stevenson nous peint comme à plaisir les étonnantes aventures, les doutes, les lâchetés, les silences, les brusques accès de violence ou même la médiocrité évidente. Loudon Dodd, de rades en tripots parisiens, est tout près de s'imaginer quelque talent artistique, le «sentiment de [ses] mérites diffus[ant] sa chaleur dans [ses] veines comme un cru d'exception» (p. 119), alors qu'il n'est tout au plus qu'un observateur d'hommes («et s'il était une chose que je savais voir, c'était lorsqu'un homme était terrifié», p. 179; ailleurs, il éprouve «un intérêt immodéré pour la diversité de la vie et des êtres», p. 373) et, qu'on se le dise, un de ces batteurs de grèves qui, lorsqu'il n'est pas «une simple brute», est «le parent pauvre de l'artiste» (p. 176), épave plus ou moins nonchalante sans beaucoup de volonté qui, pour se «détourner des sentiers battus» et être envoyé «croiser au milieu des îles paradisiaques», a besoin du «ressort d'une force extérieure», le destin devant lui-même user «du levier adéquat» (p. 177). Des marionnettes, en somme ou, pour le dire de façon imagée, des épaves.
Même si, bien souvent, les artifices paraissent quelque peu grossiers, publicitaires en quelque sorte, qui permettent à Stevenson de ménager, comme on dit, l'intérêt du lecteur entre chaque chapitre, la maîtrise avec laquelle il ourdit la trame de son récit inquiet et inquiétant est confondante. Ce récit est un jeu de miroirs savamment disposés, imbriqués les uns dans les autres, pain béni pour les amateurs de puzzle, le couple d'aventuriers Pinkerton/Dodd se dédoublant (cf. pp. 186 et 425), comme toujours chez Stevenson, dans le couple Hadden/Carthew qui, sur un autre bateau, semble avoir noué les fils que les deux amis s'ingénieront à dénouer, au risque de la ruine financière et, surtout, au risque d'y laisser leur santé physique et mentale, tant l'énigme à laquelle ils sont confrontés est coriace, comme ils ne cessent de vouloir nous en convaincre.
L'énigme, c'est bien sûr le propre du feuilleton policier ou du texte à trame peu obvie, se laissera méthodiquement résoudre par quelque «détective amateur» (p. 375), toute l'habileté du narrateur consistant à faire que des éléments disséminés dans ses centaines de pages s'emboîtent méthodiquement les uns dans les autres. Mais ce n'est là, bien sûr, que l'aspect superficiel de l'art de Stevenson, et pour ainsi dire le plus grossier, celui qui est cousu de fil blanc, relance l'intérêt du lecteur (cf. p. 340) et transforme Dodd en enquêteur qui est plus d'une fois obligé de ramener à la surface et examiner les visages «d'un certain chef-d’œuvre mnémonique» (p. 280) qui pourra, mais rien n'est moins certain, expliquer on pas «soixante ou soixante-dix pour cent de l'affaire», mais absolument pas le reste, à savoir «une ou deux brasses de mou à l'autre bout» (p. 288), ce reste qui, s'il était élucidé, permettrait à Dodd, Nares et Pinkerton d'avoir «assez de cervelle pour mettre un nom sur cette affaire» (p. 292), alors même qu'ils s'avouent plus d'une fois incapable de venir à bout des possibilités «tellement diverses» (p. 306) que leur pose l'énigme de l'épave du Flying Scud.
Je crois que le plus lourd secret de notre diable d'écrivain réside dans sa capacité à, d'un mot ou d'une scène en apparence banale, parvenir à distiller le sentiment confus mais pas moins réel, de l'horreur : nous savons que quelque chose se joue, mais nous ne savons pas vraiment de quoi il en retourne, secret ou mystère qui ne sont sans doute pas beaux à voir, lorsque Dodd observe ainsi «l'image d'un homme qui, l'écouteur du téléphone contre son oreille, devient couleur de cendres en entendant une petite voix lui poser une malheureuse question» (p. 201). Pourquoi cette transformation ? L'énigme policière commence avec la première question silencieuse qu'un texte fait naître. Au lecteur de se montrer habile mais ce n'est là qu'un leurre, car il y a fort à parier, nous le verrons, que Stevenson ne se soucie pas seulement de pure logique et de rébus, auxquels restent accrochés les forts en thème comme Champollion à sa pierre de Rosette.
L'effroi que Stevenson distille chez son lecteur est également dû au fait que, malgré tout son savoir narratif, malgré le fait qu'il en sait infiniment plus que nous sur les destinées de ses héros, il est, lui aussi, tout comme nous, un simple observateur confronté au bruit et à la fureur d'histoires à peine compréhensibles, bien qu'il faille à tout prix les dire : «Sur une partie du parcours de notre vie plane une brume idyllique autant qu'indéchiffrable, et cela se borne à cela» (p. 244) et, en effet, c'est à ce triste constat d'échec que parviennent le plus souvent les personnages que l'écrivain a campés.
Ce n'est pas seulement le cours des choses qui est indéchiffrable, l'énigme posée qu'il est impossible de conclure (cf. p. 346) mais aussi, bien évidemment, l'âme humaine, et c'est avec beaucoup de plaisir que Stevenson sonde les reins et les cœurs de personnages qui, nous l'avons vu, ne sont pas des héros, et même estiment comme Falstaff que l'honneur est du vent (cf. p. 342) : «Nous sommes de bien étranges créatures, monsieur Dodd" (p. 258), comme le dit ainsi le commandant Nares, dont Dodd affirme que «sa raison était guidée par la justice la plus équanime», alors que sa «sensibilité frémissait d'une rancœur mesquine et la seconde avait le pas sur la première» (p. 252). Dédoublements, si chers au romancier. Stevenson est un peintre d'hommes tourmentés, dans lesquels «l'instinct de destruction est profondément enraciné», instinct qu'il associe d'ailleurs à «l'esprit de découverte» (p. 276), comme si nous était suggérée l'évidence selon laquelle toute grande aventure ne peut être dissociée d'une exploration des derniers recès de ces si étranges créatures que sont les hommes, derrière ou sous lesquels pour ainsi dire, comme derrière l'histoire d'une épave bien mystérieuse, il y a quelque chose (cf. p. 346), il doit y avoir quelque chose, secret admirable ou ridicule, mais secret.
Ce qui affleure plus d'une fois, ce qui inquiète et horrifie, c'est moins la description de la sauvagerie et des meurtres qui en découlent, l'évocation de tel «héroïsme transi tourné vers le mal» (p. 370), que ces phrases où Stevenson nous laisse entrevoir une horreur non dite, indicible peut-être, immémoriale assurément, qu'il s'agisse de «possibles atrocités» (p. 460) dont Joseph Conrad se souviendra lorsqu'il suggérera les rites abominables entourant Kurtz, ou bien d'une «terreur inexprimée» (p. 461) qui constitue la «destinée humaine», un domaine que nos anti-héros ou bien ratés (cf. p. 353) ne connaissent guère, sauf, peut-être, lorsqu'ils se retrouvent perdus au beau milieu de nulle part et qu'ils cogitent, qu'ils sont bien obligés de sonder leurs pensées, plus noires que grises : «Par-dessus tout, le sentiment de notre inexorable isolement, si loin du monde et du siècle, d'une existence régie par une durée autre, remontant à des âges anciens; la journée nouvelle non plus proclamée par le journal du jour, mais par le soleil levant; l’État, les Églises, les empires et leurs populations, la guerre et les rumeurs de guerre, les commentaires sur les arts, toutes choses silencieuses et coites comme au temps où on ne les avait pas encore inventées. Telles étaient les conditions de cette expérience nouvelle pour moi de la vie, que j'eusse aimé, si cela avait été possible, partager avec tous mes confrères et tous mes contemporains» (pp. 294-5).
Confrontés à des meurtriers, Stevenson, comme tel de ses personnages, n'absout ni ne condamne, mais endure, un mot dont Faulkner ne manquera pas de se souvenir (cf. p. 484), évoque les actes de ces hommes qui, lorsqu'ils se regardent dans un miroir, contemplent leur «front sillonné de rides profondes», comme si «Caïn se voyait dans un miroir» (p. 483), et finit par dévoiler quelle est la véritable dimension de son œuvre, dans l'épilogue qu'il adresse à son ami, Will H. Low, où il écrit : «Pourquoi vous dédier un récit d'un genre si moderne, plein d'aperçus sur nos us barbares et notre morale élastique, tellement pétri d'esprit de lucre qu'il n'est de page où les dollars ne tintent ni ne trébuchent, à ce point saisi par l'agitation de ce siècle bouillonnant que le lecteur se voit précipiter d'un lieu à l'autre, d'une mer à l'autre, et que le livre relève moins de la fiction que du panorama, avant de s'achever comme une geste éclaboussée de sang ?» (p. 513). Ce type de récit n'intéresse pas Stevenson : «Car le lecteur, toujours soucieux de relever des indices, n'en retire nulle impression de réalité ou de vie, et y voit plutôt une mécanique aussi minutieuse que confinée; et si le livre demeure captivant, il n'en est pas moins insignifiant, et ressemble plus à une partie d'échecs qu'à une production artistique» (p. 514), ce qu'est, incontestablement, Le Trafiquant d'épaves, dont je n'ai pour l'heure pas touché mot de telle merveilleuse description où la vie, horrible et merveilleuse à la fois, grosse de tempêtes et d'accalmies, est nichée : «L'éclairage public était allumé lorsque nous ressortîmes de la taverne; toutes les rues scintillaient par la magie du gaz ou de l'électricité; au loin, des étagements de lignes luminescentes gravissaient les coteaux abrupts jusqu'au noir intense de la voûte céleste; de l'autre côté, là où frissonnaient, invisibles, les eaux de la baie, cent feux de mouillage marquaient l'emplacement de cent navires» (p. 221). C'est ce jeux subtil entre des ténèbres pas tout à fait noires et une lumière déjà mangée par ce qui la borde qui pourrait sans peine symboliser l'art de Robert Louis Stevenson, maître de l'inquiétude.
Notes
(1) Robert Louis Stevenson, Le Trafiquant d'épaves [The Wrecker, 1892] (traduction de l'anglais par Éric Chedaille, Phébus, coll. Libretto, 2012). La préface de Michel Le Bris s'intitule D'un trésor l'autre, p. 27.
(2) «Un livre magnifique, à rebours de l'opinion critique moyenne, un de ses meilleurs. Que personne ne semble avoir lu», in Entretien avec Daniel Balderson, Cahier de l'Herne Borges, 1994, cité par Michel Le Bris dans sa Préface, à la page indiquée dans le corps de notre article.





























































 Imprimer
Imprimer