« La Chevalière de la Mort de Léon Bloy | Page d'accueil | Le Fils de Louis XVI de Léon Bloy »
19/02/2017
Wittgenstein par lui-même, par Francis Moury
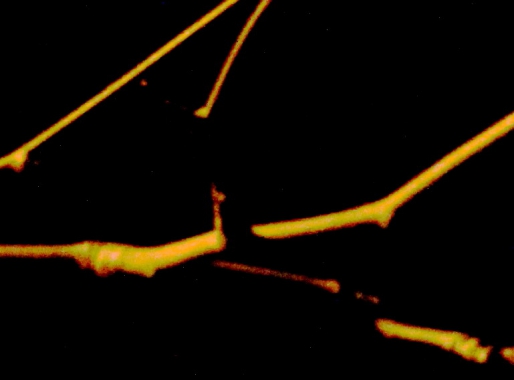
Photographie (détail) de Juan Asensio.
Remarque préliminaire : le lecteur et le service de presse de Gallimard – si attentionné et diligent à mon égard depuis près de quinze ans – s'étonneront peut-être du délai entre la parution de ce volume et celui de ma note de lecture. Il s'explique par le fait que Michel Crépu, le 10 février 2016, à qui j'avais aussi fait lire cet article, le jugeait «tout à fait remarquable», me remerciait vivement de sa communication, en souhaitait l'exclusivité pour La Nouvelle Revue Française. Avec l'obligeante amitié de Juan Asensio qui acceptait de renoncer à sa publication sur Internet, tout semblait réglé. C'était sans compter sur de mystérieux atermoiements, des délais non moins mystérieux, pour finalement apprendre le 10 mai 2016 que le texte était trop long et qu'il faudrait attendre mars 2017 pour le voir paraître à la NRF, ce qui n'était, de l'avis de Michel Crépu lui-même, «vraiment pas raisonnable». Je lui répondais le même jour que cela me semblait «long, certes mais pas déraisonnable». Le temps passa... en vain. D'autres textes furent évoqués pour la NRF : tantôt jugés trop brefs, tantôt jugés biens mais demeurés néanmoins inédits tandis que rien de nouveau n'était annoncé concernant cette note de lecture wittgensteinienne. Le terme étant un peu galvaudé ces temps-ci, il convient de rendre à cette appellation son prestige initial : une occasion réelle, un Kairos au sens le plus grec du terme, de dialogue avec – et d'approfondissement de – l’œuvre évoquée, comme de la vie intellectuelle posthume de son auteur. Bref... un an après, je tire définitivement les conclusions qui s'imposent de cette fastidieuse situation. Je remercie à nouveau mon cher et fidèle Juan d'accepter, après si longtemps, de l'éditer enfin sur Stalker-Dissection du cadavre de la littérature, remplaçant donc la défaillante NRF.
Notes de lecture sur : Ludwig Wittgenstein, Correspondance philosophique 1911-1951 (postface Wittgenstein à Cambridge par Brian McGuinness, traduction et notes par Élisabeth Rigal, éditions Gallimard, NRF, Bibliothèque de philosophie, novembre 2015).
«En quoi as-tu foi ? En ceci : qu'il faut déterminer à nouveau le poids de toutes choses.»
Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir (1882), §269 (traduction A. Vialatte, éditions Gallimard-NRF, 1950, retirage Idées-Gallimard, 1972), p. 219.
 Ce volume d'environ 900 pages rassemble la correspondance philosophique de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) tenue entre 1911 et 1951 avec ses collègues de Cambridge (Bertrand Russell, George Edward Moore, J.M. Keynes, etc.) et de Vienne (Gottlob Frege, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, etc.), avec ses élèves de Cambridge, avec Charles Kay Ogden, l'un des traducteurs anglais du Tractatus logico-philosophicus (ces lettres-là sont précieusement revues et annotées par Georg Henrik Von Wright), ainsi que des comptes rendus, parfois très savoureux, des séances du Club des sciences morales de Cambridge et de celles de la société mathématique de Trinity College. On lui a adjoint une intéressante postface de B. McGuinness sur la vie de Wittgenstein à Cambridge. L'ensemble, de presque 600 lettres et documents, était antérieurement éparpillé en plusieurs langues, en livres anglais et allemands. Certains volumes étaient parfois épuisés. Quant aux documents intégrés à certaines bases de données internet philosophiques allemandes, ils n'étaient pas d'un accès facile au lecteur français non-germaniste. Cette correspondance est pour la première fois réunie en un seul volume et traduite dans notre langue, ce qui a notamment nécessité de renuméroter l'ensemble des lettres et documents. Elle augmente notre connaissance de la biographie et de la philosophie de Wittgenstein, celle de l'histoire du positivisme logique de Vienne, et celle de l'histoire de la philosophie anglaise puisqu'elle couvre les trois périodes philosophiques qu'on distingue habituellement dans son œuvre : sa première période (Carnets 1914-1916, Tractatus logico-philosophicus, éditions 1922 et 1933), sa seconde période (Cahier bleu de 1934, Cahier brun de 1935, Fiches découpées entre 1929 et 1948, Recherches philosophiques, édition posthume de 1953), sa troisième période (De la certitude, aphorismes rédigés entre 1948 et 1951).
Ce volume d'environ 900 pages rassemble la correspondance philosophique de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) tenue entre 1911 et 1951 avec ses collègues de Cambridge (Bertrand Russell, George Edward Moore, J.M. Keynes, etc.) et de Vienne (Gottlob Frege, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, etc.), avec ses élèves de Cambridge, avec Charles Kay Ogden, l'un des traducteurs anglais du Tractatus logico-philosophicus (ces lettres-là sont précieusement revues et annotées par Georg Henrik Von Wright), ainsi que des comptes rendus, parfois très savoureux, des séances du Club des sciences morales de Cambridge et de celles de la société mathématique de Trinity College. On lui a adjoint une intéressante postface de B. McGuinness sur la vie de Wittgenstein à Cambridge. L'ensemble, de presque 600 lettres et documents, était antérieurement éparpillé en plusieurs langues, en livres anglais et allemands. Certains volumes étaient parfois épuisés. Quant aux documents intégrés à certaines bases de données internet philosophiques allemandes, ils n'étaient pas d'un accès facile au lecteur français non-germaniste. Cette correspondance est pour la première fois réunie en un seul volume et traduite dans notre langue, ce qui a notamment nécessité de renuméroter l'ensemble des lettres et documents. Elle augmente notre connaissance de la biographie et de la philosophie de Wittgenstein, celle de l'histoire du positivisme logique de Vienne, et celle de l'histoire de la philosophie anglaise puisqu'elle couvre les trois périodes philosophiques qu'on distingue habituellement dans son œuvre : sa première période (Carnets 1914-1916, Tractatus logico-philosophicus, éditions 1922 et 1933), sa seconde période (Cahier bleu de 1934, Cahier brun de 1935, Fiches découpées entre 1929 et 1948, Recherches philosophiques, édition posthume de 1953), sa troisième période (De la certitude, aphorismes rédigés entre 1948 et 1951).Dans une remarque sur l'alinéa 5-5563 du Tractatus, jointe en annexe à sa lettre à C. K. Ogden du 10 mai 1922 (p. 730), Wittgenstein écrit ceci : «Je veux dire que toutes les propositions de notre langage ordinaire ne sont pas, en quelque façon que ce soit, moins correctes, moins exactes ou plus confuses du point de vue logique que les propositions écrites, disons, dans le symbolisme russellien ou dans une autre «Begriffschrift». (Simplement il nous est plus facile de reconnaître la forme logique de ces propositions lorsqu'elles sont exprimées dans un symbolisme approprié)». Autrement dit, il a choisi de s'exprimer au moyen de la logique mathématique par souci de clarté. Choix que le lecteur français non prévenu en faveur de cette discipline, considérera peut-être moins absurde et paradoxal, à la lumière de cette remarque traduite près de cent ans après qu'elle a été formulée. Et lorsqu'il emploie le langage usuel, il le fait souvent en usant d'une forme aphoristique qui ne se signale pas, en histoire de la philosophie, par ses qualités de clarté : Héraclite (surnommé à juste titre Héraclite l'obscur) et Friedrich Nietzsche (interprété de tant de manières différentes parfois diamétralement opposées) constituant de fameux précédents à l'appui de mon assertion. C'est tout à l'honneur de Wittgenstein d'avoir voulu allier logique mathématique, aphorisme et souci de clarté, mais a-t-il réussi ? Que chaque aphorisme wittgensteinien soit clair, ce n'est, certes, pas toujours le cas. Et il faut bien convenir que leur réunion physique par des éditeurs posthumes n'augmente pas forcément la clarté des individus propositionnels réunis. C'est le moins qu'on puisse dire. Autrement dit, on peut à titre posthume lui retourner la critique qu'il proférait contre les Principia Ethica de G. E. Moore. Toute admiration étant, selon le juste mot de Renan, historique, et puisque je viens de citer le livre de Moore, l'histoire de la philosophie (histoire dont la connaissance est nécessaire avant de lire un philosophe quel qu'il soit, y compris – voire surtout ! – Wittgenstein) nous aidera peut-être à y voir plus clair.
À Cambridge, durant la période où le jeune Wittgenstein rédigeait le Tractatus, deux livres étaient considérés comme majeurs : les Principia Ethica (1903) de George Edward Moore, avec lequel Wittgenstein est en désaccord presque total, et les Principia Mathematica (1910-1913) de Bertrand Russell et Alfred North Whitehead, que Wittgenstein entreprit de «réparer» selon l'heureuse expression de B. McGuinness. Russell affirmait : «La logique est devenue la grande libératrice» (1). Mais libératrice de quoi ? D'abord libératrice de l'hégélianisme. Il convient de souligner que l'anti-hégélianisme de Wittgenstein s'exprime à deux reprises : il fait une allusion ironique à l'hégélien J.M.E. McTaggart (lettre n°134 à J.M. Keynes de 1913, p.181), il en fait une autre non moins ironique (lettre n°90 à Moore de 1914, p.132) à l'hégélien Bernard Bosanquet. Ensuite, libératrice du pragmatisme, avec lequel l'hégélianisme entretenait d'assez étroits rapports, bien que Wittgenstein ait été un lecteur passionné du livre de William James, Les Variétés de l'expérience religieuse (1902). Peut-être enfin et surtout, libératrice de l'ontologie aristotélicienne qui détermine l'ensemble de l'histoire de la philosophie. Aristote n'a pas construit une philosophie du langage mais une philosophie ontologique. La Rhétorique ne constitue que la dernière section de son Organon. Wittgenstein semble avoir décidé de refaire l'Organon en faisant semblant d'ignorer la construction métaphysique d'Aristote (2) : cette posture peut sembler, sinon historiquement du moins logiquement, aussi absurde que celle des logiciens de Port-Royal ou que celle du Descartes des Regulae ad directionem ingenii, mais, en réalité, Aristote lui-même avait posé les bases de sa possible survenue. Aristote ne fait, en effet, absolument pas confiance au langage, tenu pour très inférieur à la réalité (3). Wittgenstein non plus n'a aucune confiance dans le langage (en dépit de la citation supra qui ouvre notre article) : c'est son point commun avec Aristote, et s'il n'y en a qu'un, c'est assurément celui-là. En logique, il s'intéresse à la copule aristotélicienne. Il faut noter que sir William Hamilton avait déjà, durant la première moitié du dix-neuvième siècle, concernant la quantification du prédicat, établi que la copule aristotélicienne peut, dans certains cas, équivaloir au signe «=». Wittgenstein s'intéresse à ce genre de problèmes, au calcul logique créé par Morgan et Boole, poursuivi par Russell et d'autres encore. C'est à la physique de dire si quelque chose existe, pas à la métaphysique. La logique ne peut pas dire si quelque chose existe dans la mesure où elle n'est qu'une tautologie perfectible. Elle peut, en revanche, établir d'une manière transparente comment le dire.
Les problèmes métaphysiques seraient donc simplement de faux problèmes provenant d'un usage incorrect des règles logiques du langage. Mais quelles règles ? Et sur le fond de ces problèmes, que peut-on positivement dire ? C'est la tâche infinie de Wittgenstein de répondre à ces questions. Wittgenstein a abordé, dans des leçons variées, l'esthétique, l'éthique, la mystique religieuse en tant que domaines de recherches et de réflexions. Avec quels résultats ? Quelle esthétique, quelle éthique, quelle mystique peuvent se revendiquer aujourd'hui de lui ? Wittgenstein n'apprécia pas un exposé de J.-L. Austin, ainsi qu'en témoigne une allusion de sa correspondance, allusion éclairée en note par la traductrice. Le fait est intéressant : peut-être parce que la théorie austinienne des énoncés performatifs n'est pas une théorie logique du langage ? Autant de langages, autant de réalités différentes, autant de mondes privés constitués de relations internes et externes, dont le langage serait un isomorphisme ? On discerne parfois, dans les trois périodes de l'histoire de sa philosophie, une certaine oscillation entre idéalisme et réalisme chez Wittgenstein.
Le Tractatus logico-philosophicus est difficile à lire et à traduire, d'autant plus difficile qu'au moment de sa rédaction, la machine à écrire de Wittgenstein ne pouvait pas reproduire les signes logiques utilisés par Russell, si bien que Wittgenstein leur en a, parfois, substitués d'autres ! L'enfer pour ses éditeurs et traducteurs ne s'arrêtait pas là car Wittgenstein modifie et précise constamment, à l'occasion de sa correspondance et de la réédition de 1933, les formulations initiales. Sans parler des traductions françaises parfois défaillantes : «le cas» traduisant «état de choses» ou plus exactement l'expression latine «status rerum» en s'inspirant du «case» anglais. McGuinness résume plaisamment l'ouvrage en disant qu'il répare la logique de Russell, qu'il améliore le calcul des probabilités de J.M. Keynes, et qu'il comporte des conclusions rajoutées en 1916-1918 durant la période où Wittgenstein était prisonnier du guerre, sur la religion, la liberté, le mysticisme. A cette époque, Wittgenstein lisait Tolstoï, Trakl (qu'il admirait particulièrement), Rilke et Kraus. Cette idée d'une fracture ouverte entre logique (commandant le langage et entretenant des similitudes avec la grammaire) et réalité est peut-être l'aspect le plus fécond des recherches de la section achevée du Tractatus dès 1915 mais il n'est pourtant pas non plus – faut-il le dire ? – une innovation : Aristote, Descartes, Kant et bien d'autres l'ont pensé, sinon comme lui du moins bien avant lui. Wittgenstein l'exprime d'une manière qui n'est pas non plus entièrement nouvelle. La forme fragmentaire énigmatique, aphoristique de Wittgenstein évoque aussi le style d'Héraclite et de Nietzsche parce qu'ils exprimaient précisément déjà cette fracture. Nietzsche avait même préféré, à mesure qu'il écrivait, la forme poétique à la forme discursive et argumentative. La seule nouveauté historique réelle apportée par Wittgenstein consiste probablement dans l'énonciation de nouvelles propositions de logique formelle, sous la forme de la logique mathématique. Conscient de ses insuffisances, Wittgenstein renia avec toujours plus de vigueur, à mesure que le temps passait, le Tractatus dans son ensemble.
Il faut donc bien en convenir : Wittgenstein est inconstant en philosophie (raison pour laquelle il n'a probablement pas pu constituer un système mais juste un ensemble de recherches) comme dans sa vie privée mais à chaque fois, il s'avère sincère. Il est, assurément, amoureux de la vérité comme pouvait l'être «ce cher Socrate !» qui sert d'exemple dans la définition de l'homme par la logique aristotélicienne classique, pré-mathématique. De fait, il y a quelque chose de réellement socratique en lui, formalisme logique excepté, car son amour de la vérité l'a empêché, sa vie durant, d'être satisfait. Son amour des exemples concrets (son étonnante définition du solipsisme le 25 mai 1940, telle que la relate Isaiah Berlin in op. cit., p. 842) est, lui aussi, éminemment socratique. De même qu'il y a quelque chose de platonicien et de socratique tout à la fois, dans cette manière qu'il a d'entretenir un rapport amoureux avec certains de ses disciples. Cet aspect de sa biographie est le plus haut en couleurs et il n'est pas anodin que le cinéaste anglais Derek Jarman lui ait consacré en 1993 un remarquable téléfilm avec Michael Gough dans le rôle de Russell (nul doute, soit dit en passant, que Gough eût été tout aussi parfait dans le rôle de Wittgenstein âgé si Jarman le lui avait confié). Sa sincérité philosophique s'exprime aussi, très concrètement, par ses disputes, ses inimitiés, ses jugements abrupts («...Wisdom, Waismann, Ryle et autres charlatans...» in lettre n°510 à Malcolm, du 19 mars 1951, p. 685) sans oublier celui sur C.E.M. Joad, professeur de philosophie et conférencier radiophonique, rudement comparé au tenancier d'un taudis «s'opposant à son assainissement».
Sur la position de Wittgenstein envers le christianisme, cette correspondance apporte un éclairage intéressant. On lit en effet parfois, dans certaines notices biographiques un peu hâtivement rédigées, que Wittgenstein était devenu chrétien après la Première Guerre mondiale. Outre que «chrétien» ne veut pas dire grand-chose en raison des différences théologiques significatives entre les trois variétés du christianisme que sont le catholicisme romain, le protestantisme réformé et l'orthodoxie byzantine, on doit désormais tenir compte du fait que la lettre 548 de Wittgenstein à Smythies, du 7 avril 1944 (pp. 791-792) contredit explicitement une telle affirmation : «[...] Apprendre que tu te rallies à l'Église catholique romaine est en effet une nouvelle inattendue. Mais comment saurais-je si c'en est une bonne ou mauvaise ? Voici ce qui me paraît clair. Décider de devenir chrétien, c'est comme décider de ne plus marcher sur la terre ferme mais sur une corde raide où rien n'est plus facile que de glisser [...] je n'ai moi-même jamais quitté la terre ferme».
Sur Kant, Wittgenstein aurait déclaré : «son style est bon mais c'est celui d'un fou» ! Or Wittgenstein a fréquemment l'impression de devenir fou : il l'écrit à l'époque du Tractatus à plusieurs reprises. Plus tard, durant les années 1940-50, il remarque assez souvent et dans des termes souvent identiques : «j'ai l'impression d'être stupide, bête... mon cerveau est vide, épuisé, je crains qu'il ne puisse plus jamais rien produire» (de telles expressions sont disséminées dans un grand nombre de lettres). Sur l'histoire de la philosophie en général, Wittgenstein considère qu'elle ne sert pas à grand-chose. Pourtant, il la connaît à la perfection, citant par exemple en connaisseur saint Augustin à propos du problème du temps. Sa culture est, de toute évidence, celle de l'élite viennoise contemporaine de Freud. Signalons, en passant, que Wittgenstein n'est pas insensible au génie de Freud qui est son contemporain. Cette posture anti-historique, nourrie d'histoire parfaitement connue, est-elle donc malhonnête ? Elle paraît, en tout cas, contredire son intérêt envers Oswald Spengler et sa théorie morphologique des «airs de famille» dans l'histoire. McGuinness précise que l'idée d'un «air de famille» telle que Spengler l'utilise, est un argument en faveur de l'absence d'essence métaphysique. Le signe, à cette époque, est devenu pour Wittgenstein quelque chose qui n'est pas susceptible de relever d'une grammaire. On connaît la fameuse anecdote du «geste de Sraffa». Sraffa était un économiste italien (un marxiste, tendance Gramsci) qui était protégé par Keynes et qui discutait fréquemment avec Wittgenstein : il aurait un jour esquissé devant lui un geste familier aux Napolitains en lui demandant : «Dites-moi quelle peut bien être la grammaire de cela ?» À cette question posée, on considère aujourd'hui qu'on doit la seconde philosophie de Wittgenstein. Notons enfin, concernant Spengler, que Wittgenstein s'oppose au jugement critique très négatif que portait Martin Heidegger sur le même Spengler dans son cours du semestre d'été 1920 à Fribourg (4). Je note cette opposition sans trancher le fait de savoir si Wittgenstein en avait conscience ou non, donc sans savoir s'il avait eu connaissance du jugement de Heidegger.
On considère Wittgenstein comme un grand logicien qui a contribué à l'histoire philosophique du problème classique du fondement (ou de l'impossibilité du fondement) des mathématiques, à la construction de la logique mathématique, à celle de la philosophie analytique du langage. Pourtant ce n'était pas du tout l'avis de son maître G. Frege. Les lettres 248 à 251 adressées par Frege à Wittgenstein, constituent en effet une implacable critique du Tractatus que je recommande de lire absolument. Wittgenstein a beau penser que Frege n'a rien compris au Tractatus, il se pourrait que Frege ait, tout au contraire, parfaitement compris ses irrémédiables faiblesses. Il faut d'ailleurs bien conserver en mémoire que Wittgenstein a maintenu, selon Élisabeth Rigal, son admiration intellectuelle envers Frege en dépit de cela, à la différence de ce qui s'est passé au même moment concernant Russell. Ses relations sont cordiales avec M. Schlick, mais elles ne le furent jamais avec R. Carnap qu'il accusa ouvertement de plagiat, mettant Schlick dans un profond embarras car il s'agissait de ne pas rompre le Cercle de Vienne. Je recommande de lire les échanges épistolaires entre Schlick, Carnap et Wittgenstein à ce sujet. Plus tard Wittgenstein insiste, lui qui est autrichien naturalisé anglais depuis la Seconde Guerre mondiale et qui vit à Cambridge : il ne fait pas partie du Cercle de Vienne, ne l'a pas influencé, n'a pas été influencé par lui ! Il l'écrit en toutes lettres en 1947 à John Wisdom (lettre n°546, p. 788). La réciproque est évidemment fausse puisque Schlick l'a contacté le premier afin de l'y convier et qu'il se considérait comme son fervent disciple, s'effaçant même parfois, selon ses amis (5), un peu trop derrière Wittgenstein.
Autres enseignements notables de cette correspondance : son hostilité (et réciproquement) envers Karl Popper à la fin de sa vie. Wittgenstein : «Citez-moi une règle de morale !» à quoi Popper répond : «Vous ne devriez pas menacer les conférenciers invités avec un tisonnier» (p. 863). Son mépris relatif pour l'Angleterre, son communisme favorable à l'URSS paraissent rétrospectivement être l'effet d'une aberration politique. Ils le sont d'autant plus que les Cambridgiens morts pendant la Guerre d'Espagne en militants communistes fourvoyés, ne l'aimaient pas spécialement, voire pas du tout. C'est le cas de Julian Bell, neveu marxiste de Virginia Woolf, qui a écrit en 1930 une épître en vers dévastateurs (à la manière de Pope, précise la traductrice) contre lui, poème d'ailleurs assez beau, d'une belle tenue littéraire. Notons qu'un autre de ses correspondants, J.C. Taylor (1914-1946), ancien élève de Trinity College puis docteur de l'université de Berkeley, trouve la mort dans un bar durant une rixe. Inévitablement, la contingence parfois romanesque s'invite au détour des pages de toute correspondance, fût-elle philosophique. Wittgenstein s'intéressait beaucoup à la musique et aux histoires de détectives qu'on lui adressait d'Amérique par courrier régulier. Il admire donc Tolstoï mais aussi The Thin Man. Seul face à la mer norvégienne, seul au sommet d'une tour médiévale à Whewell's Court, à diverses époques et en divers lieux, il lui arrive assez fréquemment d'invoquer Dieu dans ses lettres, dans le strict cadre des formules de politesse finale. Vie ascétique à certains moments, rupture avec l'argent (son don célèbre à des écrivains et artistes viennois puis, plus tard, son renoncement total à son héritage), anticonformisme (il fait cours sans cravate, en chemise ouverte, il fait à peine mystère de ses liaisons homosexuelles, se livre à de curieuses «confessions»). Courageux, comme le fut Socrate : il sert durant les deux guerres mondiales comme officier autrichien d'artillerie en 1915-1918 avant d'être prisonnier de guerre des Italiens à Monte Cassino où il rédige les dernières pages du Tractatus, comme membre du personnel médical militaire anglais en 1943-1944. La lutte finale contre le cancer ne l'empêche pas de maintenir une activité intellectuelle de très haut niveau.
Peut-être, au fond et tout bien pesé, le meilleur résumé de sa philosophie et de sa vie est-il constitué par le beau texte latin gravé sur sa stèle funéraire (reproduit in lettre n°607, p. 867) conservée dans la chapelle de Trinity College ?
Un mot sur l'aspect matériel de cette belle édition. J'ai relevé très peu de coquilles – sur près de 900 pages, la performance est enviable – dont une seule me semble assez gênante pour devoir être ici signalée. On trouve, en effet, au bas de la p. 826, une note biographique sur Nicholas Bakhtine. Elle est située à la fin du compte rendu d'une séance du 31 mai 1935 du Club des sciences morales à Cambridge, consacrée aux rapports philosophiques de G.E. Moore et de Wittgenstein. Cette note est imprimée dans des caractères identiques à ceux du compte rendu qui la précède alors qu'elle aurait dû être imprimée avec les petits caractères adoptés pour les notes éditoriales et qu'elle aurait dû être placée à la fin de la lettre suivante n°569, donc à la p. 828 contenant les autres notes biographiques relatives à Nicholas Bakhtine. Pas d'index des noms ni des matières : c'est regrettable. C'est une lacune qu'il faudrait combler à l'occasion d'un second tirage, car il n'est pas évident de retrouver dans ce premier tirage, en dépit d'une table précise des matières, l'ensemble des lettres traitant de tel ou tel sujet ou l'ensemble des lettres mentionnant tel ou tel nom.
Notes
1) Cité en 1932 par Émile Bréhier, Histoire de la philosophie, tome II, fascicule 4 (cinquième édition revue et bibliographie mise à jour par Lucien Jerphagnon et Pierre-Maxime Schuhl, P.U.F., 1968), p. 962.
2) Sur Aristote, cf. mes articles, ici et là.
3) Cf. Brice Parain, Réflexions sur la nature et la fonction du langage, notamment §IV et annexe (éditions Gallimard-NRF, 1942).
4) Concernant la critique de Spengler par Heidegger, cf. mon article.
5) Sur Schlick et ses rapports avec Wittgenstein, cf. mon article.




























































 Imprimer
Imprimer