« Nous n'arriverons jamais à Carcassonne. William Faulkner lecteur de Lord Dunsany ? | Page d'accueil | Le Troisième Reich de Roberto Bolaño, par Gregory Mion »
25/07/2017
Histoires désobligeantes de Léon Bloy, Trois crimes rituels de Marcel Jouhandeau

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Léon Bloy dans la Zone.
Léon Bloy dans la Zone.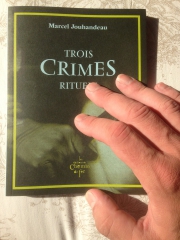 Acheter Trois crimes rituels sur Amazon.
Acheter Trois crimes rituels sur Amazon.Pour bien des raisons frappantes que tout lecteur de ces deux textes comprendra aisément, nous pourrions dire que chacun des trois crimes rituels que Marcel Jouhandeau a évoqués est une histoire désobligeante et, de la même manière, que bon nombre de ces irrésistiblement cocasses histoires désobligeantes sont des crimes rituels.
Il n'y a de rituel que dans une société qui accorde au sacré une place essentielle : bien sûr, mais il est toutefois frappant de constater que le rituel semble survivre à la disparition de la sphère sacrée et même : que le rituel est peut-être la dernière survivance du sacré dans une société qui n'en veut plus, et le range commodément au rayon poussiéreux des accessoires qui ne servent plus à rien.
Le rituel, comme toute forme spécifiquement reproduite, passe par le langage, dont la béance s'ouvre, selon Marcel Jouhandeau, entre les deux protagonistes de la première des trois affaires, Les amants de Vendôme : «je ne suis pas éloigné de croire que le drame repose tout entier sur un malentendu initial : ces deux êtres, venus de couches sociales très éloignées l'une de l'autre, ne parlent pas le même langage» (1). Plus loin dans la même page, je note, toujours à propos de la même thématique, une pique purement bloyenne, sous la plume de Jouhandeau : «Empêchée de comprendre, elle [Denise Labbé] interprétait selon ses petits moyens, elle traduisait en son patois petit-breton les propos quintessenciés qui sont l'apanage des trissotins du Saint-Germain-des-Prés d'aujourd'hui». C'est une évidence aux yeux de Jouhandeau : «Se laisser prendre aux mots, c'est ce qui est arrivé à Denise Labbé, et pour son malheur les mots auxquels elle se laissa prendre cachaient un piège mortel» (pp. 14-5), celui que lui tend son amant, Algarron qui a peut-être «émis une suggestion risquée par légèreté, ou prononcé avec autorité une injonction qui avait je ne sais quoi d'un ordre» (p. 15).
Ce n'est pas seulement le langage qui rapproche ces crimes rituels des histoires désobligeantes, mais l'évidence que ces crimes, souvent atroces, le plus souvent grotesques puisqu'ils semblent convoquer une dimension qui n'existe plus je l'ai dit, ou en tous les cas dont nos contemporains ne veulent plus, témoignent pour une réalité plus haute, lumineuse : l'invisible de bonté s'inscrit dans les linéaments de l'horreur, et le curé d'Uruffe, Guy Desnoyers, taillade le visage de son propre fils, qu'il vient d'extraire du ventre de sa jeune mère qui fut sa maîtresse, parce qu'il croit y reconnaître ses propres traits, mais aussi une marque plus haute, la ressemblance de tout visage d'homme à celle de Dieu.
Le rituel criminel ou diabolique abolit la grandeur de l'homme, qui ne s'adresse plus à Dieu mais à son Singe et, tel maître ayant des serviteurs qui lui ressemblent, devient lui-même singe. Ainsi le rituel moderne ne peut-il qu'adopter un langage parodique, puisque la sphère qu'il consacre de ses offrandes abominables n'est que le miroir inversé d'un Dieu enfui ou fui (selon Max Picard), à moins qu'il ne soit tout bonnement oublié.
Assez curieusement, Jouhandeau semble croire au Démon bien plus que Léon Bloy, qui pourtant affirma son existence dans l'un de ses textes. C'est toujours dans cette première histoire que Jouhandeau affirme ainsi qu'on «ne pratique pas de certains sentiers qui côtoient l'abîme, sans réveiller des puissances malignes qu'on ne savait pas à ce point à notre merci, à notre portée, et les a-t-on déchaînées, apprenti sorcier, impossible ensuite de les maîtriser» (p. 14), puissances elles-même convoquées par le langage (2), bien incapables de donner quelque grandeur à ces crimes ou ces histoires grotesques mais susceptibles, néanmoins, de nous faire soupçonner que se cache une réalité seconde sous les apparences d'une confondante banalité petite-bourgeoise.
Le procès Évenou-Deschamps est le deuxième crime rituel évoqué par Jouhandeau, lequel ressemble, mais cependant moins que le dernier, la terrifiante histoire du curé d'Uruffe dont Jean-François Colosimo fit un roman étonnant, à l'une des histoires diaboliques de Barbey d'Aurevilly (voir par exemple l'histoire intitulée La Fève). La question de la responsabilité y est posée et, même si les puissances des ténèbres veillent, même si «le second maillon de la chaîne de perdition ne dépend plus de notre volonté, c'est bien nous qui passons le premier autour de notre poignet ou de notre cou» (p. 26). Cette solidarité dans le Mal est aussi aurevilienne, même si nous ne sommes ici que dans la banalité contemporaine, l'ennui quotidien, mère et père de tous les vices comme nous le savons : «La damnation, pour Évenou, ce fut que leur commun attentat le liât indissolublement et à jamais à cette Simone Deschamps qu'il méprisait, en même temps qu'il se séparait violemment du seul être qui avait le pouvoir de le sauver, sa femme, parce que, sans reproche, elle était la Pureté même» (p. 27).
C'est la seule fois que Marcel Jouhandeau, à propos d'un de ces personnages de fait divers relevé jusqu'à une lumière plus durable que celle du seul journalisme, parlera de pureté. Il ne parlera pas de pureté à propos de la jeune maîtresse du curé d'Uruffe, Guy Desnoyers, ni même de son propre fils arraché, encore chaud et les yeux grand ouverts le fixant selon ses propres dires, du ventre de sa mère. C'est dans la relation de ce fait divers particulièrement abominable que Jouhandeau s'approche le plus près d'une intention surhumaine du criminel, au sens où certains gestes particulièrement abominables semblent excéder les capacités humaines, et rejoindre une espèce de pureté dans le Mal absolu : «Desnoyers a donc procédé simplement par crainte d'abord, dans le but de se délivrer d'une présence gênante, et au cours de cette action si noire lui en est suggérée une autre, plus noire encore, qui relève de la sorcellerie» (p. 43). L'auteur caractérise plus loin ces «puissances occultes qu'il ne serait peut-être pas abusif d'appeler démoniaques», et qui «s'emparent de lui et le conduisent, déjà hors de lui-même, au-delà de l'humain; son passé inqualifiable les y avait tout d'un coup invitées, autorisées» (p. 44).
Léon Bloy n'est pas loin de Marcel Jouhandeau dans l'observation qui suit, moquant l'état contemporain des curés lorsqu'il rapporte les paroles de Me Gasse : «Autrefois le prêtre ne quittait guère son église. Il y a passait ses journées à prier, à méditer, quand il n'y faisait pas retentir les orgues. Aujourd'hui on a fait de lui un chauffeur de taxi, un cinéaste, un amateur de sports», l'écrivain affirmant par ailleurs que cet avocat «entendait suggérer par là que de telles activités, en rapprochant le prêtre du commun des hommes, finissent par le détourner, en même temps que de sa solitude, de son sacerdoce. Si «saint» veut dire «séparé», du moment que le prêtre ne mène plus une existence à part, il tend à se conduire en profane et de là à profaner sa vocation il n'y a qu'un pas» (pp. 45-6).
Si les actes de Desnoyers semblent avoir été commis «dans une sorte d'état second, dans un état d'hypnose, comme envahi intérieurement et environné de ténèbres» (pp. 52-3), si lui-même affirme devant ses juges qu'il «n'est pas possible que ce soit [lui] qui aie fait cela» (p. 53) et que quelque chose l'a dépassé, il est une chose cependant dont le curé n'a pas réussi à se débarrasser pour le rejeter sur un autre : son ordination elle-même. C'est à celle-ci qu'il «restait fidèle jusque dans l'abjection et dans le crime, si bien qu'on pourrait avancer que ce n'est pas l'homme en lui, mais le prêtre, dont il ne pouvait pas plus se libérer que de son péché, qui a tué Régine et défiguré leur enfant, après l'avoir égorgé», et que c'est même ce qui donne «aux modalités de ce double meurtre sa signification étrange» (p. 55), satanique, aurevilienne et même bloyenne, celle d'une forme de pureté dans le Mal, encore une fois.
 Marcel Jouhandeau est formel : avec Desnoyers, «on n'est pas en présence d'un être simple, mais double que les abominations dont il est coupable ne sauraient priver du signe sacré qui l'a marqué et qui lui reste acquis pour toujours, selon la Foi, au plus grand scandale de la raison» (p. 56). La tragédie du curé d'Uruffe, selon Jouhandeau, «ne doit sa singularité qu'à cela justement qu'ayant renoncé à tout ce qu'exigeait de lui le christianisme, il ait gardé son christianisme intégral» (pp. 56-7), et c'est même à cette condition que le crime dont s'est rendu coupable le curé fornicateur, devenu père de surcroît (mais sans doute n'était-ce pas la première fois qu'il l'était devenu), présente si visiblement un caractère satanique, en dépit de l'extrême médiocrité de la vie de cet homme banal : «Prêtre, il reste prêtre intégralement, même sans intégrité. Tout homicide qu'il soit, s'il était permis à Desnoyers d'administrer les sacrements, ils seraient valables de sa main. Tout infâme qu'il soit, s'il célébrait la messe, Dieu à sa voix obéirait, l'hostie qu'il consacrerait le serait dûment. On en reste pantois, mais cette sorte d'intangibilité du sacerdoce catholique impose. Quel défi à ce qui passe ! ce Signe qui demeure, intangible, inaltérable. Celui qui a reçu l'onction peut se perdre, sans en perdre le privilège» (p. 58).
Marcel Jouhandeau est formel : avec Desnoyers, «on n'est pas en présence d'un être simple, mais double que les abominations dont il est coupable ne sauraient priver du signe sacré qui l'a marqué et qui lui reste acquis pour toujours, selon la Foi, au plus grand scandale de la raison» (p. 56). La tragédie du curé d'Uruffe, selon Jouhandeau, «ne doit sa singularité qu'à cela justement qu'ayant renoncé à tout ce qu'exigeait de lui le christianisme, il ait gardé son christianisme intégral» (pp. 56-7), et c'est même à cette condition que le crime dont s'est rendu coupable le curé fornicateur, devenu père de surcroît (mais sans doute n'était-ce pas la première fois qu'il l'était devenu), présente si visiblement un caractère satanique, en dépit de l'extrême médiocrité de la vie de cet homme banal : «Prêtre, il reste prêtre intégralement, même sans intégrité. Tout homicide qu'il soit, s'il était permis à Desnoyers d'administrer les sacrements, ils seraient valables de sa main. Tout infâme qu'il soit, s'il célébrait la messe, Dieu à sa voix obéirait, l'hostie qu'il consacrerait le serait dûment. On en reste pantois, mais cette sorte d'intangibilité du sacerdoce catholique impose. Quel défi à ce qui passe ! ce Signe qui demeure, intangible, inaltérable. Celui qui a reçu l'onction peut se perdre, sans en perdre le privilège» (p. 58).Seul un écrivain comme Jouhandeau, si sensible aux linéaments secrets de la chute et de la grâce, pouvait se déclarer troublé par une telle prévarication, car seul un écrivain, affirme-t-il dans ses Réflexions familières sur la justice humaine clôturant ses trois diaboliques, si je puis dire, pour «entrer dans les méandres d'une conscience», dispose de suffisamment de tact, mais aussi de prudence, de scrupules, de perspicacité, de respect aussi «dont le commun des jurés est incapable, qui ne voit dans le prévenu qu'un meurtre ou un vol à punir, quel que soit l'homme» (pp. 63-4).
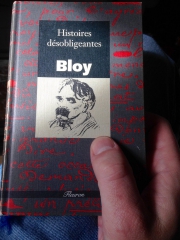 Acheter Histoires désobligeantes sur Amazon (édition différente de celle, épuisée, utilisée dans cette note).
Acheter Histoires désobligeantes sur Amazon (édition différente de celle, épuisée, utilisée dans cette note).En somme, comme l'écrit Pierre Glaudes, la «dénaturation diabolique, l'aliénation de l'être» dont Léon Bloy «dresse le constat impitoyable» dans ses Histoires désobligeantes «n'ont pas séparé l'homme de son origine surnaturelle mais l'ont en quelque sorte brouillée» (3). C'est aussi, même si les déclarations sont moins tonitruantes et le sujet encore plus torve (et nous savons que Dieu écrit certo por linhas tortas) que celui de Bloy, tout le propos de Marcel Jouhandeau : le crime, la situation cocasse, le monde contemporain abject n'en figurent «pas moins, à sa manière mi-terrifiante mi-ridicule, l'histoire de Dieu» (p. 22), Dieu faisant en effet mieux qu'Arsène Lupin (4), puisqu'il «stupéfie sans trêve par l'extravagance de ses travestissements», travestissement qui lui-même, «même s'il n'est qu'un leurre», «rend possible la perversion de la Parole, son adultération par l'insignifiance et la trivialité» (p. 29). Les occurrences de ce thème fascinant, pré-dickien si l'on ose, sont nombreuses; en voici une qui m'a frappé : «Les consciences modernes sont tellement endettées qu'il est au pouvoir du premier audacieux venu de se transformer en coup de tonnerre et de circuler comme la Gorgone au milieu des foule honorables» (Le Torchon brûle, pp. 232-3).
De fait, «l'assurance que la Parole divine ne cesse de se déguiser n'endigue pas tout à fait l'hémorragie de sens», le lecteur hésitant souvent entre «l'angoisse métaphysique et le fou rire» (p. 30), Dieu pouvant ainsi fort bien paraître «sous les traits d'un avare [que] d'un militant libertaire», autant de «figures déroutantes, inépuisables, qui tranchent avec les représentations dévotes et opposent leur mystère aux clichés» (p. 37).
L'une de ces «études de mœurs» est saisissante, et cache une parabole contée «sur le ton de la blague» (p. 41), et peut illustrer l'extrémisation en somme, l'hyperbolisation à laquelle Bloy procède systématiquement, allant plus loin que Marcel Jouhandeau, puisque, dans Tout ce que tu voudras !... la sœur, que l'on croyait sainte et morte, est vivante et fière putain : «Au moment même où la vieille prostituée lui promettait sa viande exécrable, et dans quel style, justes cieux ! il entendait sa sœur, mangée par les poissons depuis un quart de siècle, lui recommander l'amour de Dieu et l'amour des pauvres» (p. 175). La réversibilité, non seulement des mérites mais des images et des réalités, est une vieille affaire chez Léon Bloy, et ce n'est pas pour rien qu'il place ses Histoires désobligeantes sous le miroir pour le moins déformant de cette symbolique ou, pour mieux le dire, pour le signifier apostoliquement, inversé, lorsqu'il écrit, dans sa préface rédigée en 1913 : «Vous m'avez dit, Marchenoir, qu'à cet instant même votre fille faisait sa première communion et qu'il n'avait pas fallu une victime de moins [Bloy fait allusion à une éruption volcanique à Saint-Pierre Martinique] à cette innocente pour que l'acte prodigieux qu'elle accomplissait fût ineffaçablement et très singulièrement marqué pour elle de ce geste colossal de la Mort (p. 64, toute la préface est écrite en italique).
C'est dans l'histoire désobligeante qui est sans doute la plus célèbre, La Religion de M. Pleur, que le thème de la réversibilité des figures est le plus remarquablement illustré, thème qui lui-même n'est que la figuration du fait que la seule réalité qui compte est invisible. Dès que ce postulat paradoxal est admis, Léon Bloy peut dérouler les ficelles de son implacable parabole auréolée d'une étrangeté toute kafkaïenne ou dickienne. Et tout d'abord, Bloy, puisqu'il vit dans une époque où «tous les hommes sont sur le trottoir, à peu près sans exception» (La Fin de don Juan, p. 190), de conchier, comme de coutume, les prudents et les lâches qui s'éloignent de son abject personnage, bien à tort selon le Mendiant ingrat : «Hypocrites salauds qui détestez en moi le dénonciateur silencieux de vos turpitudes, l'horreur matérielle que je vous inspire est précisément la mesure des abominations de votre pensée. Car enfin, de quoi pourrais-je donc être vermineux, sinon de vous-mêmes qui me grouillez au fond du cœur ?» (p. 87). M. Pleur, qui «n'avait de terrible que sa crasse et sa puanteur de bête crevée» qui, étant encore «d'un modernisme décourageant», «ne lui conférait la bienvenue dans aucun abîme» (p. 86), «ne réalisait, en apparence du moins, que le BOURGEOIS, le Médiocre», accompli et définitivement révolu, tel qu'il doit apparaître à la fin des fins, quand les Tremblants sortiront de leurs tanières et que les sales âmes seront manifestées au grand jour !». Pourtant, ce médiocre fait encore office de révélateur : «Ne comprenez-vous pas, ô mes frères, que je vous traduis pour l'éternité et que mon impure carcasse vous reflète prodigieusement ? Quand la vérité sera connue, vous découvrirez, une bonne foi, que j'étais votre vraie patrie, à tel point que, venant à disparaître, la pestilence de vos esprits me regrettera» (p. 87). La sagacité des contemporain finira tout de même par s'exercer car «enfin on crut deviner ou comprendre que M. Pleur n'avait pas été ce qu'il paraissait être (p. 90). Et le secret de M. Pleur est ainsi éventé : «Savez-vous, me dit-il, que l'Argent est Dieu et que c'est pour cette raison que les hommes le cherchent avec tant d'ardeur ? Non, n'est-ce pas ? vous êtes trop jeune pour y avoir pensé. Vous me prendriez infailliblement pour une espèce de fou sacrilège si je vous disais qu'Il est infiniment bon, infiniment parfait, le souverain Seigneur de toutes choses et que rien ne se fait en ce monde sans Son ordre ou Sa permission; qu'en conséquence nous sommes créés uniquement pour Le connaître, L'adorer et Le servir, et gagner, par ce moyen, La Vie éternelle». Je cite la suite qui vaut le détour : «Vous me vomiriez si je vous parlais du mystère de Son Incarnation. N'importe ! apprenez que je ne passe pas un jour sans demander que Son Règne arrive et que Son nom soit sanctifié», puis : «Vous comprendrez un jour, mon garçon, combien ce Dieu S'est avili pour nous autres. Rappelez-vous mon maniaque ! Et voyez à quels emplois la malice des hommes Le condamne !» (p. 93). Du coup, M. Pleur peut à bon droit se prétendre «un pénitent de l'Argent», car «Avec des consolations inexprimables», il «endure pour Lui d'être méprisé par les hommes, d'épouvanter jusqu'aux bêtes et d'être crucifié tous les jours de ma vie par la plus épouvantable misère...», raison pour laquelle le narrateur peut affirmer qu'il a «assez pénétré l'existence mystérieuse de cet homme extraordinaire pour entrevoir qu'il [lui] parlait d'une façon toute symbolique» et, qu'un jour, il pourra raconter que M. Pleur avait «découvert la cachette, infiniment sûre, dont aucun avare, avant [lui], ne s'était encore avisé : J'enfouis mon Argent dans le Sein des Pauvres !...» (p. 94, l'auteur souligne pour l'ensemble de ces extraits). Dans une de ces histoires désobligeantes qui n'a pas été retenue par Léon Bloy, intitulée Celui qui avait vendu la tête de Napoléon Ier, il est écrit que «Sans Barabbas, point de Rédemption. Dieu n'aurait pas été digne de créer le monde s'il avait oublié dans le néant l'immense Racaille qui devait, un jour, le crucifier» (p. 330, l'auteur souligne) et, dans une autre, c'est à partir du moment où tel personnage se croit tombé «dans un chenil de démons» qu'il est jugé, «au même instant», «digne de collaborer au salut du monde» (Une recrue, p. 218).
Comme dans les faits divers immondes qu'évoque Marcel Jouhandeau (5), c'est bien souvent le personnage féminin qui, chez Bloy, se distingue, non pour ses vertus éminentes, mais le plus souvent par la fadeur de son compagnon : «Seulement, pour que la nature ne perdît pas tous ses droits, celui qu'elle aima, beaucoup plus que sa propre vie, était un médiocre parmi les médiocres, un employé blond qui raclait l'alto, léchotait de petits paysages en savon et conservait, à trente ans, le prestige du poil follet de l'adolescence» (Le Passé du monsieur, p. 166). Et quelle langue, toujours, chez cet «enragé volontaire» (p. 66), cet «aborigène du malheur» (La plus belle Trouvaille de Caïn, p. 300) qui, lorsqu'il ne massacre pas, désoblige (cf. p. 65), que de trouvailles admirables, non seulement dans la haine, lorsqu'il s'agit, d'un prénom et d'un nom, de ridiculiser un personnage (tel ce Narcisse Lépinoche, tel ce Florimond Duputois, telle cette improbable Melle Cléopâtre du Tesson des Mirabelles de Saint-Pothin-sur-le-Gland) ou de clouer comme une chouette la bêtise d'un trait de pure méchanceté («Il fallait attendre, hélas ! puisque cet homme ne pouvait être utile qu'à la manière des cochons, c'est-à-dire après sa mort», p. 167, ou encore «Notre fin de siècle amincie et spiraliforme, comme la queue d'un porc», p. 164; une autre, ô combien drôle : «Le ridicule naissait tellement sous leurs pas, qu'ils durent plusieurs fois changer de quartier», p. 125), mais aussi dans la célébration de la beauté, grâce à de géniales trouvailles comme tel poétique «parapet de sa mémoire» (p. 174) ou telle «rosace des horizons» (p. 153).
Les traits de cruauté, génialement propulsés par des images que l'on dirait douées d'une véritable force cinétique intérieure et autonome, sont innombrables dans ces Histoires désobligeantes dont la rage semble figurée par Damascène Chabrol (dans Le Parloir des tarentules; il s'agit d'un écrivain «assez ivre de [s]es propres indignations, sans avoir besoin de [s]e soûler de celle des autres» (p. 100)). Assez inhabituellement, Léon Bloy, qui bien sûr connaît le «secret magique», oublié «depuis tant de siècles», consistant à être capable de «distinguer un lion d'un porc et l'Himalaya d'un cumul de bran» (La Taie d'argent, p. 239), peut se laisser aller au lyrisme. Qu'on en juge : «Qu'ils avaient été beaux les commencements ! On avait vingt ans, on éblouissait les hommes et les femmes, toutes les fanfares éclataient sur tous les seuils, on apportait au monde quelque chose de nouveau, de tout à fait inouï que le monde allait sans doute adorer, puisque c'était le reflet, l'intaille fidèle des primitives Idoles» (p. 110, Projet d'oraison funèbre), ce court intervalle nostalgique cédant comme il se doit bien vite la place à l'horreur toute borgésienne de situations aussi caricaturales que sordides, voire machiavéliques, comme le montrent les fameux Captifs de Longjumeau que j'ai rapprochés, ailleurs, du Carcassonne de Lord Dunsany, comme le montre encore cette Idée médiocre que nous pourrions sans trop de peine assimiler à la peinture ironique des ravages d'une espèce de communisme intégral (6).
L'horreur contemporaine n'indique pas seulement les sentes de l'Enfer, mais, en creux, en négatif pourrait-on dire, le Ciel, un visage pouvant être un révélateur, comme l'est en fin de compte celui du propre enfant du curé d'Uruffe, que ce dernier tailladera : «Mais en même temps» écrit ainsi Bloy dans son Terrible Châtiment d'un dentiste, «parce qu'il est impossible de détruire quoi que ce soit», vieille idée bloyenne s'il en est, «l'image hostile qui n'existait auparavant sur le papier que comme le reflet visible de l'un des fragments de l'indiscernable Cliché photographique dont l'univers est enveloppé, s'alla fixer dans la mémoire soudainement impressionnée de Mme Gerbillon» (p. 143, l'auteur souligne, comme dans la plupart de ces contes, lorsqu'il s'agit d'indiquer ce de quoi il retourne réellement).
Dans le monde de l'illusion et du simulacre qui est le nôtre depuis la Chute (puisque nous ne saurons jamais «le nombre des gens qui sont autre chose que ce qu'ils paraissent aux yeux des contemporains», La Fin de don Juan, p. 193), il est encore possible de guetter les signes de l'Inversion généralisée, donc du fait que nous vivons dans un univers tordu, déchu, bien que paradoxal (7). Dominique de Roux, dans Immédiatement que je suis en train de relire, évoque Disraeli qui, dans Coningsby, écrit une phrase «dont l'invitation à la voyance, à une certaine lucidité seconde, vaut, peut-être à elle seule, toute la carrière historique d'un Toynbee», que voici : «Le monde est mené par tous autres personnages que ne l'imaginent ceux dont l’œil ne plonge pas dans les coulisses» (Immédiatement, L'Âge d'homme, 1980, pp. 183-4). Pour Léon Bloy, ces coulisses sont non seulement invisibles mais surnaturelles. Parlant de la vie d'un certain Lazare placée sous les auspices de telle fameuse parole de Blanc de Saint-Bonnet («Tout homme est l'addition de sa race»), Bloy écrit ainsi que : «Cette histoire qui est juste au centre de l'Histoire universelle et qu'on apprend si mal dans les écoles, était, en lui, tout à fait vivante et contemporaine. Elle le brûlait, le dévorait comme une flamme furieuse dont il eût été l'aliment dernier» (p. 109).
Ainsi, puisque «Nul ne sait son propre nom, nul ne connaît sa propre face, parce que nul ne sait de quel personnage mystérieux – et peut-être mangé des vers –, il tient essentiellement la place» (Propos digestifs, p. 263), il est temps, grand temps même, plus que temps que se produise le Dénouement, par exemple par l'intrusion de «Quelqu'un qui ne sentait pas bon» (p. 264) sur l'identité duquel Léon Bloy ne souffle mot, mais que nous ne pourrions sans nous tromper que rapprocher d'un éminent Vicaire, non pas Caïn Marchenoir en personne, qualifié d'«aborigène du malheur» (La plus belle trouvaille de Caïn, p. 300) ou de «blasphémateur de la Racaille, absolument invincible et toujours sur ses étriers, malgré le tourbillon des crapules et le cyclone des pusillanimes» (p. 297), mais encore plus grand que lui, plus surnaturellement grand que lui, qui ne pourra que réduire en cendres ce monde où un homme peut coucher avec sa propre mère (cf. Jocaste sur le trottoir), une époque croulant sous les actions ignobles de tant d'autres qui envient, convoitent, trompent, blasphèment, tuent, sans que le feu liquide tombé du Ciel jamais ne semble désirer les consumer.
Comme toujours, la colère que Léon Bloy dirige, avec sa formidable verve, contre ses contemporains, hâte son impatience eschatologique, une caractéristique qui suffit à distinguer cette dernière de la colère du lilliputien Nabe, laquelle n'est jamais que sale, ordurière, n'est jamais qu'une façon grotesque de se tendre un miroir faussement avantageux, mais qui jamais ne parviendra, fût-ce au prix des plus comiques contorsions, à transformer ce nabot haineux qu'est Alain Zannini en héritier même approximatif de Léon Bloy.
Notes
(1) Marcel Jouhandeau, Trois crimes rituels (1962, Gallimard, Les éditions du Chemin de fer, 2017), p. 13.
(2) «Comment ceux qui s'aiment pourront-ils ce soir ne pas se regarder avec un soupçon de défiance, de terreur, à la pensée qu'une seule parole de l'un, mal interprétée par l'autre, pourrait faire d'eux des ennemis irréconciliables pour l'éternité» (p. 16).
(3) Léon Bloy, Histoires désobligeantes (1894) (établissement du texte, préface et notice par Pierre Glaudes, Slatkine, coll. Fleuron, 1997), pp. 19-20.
(4) Pierre Glaudes cite Bernard Sarrazin, Rire et mort de Dieu : le jeu théologique de Léon Bloy in Léon Bloy au tournant du siècle (Toulouse, PUM, 1992), p. 167.
(5) Léon Bloy n'est pas en reste, même s'il les invente : «Jacques avait un anévrisme au dernier période et sa mère avait un amant qui ne voulait pas être beau-père» (p. 74, l'auteur souligne), raison pour laquelle une femme sans le moindre reproche empoisonne son propre fils dans La Tisane.
(6) «N'avoir qu'une seule âme et qu'un seul cerveau répartis sous quatre épidermes, c'est-à-dire, en fin de compte, renoncer à sa personnalité, devenir nombre, quantité, paquet, fractions d'un être collectif. Quelle géniale conception !» (p. 123).
(7) D'où le grand nombre de non-dits, bien notés par Pierre Glaudes, qui constituent comme des trous au sein de la trame narrative de ces différentes histoires : «Je ne me charge pas d'expliquer les prodiges non plus que les mystères, et il ne faut pas compter sur moi pour une élucidation psychologique des histoires trop arrivées dont je me suis fait le narrateur» (Le Passé du monsieur, p. 165, l'auteur souligne). Je note cette autre ellipse : «Brunissende agenouillée la première, le troupeau des humbles s'approchant, recula soudain, comme devant un mur de flammes et le prêtre qui descendait la première marche de l'autel pour s'en venir, portant le ciboire, vers la table sainte, remonta précipitamment... On fut obligé de purifier le sanctuaire, et tous les ans, à pareil jour, une cérémonie lavatoire est scrupuleusement observée», Sacrilège raté, p. 228). Les paradoxes, eux, sont bien illustrés par ces renversements, habituels sous la plume de Bloy : «Il est indispensable d'avoir des capitaux pour rendre l'âme, et voilà ce qu'on ne veut pas comprendre. La mort n'est que la séparation d'avec l'Argent. Ceux qui n'en ont pas n'ont pas la vie, et, dès lors, ne sauraient mourir» (La Dernière Cuite, p. 182). Encore un, concernant cette fois-ci un cocu, les «consolations» de sa femme, autrement dit ses infidélités, «pouvant être comparées aux invisibles rayons de la roue d'un char qui passerait avec une inconcevable rapidité» : « – Oui, mon cher, vous êtes cocu. C'était là, sans contredit, une affirmation, et par conséquent, une imposture, d'après son système» (Le Soupçon, p. 209).






























































 Imprimer
Imprimer